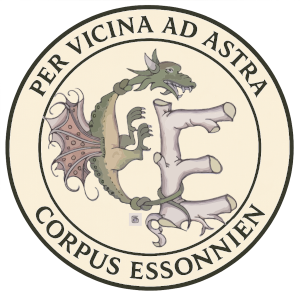per:shaceh.04.1898
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| per:shaceh.04.1898 [2025/11/23 06:05] – créée bg | per:shaceh.04.1898 [2025/11/23 16:31] (Version actuelle) – bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | **[[bul.shaeh|SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| ======Bulletin n°4 (1898)==== | ======Bulletin n°4 (1898)==== | ||
| ======PAGE EN CONSTRUCTION====== | ======PAGE EN CONSTRUCTION====== | ||
| + | |||
| + | BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000008**| IMPRIMERIE G. BELLIN, A MONTDIDIER | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000009**| BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL D' | ||
| + | |||
| + | CORNEIL ETAMPES PARIS ALPHONSE PICARD ET FILS, ÉDITEURS LIBRAIRES DES ARCHIVES NATIONALES ET DE LA SOCIÉTÉ DE L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000010**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000011**| DC 611 S45856 V₁ 3-4 SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000012**| VI Les mineurs ne seront admis dans la Société que sur le consentement soit de leurs parents, soit de leur tuteur. ART. IV. Le titre de fondateur est acquis: 1° aux signataires des présents statuts, 2° à tout membre qui fait don à la Société d'une somme de cent francs au moins. - ART. V. Chaque sociétaire paie une cotisation annuelle de dix francs; cependant cette cotisation est réduite à cinq francs pour les personnes appartenant au clergé et à l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000013**| VII - ART XIII. En cas de dissolution de la Société, les membres titulaires, réunis en une Assemblée générale spécialement convoquée à cet effet, seront appelés à statuer sur la liquidation de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000014**| RÈGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000015**| IX - ART. V. Le Secrétaire rédacteur rédige les procès-verbaux des séances et est chargé de tout ce qui se rapporte à la correspondance. ART. VI. Le Trésorier est chargé du recouvrement des cotisations annuelles; il paie les dépenses ordonnancées et donne, chaque année, à la séance générale, un état de la situation financière de la Société. -- ART. VII. Le Conseil se réunit tous les trois mois; cependant le Président peut le convoquer chaque fois que les intérêts de la Société l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000016**| X ART. XV. - Les Sociétaires ont droit à toutes les publications de la Société à partir de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000017**| LISTE DES MEMBRES Les noms précédés d'un astérisque (") sont ceux des MEMBRES FONDATEURS qui ont racheté leur cotisation. MM. ALLAIN, Maire de Soisy-sous-Étiolles. ALLIOT (l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000018**| XII MM. BONNEFILLE, Conseiller général de Seine-et-Oise, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000019**| XIII MM. DELESSARD (Edouard), Avoué honoraire près le Tribunal de la Seine, à Ris-Orangis. DELESSARD (Ernest), Ingénieur civil, à Lardy. DEPOIN (Joseph), Secrétaire général de la Société historique de Pontoise, 50, rue Basse, à Pontoise, et à Paris. 62, rue Bonaparte. DESRUES (l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000020**| XIV MM. GIBERT, ancien percepteur, à Corbeil. GIBOIN, rue Orbe, à Libourne (Gironde). GLIMPIER (l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000021**| XV MM. LORIN, Avoué, Secrétaire général de la Société historique de Rambouillet, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000022**| XVI MM. RADOT (Émile), industriel, à Essonnes. RAVAUT (Paul), au château de Ste-Radegonde, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000023**| XVII MEMBRES HONORAIRES-CORRESPONDANTS MM. BOURNON (Fernand), Archiviste-Paléographe, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000024**| XVIII BUREAU DE LA SOCIÉTÉ PRÉSIDENTS D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000025**| SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000026**| XX 3° Histoire généalogique de la famille Bosquillon de Jarcy, par M. Théodore Courtaux, offert par M. Mottheau, de Brunoy. En outre M. Dufour dépose sur le bureau le catalogue des 43 ouvrages possédés actuellement par la Société; puis il annonce que le deuxième Bulletin de 1896, paru en février dernier, a été accueilli avec faveur. Des remercîments sont votés aux généreux donateurs et à M. le Secrétaire-général. Sur la proposition de M. G. de Courcel, il est décidé que le Catalogue, dressé par M. le Secrétaire général, portera la mention: État des volumes offerts à la Bibliothèque de la Société. » Le Conseil prononce les admissions suivantes : Comme membres fondateurs: M. Beranger (Charles), de Paris, présenté par MM. Aymé Darblay et Aubry-Vitet. Et M. Feray (Georges), de Paris, présenté par MM. le Pasteur Pannier et Louis Cros. Comme membres adhérents: M. Vollant, de St Germain-lez-Corbeil, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000027**| XXI seront également adressées, en échange de la cotisation annuelle. M. Aymé Darblay s' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000028**| XXII M. Mottheau complète la communication intéressante, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000029**| NOTE SUR DES DOUBLES TOURNOIS DU XV SIÈCLE TROUVÉS A ANGERVILLE (S.-et-Q.). Les découvertes numismatiques se font de plus en plus rares et bien peu maintenant dédommagent de sa peine l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000030**| allemande en 1870, assise aux confins de la Beauce ce grenier de la France, est comme les villages voisins un centre presque exclusivement agricole. C'est en nettoyant le fonds d'un puits comblé à une époque inconnue, au lieu désigné dans le pays sous le nom de Chantalouet qu Chantaloë (chant à l'oè, à la volaille) sur l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000031**| 3mités fleurdelysées; | ||
| + | |||
| + | નો R O Con Toutes ces monnaies étaient tellement corrodées par leur long séjour au fond du puits de Chantalouet ou Chantaloé, qu'il a fallu, pour essayer de reconstituer les légendes, en aligner un grand nombre, prendre une lettre de ci, une autre de là. Quelques rares exemplaires mieux conservés en ont fourni des fragments entiers; mais bien que la lecture ait été de notre part l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000032**| 4 - imitation calculée, qu'il y ait simplement contrefaçon, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000033**| 5 Les monnaies que signale M. le comte de Castellane sont des imitations du type royal que l'on peut qualifier d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000034**| -6 lippe VI et plus tard des parodies des Doubles tournois frappées probablement depuis que la démence du Roi et l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000035**| 7- ---- les états situés dans le Limbourg, le Brabant septentrional et le Luxembourg avaient à peine quelques kilomètres d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000036**| 8Jeanne de tromper des populations ignorantes et apeurées, toujours sous le coup de quelque invasion? Quant aux imitations qu'il est impossible d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000037**| 9de M. R. Serrure auquel j'ai montré la trouvaille. Tel n'est point non plus l'avis de M. Maurice Prou, le distingué sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, département des médailles. Consulté par moi au sujet de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000038**| 10 -- Bien au contraire les simples imitateurs qui se trouvaient par leur situation ou leur position à l'abri des poursuites de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000039**| LES LOUVOIS ET LES VILLEROY Sait-on que le marquis de Louvois, ministre de Louis XIV, était le proche parent du duc de Villeroy, maréchal de France et gouverneur de Louis XIV? Voici comment: François Mandelot, né à Paris vers 1529, seigneur de Pacy-surArmançon, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000040**| - 12Tonnerre, Louise de Clermont, duchesse d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000041**| 13 - fille née posthume le 30 novembre 1646, qui fut Anne de Souvré; Enfin Eléonore et Marguerite de Souvré qui furent successivement abbesses de Saint Amand de Rouen. En sorte qu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000042**| CHILLY-MAZARIN Les Tombeaux Le touriste qui visite les tombeaux et les mausolées de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000043**| - 15 cureur de la commune du dit Chilly pour entreprendre d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000044**| - 16 --- Monument de Martin Ruzé de Beaulieu Nous empruntons d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000045**| 17 Ruzé de Beaulieu. Pour s'en convaincre on n'a qu'à regarder le portrait de ce personnage au musée de Versailles, salle 154, nº 3323. La ressemblance est frappante. Du reste les inscriptions achèveront de nous fixer. Dans le manteau on voit une large entaille avec le reste d'un scellement. C' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000046**| 18 ler du grand Conseil et de la Chambre des Pairs de France, grand maître des mines, du trésor et du fisc, gouverneur en Touraine, a élevé ce monument de la piété et de la reconnaissance et cet hommage funèbre qu'il souhaitait à son oncle très cher, suivant son pieux désir. P. C. A. l'an de l'ère chrétienne 1627. » L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000047**| 19 --- « D. O. M. S. Deo, Optimo, Maximo, Summo A Dieu Très Bon, Très Grand, Très puissant. << Regarde, passant, pour reconnaître Celui qui fixera l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000048**| 20 - Chilly, Longjumeau, Champeaux, et la Presaye, Conser du Roy en ses Conseils d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000049**| LA PORCELAINE DE VILLEROY Le XVIIIe siècle a repris étrangement faveur en cette fin du XIX. Pour ne parler que des arts de la céramique, tandis que les faïences de Bernard Palissy et certaines porcelaines de Chine sont moins recherchées qu'il y a trente ans, tous les yeux sont tournés, dans les ventes publiques, soit vers les porcelaines d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000050**| 22 - velle description des environs de Paris, ne fait mention à aucun moment de cette fabrique. L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000051**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000052**| Fol ان لوله لولو بولم ان و لوله لولو 0: B F ม่ 2222 E لو او له لو يو به او لوبو او اوبه ala of لولي نوم لوية ويع دهـ B. AA. Château Annexes C. D. E. F • Communs Pavillons d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000053**| 23 --- auteurs s'en rapportent à Brongniart à ce sujet. Nous apprenons encore que « Les sieurs Jacques et Julien succedèrent à François Barbin dans la direction de la fabrique (1) et la maintinrent dans un état florissant jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000054**| 24 - porcelaine fort dure, cuite assurément à une température très élevée, puis, le lendemain, un manche de couteau brisé, n' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000055**| | ||
| + | |||
| + | Héliog. Dujardin Imp Ch.Wittmann POMMES DE CANNES FT MANCHES DE COUTEAUX trouves dans le parc de Villeroy | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000056**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000057**| — - 25 Le plan terrier de 1751 ne faisant figurer à l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000058**| UN BAIL SOUS LA RÉVOLUTION Il est peu de villes en France où le vandalisme se soit autant donné carrière qu'à Corbeil; le siècle qui va finir aura eu le triste privilège d'y voir détruire, sans nécessité apparente, presque tous les anciens monuments. C'est ainsi qu'ont disparu, l'une après l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000059**| 27- - << tolat révolutionnaire, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000060**| UNE AUTOBIOGRAPHIE L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000061**| -- - 29 - qui nous en a laissé tant de travaux intéressants, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000062**| - 30 - signées du citoyen Pierre Thuin, évêque de Meaux. Ce ne fut pas à Melun, hélas ! que le pauvre Abbé Guiot trouva la tranquillité et le repos, car il fut bientôt persécuté, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000063**| ---- -- 31 Guiot fut ramené à Melun et mis en liberté au commencement de Germinal an II, sur la recommandation du citoyen Maure, représentant du peuple. Le 5 Nivose an III (25 décembre 1794), il obtient un certificat de civisme qui lui est délivré par le Conseil général de Melun. Sa qualité de prêtre l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000064**| - - - 32 - là que Guiot, sorti pour un temps de ses épreuves, se consacra à son ministère en essayant de réparer dans Saint-Spire les ruines accumulées par la Révolution. Mais son installation n' | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000065**| 33 nouvel article qui sera inséré dans un de nos prochains bulletins. Nous laissons donc la parole à l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000066**| - 34ner le disciple à lui-même, sauf à le redresser, s'il venoit à s' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000067**| - --- 35 par l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000068**| - - 36 - formé à l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000069**| - 37 se proposa de le renfermer dans un petit ouvrage exprès dont le succès lui paroissoit assuré. Déjà l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000070**| 38 - -― plus facilement à son génie, quand il se présentoit quelque occasion de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000071**| -- - 39 seconde version poétique de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000072**| - - 40 autre part, que l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000073**| - -- 41 sur quantité de sujets utiles, ou seulement agréables. Ces derniers étoient spécialement dans le dessein de dissiper les nombreux chagrins qu'eut à essuyer le prieur de Saint-Guenault, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000074**| 42 - Un des ouvrages de goût, qui étoit le plus du sien, et dont il avoit toujours désiré de donner une nouvelle édition, étoit les Poemata didascalica donnés par l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000075**| - - 43 tiers le champ libre aux autres, et s'il avoit quelque chose à raconter, c' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000076**| -- 44 qu'il eût peut-être été indiscret d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000077**| 45 - - campagne, un maintien de bonhomie en général et rarement d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000078**| — — 46 - Noctem in quà nemo potest operari, ingressus est Anno reparata salutis 1794 (1), Vita temporalis 56, Regularis autem 22, Denique Prioratis et Pastoralis regiminis 5. Respiciat hunc Dominus in bonum! Ici repose en attendant la Miséricorde de celui qui récompense ceux qui le cherchent Joseph-André Guiot, né dans la petite paroisse de St Cande de Rouen, (dédiée autrefois à St Victor), poète et lauréat de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000079**| SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000080**| 50 M. Pinson, de Douai, a adressé à la Société, pour son bulletin, des documents inédits sur l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000081**| 51 tive; comme médecin en chef de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000082**| UNE TENTATIVE D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000083**| 53 - - Nous vous mandons de bien et diligemment admonester par nostre auctorité, soubz peyne d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000084**| LA FÉODALITÉ ET LE DROIT DE VASSELAGE Un siècle à peine s'est écoulé depuis que la Révolution, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000085**| - 55 autrefois qu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000086**| 56 - - faire à cause des ditz fiefz, et lui avons donné terme et delay jusques au 1er jour davril prochain venant, de nous bailler son adveu et dénombrement d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000087**| 57 -- partye dudict fief et seigneurye de la Borde, assis audict vielz Corbueil, qui se consiste en Cens et Rentes à eulx advenuz et escheuz à cause de feuz Péronne et Yvonne de Fleury leurs tantes, filles de feuz dame Marguerite Sanguyn, leur mère, mouvant et tenu a une seulle foy et hommaige dudict de Blosset, à cause de sa dicte terre et seigneurye de Morsang, à la charge toutesfoys que ledict Guillaume de Baulx audict nom a promis et sera tenu' de bailler dénombrement au dict de Blosset dudict fief et seigneurye de la Borde dedans quarante jours, à compter du jour et datte de ces présentes, sauf à le blasmer par ledict de Blosset, s'il y eschet, suyvant la coutume et, en ce faisant, ledict de Blosset a quicté et remis, audict de Baulx tous droictz et devoirs qui lui eussent peu estre deubz à cause dudict fief et seigneurye de La Borde, sauf audict seigneur de Morsang son droict et l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000088**| -- 58de la Borde assis audict viel Corbeil, paroisse Saint-Germain, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000089**| 59 --- fief de la Borde, relevant dudict sieur de Morsang, si tost que le dict sieur ou dame dudict Morsang aura faict ventiler et liquider avec les seigneurs des autres fiefs, contenus par ledict décret, ce qui leur apartient à chacun d'eux, à cause de ladicte acquisition; | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000090**| - - 60 quelqu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000091**| -- - 61 été donnés en dot par très haut et puissant seigneur Marie Thomas Auguste marquis de Matignon et très haute et puissante dame Edmée Charlotte de Bresne son épouze, ses père et mère, lors et par le contract de son mariage avec le dit seigneur marquis de Traisnel, passé devant Maître Roger et son confrère, notaires à Paris, le vingt-neuf et le trente janvier mil sept cens quarante quatre; lesquelles terres et seigneurie d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000092**| DÉDICACE DE L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000093**| 63 - Texte de la dédicace de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000094**| - 64 temporibus dedicari, ut ipsa quæ tam honorabilis valde et commendata apud universos habebatur, tam digno spirituali dedicationis et consecrationis munere adepto, honorabilior et deo gratior redderetur. Quapropter supradictus dominus Abbas suo et prædictorum canonicorum nominibus nobis supplicabat, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000095**| - — 65 Quibus sic peractis, fuit pro parte sæpedicti Domini Episcopi Parisiensis ordinatum quod a modo in prædicta Ecclesia annis singulis fiat annua solemnitas præfatæ dedicationis, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000096**| DOCUMENTS INÉDITS Sur Jacques-Guillaume SIMONNEAU MAIRE DE LA VILLE D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000097**| ― - - 67 accompagnaient le malheureux maire d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000098**| - 68 rées. Je reste convaincu que ce détachement a fait humainement tout ce qu'il lui étoit possible pour sauver le maire. >> Le Mal de Camp employé provisoirement à la 17 Division. BOISSIEU. (1) Quelques jours après le meurtre de Simonneau, c' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000099**| ― - 69 - feuilletant, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000100**| -- ____ 70 << 5° L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000101**| 71 accueillir toutes les demandes particulières qui, comme la vôtre, peuvent y ajouter un nouvel intérêt. << Adressez-vous donc, Monsieur, au Ministre citoyen chargé de cet objet, M. Roland, et recevez les témoignages particuliers de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000102**| 72 • mité des emplacemens convenables, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000103**| 73Or, comme les conseillers municipaux actuels n'ont plus à redouter cette opposition, il leur appartient de prendre l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000104**| RELATION DE LA RÉCEPTION FAITE A LOUIS XIV A SON PASSAGE A ÉTAMPES (Septembre 1668) Nous avons toujours eu à cœur de recueillir avec la plus profonde sollicitude tous les documents imprimés ou manuscrits qui peuvent être de quelque intérêt pour la ville d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000105**| - 75 - enseignements qui les aident à connaître et à apprécier les faits et gestes de leurs ancêtres. Malheureusement, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000106**| - - 76mélites, pour y pleurer ses fautes et les infidélités de son royal amant. Le 21 septembre, le roi et la reine arrivèrent à Etampes; quelques jours auparavant, une foule d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000107**| ― 77 - monarque de la France, et les seconds comme à celuy qui mérite l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000108**| 78 - par toute la population accourue, qui se trouvait groupée en manière d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000109**| 79 de divertissement, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000110**| L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000111**| 81 << la Comtesse, qui est placé au milieu du choeur de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000112**| 82 chambre à farine; celles des deux premières abbesses, Oda et Ameline, contre le mur de refend, sous les bluteries; d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000113**| 83 La révolution a passé là et il n'en reste plus que le souvenir, qui nous a été heureusement conservé par des auteurs autorisés tels que de la Barre, du Breul, l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000114**| 84 tuelle de Jarcy, et en fournir un plan géométrique qui sera annexé au présent dont le détail suit: Cette maison est située à environ sept lieues de Paris, deux lieues de Corbeil et à une lieue de Brie-Comte-Robert, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000115**| - 85 - la croisée de laditte Église, avec le sanctuaire. Laditte Église de cent soixante pieds de long sur soixante-six pieds de large, non compris la croisée de laditte Église, et contient en superficie, y compris le cul de lampe (1), la quantité de deux cent vingt-trois toizes, cy A l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000116**| 86 - à valoir la somme de cinquante-neuf mille cinquante livres, cy. Item, deux arpents de préz situés près et sous les lieux cy-dessus, en descendant du côté de Boussy, tenant d'un côté au S' Prévost, d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000117**| - - - 87 Le tout vû et examiné, et après avoir demandé l'avis desdits. Maire et officiers municipaux, lesquels, d'une voix unanime, ainsy que moi expert, avons reconnu que lesdits bâtiments et clôture ne peuvent être divisés sans un domage considérable pour la Nation; c'est pourquoi, nous expert susdit et soussigné, avons clos et arrêté le présent procès-verbal, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000118**| - - 88 TIMBRE 35 ROYAL No5. Nord. Prairie de Jarcy. N°10. Nº2. N°13 Levée de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000119**| - - 89 Certifie conforme au plan terrier de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000120**| - 90 d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000121**| LES SŒURS DE SAINT VINCENT DE PAUL A CORBEIL ETABLISSEMENT D'UNE CHARITÉ EN 1672 A toutes les époques de notre histoire nationale, les grands fléaux ont suscité des dévouements admirables. La Providence, aux heures de tristesse et de deuil, a fait surgir des héros, des intelligences supérieures, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000122**| -- 92 Humbles furent les débuts, mais l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000123**| 93 - « Acte de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000124**| --- - 94 ainsi que le chapitre des recettes contient les mentions suivantes: le fonds, 12 pistoles d'or, a été donné par Mlle de Lamoignon; le tout a produit 121 livres, plus un écu blanc: total, 124 livres. Le 29 septembre suivant, Mlle de Lamoignon a versé 110 livres. Le 16 juin 1673, Mme la Maréchale de Villeroy a envoyé 27 l. 14 S. Les membres de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000125**| ― - 95 Plus tard, Monseigneur le cardinal de Noailles étant venu à Corbeil pour donner le sacrement de la Confirmation, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000126**| - - 96 - En 1656, des plaintes se produisirent, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000127**| 97 << dite partie a vingt-cinq pieds de long sur treize pieds par bas << du côté de la partie ci-devant dite, de dix pieds et demi par l'en- << | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000128**| --- 98 - 3 livres pour la toile d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000129**| 99 << vée du mercredi 20 avec deux nouvelles Sœurs, que de son « départ, avec les sœurs Cordes et Martin led. jour 22 mars, par << un carrosse des nouvelles messageries. >> << Item: J'ai payé d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000130**| 100 - prix des plus grands sacrifices. Elles durent quitter leur habit religieux, et prêter serment de fidélité aux lois nouvelles. L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000131**| ΙΟΙ - MM. les curés d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000132**| - 102 - comptes, des correspondances, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000133**| - - 103 eut lieu le 29 avril 1847 (1). Le procès-verbal de la réunion nous fournit les noms des premiers fondateurs et bienfaiteurs de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000134**| ― - 104 Les recettes se décomposaient ainsi: 1º Fonds alloués par l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000135**| - - 105 DOCUMENT-ANNEXE · ENGAGEMENT DES SCEURS DE L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000136**| 106 -- d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000137**| - - 107 mains, tabliers blancs, aux dépens dudit Hôtel-Dieu; | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000138**| 108 - ART. 13 Le décès d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000139**| · - 109 ART. 17e Avant le départ desdites trois filles de la charité pour l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000140**| 110 - BIBLIOGRAPHIE Dictionnaire biographique international des écrivains. Fascicule VIII, page 108, notice biographique sur Périn Jules, avec portrait. M. Jules Périn, archiviste-paléographe, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000141**| III G. L. MELUNAIS. Le chemin de fer Corbeil-Melun-Montereau; | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000142**| - - 112 Et ce qui prouve la valeur de son travail, c'est qu'il avait déjà été publié dans l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000143**| 113 - beaucoup question de Corbeil. Il a mis à contribution, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000144**| 114 - reux commentaire des différents auteurs qui ont traité le même sujet ; il est intéressant surtout par les nombreuses recherches auxquelles il s'est livré et qui lui ont permis de pouvoir rattacher, d'une manière certaine, à la descendance d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000145**| - - 115 de Senart et Mandres, où l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000146**| - 116 Alexis MARTIN. Les étapes d'un touriste en France. Promenades et excursions dans les environs de Paris. Région du sud, III. Dourdan et la Vallée de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000147**| --- - 117 les décrire avant qu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000148**| 118 --- LORIN. - Henry Levasseur, adjudant général, maire et SousPréfet de Rambouillet. Napoléon Ier à Rambouillet. L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000149**| ― - 119 hors texte (vues de Corbeil) et d'un grand nombre de vignettes dans le texte. Corbeil, Crété (Prix: 1 fr.). En rendant compte l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000150**| 120 - Catalogue de la Bibliothèque de feu M. le Bon Jérôme Pichon, Ire partie livres rares et précieux, manuscrits et imprimés. Paris, Librairie Techner, 1897, grand in-8º de xvii et 460 pages, illustré. Cette première vente, qui eut lieu du 3 au 14 mai 1897, a été un événement dans le monde des livres et elle prendra rang parmi les ventes célèbres. Dans ses onze vacations elle a produit 505.524 fr. Une seconde vente a eu lieu en février 1898; une troisième se fait dans ce présent mois de mars. Celle-ci renferme beaucoup de numéros qui intéressent Corbeil et sa contrée. Cette vente n' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000151**| - 121 château, très intéressantes pour la décoration intérieure; | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000152**| - - 122 On vend séparément les sections Sud-est et Sud-ouest. Nouvelle carte routière de Paris sud-est, à 200 kilomètres, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000153**| --- 123 lant colonel. Corbeil, la dernière étape, suivit l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000154**| - -- 124 TROUVAILLES ET DÉCOUVERTES ― ESSONNES, Décembre 1897. En faisant une fouille pour établir des cabinets d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000155**| - - 125 TABLE DE LA 3° ANNÉE Statuts et réglement de la Société. Liste des membres · Page XI • XVII XIX Conseil d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000156**| ERRATA Page 18, ligne 28, au lieu de: imo non rem seipsum, lire: imo non tam seipsum. Même page, ligne 35, au lieu de: ergo animæ precare, lire: ergo animæ bona precare. | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000157**| BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000158**| IMPRIMERIE G. BELLIN, A MONTDIDIER | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000159**| BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL D' | ||
| + | |||
| + | CORBEIL CHUREPO ETAMPES PARIS ALPHONSE PICARD ET FILS, ÉDITEURS LIBRAIRES DES ARCHIVES NATIONALES ET DE LA SOCIÉTÉ DE L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000160**| ! | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000161**| SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000162**| VI Les mineurs ne seront admis dans la Société que sur le consentement soit de leurs parents, soit de leur tuteur. ART. IV. Le titre de fondateur est acquis: 1° aux signataires des présents statuts, 2º à tout membre qui fait don à la Société d'une somme de cent francs au moins. ART. V. Chaque sociétaire paie une cotisation annuelle de dix francs cependant cette cotisation est réduite à cinq francs pour les personnes appartenant au clergé et à l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000163**| VII ART. XIII. En cas de dissolution de la Société, les membres titulaires, réunis en une Assemblée générale spécialement convoquée à cet effet, seront appelés à statuer sur la liquidation de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000164**| RÉGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000165**| IX ART. V. Le Secrétaire rédacteur rédige les procès-verbaux des séances et est chargé de tout ce qui se rapporte à la correspondance. ART. VI. Le Trésorier est chargé du recouvrement des cotisations annuelles; il paie les dépenses ordonnancées et donne chaque année, à la séance générale, un état de la situation financière de la Société. ART. VII. Le Conseil se réunit tous les trois mois ; cependant le Président peut le convoquer chaque fois que les intérêts de la Société l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000166**| X ART. XV. Les Sociétaires ont droit à toutes les publications de la Société à partir de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000167**| LISTE DES MEMBRES Les noms précédés d'un astérique (*) sont ceux des MEMBRES FONDATEURS qui ont racheté leur cotisation, MM. ALLAIN, Maire de Soisy-sous-Étiolles. ALLIOT (l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000168**| XII MM. BLONDEAU, entrepreneur de travaux à Corbeil. BONNEFILLE, Sénateur de Seine-et-Oise, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000169**| XIII MM. *COURCEL (Valentin de), Maire d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000170**| XIV MM. FOUDRIER (l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000171**| XV MM. LACHASSE (Auguste), Adjoint au Maire de St-Germain-lèsCorbeil. LACOMBE (Paul), Trésorier de la Société de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000172**| XVI MM. MOTTHEAU, 4, place St-Médard, à Brunoy, et à Paris, 18, rue le Verrier. MURET (l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000173**| XVII MM. SELVE (le marquis de), au château de Villiers, par la FertéAlais (S.-et-O.), et 36, avenue Hoche, à Paris. SÉRÉ-DEPOIN, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000174**| XVIII MEMBRES HONORAIRES-CORRESPONDANTS MM. BOURNON (Fernand), Archiviste-Paléographe, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000175**| XIX BUREAU DE LA SOCIÉTÉ Présidents d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000176**| SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000177**| XXI M. le comte de Rilly, au château d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000178**| XXII financière de la Société au premier mai 1898. Cette situation est satisfaisante et se résume ainsi : Attribution au musée . . Attribution à la Société. • . 198.60 3.443.25 3.641.85 Total. M. Barthélemy entretient le Conseil des recherches qu'il a faites. sur l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000179**| LES SCULPTURES DU CLOCHER DE BRUNOY Le joli village de Brunoy, situé à 24 kilomètres de Paris, dans la belle vallée de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000180**| nous aurons réussi à faire la lumière sur un point d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000181**| | ||
| + | |||
| + | CLOCHER DE BRUNOY, SCULPTURE DU CONTREFORT DROIT, COTE OUEST. | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000182**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000183**| | ||
| + | |||
| + | CLOCHER DE BRUNOY, SCULPTURE DU CONTREFORT GAUCHE, COTÉ OUEST. | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000184**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000185**| - -- 3 1 laurier, supportés par un chérubin; les émaux ne sont pas indiqués. Celui de gauche porte un écusson en abîme accompagné de huit coquilles en orle. Ecu penché et soutenu par deux griffons, surmonté d'un heaume cimé d'une tête de griffon; le tout dans un vol de palmes. Enfin sur le contrefort droit de la face nord, les mêmes deux écus mi-parti sont reproduits dans le même ordre, avec cette particularité que les fuseaux ont un support, tandis que les coquilles n'en ont pas. Pour un amateur, même peu versé dans la science héraldique, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000186**| 4 Nous reproduisons ci-dessous son blason, d' | ||
| + | |||
| + | NGU Nous partagions l'avis de M. Jeannest-Saint-Hilaire quant aux écus de la face ouest et, nous appuyant sur l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000187**| | ||
| + | |||
| + | CLOCHER DE BRUNOY, SCULPTURE DU CONTREFORT DROIT, COTÉ NORD. | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000188**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000189**| 5 Comment contredire l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000190**| 6 — << et ce pour le quartier de juillet, aoust et septembre mil cinq cent << cinquante devant passé. De laquelle somme de cent cinquante << livres tournois nous nous sommes tenu et tenons pour content << et bien payé et en avons quitté et quittons lesdits trésoriers Veau. <<et Corbie payeur, dessus nommés. << En témoing de ce nous avons signé les présentes de nostre << main et a ycelles faict mectre le cachet de nos armes le troisiesme << jour de novembre mil cinq cens cinquante >>. (Signé) G. de Lannoi, | ||
| + | |||
| + | Ce Guillaume était le fils aîné de Pierre de Lannoy et de Françoise de Rouy. A la mort de son père, il fit l'aveu au roi des fief et seigneurie de Brunoy, à Paris le vingt novembre quinze cent trentehuit (1). — 5065. DE LANNOY, Chistophe, seigneur de la Boissière, gentilhomme ordinaire de la chambre, guidon de soixante lances sous monsieur de Villequier. Ecu en abîme accompagné de huit coquilles en orle, entouré de trois palmes; sans légende. Reçu de gages daté de 1581. << Nous Christophle de Launoy, seigneur de la Boissière, gen- << tilhomme ordinaire de la chambre du roi, guidon de la com- << pagnie de soixante lances de ses ordonnances sous la charge de <<< | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000191**| 7 — << jours du présent quartier d' | ||
| + | |||
| + | [Tous les sceaux de la collection Clairambault ayant été surmoulés sur les originaux et ces moulages déposés aux archives nationales, nous nous sommes fait délivrer un exemplaire de chacun des signets de Guillaume et Christophe de Lannoy, lesquels ont servi à la reproduction ci-dessus]. Enfin aucun doute ne pouvait plus subsister, les armoiries sculptées sur le pilier gauche de la face ouest de notre clocher sont incontestablement celles de Lannoy de la Boissière. Restait à établir aussi incontestablement que l'écu aux sept fusées sont celles de Rouy. C'est ce que nous avons tenté sans avoir encore su y parvenir. Tout ce que nous avons pu découvrir de relatif à cette famille, c'est que: Jean de Rouy, seigneur de la Boissière, colonel des légions de Picardie, maria sa fille Barbe, par contrat du 19 décembre 1525, à Antoine de Conflans (souche des vicomtes d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000192**| - - - 8 Françoise de Rouy, qui nous occupe, était, tout probablement, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000193**| 9 - écuyer puis chevalier. Elle portait de... à deux haches de... adossées et posées en pal (1). — 1477. Marie de Braye, mariée à Rogerin de Lannoy dit Lamon, chevalier, seigneur de Brunoy, du Colombier, et de Civry. Mêmes armoiries que la précédente. — 1515. Françoise de Rouy, mariée à Pierre de Lannoy, seigneur de Brunoy, de Civry et du Colombier. - 1548. Anne Jouvenel des Ursins, mariée en 1548 (2) à Guillaume de Lannoy, sgr de Brunoy et de la Boissière, veuve en 1561. Bandé d' | ||
| + | |||
| + | (1) Collection Clairambault, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000194**| Remariée à Louis d' | ||
| + | |||
| + | (1) Nobiliaire de Picardie. (2) Archives de Seine-et-Oise, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000195**| II - 1610. Anne d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000196**| --- - 12 ont toujours témoignée, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000197**| LA FÊTE DE LA FÉDÉRATION A MONTGERON (14 juillet 1790) La révolution de 1789 fut accueillie avec enthousiasme par la population de cette commune, qui entrevoyait par là le terme de ses souffrances, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000198**| - 14 route pour se rendre à la confédération générale que pour en imposer, par l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000199**| 15 -- parties de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000200**| - 16 publique, vous jurez d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000201**| - - 17 pouiller de ses habits sacerdotaux. Le même cortège revint sur la place d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000202**| RELATION DE LA RÉCEPTION FAITE A PHILIPPE V, ROI D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000203**| 19 - le nouveau roi d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000204**| 20 — << Il arriva dès ce jour du désordre dans les équipages, car les gens de Monsieur le maréchal de Noailles (1) ayant pris le chemin de Chartres pour celui de Châtres (2), n' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000205**| 21 de suite; et que M. de Beauvilliers (1) et M. de Noailles avaient aussi chacun quatre carrosses, et que plusieurs autres gens de qualité en avaient à eux, ou les avaient loués; il y avait beaucoup de chaises à une et à deux personnes. << Le lendemain, dimanche 5, nous partîmes de Châtres à onze heures, et après avoir passé par Étréchy-le-Larron, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000206**| 22 _______ Toury, qui n'est qu'un gros village à dix lieues d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000207**| - - 23 votre domination du bonheur dont ils vont jouir; pour nous, nous allons faire mille vœux pour la durée de votre Empire, et pour la conservation d'un prince sy chéry du ciel. >> Comme l'on rend les mêmes honneurs aux Princes qu'au Roi d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000208**| CHATRES-SOUS-MONTLHÉRY ÉRIGÉ EN MARQUISAT EN OCTOBRE 1720 ET DEVENANT ARPAJON (1) La petite ville d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000209**| - ― 25 tres à Louis d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000210**| 26 - signée le 11 avril 1713. Philippe V, roi d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000211**| - - - 27 La Croix-Blanche, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000212**| -- - 28 voyageur se dirigeant sur cette ville, les anciens bâtiments de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000213**| - 29 dxxxxxxxxx Louis d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000214**| - 30le xxi août de l'an MDCCXXXVI, de son âge le LXVIIeme, et est inhumé dans le coeur de cette église selon ses désirs. Requiescal in pace. Les armes de la maison d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000215**| LA DATE DE LA MORT DE DOM BASILE FLEUREAU En 1873, notre savant compatriote, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000216**| 32 - Paris, à Montargis ou à Etampes, villes où il avait professé dans les collèges de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000217**| LE JOURNAL D'UN BOURGEOIS DE CORBEIL En visitant un fort lot de vieux papiers, nous y avons rencontré des pages, écrites par un habitant de Corbeil, vers 1740. C'est une sorte de journal dans lequel l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000218**| -34JOURNAL D'UN BOURGEOIS DE CORBEIL En 1739 on commençoit à ne plus se sentir des fureurs de Bellonne, quoy que cependant les vivres estoient toujours très chères et principalement le pain, qui valloit jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000219**| - -- 35maturité. Il tomboit tous les jours des pluyes continuelles, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000220**| 36ces raisons on jugea plus a propos de recommencer une seconde neuvaine de prierre publique, ce qui fut fait, et on vit les airs changés, la saison devint bien favorable, puisque les bleds vinrent à maturité à leur temps ordinaire de la moisson, mais il vint des pluyes si fréquentes que l'on eut de la peine à les serrer, et c'est ce qui a fait que le bled a toujours esté d'un prix exorbitant. On se resouviendra longtemps de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000221**| - — 37 - quinzième de May on n' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000222**| - 38 - tampes, puisque c'est elles qui arrosent cette ville de Corbeil et qui sont les causes des dommages qui sont arrivés et mesme qui ne sont pas encore visibles (1). Il n'est pas estonnant de voir la rivierre de Seine augmenter dans le mois de décembre, mais tous les ans il n'y a pas une augmentation si terrible que celle-cy. Il est vrai que dès le mois de novembre la rivierre estoit toujours dans son bassin et dans ses berges, elle s'est sous-tenue dans sa hauteur, mais le jour de Saint Nicolas, 6º de décembre, elle augmenta dans la nuit mesme de trois pieds de hauteur, de sorte que le coche de Corbeil (2) qui estoit allé à Paris, eut bien de la peine à remonter à Corbeil, à cause que la rivierre avoit monté plus haut que les berges; même sur la chaussée de Petit Bourg, il y en avoit plus d'un pied et demy. C' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000223**| - - 39 - rons du pont de la manufacture des buffles (1), quoy que cependant, en payant les batteliers, ce n' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000224**| - - - 40 - toient ces chambres, on a vu jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000225**| - 41 coin du mur de Nagis, car la rivière passoit de plus de trois pieds sur le pavé et prenoit depuis les murs de Nagis jusques au coin du cimetière du costé de la ville, puisque tous les jardins qui sont dans ce faubourg et le cimetière mesme estoient pleins d'eau jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000226**| 42 - jaloux de leurs droits, ils avoient résolu qu'ils feroient poser des planches pour pouvoir faire entrer les auditeurs dans le chœur, et que le Prédicateur prescheroit dans un fauteuil proche de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000227**| INAUGURATION DU MUSÉE SAINT-JEAN ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Tenue dans l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000228**| - 44 gnirent ceux de Corbeil, d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000229**| | ||
| + | |||
| + | Societe HISTORIQUET ARCHEOLOGIQUE DE CORBEIL D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000230**| i | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000231**| - - 45 Messieurs, << Notre Société compte à peine quelques années d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000232**| - 46 - - Et pour dissiper le nuage de tristesse que viennent d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000233**| - 47 De ces quelques couplets, messieurs, Vous excuserez, j' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000234**| - --- 48 parrain avec Dame Louise Bouret, d'où les noms de Louise Michel donnés à cette cloche. Mais la séance va s' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000235**| 49 --- époque je vous indiquais 137 sociétaires, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000236**| 50 -- d'une vue du Château de Chilly, d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000237**| - - 51 ments inédits, par M. l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000238**| 52 Ce musée, que nous avons entrepris de fonder et que nous inaugurons aujourd' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000239**| - 53 SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 1897 A cette époque les fondations se montaient à Fr. En outre il a été encaissé : 103 cotisations à 10 fr. . • 23 cotisations à 5 fr. Excédent de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000240**| -54- — une année, conformément aux articles II et XIV du réglement, les pouvoirs du bureau et du Comité de publication. Pour épuiser l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000241**| LE PRÉHISTORIQUE EN SEINE-ET-OISE (1) Les premiers documents relatifs à l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000242**| - - - 56 côté le grand développement de la culture, en faisant disparaître les roches isolées, en nivelant les terrains, a changé la surface du sol et enfoui bien des objets du plus grand intérêt; de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000243**| - 57 - APERÇU GÉOLOGIQUE Les géologues ont classé les couches du globe, suivant leur ancienneté, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000244**| - - 58signaleront des objets ou des monuments qui ont, jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000245**| — ---- 59 c'est l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000246**| - - 60 renne trouvés dans les grottes ou les tourbières, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000247**| 61 ― polie, des poteries plus ou moins complètes, beaucoup d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000248**| - - 62 Une pointe de lance avec oreille. Une id. id. Des Torques, anneaux ou bracelets. Une fibule. Les analyses de ces bronzes ont montré que la composition s' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000249**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000250**| A.L. Clem LA PIERRE LEVÉE; DOLMEN DE JANVILLE-SUR-JUINE. Gravure offerte par l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000251**| - 63 - nombre de personnes, et tout prouve que les ensevelissements étaient successifs. Les dolmens sont donc des chambres funéraires, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000252**| - 64 monument. L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000253**| - 65- - sens de leur plus grande dimension, de manière à former des espèces d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000254**| - 66 4° MENHIRS DISPARUS La grande Borne, près du Mesnil-Recoin. La pierre, près du château de Fascheville. A Bruyères-le-Chatel, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000255**| - - 67 de 1 m. 65 et son épaisseur de o m. 70. La largeur et l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000256**| - 68 Auprès du hameau, on a découvert une caverne, et les alentours ont fourni de nombreux échantillons de silex taillés, généralement type du Moustier. III. PIERRES BRANLANTES ET TOURNANTES On rencontre quelquefois un énorme bloc de pierre reposant par un ou deux points sur un rocher: quand le bloc supérieur s' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000257**| -69- - La Roche qui tourne présente, en dessus et latéralement, | ||
| + | |||
| + | Ade Mortiffer La Roche-qui-tourne, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000258**| - - 70 - IV. - PIERRES STRIÉES POLISSOIRS - La pierre striée, légendaire à Villeconin, se trouve à gauche de la route allant de St-Sulpice à Villeconin, à environ 200 mètres du chemin, à la lisière du bois. C'est un bloc de grès qui paraît avoir été travaillé ; sa surface antérieure verticale est à peu près plane et est couverte d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000259**| 71 - M. A. de Mortillet, auquel j'ai fait examiner cette roche, prétend que ces stries n'ont que des rapports assez éloignés avec les rainures des véritables polissoirs de la période néolithique. Il objecte la difficulté de travailler dans cette cavité. L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000260**| 72- - obscur et généralement d'un accès difficile, et en Grottes, salles s' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000261**| ! | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000262**| Plan Terre Végétale 0, 30Sable Sépulture de l'âge du bronze. Coupe | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000263**| - - 73 - Tout a été à peu près dispersé, sauf quelques pièces recueillies par M. Thomassi, avec lequel j'ai exploré cette grotte. CIMETIÈRE DE L'age du BRONZE Sablières situées dans la vallée allant d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000264**| 74 - Il a été trouvé une amulette en pierre blanche représentant à peu près un poisson. Les yeux étaient en creux et remplis d'une matière rouge, probablement de la sanguine; il existait un trou de suspension. Il y avait aussi une espèce de boucle, en métal blanc, de forme rectangulaire à angles arrondis. Le métal très fragile n'a pu résister au coup de pioche (1). La levée des squelettes et l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000265**| LA REINE ISBURGE ET LA COMMANDERIE DE SAINT-JEAN-EN-L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000266**| - -- 76 - jours de leur mariage. Les uns attribuent ce dégoût à un vice de conformation; | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000267**| 77jeter l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000268**| 78 - Philippe, après avoir résisté longtemps, dut enfin céder; il se rendit aux conseils de quelques-uns de ses barons et intercéda auprès du pape. Celui-ci envoya deux cardinaux qui obtinrent le renvoi d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000269**| -- 79 « grâce son offre, et au mesme instant elle fut eslevée et reçeue sur le courcier, «<et emmenée par le Roy en son hostel, où la réconciliation entière se para- «< cheva; de quoy tous les Prélats demeurèrent fort contens de se voir délivrez de << la peine de prononcer un jugement rigoureux contre un Roy si attaché à ses << affections >> (1). Philippe eut pour Isburge un peu plus d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000270**| 80 écoulées depuis 1223 eussent été bien insuffisantes, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000271**| | ||
| + | |||
| + | LA REINE ISBURGE Statue en cuivre qui ornait son tombeau | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000272**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000273**| 81 - ayant besoin de réparer leur église et d'en refaire l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000274**| 82 Les profanateurs de la révolution n' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000275**| - -- - 83 Feray acquit tout le domaine de St-Jean, au nom de son père, M. Louis Feray, gendre d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000276**| - - 84 confectionner la pâtisserie (1). Cette belle dalle de 2 m. 25 de long sur 1 m. 10 de large, avait recouvert la tombe de M. de Boisboudran, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000277**| - 85 portée dans l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000278**| LE JOURNAL D'UN BOURGEOIS DE CORBEIL (Suite) Le jeudy quinzième de juin 1741, il arriva dans Corbeil une chose des plus surprenantes et des plus affreuses que l'on ait peutestre vües de la vie; c' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000279**| - - 87 mettre l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000280**| 88 ― Martin (1), afin que sy il se trouvoit une nécessité d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000281**| - — 89 trop petite pour pouvoir les contenir, ou du moins par manque d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000282**| - -- 90 porte, où estant arrivé, on répéta l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000283**| - 91 parce qu'il s' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000284**| - - 92 présent de la somme de 50 livres pour l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000285**| - ― 93 Bonaventure Mesnage, huissier à cheval au Chastelet de Paris, celle de saint Anthoine par le sieur Buffin, marchand espicier à Milly, celle de saint Louïs par Severin Cottereau, maître charron au fauxbourg saint Léonard de Corbeil, celle de saint Charles par Charles Formager, marchand espicier à Corbeil et Charles Divry, aussy marchand, celle de sainte Marguerite par Margueritte Mariette veuve de feu sieur Thevenet, vivant commissaire des moulins à poudre d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000286**| - son corps, de plus un autre suaire de saint Spire dans lequel il avoit esté apporté de Bayeux à Palleau; puis un autre suaire de saint Leu. Dans chacun de ces suaires, il y avoit un escrit indiquant le saint dont il provenoit avec la date de la translation dernière qui en avoit esté faite; l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000287**| - - 95 (1740) Le proverbe nous dit que les guerres nous amènent des suittes fâcheuses, et qu'un fléau de Dieu n' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000288**| - 96 -- Le droit de confirmation estant perçu, on ne fut pas plus en repos, car les collecteurs des tailles, voyant que le receveur de ce nouveau droit avoit amassé tant d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000289**| - 97 - pierrailles et terres estoient apportées par des voitures des laboureurs, commandées par un ordre que M. Guynand envoyoit aux syndics des paroisses. Les syndics estoient dans l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000290**| - 98 - ― d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000291**| 99 - y faisoit marcher tous les habitans de la ville en trois colonnes ou équipes; la première colonne comprenoit les habitans depuis la porte de Paris jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000292**| - 100 - brouetter des terres qui estoient le long des maisons de la Pescherie pour élever et aplanir le sol afin d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000293**| 101 quand quelqu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000294**| - - 102 manufactures de France, d'une part, et le dit Jaback d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000295**| 103 - luy semblera, ensemble les machines, ustancilles et matériaux et généralement tout ce qui se trouvera dépendant après les dites trente années expirées, appartiennent au dit Jaback, ses hoirs et ayans cause, pour par eux en faire et disposer comme bon leur semblera; et pour convier les estrangers à s' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000296**| - - 104 sentes, sauf en autres choses réservant nostre droit, et celuy de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000297**| - - 105 La porte Royalle ouverte au lieu du cul de sac qui y estoit appelé le cul de sac de la herse (1). Deux arches refaites à neuf au grand pont du costé du fauxbourg en 1717 (2). La grande arche du pont faite à neuf en l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000298**| BIBLIOGRAPHIE " PERRAULT-DABOT. -- Monographie de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000299**| ― 107 538. Brunoy (S.-et-O.) Ecu de France entouré des cordons de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000300**| - - 108 Le 1er fascicule, 8 pages et une grande planche, est consacré à la porte du cloître Saint-Spire, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000301**| 109 notre France, dont les Etats-généraux de 1789 étaient appelés à résumer les aspirations. Des biographies, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000302**| -- - 110 Mémoires de la Société d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000303**| III - Extrait du tome XXIVe des mémoires de la Société de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000304**| 112 --- Il semblerait, d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000305**| 113 les collections privées. De ses recherches a surgi une longue suite d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000306**| 114 -- J. Florange, expert en médailles, 21, quai Malaquais. 1899, in-4º. Ouvrage édité avec luxe, dans lequel sont cités et gravés quatre jetons des arquebusiers de Corbeil. Contrairement à la date ci-dessus (1899), il a paru en 1898. Annuaire du département de Seine-et-Oise pour 1898. Versailles, Cerf, in-12. Rien que des renseignements administratifs et autres, comme dans la plupart des annuaires de ce genre. Les éditeurs nous avaient cependant habitués à des notices historiques, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000307**| - -- 115 No 4957 bis. Les antiquités de la ville et du Duché d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000308**| - ― 116 L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000309**| 117 - Le Petit Journal. — 3 janvier 1899. Le musée de Corbeil. - L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000310**| - - - 118 ERRATUM A propos d'un passage du procès-verbal du 3 mai 1898 (1er bulletin de 1898, p. XXII), dans lequel M. J. Barthélemy émettait le vœu que des fouilles fussent entreprises dans le champ attenant à la gendarmerie d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000311**| TABLE DE LA 4° ANNÉE Statuts et réglement de la Société. Liste des membres. . Conseil d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000312**| - 120 - Reproduction du Menu du 13 juin 1898. La Pierre-Levée: | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000313**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000314**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000315**| L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000316**| 6455-97. - CORBEIL. Imprimerie Éd. CRÉTÉ. | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000317**| DOCUMENTS PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | CORBEIL THUHE POLY ETAMPES PARIS ALPHONSE PICARD ET FILS, ÉDITEURS Libraires des Archives nationales et de la Société de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000318**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000319**| | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000320**| 2 - du x siècle; les chevrons, les feuilles régulièrement imbriquées, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000321**| 3 les églises qui s' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000322**| 4 -- fert de ses restes à l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000323**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000324**| ! I come chemin Brad chemin. Gassewae tourduchas de monieur Padur Jarden Drent Jarin Jarden Jardin Vignes chemor Helo Durardin kemen Réduction du plan manufcrit de 1645 lop CA Wium 1*- | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000325**| Stern gray Route de Tigery Château de S!Germain Parc Route de Lieusaint Etat actuel des abords de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000326**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000327**| Hehog Dujardin Veue de S.Germain le vieil Corbeil et maifon de M. de Bouille Imp. Ch. Wittmann PL HI | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000328**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000329**| 5 Un clocher surmonté d'une haute flèche, recouverte d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000330**| 6 - pas été déplacée, circonstance qui aurait, dit-on, déterminé la chute de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000331**| Cogo Jos de Eglise de S. Gomain ter Corbeil 4 Juilles 1841. Heliog. Dujardin P. IV | ||
| + | |||
| + | Imp Ch. Wittmann VUE DE L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000332**| 1 • | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000333**| 7 La partie qui surmonte le portail fut presque entièrement reconstruite, | ||
| + | |||
| + | colonnes et d'un certain nombre de chapiteaux, le renouvellement des vitraux de la façade. Plus tard, en 1872, M. Darblay jeune faisait construire le grand tambour d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000334**| - 8 M. l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000335**| 9 - sous le badigeon de chaux qui les recouvrait ; il en était de même pour les clefs de voûte peintes à l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000336**| - - IO Le sol de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000337**| XVI-LAS@MAINRE DEVANT LA 8 LAVRENZ PRIEZ POVR LM Heliog Dujardin OE DALVIM IαI G) GRACE.M EV PIERRE LEGGINGVRIER LE DIELOVI TRESPASSA D Imp Ch Wittmann TOMBE DE PIERRE LETEINTURIER PL. V | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000338**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000339**| Placé dans de meilleures conditions, il nous a été permis de faire de ces monuments une étude plus complète. Nous avons trouvé un auxiliaire précieux dans l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000340**| 12 La date de 1287, rapportée par l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000341**| IA T | ||
| + | |||
| + | Hehog Irajardin ANNO DNIA: OCGVAO VII HI EI REQESⱭAT: FAST BI GEORGI TOMBE D'UN PRÊTRE DÉCÉDÉ EN 1287 Imp Ch Wittmann ・・・・玉 121 | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000342**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000343**| DIGILIFT ASSUOD MONIS ThⱭIHAAT OAGISTARIOHAN EOARIE VIRGINIS CUIUS ANIONT REQUIES CAT IN PAAE AMEN ㄨㄨ RIO CONOTON CANONICUS SANATI QUINTINI DE VIROOVANOIFAO CURATUS ISTIUS CAS DICTOLISIA Hélio Dujardin 00:00 Imp Ch Wittmann TOMBE D'UN CURE DU VIEUX-CORBEIL décédé en 1309 PL VII | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000344**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000345**| PL. VIII | ||
| + | |||
| + | PRO O ORAGE Iua hic LACEY QAGIS QUER IOHANNES AVRAUVS ISTIVS ECCLESIA DE VEGERI CORBOLIO E DECANVS (31) για ˋ 園 Caα QVADRAGESIMO . W rua 3 ouul 83 21180 AD Heljog Dujardie RPIANITATIS trp Ch Wittmann TOMBE D'UN CURE DU VIEUX-CORBEIL decédé en 1340 | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000346**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000347**| 13 - au nom patronymique, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000348**| — — 14 Guilhermy de déchiffrer les dernières lignes qu' | ||
| + | |||
| + | Ler marges or ceans lout tal fire dire et chunter le con biase De celle cale per chi premier jo es mopslam ans enrichment Tales and pleaulnes et neuf lecons lanes comentes et melle Jade a diacre Toubh diecer e choices fru gemein troet dit oudert urce faire ang alay eat worse tres tournops Tente pris pr chun an hr mailion geance citables regrettes et Jardin le tout dos auies al a tiller et bir yo suras te terer al ala bunte gue bergiees few a une ala egle quatre arus re alan tillrep muheil dit alle mele mis prices e la epile Delques reate et terre mor andre en afaict buiter les mains a late car par puillance de fiet et.ru eft put temptar pur Lequel cente et terre le Fandre almille le gyres tour Dont le cure on are quarraletres à cahir ter guaires arrus & terry delhi Fletely wrts out temp faire dirgr rhin an mur fours elcris au martilage quatre uelles balles De requiem feu facques brieet dit budirt pe dus gemat item ally lord train leg mrls faire dice le tenace dead ablob releure et laire les pie agnes anom rs y sufres et de alceule munires a com bug calea ettroys Colts et faire dire une meile balle le premier fo Conurnable dames ovena miques n'et a liminonak amiot yufur feu/aques bebet dat oudert etaule diftribuer Buy afilias and Cutter a counung til gallegu me faire Lane enile a comme un septier ble de rente a lane cult pris tur un arpent deterre alla dilep série de figures: le Christ nu, assis sur un tombeau et tenant un roseau; Germain Hébert, à genoux devant lui, ayant à ses côtés saint Germain évêque; à la gauche du Christ, la femme de Germain Hébert, également à genoux, est assistée par un diacre revêtu d'une dalmatique : c'est saint Vincent, premier patron de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000349**| FL IX | ||
| + | |||
| + | Moble feme emile mris Javis la feme Qm Challa Paez neu peule: Hélieg Dujardin Cygilt doble home toys tillet enlon vialt Frownl le ybi Jo de feptemibze mil vez kye: Ct TOMBE DE LOYS TILLET. décédé en 1516. et de DENISE PARIS. sa femme coquatre degenolly z de la granche ala puote huller du Foy ure fire en la cot de plemet Qm Plmalla Imp Ch Wittmann | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000350**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000351**| 15 · lefquels rente et terre ledit S¹ andre abaille leize · xx livres tournops Dont le care en a receu quarente livres a canle des quatre 7 arpens de terre dellns diks. Item leldits margnilliers sont tennz faire dire par chacun an anx Jours elcriptz an martnologe quatre melles balles De requiem pour fen Jacques heberk dik hondark pere dudik germain item anlli lont tenuz leldiks margnilliers faire dire le lervice du Jendy ablolu de relevee ef laver les piedz a xui panvres an nom des xiu apoltres et donner a Jcenlx panvres a chacun ung galtean et trops Colz tournops et faire dire nne melle balle le prenmier Jonr convenable dapres on devant palques pour et a lintencion de denile amiok venfve de fen Jacques þebert dık ondart et anſſi diſtribner anx alliltans andik lervice a chacnn nng petit galtean pour ce faire ladite denise a donne nu sepkier de ble de rente a ladite eglise pris fur un arpent de terre allis a killery.. Haut. om,86, larg. om,71. Au-dessous de la fenêtre qui s' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000352**| - 16 - veuve de Loys Tillet, comme paraît l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000353**| 17la fondatrice couchée dans son cercueil, le corps déjà envahi par les vers. Cette pierre était scellée sur un des piliers de la chapelle de Saint-Pierre, | ||
| + | |||
| + | Les marguilliers paelens eta lenie te legte et paroille germain du bicil corbueil font terug face dice chanter et celebzer en la eate a toulious peetuellement a bintentio be fobleteme Catherine utillet efue de feu Tebo le cocheteen Con viuant buillier des requeltes duplas et de les parens et amps buns et trefalleg douge obitz Colewpnely par chi a quele afondes de lon but quá feront celebzez le premier leadede de chun moes heure de buiet atenda neuf heures du matin au cueur de ladicte egte Lelquely obity feront de bigilles a neuf plenulmes et neuf becons laudes Vecbmandaces et une melle po les teelpallez le tout chauta notte a multe wix et la melle a diacie loubg diace et chailles ala fin du fuice Ceza faicte procellion alentour des pilliers de ladicte egte auce la cor et lease temilte en chantant le teilet libera me domine de monte etema et aultres fuffrages zozailos propres Et ala fin de la procellion viendront les gens begile fur la folle et au lieu ou eft Jubume feu moys. Dutillet feigneur dual roquatris ze te ladicte lefue et aucuns tes frezes et leurs telle en la chapelle viere ou z adruezout leld fuffrages et y diront aulle le pleadme de deprofimdis et orailons popes pour la celebzation telquely obitz fences et melles lety mattre Cont temuz fournir et adminiftrer les plus beaulx et les plus boneltes amemens tes teelpallez de la eglife bare calice huminaire et aultres chules ace necellaires Et auant que comancer a chanter et celeber left obitz Cezont temy lely margalhiers faire tinter p de dueles fois les petites doces et ala troifiefme fors fare Conner les grolles cloches pour laquelle fondado ladicte dutillet a conlane alad egile vingt lures e de vente media ao Pachetable aux bous poinct et ailemens de la duillet a la charge que les tenies du vachapt lezout employez en autres Yentes toutefois et quantes que vachapt en Ceza faict es lers delquely emplois Ceza faict mention que left de la fondado de lad dutillet ainly que le tout eft aplain contenu au contract de ce faict et palle p deuat Jacques patio notaire Topal aud coburil le yeb Jour dail mil cinq cens (oixante fix Tequielcat Jn pace ce qui explique la vingtième ligne de cette longue inscription que nous transcrivons: | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000354**| 18 - Ceront celebrez le premier vendredy de chacun mops heare de þnick atendant nenf þenres du matin an cnenr de ladicte eglile Lelqnel; obitz leront de vigilles a nenf pleanlmes et nenf lecons landes Fecommandaces el nne melle pour les trespallez le tont chank a notte a hanlte voix et ladite melle a diacre lonbz diacre et choriftes a la fin dndit Cervice lera faicte procellion alentour des pilliers de ladicke eglile anec la croix et leane benilte en chantant le verlet libera me domine de morte eterna et anltres luffrages z orailons propres Et a la fin de ladite procellion viendront les gens deglile fur la folle et an lien on elt Jnhume fen m' loys dakillet leigneur du val coquatrix pere de ladicte vefne et ancnns des freres et leurs delle en la chapelle k¹ Pierre on ilz acheneront lesdits (uffrages et y diront anlly le pleaulme de Deprofundis et orailons propres pour la celebration delquelz obitz lernices et melles leldiks margnilliers lout tennz fournir et adminiffrer les plus beaulx et les plus honeftes ornemens des trelpallez de ladite eglise liure calice luminaire et anltres choles ace necellaires Et anant que commancer a chanter et celebrer leldiks obitz leront tennz lesdits margnilliers faire tinter par denx dinerles fois les petites cloches et a la troilielme foys faire Conner Les grolles cloches Pour laquelle fondation ladicke dnkillet a conftitne a ladite eglise vingt linres fonrnops de Vente par chacnn. an kachetable anx bons poinctz et ailemens de ladite dnkillet a la charge que les deniers du Vachapt feront Vemployez en autres Ventes tontesfois et quantes que Vachapt en Cera faict es lettres delquels Femploy lera faict mention que left de la fondation de ladite dutillet ainly que le kont elt aplain contenn an contract de ce faict et palle par denant Jacques patin notaire Voyal andit corbneil le xxvu Jour danrıl mil cinq cens foixante fix Veqnielcat In pace Haut. 1,51, larg. om,615. | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000355**| - — 19 Nous avons retrouvé dans le manuscrit de l' | ||
| + | |||
| + | DO M Fey gift Francois Baftonneau viuat efeuyers de la Beranderie & Ber Jeuille Cappitame de gens de pied Toubzle Comanderant de Monteur de Giury qui fut the Flefcalde par les espagnolzalaroprie de Corbeil Muriceux par led, Seig de Giary level D. O. M. Icy gist Francois Bastonneau vivant escuyer S. de la Berauderie & Belleuille Cappitaine de gens de pied soubz le Comandemant de Monsieur de Givry qui fut tué a lescalade par les espagnolz a la reprise de Corbeil sur Iceux par led. Seig", de Givry le x Io" de Novem. bre M. vc xxx Priez dieu por so Ame Haut. om,275, larg. om,365. Deux écus découpés dans la partie inférieure de la plaque de cuivre ont dû contenir, en émaux peut-être, les armoiries du défunt. Le tombeau sur lequel se trouvait autrefois cette inscription n' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000356**| - - 20 bour d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000357**| 21 écussons, supportés par deux lions, et surmontés d'un heaume à lambrequins, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000358**| - ― 22 lement, puisque les successeurs de Michel Boucher continuèrent, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000359**| -- 23 Ces arrêts du Parlement intéressant également l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000360**| 24 dre que dung huict, de la mesure ordinaire de nre ville & chastellenye de corbueil le sur plus desde dixmes demeurans ausd Marguiller Abbesse de St. Anthoine & Prieur de St. Iehan en lisle & oultre codenné lesdz Marguill & Consors payer aud Boucher lesa Arrerages a luy deues dud gros pour lannée six cens sept sans aulcune diminution po' la sterilité de lad année deduction faicte de de ce qui se trouuera auoir esté sur ce payé a la charge que led Boucher et ses sucesseurs Curéz serot tenuz suiuat le tiltre de Tanée M. IIII pduict au pces oultre la Messe parrochialle de chacun dimache dire et celebrer par chacune sepmaines trois aues Messes compris en Icelle les grande Messes des festes y escheantes & oultre dire & celebrer les vespres esa festes & dimanches sabmedis & veilles de festes & les matines & heure Canonialles en touttes les festes sollempnelles & encorre en administrer les sacremens de legle & fe inhumer ses parroissiens q' nauront aulcuns moyens gratuitemet & sans predre aucune chose sans despes tant de la cause principalle que des causes dappel & de lad Instance. Aultre arrestz donné de Mesdz s" de la Court entre les partyes le xxi lor de Ianuier Mil six cents dix sept Nostred Cour executant larrest donné allencotre dud curé du 8 Mars M. VIC XIIII. A en loinct aud curé & ces sucesseurs curez de dire et celebrer le seruice diuin porté par Icelluy aultremet & a faulte de ce fe a pmis & pmect ausd Marger de fe dire & celebrer led seruice a laduenir aux fraiz & despes dud curé deffandeur po' lesqlz recourir se pouruoirot par saisye sur le reuenu teporel de lad cure & a ce fe en Ioinct au subtitud de Nre pcureur general tenir la main sans que led defadeur en puisse estre recherché por le passé & oultre a maitenu & garde Maictyent & garde lesd Margers & parroissies en pocession de ne payer aucune chose pour les celebratios des mariages et administration de lextremontio & enterm suyuat lencyen tiltre sauf cy por lesd Mariages & enterm estoit celebrer aultre мesse et seruice extraordinaire & neantmoings a pmis & pmect aud curé daxepter se quil luy sera gratuytement & liberallemet offert par lesd parroissiens sans quil puisse exiger ne vser de contrainte condempné led Boucher es despen' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000361**| 25 - Nous trouvons à côté le texte de la fondation de Vincent Dupont, que nous citons tel qu'il a pu être rétabli : D. 0. M. PAR CONTRAT PASSÉ DEVANT DU RUCHANOY (1) ET SON CONFRERE NORES ROYAUX (2) A CORBEIL LE 10 DECEMBRE 1733. LES SIEURS CURÉ ET MARGUILLIERS DE CETTE ÉGLISE SONT TENUS ET OBLIGÉS DE FAIRE DIRE ET CELEBRER A PERPETUITTÉE PAR CHACUN AN A L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000362**| 26 - PORTÉES PAR LE DIT CONTRat du quel cET EXTRAIT A ÉTÉ TIRÉ XAGé de 68 ans. Xagée de 78 ans (1). Requiescant in pace. Haut. 1,14, larg. om,79. L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000363**| - - 27 PAROISSE SAINTE MARINE (1) EN LA CITE DECEDE EN SA MAISON DE CAMPAGNE SIZE A SAINT GERMAIN LEZ CORBEIL LE NEUF JUILLET MIL SEPT CENT CINQUANTE Huit AGE DE CINQUANTE HUIT ANS Priez Dieu pour le Repos de son ame Haut. 1,93, larg. om,98. La tombe de Nicolas Giroux est fort bien gravée, les insignes de la profession du défunt, enveloppés d'une draperie, surmontent l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000364**| --- - 28 parlé plus haut, et celle de Jacques de Bretigneres. C'est dans le manuscrit de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000365**| 29 CETTE ÉGLISE DOIT A M. AIMÉ-STANISLAS DARBLAY LA RECONSTRUCTION DE SA FAÇADE AU-DESSUS DU PORTAIL AVEC SON CAMPANILE ET SES STATUES (1862) SON TAMBOUR ET SES ORGUES (1878). LE CALORIFÈRE, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000366**| — - 30 cerdotaux trouvés dans le sol ne laissent aucun doute sur la nature de la plupart de ces tombes. C' | ||
| + | |||
| + | à peu près intacts, ils renfermaient encore des fragments de charbon de bois; quatre à cinq trous avaient été percés sur leur pourtour. C' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000367**| | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000368**| | ||
| + | |||
| + | noiensseA3 anioma? sb sb لوع 2.W noiansoek! Jog 20mm972 usedmal us espnA xion si trenobs tehub لو joj Jaind joj supiszol xion ne allevuok evestab noisllspet STEM ebarq 29b tramenntue eenigsb و auasl angus pinopAJ Kusem& | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000369**| PL X | ||
| + | |||
| + | Heliog Du aran Imp h Wittmann GRAND VITRAIL DU SANCTUAIRE | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000370**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000371**| Isaac Trois Colombes Trois Colombes Le St Esprit Le Christ Moïse Manasses La Ste Vierge Salomon Daniel Josué Roboam Jeremie Jessé David Jacob Aaron Abraham des Anges présentent la Couronne desElus SCerma Mort de S: Germain S:Germain est sacré Evêque de Paris S' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000372**| McM 016792' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000373**| PL. XI | ||
| + | |||
| + | Hoog Dujardin VITRAUX DES PETITES BAIES du Sanctuaire Imp Ch Wittmann | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000374**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000375**| | ||
| + | |||
| + | Décollation de Martyre de SJean Baptiste S! Laurent Martyre de St Barbe Le couronnement Agneau Pascal de Charlemagne parle PapeS Léon St Martin coupant Martyre de son manteau S.Barthélemy | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000376**| sMץ97 noits!lo390 sb eb nemann 9J 33sMץ97 engamehadab ubongA 160289 ab nos/29969 sineq 907582 sMנץ nisM 2 9b ymoladhs8:2 វពនqu03 1693n6m no2 | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000377**| 11 XI. | ||
| + | |||
| + | Hang Luardin OCULUS DU SANCTUAIRE Imp Ca W mann | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000378**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000379**| 31 Tonnerre. Dans la partie réservée aux fidèles, il est coupé de passages dessinés par des bordures de marbre; dans le choeur et le sanctuaire, la disposition, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000380**| -- 32 Un petit panneau circulaire, représentant l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000381**| - - 33 Cette pratique est conforme à la tradition architecturale du moyen âge, dont l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000382**| - 34 savant bibliothécaire de la ville de Corbeil, dont les avis nous ont été précieux pendant le cours des travaux qui nous occupent. Les verrières qui en font l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000383**| 35 — Jacques. Un fragment important du vitrail de saint Paul subsistait seul en 1895 au milieu des vitraux blancs, qui, dans toutes ces fenêtres, avaient remplacé les anciens panneaux à personnages. | ||
| + | |||
| + | Ce fragment, qui n'a pu être utilisé, est aujourd' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000384**| 36 trop tard pour pouvoir, lors de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000385**| - - 37 rieur. Des précautions ont été prises à l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000386**| - 38 Un petit mur, surmonté d'une balustrade en bois, interrompu dans son milieu par un escalier de trois marches, séparait le chœur du reste de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000387**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000388**| | ||
| + | |||
| + | Tujardin PL 12 HRIEUR DE LEGLISE avant la restauration de 1895 96. Imp. Ch. Wittmann | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000389**| | ||
| + | |||
| + | 1. Dujardin 165 INTERIEUR DE L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000390**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000391**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000392**| | ||
| + | |||
| + | Dujardin ESQUISSE DU TABLEAU DE L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000393**| | ||
| + | |||
| + | EGLISE DE SAINT GERMAIN LEZ CORBEIL. Imp. Ch Wittmann | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000394**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000395**| - - 39 Des clôtures en fer forgé, dessinées dans le goût du xII° siècle, ferment le chœur du côté des fidèles et séparent le sanctuaire des bas-côtés. Une chaire isolée, en chêne, ornée de quelques sculptures, un banc d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000396**| - -- 40 L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000397**| Heliog Dujardin. L EGLISE DE ST GERMAIN-LEZ-CORBEIL Imp. Ch Wittmann PL XVI | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000398**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000399**| - - 41 plâtre, sans caractère; le côté nord n' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769654_00000400**| - — 42 rehaussé d'or abritait le trône épiscopal. Un groupe d' | ||
per/shaceh.04.1898.1763874310.txt.gz · Dernière modification : de bg