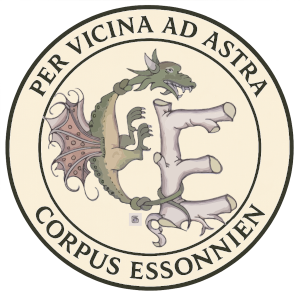per:shaceh.05.1899
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| per:shaceh.05.1899 [2025/11/23 06:05] – créée bg | per:shaceh.05.1899 [2025/11/23 17:18] (Version actuelle) – bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | **[[bul.shaeh|SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| ======Bulletin n°5 (1899)==== | ======Bulletin n°5 (1899)==== | ||
| ======PAGE EN CONSTRUCTION====== | ======PAGE EN CONSTRUCTION====== | ||
| + | |||
| + | BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | IMPRIMERIE G. BELLIN, A MONTDIDIER | ||
| + | |||
| + | BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL D' | ||
| + | |||
| + | ZORBEIL THUNE POD ETAMPEST PARIS ALPHONSE PICARD ET FILS, ÉDITEURS LIBRAIRES DES ARCHIVES NATIONALES ET DE LA SOCIÉTÉ DE L' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | ===STATUTS=== | ||
| + | |||
| + | * Approuves par arrêté préfectoral en date du 19 février 1895 | ||
| + | * ARTICLE I. - Une Société est fondée à Corbeil sous le titre de SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE Corbeil, D' | ||
| + | * ART. II. La Société s' | ||
| + | * ART. III. La Société se compose de tous les fondateurs et, en nombre illimité, des personnes qui, adhérant aux Statuts, sont admises par le Conseil sur la présentation de deux membres. - Le Conseil peut aussi désigner des membres correspondants qui seront nommés par l' | ||
| + | * ART. IV. Le titre de fondateur est acquis: 1º aux signataires des présents statuts, 2º à tout membre qui fait don à la Société d'une somme de cent francs au moins. ART. V. Chaque sociétaire paie une cotisation annuelle de dix francs: cependant cette cotisation est réduite à cinq francs pour les personnes appartenant au clergé et à l' | ||
| + | * ART. XIII. En cas de dissolution de la Société, les membres titulaires, réunis en une Assemblée générale spécialement convoquée à cet effet, seront appelés à statuer sur la liquidation de l' | ||
| + | * ART. XIV. Les présents Statuts pourront être modifiés par l' | ||
| + | * ART. XV et dernier. Un règlement intérieur, adopté par l' | ||
| + | * Vu par le Vice-Président: | ||
| + | |||
| + | |**VIII**| | ||
| + | RÉGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**IX**| | ||
| + | ART. V. - Le Secrétaire rédacteur rédige les procès-verbaux des séances et est chargé de tout ce qui se rapporte à la correspondance. - ART. VI. Le Trésorier est chargé du recouvrement des cotisations annuelles; il paie les dépenses ordonnancées et donne chaque année, à la séance générale, un état de la situation financière de la Société. ART. VII. Le Conseil se réunit tous les trois mois; cependant le Président peut le convoquer chaque fois que les intérêts de la Société l' | ||
| + | |||
| + | |**X**| | ||
| + | ART. XV. - Les Sociétaires ont droit à toutes les publications de la Société à partir de l' | ||
| + | |||
| + | |**XI**| | ||
| + | LISTE DES MEMBRES Les noms précédés d'un astérique (*) sont ceux des MEMBRES FONDATEURS qui ont racheté leur cotisation. MM. ALLAIN, Maire de Soisy-sous-Étiolles. ALLIOT (l' | ||
| + | |||
| + | |**XII**| | ||
| + | XII MM. BLONDEAU, entrepreneur de travaux à Corbeil. BONNEFILLE, Sénateur de Seine-et-Oise, | ||
| + | |||
| + | |**XIII**| | ||
| + | MM. *COURCEL (Valentin de), Maire d' | ||
| + | |||
| + | |**XIV**| | ||
| + | MM. FOUDRIER (l' | ||
| + | |||
| + | |**XV**| | ||
| + | MM. LACHASSE (Auguste), Adjoint au Maire de St-Germain-lèsCorbeil. LACOMBE (Paul), Trésorier de la Société de l' | ||
| + | |||
| + | |**XVI**| | ||
| + | MM. MOTTHEAU, 4, place St-Médard, à Brunoy, et à Paris, 18, rue le Verrier. MURET (l' | ||
| + | |||
| + | |**XVII**| | ||
| + | MM. SELVE (le marquis de), au château de Villiers, par la FertéAlais (S.-et-O.), et 36, avenue Hoche, à Paris. SÉRÉ-DEPOIN, | ||
| + | |||
| + | |**XVIII**| | ||
| + | MEMBRES HONORAIRES-CORRESPONDANTS MM. BOURNON (Fernand), Archiviste-Paléographe, | ||
| + | |||
| + | |**XIX**| | ||
| + | BUREAU DE LA SOCIÉTÉ Présidents d' | ||
| + | |||
| + | |**XX**| | ||
| + | SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**XXI**| | ||
| + | M. le comte de Rilly, au château d' | ||
| + | |||
| + | |**XXII**| | ||
| + | financière de la Société au premier mai 1898. Cette situation est satisfaisante et se résume ainsi: Attribution au musée • Attribution à la Société. Total. 198.60. 3.443.25 3.641.85 M. Barthélemy entretient le Conseil des recherches qu'il a faites sur l' | ||
| + | |||
| + | |**1**| | ||
| + | |||
| + | =====LES SCULPTURES DU CLOCHER DE BRUNOY===== | ||
| + | |||
| + | Le joli village de Brunoy, situé à 24 kilomètres de Paris, dans la belle vallée de l' | ||
| + | |||
| + | |**2**| | ||
| + | nous aurons réussi à faire la lumière sur un point d' | ||
| + | |||
| + | |**np**| | ||
| + | |||
| + | CLOCHER DE BRUNOY, SCULPTURE DU CONTREFORT DROIT, COTÉ QUEST. | ||
| + | |||
| + | |**np**| | ||
| + | |||
| + | |**np**| | ||
| + | |||
| + | CLOCHER DE BRUNOY, SCULPTURE DU CONTREFORT GAUCHF, COTÉ QUEST. | ||
| + | |||
| + | |**np**| | ||
| + | |||
| + | |**3**| | ||
| + | laurier, supportés par un chérubin; les émaux ne sont pas indiqués. Celui de gauche porte un écusson en abîme accompagné de huit coquilles en orle. Ecu penché et soutenu par deux griffons, surmonté d'un heaume cimé d'une tête de griffon; le tout dans un vol de palmes. Enfin sur le contresort droit de la face nord, les mêmes deux écus mi-parti sont reproduits dans le même ordre, avec cette particularité que les fuseaux ont un support, tandis que les coquilles n'en ont pas. Pour un amateur, même peu versé dans la science héraldique, | ||
| + | |||
| + | |**4**| | ||
| + | Nous reproduisons ci-dessous son blason, d' | ||
| + | |||
| + | GA Nous partagions l'avis de M. Jeannest-Saint-Hilaire quant aux écus de la face ouest et, nous appuyant sur l' | ||
| + | |||
| + | |**np**| | ||
| + | |||
| + | CLOCHER DE BRUNOY, SCULPTURE DU CONTREFORT DROIT, COTÉ NORD. | ||
| + | |||
| + | |**np**| | ||
| + | |||
| + | |**5**| | ||
| + | Comment contredire l' | ||
| + | |||
| + | |**6**| | ||
| + | << et ce pour le quartier de juillet, aoust et septembre mil cinq cent << cinquante devant passé. De laquelle somme de cent cinquante << livres tournois nous nous sommes tenu et tenons pour content <<< | ||
| + | |||
| + | Ce Guillaume était le fils aîné de Pierre de Lannoy et de Françoise de Rouy. A la mort de son père, il fit l'aveu au roi des fief et seigneurie de Brunoy, à Paris le vingt novembre quinze cent trentehuit (1). 5065. - DE LANNOY, Chistophe, seigneur de la Boissière, gentilhomme ordinaire de la chambre, guidon de soixante lances sous monsieur de Villequier. Ecu en abîme accompagné de huit coquilles en orle, entouré de trois palmes; sans légende. Reçu de gages daté de 1581. << Nous Christophle de Launoy, seigneur de la Boissière, gen- <<< | ||
| + | |||
| + | |**7**| | ||
| + | << jours du présent quartier d' | ||
| + | |||
| + | [Tous les sceaux de la collection Clairambault ayant été surmoulés sur les originaux et ces moulages déposés aux archives nationales, nous nous sommes fait délivrer un exemplaire de chacun des signets de Guillaume et Christophe de Lannoy, lesquels ont servi à la reproduction ci-dessus]. Enfin aucun doute ne pouvait plus subsister, les armoiries sculptées sur le pilier gauche de la face ouest de notre clocher sont incontestablement celles de Lannoy de la Boissière. Restait à établir aussi incontestablement que l'écu aux sept fusées sont celles de Rouy. C'est ce que nous avons tenté sans avoir encore su y parvenir. Tout ce que nous avons pu découvrir de relatif à cette famille, c'est que: Jean de Rouy, seigneur de la Boissière, colonel des légions de Picardie, maria sa fille Barbe, par contrat du 19 décembre 1525, à Antoine de Conflans (souche des vicomtes d' | ||
| + | |||
| + | |**8**| | ||
| + | Françoise de Rouy, qui nous occupe, était, tout probablement, | ||
| + | |||
| + | |**9**| | ||
| + | écuyer puis chevalier. Elle portait de... à deux haches de... adossées et posées en pal (1). 1477. 1515. Marie de Braye, mariée à Rogerin de Lannoy dit Lamon, chevalier, seigneur de Brunoy, du Colombier, et de Civry. Mêmes armoiries que la précédente. - Françoise de Rouy, mariée à Pierre de Lannoy, seigneur de Brunoy, de Civry et du Colombier. 1548. - Anne Jouvenel des Ursins, mariée en 1548 (2) à Guillaume de Lannoy, sgr de Brunoy et de la Boissière, veuve en 1561. Bandé d' | ||
| + | |||
| + | (1) Collection Clairambault, | ||
| + | |||
| + | |**10**| | ||
| + | Remariée à Louis d' | ||
| + | |||
| + | (1) Nobiliaire de Picardie. (2) Archives de Seine-et-Oise, | ||
| + | |||
| + | |**11**| | ||
| + | 1610. - Anne d' | ||
| + | |||
| + | |**12**| | ||
| + | ont toujours témoignée, | ||
| + | |||
| + | |**13**| | ||
| + | |||
| + | =====LA FÊTE DE LA FÉDÉRATION A MONTGERON (14 juillet 1790)===== | ||
| + | |||
| + | La révolution de 1789 fut accueillie avec enthousiasme par la population de cette commune, qui entrevoyait par là le terme de ses souffrances, | ||
| + | |||
| + | |**14**| | ||
| + | route pour se rendre à la confédération générale que pour en imposer, par l' | ||
| + | |||
| + | |**15**| | ||
| + | parties de l' | ||
| + | |||
| + | |**16**| | ||
| + | publique, vous jurez d' | ||
| + | |||
| + | |**17**| | ||
| + | pouiller de ses habits sacerdotaux. Le même cortège revint sur la place d' | ||
| + | |||
| + | |**18**| | ||
| + | =====RELATION DE LA RÉCEPTION FAITE A PHILIPPE V, ROI D' | ||
| + | M. Maxime de Montrond, dans ses Essais sur la ville d' | ||
| + | |||
| + | |**19**| | ||
| + | le nouveau roi d' | ||
| + | |||
| + | |**20**| | ||
| + | << Il arriva dès ce jour du désordre dans les équipages, car les gens de Monsieur le maréchal de Noailles (1) ayant pris le chemin de Chartres pour celui de Châtres (2), n' | ||
| + | |||
| + | |**21**| | ||
| + | de suite; et que M. de Beauvilliers (1) et M. de Noailles avaient aussi chacun quatre carrosses, et que plusieurs autres gens de qualité en avaient à eux, ou les avaient loués; il y avait beaucoup de chaises à une et à deux personnes. <<< | ||
| + | |||
| + | |**22**| | ||
| + | Toury, qui n'est qu'un gros village à dix lieues d' | ||
| + | |||
| + | |**23**| | ||
| + | votre domination du bonheur dont ils vont jouir; pour nous, nous allons faire mille vœux pour la durée de votre Empire, et pour la conservation d'un prince sy chéry du ciel. >>> | ||
| + | |||
| + | |**24**| | ||
| + | =====CHATRES-SOUS-MONTLHÉRY ÉRIGÉ EN MARQUISAT EN OCTOBRE 1720 ET DEVENANT ARPAJON===== | ||
| + | (1) La petite ville d' | ||
| + | |||
| + | |**25**| | ||
| + | tres à Louis d' | ||
| + | |||
| + | |**26**| | ||
| + | signée le 11 avril 1713. Philippe V, roi d' | ||
| + | |||
| + | |**00000059**| -27 La Croix-Blanche, | ||
| + | |||
| + | |**00000060**| 28 - voyageur se dirigeant sur cette ville, les anciens bâtiments de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000061**| 29 - Louis d' | ||
| + | |||
| + | |**00000062**| 30 - le xxi août de l'an MDCCXXXVI, de son âge le LXVIIeme, et est inhumé dans le coeur de cette église selon ses désirs. Requiescat in pace. Les armes de la maison d' | ||
| + | |||
| + | |**00000063**| LA DATE DE LA MORT DE DOM BASILE FLEUREAU En 1873, notre savant compatriote, | ||
| + | |||
| + | |**00000064**| 32 - Paris, à Montargis ou à Etampes, villes où il avait professé dans les collèges de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000065**| LE JOURNAL D'UN BOURGEOIS DE CORBEIL En visitant un fort lot de vieux papiers, nous y avons rencontré des pages, écrites par un habitant de Corbeil, vers 1740. C'est une sorte de journal dans lequel l' | ||
| + | |||
| + | |**00000066**| 34 - JOURNAL D'UN BOURGEOIS DE CORBEIL En 1739 on commençoit à ne plus se sentir des fureurs de Bellonne, quoy que cependant les vivres estoient toujours très chères et principalement le pain, qui valloit jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**00000067**| 35 - maturité. Il tomboit tous les jours des pluyes continuelles, | ||
| + | |||
| + | |**00000068**| 36 - ces raisons on jugea plus a propos de recommencer une seconde neuvaine de prierre publique, ce qui fut fait, et on vit les airs changés, la saison devint bien favorable, puisque les bleds vinrent à maturité à leur temps ordinaire de la moisson, mais il vint des pluyes si fréquentes que l'on eut de la peine à les serrer, et c'est ce qui a fait que le bled a toujours esté d'un prix exorbitant. On se resouviendra longtemps de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000069**| 37 - quinzième de May on n' | ||
| + | |||
| + | |**00000070**| - - 38 tampes, puisque c'est elles qui arrosent cette ville de Corbeil et qui sont les causes des dommages qui sont arrivés et mesme qui ne sont pas encore visibles (1). Il n'est pas estonnant de voir la rivierre de Seine augmenter dans le mois de décembre, mais tous les ans il n'y a pas une augmentation si terrible que celle-cy. Il est vrai que dès le mois de novembre la rivierre estoit toujours dans son bassin et dans ses berges, elle s'est sous-tenue dans sa hauteur, mais le jour de Saint Nicolas, 6º de décembre, elle augmenta dans la nuit mesme de trois pieds de hauteur, de sorte que le coche de Corbeil (2) qui estoit allé à Paris, eut bien de la peine à remonter à Corbeil, à cause que la rivierre avoit monté plus haut que les berges; même sur la chaussée de Petit Bourg, il y en avoit plus d'un pied et demy. C' | ||
| + | |||
| + | |**00000071**| - - 39 rons du pont de la manufacture des buffles (1), quoy que cependant, en payant les batteliers, ce n' | ||
| + | |||
| + | |**00000072**| 40 toient ces chambres, on a vu jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**00000073**| 41 - coin du mur de Nagis, car la rivière passoit de plus de trois pieds sur le pavé et prenoit depuis les murs de Nagis jusques au coin du cimetière du costé de la ville, puisque tous les jardins qui sont dans ce faubourg et le cimetière mesme estoient pleins d'eau jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**00000074**| 42 - jaloux de leurs droits, ils avoient résolu qu'ils feroient poser des planches pour pouvoir faire entrer les auditeurs dans le chœur, et que le Prédicateur prescheroit dans un fauteuil proche de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000075**| INAUGURATION DU MUSÉE SAINT-JEAN ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Tenue dans l' | ||
| + | |||
| + | |**00000076**| 44 gnirent ceux de Corbeil, d' | ||
| + | |||
| + | |**00000077**| | ||
| + | |||
| + | Societe HISTORIQUEAT ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL NOREPO1X TAMPES D' | ||
| + | |||
| + | |**00000078**| | ||
| + | |||
| + | |**00000079**| 45 Messieurs, << Notre Société compte à peine quelques années d' | ||
| + | |||
| + | |**00000080**| 46 - Et pour dissiper le nuage de tristesse que viennent d' | ||
| + | |||
| + | |**00000081**| 47 De ces quelques couplets, messieurs, Vous excuserez, j' | ||
| + | |||
| + | |**00000082**| 48 parrain avec Dame Louise Bouret, d'où les noms de Louise Michel donnés à cette cloche. Mais la séance va s' | ||
| + | |||
| + | |**00000083**| 49 époque je vous indiquais 137 sociétaires, | ||
| + | |||
| + | |**00000084**| - - 50 d'une vue du Château de Chilly, d' | ||
| + | |||
| + | |**00000085**| 51 ments inédits, par M. l' | ||
| + | |||
| + | |**00000086**| 52 Ce musée, que nous avons entrepris de fonder et que nous inaugurons aujourd' | ||
| + | |||
| + | |**00000087**| 53 SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 1897 A cette époque les fondations se montaient à Fr. En outre il a été encaissé: 103 cotisations à to fr. 23 cotisations à 5 fr. Excédent de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000088**| 54 une année, conformément aux articles II et XIV du réglement, les pouvoirs du bureau et du Comité de publication. Pour épuiser l' | ||
| + | |||
| + | |**00000089**| LE PRÉHISTORIQUE EN SEINE-ET-OISE (1) Les premiers documents relatifs à l' | ||
| + | |||
| + | |**00000090**| 56 - côté le grand développement de la culture, en faisant disparaître les roches isolées, en nivelant les terrains, a changé la surface du sol et enfoui bien des objets du plus grand intérêt; de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000091**| - - 57 APERÇU GÉOLOGIQUE Les géologues ont classé les couches du globe, suivant leur ancienneté, | ||
| + | |||
| + | |**00000092**| 58 - signaleront des objets ou des monuments qui ont, jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**00000093**| 59 c'est l' | ||
| + | |||
| + | |**00000094**| - - 60 renne trouvés dans les grottes ou les tourbières, | ||
| + | |||
| + | |**00000095**| 61 - polie, des poteries plus ou moins complètes, beaucoup d' | ||
| + | |||
| + | |**00000096**| - - 62 Une pointe de lance avec oreille. Une id. id. Des Torques, anneaux ou bracelets. Une fibule. Les analyses de ces bronzes ont montré que la composition s' | ||
| + | |||
| + | |**00000097**| | ||
| + | |||
| + | |**00000098**| A. L. Cléme LA PIERRE LEVÉE; DOLMEN DE JANVILLE-SUR-JUINE. Gravure offerte par l' | ||
| + | |||
| + | 1 | ||
| + | |||
| + | |**00000099**| - - 63 nombre de personnes, et tout prouve que les ensevelissements étaient successifs. Les dolmens sont donc des chambres funéraires, | ||
| + | |||
| + | |**00000100**| - - 64 P 1 1 : monument. L' | ||
| + | |||
| + | |**00000101**| - - 65 sens de leur plus grande dimension, de manière à former des espèces d' | ||
| + | |||
| + | |**00000102**| 66 4° MENHIRS DISPARUS La grande Borne, près du Mesnil-Recoin. La pierre, près du château de Fascheville. A Bruyères-le-Chatel, | ||
| + | |||
| + | k 380 Menhir d' | ||
| + | |||
| + | |**00000103**| 67de 1 m. 65 et son épaisseur de om. 70. La largeur et l' | ||
| + | |||
| + | |**00000104**| 68 Auprès du hameau, on a découvert une caverne, et les alentours ont fourni de nombreux échantillons de silex taillés, généralement type du Moustier. III. PIERRES BRANLANTES ET TOURNANTES - On rencontre quelquefois un énorme bloc de pierre reposant par un ou deux points sur un rocher: quand le bloc supérieur s' | ||
| + | |||
| + | |**00000105**| 69 La Roche qui tourne présente, en dessus et latéralement, | ||
| + | |||
| + | Aide Mortiffor La Roche-qui-tourne, | ||
| + | |||
| + | |**00000106**| 70 - IV. PIERRES STRIÉES - POLISSOIRS La pierre striée, légendaire à Villeconin, se trouve à gauche de la route allant de St-Sulpice à Villeconin, à environ 200 mètres du chemin, à la lisière du bois. C'est un bloc de grès qui paraît avoir été travaillé; sa surface antérieure verticale est à peu près plane et est couverte d' | ||
| + | |||
| + | |**00000107**| 71 M. A. de Mortillet, auquel j'ai fait examiner cette roche, prétend que ces stries n'ont que des rapports assez éloignés avec les rainures des véritables polissoirs de la période néolithique. Il objecte la difficulté de travailler dans cette cavité. L' | ||
| + | |||
| + | |**00000108**| 72 - obscur et généralement d'un accès difficile, et en Grottes, salles s' | ||
| + | |||
| + | |**00000109**| | ||
| + | |||
| + | |**00000110**| 0,30 Plan Sable Sépulture de l'âge du bronze. Terre Végétale Coupe | ||
| + | |||
| + | |**00000111**| 73 Tout a été à peu près dispersé, sauf quelques pièces recueillies par M. Thomassi, avec lequel j'ai exploré cette grotte. CIMETIÈRE DE L'AGE DU BRONZE Sablières situées dans la vallée allant d' | ||
| + | |||
| + | |**00000112**| 74 - Il a été trouvé une amulette en pierre blanche représentant à peu près un poisson. Les yeux étaient en creux et remplis d'une matière rouge, probablement de la sanguine; il existait un trou de suspension. Il y avait aussi une espèce de boucle, en métal blanc, de forme rectangulaire à angles arrondis. Le métal très fragile n'a pu résister au coup de pioche (1). La levée des squelettes et l' | ||
| + | |||
| + | |**00000113**| LA REINE ISBURGE ET LA COMMANDERIE DE SAINT-JEAN-EN-L' | ||
| + | |||
| + | |**00000114**| 76 jours de leur mariage. Les uns attribuent ce dégoût à un vice de conformation; | ||
| + | |||
| + | |**00000115**| - - 77 jeter l' | ||
| + | |||
| + | |**00000116**| - - 78 Philippe, après avoir résisté longtemps, dut enfin céder; il se rendit aux conseils de quelques-uns de ses barons et intercéda auprès du pape. Celui-ci envoya deux cardinaux qui obtinrent le renvoi d' | ||
| + | |||
| + | |**00000117**| - - 79 << grâce son offre, et au mesme instant elle fut eslevée et reçeue sur le courcier, « et emmenée par le Roy en son hostel, où la réconciliation entière se para- << cheva; de quoy tous les Prélats demeurèrent fort contens de se voir délivrez de << la peine de prononcer un jugement rigoureux contre un Roy si attaché à ses << affections » (1). Philippe eut pour Isburge un peu plus d' | ||
| + | |||
| + | |**00000118**| 80 écoulées depuis 1223 eussent été bien insuffisantes, | ||
| + | |||
| + | |**00000119**| | ||
| + | |||
| + | LA REINE ISBURGE Statue en cuivre qui ornait son tombeau | ||
| + | |||
| + | |**00000120**| | ||
| + | |||
| + | |**00000121**| - - 81 ayant besoin de réparer leur église et d'en refaire l' | ||
| + | |||
| + | |**00000122**| 82 Les profanateurs de la révolution n' | ||
| + | |||
| + | |**00000123**| - - 83 Feray acquit tout le domaine de St-Jean, au nom de son père, M. Louis Feray, gendre d' | ||
| + | |||
| + | |**00000124**| - - 84 confectionner la pâtisserie (1). Cette belle dalle de 2 m. 25 de long sur I m. 1o de large, avait recouvert la tombe de M. de Boisboudran, | ||
| + | |||
| + | |**00000125**| - - 85 portée dans l' | ||
| + | |||
| + | |**00000126**| LE JOURNAL D'UN BOURGEOIS DE CORBEIL (Suite) Le jeudy quinzième de juin 1741, il arriva dans Corbeil une chose des plus surprenantes et des plus affreuses que l'on ait peutestre vües de la vie; c' | ||
| + | |||
| + | |**00000127**| 87 - mettre l' | ||
| + | |||
| + | |**00000128**| 88 - Martin (1), afin que sy il se trouvoit une nécessité d' | ||
| + | |||
| + | |**00000129**| - 89 trop petite pour pouvoir les contenir, ou du moins par manque d' | ||
| + | |||
| + | |**00000130**| 90 - porte, où estant arrivé, on répéta l' | ||
| + | |||
| + | |**00000131**| - - 91 parce qu'il s' | ||
| + | |||
| + | |**00000132**| 92 - présent de la somme de 50 livres pour l' | ||
| + | |||
| + | |**00000133**| 93 Bonaventure Mesnage, huissier à cheval au Chastelet de Paris, celle de saint Anthoine par le sieur Buffin, marchand espicier à Milly, celle de saint Louïs par Severin Cottereau, maître charron au fauxbourg saint Léonard de Corbeil, celle de saint Charles par Charles Formager, marchand espicier à Corbeil et Charles Divry, aussy marchand, celle de sainte Marguerite par Margueritte Mariette veuve de feu sieur Thevenet, vivant commissaire des moulins à poudre d' | ||
| + | |||
| + | |**00000134**| - - 94 son corps, de plus un autre suaire de saint Spire dans lequel il avoit esté apporté de Bayeux à Palleau; puis un autre suaire de saint Leu. Dans chacun de ces suaires, il y avoit un escrit indiquant le saint dont il provenoit avec la date de la translation dernière qui en avoit esté faite; l' | ||
| + | |||
| + | |**00000135**| 95 - (1740) Le proverbe nous dit que les guerres nous amènent des suittes fâcheuses, et qu'un fléau de Dieu n' | ||
| + | |||
| + | |**00000136**| - - 96 Le droit de confirmation estant perçu, on ne fut pas plus en repos, car les collecteurs des tailles, voyant que le receveur de ce nouveau droit avoit amassé tant d' | ||
| + | |||
| + | |**00000137**| - 97 pierrailles et terres estoient apportées par des voitures des laboureurs, commandées par un ordre que M. Guynand envoyoit aux syndics des paroisses. Les syndics estoient dans l' | ||
| + | |||
| + | |**00000138**| - 98 - d' | ||
| + | |||
| + | |**00000139**| - - 99 y faisoit marcher tous les habitans de la ville en trois colonnes ou équipes; la première colonne comprenoit les habitans depuis la porte de Paris jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**00000140**| 100 brouetter des terres qui estoient le long des maisons de la Pescherie pour élever et aplanir le sol afin d' | ||
| + | |||
| + | |**00000141**| 101 quand quelqu' | ||
| + | |||
| + | |**00000142**| 102 manufactures de France, d'une part, et le dit Jaback d' | ||
| + | |||
| + | |**00000143**| 103 - luy semblera, ensemble les machines, ustancilles et matériaux et généralement tout ce qui se trouvera dépendant après les dites trente années expirées, appartiennent au dit Jaback, ses hoirs et ayans cause, pour par eux en faire et disposer comme bon leur semblera; et pour convier les estrangers à s' | ||
| + | |||
| + | |**00000144**| 104 - sentes, sauf en autres choses réservant nostre droit, et celuy de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000145**| 105 La porte Royalle ouverte au lieu du cul de sac qui y estoit appelé le cul de sac de la herse (1). Deux arches refaites à neuf au grand pont du costé du fauxbourg en 1717 (2). La grande arche du pont faite à neuf en l' | ||
| + | |||
| + | |**00000146**| BIBLIOGRAPHIE PERRAULT-DABOT. Monographie de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000147**| - - 107 538. Brunoy (S.-et-O.) Ecu de France entouré des cordons de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000148**| 108 - Le rer fascicule, 8 pages et une grande planche, est consacré à la porte du cloître Saint-Spire, | ||
| + | |||
| + | |**00000149**| 109 notre France, dont les Etats-généraux de 1789 étaient appelés à résumer les aspirations. Des biographies, | ||
| + | |||
| + | |**00000150**| - - 110 Mémoires de la Société d' | ||
| + | |||
| + | |**00000151**| III Extrait du tome XXIVe des mémoires de la Société de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000152**| - 112 Il semblerait, d' | ||
| + | |||
| + | |**00000153**| 113 les collections privées. De ses recherches a surgi une longue suite d' | ||
| + | |||
| + | |**00000154**| 114 - / J. Florange, expert en médailles, 21, quai Malaquais. 1899, in-4°. Ouvrage édité avec luxe, dans lequel sont cités et gravés quatre jetons des arquebusiers de Corbeil. Contrairement à la date ci-dessus (1899), il a paru en 1898. Annuaire du département de Seine-et-Oise pour 1898. Versailles, Cerf, in-12. Rien que des renseignements administratifs et autres, comme dans la plupart des annuaires de ce genre. Les éditeurs nous avaient cependant habitués à des notices historiques, | ||
| + | |||
| + | |**00000155**| 115 Nº 4957 bis. - Les antiquités de la ville et du Duché d' | ||
| + | |||
| + | |**00000156**| 116 L' | ||
| + | |||
| + | |**00000157**| 117 - Le Petit Journal. 3 janvier 1899. Le musée de Corbeil. L' | ||
| + | |||
| + | |**00000158**| 118 - ERRATUM A propos d'un passage du procès-verbal du 3 mai 1898 (1er bulletin de 1898, p. XXII), dans lequel M. J. Barthélemy émettait le vœu que des fouilles fussent entreprises dans le champ attenant à la gendarmerie d' Essonnes..... lire: dans le champ qui se trouve en face de la gendarmerie, | ||
| + | |||
| + | |**00000159**| TABLE DE LA 4º ANNÉE Statuts et réglement de la Société. Liste des membres. Conseil d' | ||
| + | |||
| + | |**00000160**| 120 Reproduction du Menu du 13 juin 1898 44 La Pierre-Levée: | ||
| + | |||
| + | |**00000161**| | ||
| + | |||
| + | |**00000162**| | ||
| + | |||
| + | |**00000163**| BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**00000164**| IMPRIMERIE G. BELLIN, A MONTDIDIER. | ||
| + | |||
| + | |**00000165**| BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL D' | ||
| + | |||
| + | TORBEIL HURE POI ETAMPEST PARIS ALPHONSE PICARD ET FILS, ÉDITEURS LIBRAIRES DES ARCHIVES NATIONALES ET DE LA SOCIÉTÉ DE L' | ||
| + | |||
| + | |**00000166**| | ||
| + | |||
| + | |**00000167**| SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**00000168**| VI Les mineurs ne seront admis dans la Société que sur le consentement soit de leurs parents, soit de leur tuteur. - ART. IV. Le titre de fondateur est acquis: 1º aux signataires des présents statuts, 2º à tout membre qui fait don à la Société d'une somme de cent francs au moins. ART. V. Chaque sociétaire paie une cotisation annuelle de dix francs; cependant cette cotisation est réduite à cinq francs pour les personnes appartenant au clergé et à l' | ||
| + | |||
| + | |**00000169**| VII - ART. XIII. En cas de dissolution de la Société, les membres titulaires, réunis en une Assemblée générale spécialement convoquée à cet effet, seront appelés à statuer sur la liquidation de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000170**| RÉGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**00000171**| IX ART. V. - Le Secrétaire rédacteur rédige les procès-verbaux des séances et est chargé de tout ce qui se rapporte à la correspondance. - ART. VI. Le Trésorier est chargé du recouvrement des cotisations annuelles; il paie les dépenses ordonnancées et donne, chaque année, à la séance générale, un état de la situation financière de la Société. ART. VII. Le Conseil se réunit tous les trois mois; cependant le Président peut le convoquer chaque fois que les intérêts de la Société l' | ||
| + | |||
| + | |**00000172**| X ART. XV. - Les Sociétaires ont droit à toutes les publications de la Société à partir de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000173**| LISTE DES MEMBRES Les noms précédés d'un astérique (*) sont ceux des MEMBRES FONDATEURS qui ont racheté leur cotisation. MM. ALLAIN, Maire de Soisy-sous-Étiolles. ALLIOT, (l' | ||
| + | |||
| + | |**00000174**| XII MM. BLAVET, Président de la Société d' | ||
| + | |||
| + | |**00000175**| XIII MM. *COURCEL (le Baron Alphonse de), membre de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000176**| XIV MM. FLAMMARION (Camille), Directeur de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000177**| XV MM. JOYEUX (André), à Essonnes. Jozon (Maurice), Notaire à Corbeil. LACHASSE (Auguste), Adjoint au Maire de St-Germain-lèsCorbeil. LACOMBE (Paul), Trésorier de la Société de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000178**| XVI MM. MICHELEZ (Léon), propriétaire à Lardy. MONTGERMONT (le Comte G. de), 62, rue Pierre Charron, à Paris, et au château de Montgermont, | ||
| + | |||
| + | |**00000179**| XVII MM. SABATIER, Maire de Viry-Châtillon. SAINT-MARC-GIRARDIN (Henri), au château de Morsang-surSeine, | ||
| + | |||
| + | |**00000180**| XVIII MEMBRES HONORAIRES-CORRESPONDANTS MM. BOURNON (Fernand), Archiviste-Paléographe, | ||
| + | |||
| + | |**00000181**| XIX BUREAU DE LA SOCIÉTÉ Présidents d' | ||
| + | |||
| + | |**00000182**| XX SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES La Société de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000183**| SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**00000184**| XXII dans les terrains d' | ||
| + | |||
| + | |**00000185**| XXIII XIIIe siècle, et il prie ceux des membres de la Société qui posséderaient des documents sur un ou plusieurs de ces lointains personnages de vouloir bien les lui communiquer. La question du musée revient ensuite à l' | ||
| + | |||
| + | |**00000186**| XXIV plications, M. Dufour est chargé de s' | ||
| + | |||
| + | |**00000187**| AYMÉ DARBLAY 1854 † 1899 9* 2 | ||
| + | |||
| + | |**00000188**| | ||
| + | |||
| + | |**00000189**| | ||
| + | |||
| + | C | ||
| + | |||
| + | |**00000190**| | ||
| + | |||
| + | |**00000191**| AYMÉ DARBLAY 1854-1899 Messieurs et chers Collègues (1), La Société historique et archéologique de Corbeil, d' | ||
| + | |||
| + | |**00000192**| XXVIII dailles; il recherchait tout, classait tout et laisse ainsi un véritable trésor pour l' | ||
| + | |||
| + | |**00000193**| XXIX quila couronnait, par un campanile de pierre, surmonté de la haute croix que nous voyons à présent. Désireux de compléter l' | ||
| + | |||
| + | |**00000194**| XXX ouvrage : << Cette œuvre, aussi remarquable par la forme que par le fond, dénote, chez ses auteurs, un esprit de recherche savante et consciencieuse que, seuls, arrivent à posséder, les amateurs passionnés des choses de l'Art et des travaux d' | ||
| + | |||
| + | |**00000195**| XXXI peu partout, et non sans peine, minutieusement réparées, viennent, aujourd' | ||
| + | |||
| + | |**00000196**| XXXI J' | ||
| + | |||
| + | |**00000197**| LES VICOMTES DE CORBEIL ET LES CHEVALIERS D' | ||
| + | |||
| + | |**00000198**| I LES VICOMTES DE CORBEIL AU XI SIÈCLE ROBERT - NANTIER - EUDES (1006-1071) Le premier Vicomte de Corbeil que nous connaissions se nommait Robert; il est cité dans l'acte testamentaire du comte Bouchard I, daté du 1er mai 1006 (1). Cet acte est souscrit par: un chambrier, Josselin; un bouteiller, Gaudri; un connétable, | ||
| + | |||
| + | |**00000199**| 3 - Nantier, fils aîné de Robert, lui succéda. Dans un diplôme de Henri I pour Saint-Maur en 1043, un vicomte Nantier paraît immédiatement après Guillaume, comte de Corbeil et Ives, comte de Beaumont sur Oise (6). Plus tard, nous retrouverons un domaine appelé l' | ||
| + | |||
| + | |**00000200**| 4 parler, et où figure le vicomte Gui, se qualifie Gaudri, fils d' | ||
| + | |||
| + | |**00000201**| 5 remariée à Corbeil. En 1056 en effet, un Ansoud (probablement allié de Guérin) se faisant religieux à l' | ||
| + | |||
| + | |**00000202**| - - 6 L' | ||
| + | |||
| + | |**00000203**| 7 Tirel (14) et qu'il fit, à la fin de sa vie, le pèlerinage de Jérusalem (15). Nous sommes donc amené à l' | ||
| + | |||
| + | |**00000204**| 8 de Viry qu'il voulut s' | ||
| + | |||
| + | |**00000205**| -9 III LES VICOMTES DE CORBEIL DE 1140 A 1237. - GILBERT I. ANSEAU. - GILBERT II. PAYEN. GUI. - - Il est difficile d' | ||
| + | |||
| + | |**00000206**| 10 qui touchait au vivre et au vêtement des religieux (25). Enfin une charte de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000207**| II - de la maison de Paris. C'est là qu'en 811, le comte Etienne, fils de Bégon, rédigea ses dernières volontés. un De 1199 à 1221, le vicomte de Corbeil se nomme Payen. Il amortit, en 1203, à St-Lazare de Paris, une vigne au Pré St-Gervais, donnée par une lépreuse, Hersende de la Poterie; - en février 1213 il confirme le don d'une terre fait par son vassal Pierre Panier (31); en mai 1213, il se constitue pleige pour Guérin d'Igny descendant de Guérin de Paris - au sujet de la vente d'une pièce à l' | ||
| + | |||
| + | |**00000208**| 12 - Gui épousa Isabelle: tous deux, en 1237, firent accord avec St-Denis au sujet de terres au Pré St-Gervais (36). En 1248, Simon de Poissy approuve la donation à St-Denis par son père << de toto feodo quem nobilis domina vice comitissa Corboliensis ab ipso patre meo tenebat in feodum ». C'est toujours au Pré St-Gervais, et cela laisse supposer que la vicomtesse dont il est question doute Laurence, femme de Payen était de la famille de Simon de Poissy le père. On se souvient que ce chevalier épousa en secondes noces Agnès de Garlande, veuve d' | ||
| + | |||
| + | |**00000209**| | ||
| + | |||
| + | A: | ||
| + | |||
| + | |**00000210**| | ||
| + | |||
| + | |**00000211**| - 13 et de petites croix grecques, retient l' | ||
| + | |||
| + | |**00000212**| 14 - IV FERRI DE CHATILLON, FILS DE GAUDRI. - DOUBLE ALLIANCE DES MAISONS D' | ||
| + | |||
| + | |**00000213**| 15 sœurs d' | ||
| + | |||
| + | |**00000214**| - - 16 L' | ||
| + | |||
| + | |**00000215**| 17 Ils furent au nombre de trois : Anseau, Ferri et Geofroi. Ils nous sont connus par divers actes du cartulaire de St-Jean-en-Vallée, | ||
| + | |||
| + | |**00000216**| 18 Le texte du cartulaire de Longpont (Fredericus, | ||
| + | |||
| + | |**00000217**| 19 V LA FAMILLE DE BEAUVAIS, TIGE DE LA MAISON DU DONJON ET DE LA SECONDE MAISON DE CORBEIL. LES BAUDOIN. EUSTACHIE, FILLE DE FERRI DE CHATILLON; SES DEUX MARIS, BAUDOIN IV DE BEAUVAIS ET JEAN I D' | ||
| + | |||
| + | |**00000218**| 20 dericus. Balduinus Nepos. Wido Frederici, généalogie qui doit ainsi s' | ||
| + | |||
| + | |**00000219**| 21 - d'eux, et sans émettre aucune prétention de la rattacher à une chaîne unique, nous appellerons (55) Baudoin I, le prévôt de Bouchardle-Vieux, | ||
| + | |||
| + | |**00000220**| 22 Mesnil Ricuin, du consentement de sa sœur Aveline et de son beau-frère (57). Ferri, fils d' | ||
| + | |||
| + | |**00000221**| - - 23 La garde du donjon de Corbeil avait d' | ||
| + | |||
| + | |**00000222**| 24 - Dame de Corbeil, Aubert, la concession de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000223**| 25 - Amicie était certainement veuve en 1204, car dans un titre où la reine Adèle la qualifie « Amicia de Dongione fidelis nostra », c'est elle qui, comme suzeraine, approuve le don à Notre-Dame de Franchart, dans la forêt de Fontainebleau, | ||
| + | |||
| + | |**00000224**| 26 - En février 1219, Jean Briart, qui se qualifie sire de Breteuil, fit du consentement d' | ||
| + | |||
| + | |**00000225**| - - 27 - neveu, et celui-ci de Pierre du Donjon. Pierre était aussi le suzerain de Baudoin VI de Corbeil pour certaines terres (78). A Corbeil, en 1227, avec sa femme Marguerite, il approuva le legs fait à St-Spire par le chanoine Renaud de Cramayel du quint de son héritage. Il mourut le 1er avril 1232. En juillet suivant, son fils Renaud, archidiacre d' | ||
| + | |||
| + | |**00000226**| 28 - chargé d'un donjon à poivrière accosté de deux fleurs de lis d'or. Ces armes ne furent point reprises par Jean, l' | ||
| + | |||
| + | |**00000227**| 29 - V AVELINF, FILLE D' | ||
| + | |||
| + | |**00000228**| - - 30 janvier à Rosoy-en-Brie; | ||
| + | |||
| + | |**00000229**| 31 temps-là. On eût pu, en l' | ||
| + | |||
| + | |**00000230**| - - 32 VI JEAN II DE CORBEIL ET JEANNE CARCASSONNE DE DURAS, SA FEMME. (1174-1224) Jean II de Corbeil est assurément le personnage le plus connu de toute cette lignée. Il était chevalier (97) et l'un des fidèles de la reine Adèle, dame de Corbeil (98). Maurice de Sully, évêque de Paris, lui décerne des éloges publics en vantant ses hautes vertus et ses excellentes dispositions envers l' | ||
| + | |||
| + | |**00000231**| 33 - Des actes postérieurs nomment avec Jean III, Baudoin VI et Aveline, d' | ||
| + | |||
| + | |**00000232**| 34 - Noisy, en échange duquel, par pure libéralité, | ||
| + | |||
| + | |**00000233**| 35 Le sceau de son fils. Baudoin, également conservé, porte un dragon ailé. L'acte constate l' | ||
| + | |||
| + | |**00000234**| - - 36 tèrent la chaise du prélat à son entrée dans la cathédrale. En tête on cite sire Baudoin de Corbeil et sire Thibaut Le Maigre, désignés par le Roi, pour l' | ||
| + | |||
| + | |**00000235**| 37 - tige d'une famille parisienne qui porta le surnom de Corbeil (116). Baudoin de Corbeil est témoin en 1223-1224, d'une déclaration du bailli de Béthune reconnaissant au roi toute la haute justice de cette terre (117). Baudoin était suzerain de fiefs à Draveil; en cette qualité il approuva la cession de quatre arpents de terre sur la route de Draveil à Vigneux (Vicus novus), faite à St-Victor par Renaud de Monceaux, Aélis sa femme, Thomas (Pasté) son frère, Béatrice de Verneuil (sa sœur) et Simon de Verneuil (son neveu). Cet acte est muni d'un sceau du chevalier Baudoin; le champ est chargé d'un dragon ailé (118). Baudoin avait, pour garder ses chasses du Breuil (ainsi s' | ||
| + | |||
| + | |**00000236**| - 38 reconduire la reine de Chypre, que son cousin Ferri Pasté, maréchal de France, avait eu mission d' | ||
| + | |||
| + | |**00000237**| 39 - cette union qui fut sans doute assez courte, naquit une fille unique, Marguerite de Corbeil, qui fut mariée à Raoul le Bouteiller, seigneur de Luzarches, fils de Gui VI de Senlis (125). En juin 1264, Jeanne de Lorris ayant perdu ses parents, son époux, sa fille et son gendre, fonda pour eux et pour elle-même des anniversaires au prieuré de Doulcamp auquel elle donna la dîme de Luères (126). Outre Jean IV et Milon, nous connaissons à Baudoin VI trois autres enfants: Baudoin VII et Simon II, chevaliers en 1251, et Blanche, qui à cette date était mariée au chevalier Girard des Chastelliers (127). Simon II, fils de Baudoin de Corbeil, était possesseur du fief du four de Corbeil; en 1243 Ferri (Pasté) maréchal de France, sollicita son approbation pour la vente d'une rente sur ce four, qu'il tenait en fief de lui (128). Simon II de Corbeil figure en 1256 dans la distribution de manteaux aux chevaliers du roi, qui se faisait le jour de la Pentecôte (129). Nous ignorons si c'est lui ou son oncle Simon I, dont le tombeau monumental de marbre noir, avec une statue de chevalier couchée sur un socle, fut élevé dans une chapelle voûtée, à St-Spire de Corbeil. Une aquarelle de Gaignières nous a conservé la vue de ce monument (130). Les armes un dragon volant - sont celles que portait Baudoin VI, frère de Simon I, et père de Simon II. Quant à Simon I, il obtint pour lui et Barthélemi de Corbeil l' | ||
| + | |||
| + | |**00000238**| - - 40 de Corbeil, évêque de Paris en 1250, mort en juillet 1268. Ce qui est certain, c'est qu' | ||
| + | |||
| + | |**00000239**| PIÈCES JUSTIFICATIVES I Quomodo Rotbertus vicecomes postea monachus, dedit cenobio Fossatensi quod est supra Novigentum. (1018) Quicquid ecclesiis Dei largitur, id ratum atque imperpetuum debet esse firmissimum. Cupiditas enim quorumdam pravorum semper sui calliditate nititur exterminare, | ||
| + | |||
| + | |**00000240**| 42 Ut autem hec carta in Dei nomine eternaliter firmitatem optineat, manu propria subter eam firmavi, manibusque Franconis (1) pontificis et filiorum meorum necnon amicorum atque fidelium corroborandum tradidi. Signum Rotberti vicecomitis et filiorum ejus Nantherii atque Joscelini qui hanc epistolam donationis fieri et firmare rogaverurt. Signum Franconis episcopi Parisii, et Drogonis, Udonis, Aganonis, Hildegarii, Roberti, item Rotberti, Vuarmundi, Rainaldi, Vualterii, item Vualterii, Frederici, Joscelini, Benardi, Ingelberti, Robelini, Godefredi, Morardi. Data IIII idus maii, anno XXIIII (2) indictione prima, regnante Rotberto gloriosissimo rege. Actum Fossatensi monasterio in Dei nomine feliciter. Amen. Laurentius scripsit ac subscripsit. (A. N. LL 49, fol. 83. Cartulaire en papier, de la fin du XVe siècle, provenant de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000241**| - - 43 firmasque in perpetuum fore volui, regique ac obtimatibus ejus corroborandas tradidi. S. Henrici Francorum regis. S. Mainardi Senonensis archiepiscopi. S. Imberti Parisiorum episcopi. S. Frollandi Silvanectensis episcopi. S. Guillelmi Corboilensis comitis. S. Ivonis comitis. S. Rodulfi comitis. S. Nanterii vicecomitis Corboilensis. S. Begonis militis. S. Balduini militis. S. Galteri de Vova. S. Tebaldi Genardi. S. Vualterii Blanchart fratris ejus. S. Fulberti. S. Huberti. Actum Parisius civitate anno Incarnati Verbi millo XLIII, indictione XI, sub die VIII kal. junii, anno Henrici regis XII. Balduinus cancellarius ejus relegit et subscripsit. (A. N. LL 49, fol. 121). III CARTULAIRE DE SAINT-VRAIN (Extrait du cartulaire en papier de Saint-Maur rédigé vers la fin du XVe siècle. A. N. LL 49, fol. 123-128). I. Quomodo Odo de Bracello contulit ecclesie Fossatensi cellulam Sti Verani in silva que dicitur Bracellus. (Entre 1031 et 1043) Qui eterne vite hereditatem cum Christo et Sanctis ejus in suturo seculo dessiderat possidere, oportet illum agere unde hoc mereatur optinere. Qua propter ego Odo militari honore fruitus, scelerum meorum immanitate perterritus, | ||
| + | |||
| + | |**00000242**| 44 - tam que est in silva que dicitur Bracellus, ubi nunc invente sunt reliquie sanctorum predictorum martyrum Sergi et Bachi, ut ibidem Deo et sanctis ejus a jamdictis monachis usque ad finem serviatur seculi, et pro me et uxore mea Eva nomine, filiis quoque meis Malgerio, Tebaldo, Buchardo, Rainardo, et filia vocata Rencia, et pro omni populo Christiano, misericordiam Dei jugiter exorare dignentur. Concedimus autem eis terram et silvam ad ecclesiam edificandam et atrium consecrandum, | ||
| + | |||
| + | |**00000243**| - - 45 et filii mei super sanctorum juravimus reliquias nichil nos repetituros neque ablaturos nec accepturos ex his omnibus, neque ex his que ab aliis data fuerint, nec quecumque monachorum inibi consistentium potestati subjecta fuerint, nec nos nec aliquem heredum nostrorum. Hec autem omnia egi assensu et voluntate domni nostri Heinrici Francorum regis et domni nostri Imberti Parisiorum presulis (1), et senioris nostri Milonis et filiorum ejus Guidonis atque Hugonis (2), et omnium comitum et primatum et militum regni Francorum. Igitur quicumque hanc nostre donationis parvitatem, quod nunquam fieri spero, calumniare vel recidere aut abstrahere ac minuere aliquo modo a potestate seu dominatione sanctorum et servorum Dei monachorum presumpserit, | ||
| + | |||
| + | |**00000244**| 46 - inique sanctis Dei abstulit et multa mala ut potuit fecit; unde non dubium quod non solum particeps sed etiam dominus prescripte maledictionis et excommunicationis existat, suique cuncti sequaces et heredes qui omnia ab eo invasa possident et conlaudatores fiunt, per omnia secula seculorum. Amen. II. Quoniam Malgerius Bracelli dedit ecclesie Fossatensi sanctoque Verano manum firmam Odonis Calot et alia quedam. Quicquid ecclesiis Dei et sacerdotibus ac ministris Christi in hoc presenti conceditur seculo, hoc ad salutem largientium animarum prodesse creditur in futuro. Ego, Malgerius dictus, patris mei Odonis vestigia sequi cupiens et devotionem, ac bonam voluntatem quam erga locum Fossatensem et sanctos ipsius loci patronos habuit, imitari desiderans, confero Deo et sancte Marie, apostolisque Petro et Paulo, sanctisque martiribus Sergio et Bacho, beatisque confessoribus Mauro atque Verano, de rebus patris ab eo michi relictis in mea morte que michi jam proxima esse videtur, ut misericordia Dei sanctorumque predictorum et omnium simul in hora resolutionis anime a corpore invenire valeam, manum firmam quam Odo Calot in vita sua habuit in parochia que dicitur Scortiacus, cum duobus aripennis pratorum et omnibus consuetudinibus, | ||
| + | |||
| + | |**00000245**| - 47 sancte Dei genitrixis Marie et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli consecrato (sic), in quo sanctus pater Maurus corpore quiescit, uli jugum Christi suave et onus ejus leve suscipere desidero, in quo domnus Robertus abbas presse videtur, dono de rebus mee proprietatis sepulturam et baptisterium atque decimam de loco et de atrio et de omni terra que ad Sanctum Veranum pertinere videtur; sed quoniam exigente (1), altare de Scortiaco ad quod predicte res aspicere videntur, seniori meo Buchardo in vuadimonium commisi in Purificatione Sancte Marie, quo die terminus redimendi est, datis vinginti solidis eidem Buchardo aut ejus heredi, ab illa die et deinceps usque ad finem seculi, absque alicujus mortalis calumnia vel inquietudine, | ||
| + | |||
| + | |**00000246**| - 48 dientes: Abbas Robertus, Odo mo, Aszo mo, Ingelbodus mº (1). Laici et servientes isti: Drogo viator. Drogo Crassus. Lecelinus. Airicus. Gualterius. Baldrannus. Arnulfus. Durandus. Berengerius. Josfredus de Klaci. Gauterius Bolzet, Lisiardus frater ejus. Gualterius Cochelin. Fulcherius. Andreas. Ungerius. Rogerius, Henricus frater ejus, alius Heinricus, Barnerius et alii quamplures, quorum: nomina scribere fastidium est. Actum in atrio Sanctorum Sergi et Bachi et Sti Verani, anno Incarnati Verbi millesimo LVI, indictione VIIII, anno regni Henrici regis Francorum XXVI. Odo cancellarius scripsit et subscripsit. Hoc donum quod Ansculfus Deo et Sanctis ejus obtulit, nefandus Herlannus abstulit, ut dampnationem, | ||
| + | |||
| + | |**00000247**| 49 sue a corpore, inveniat sibi contrarios et inimicos; et cum Diabolo et angelis ejus pereat in eternum, nisi cito resipuerit et ad satisfactionem et emendationem in presentia monachorum Fossatensium venerit. Ut autem omnes agnoscant, presentes scilicet et absentes atque futuri, me libenti animo hoc fecisse, super sanctorum juravi reliquias nichil exinde me possessurum neque accepturum, et adversus illum qui contrarius eis extiterit, corpore et animo, et armis et viribus decertando debellaturum. Et ut hoc donum firmum et stabile semper permaneat, manu propria hoc scriptum firmavi, et uxori mee et matri, cunctisque meis fidelibus, corroborandum tradidi, ut quamdiu vixerint, Deo et sanctis ejus et jamdictis cenobitis testes fideliter existant. S. Buchardi. + S. Judith uxoris ejus. S. Anselli filii ejus. S. Joscelini. S. Lisiardi Bardulfi. S. Rainardi. S. Drogonis viatoris. S. Walterii Baldranni. S. Ascelini. S. Rainardi. S. Milonis. S. Geroloni. S. Drogonis Crassi. S. Widonis filii ejus (1). Actum cenobio Fossatensi anno Incarnati Verbi millo LVII, indictione (chiffre omis), anno Henrici regis XXVII. Odo cancellarius scripsit et subscripsit uomodo (ac modo?) Nantherius Corboilensis (2). IV Donation de Hugues de Voves. (1096-1097) Utile indicavimus in hac cartula scribere, et sic fidelium p. et f. noticie tradere quod Hugo filius Frederici dedit æcclesiæ Sci Martini de Campis quæ sita est extra muros Parisiacæ urbis ac Cluniacensibus monachis Deo in ea servientibus villam que Vozua dicitur, scilicet omnem terram, nemus, vineas, aquæ quoque partem ad eandem villam pertinentem : omnia dedit æcclesiæ Sci Martini prædictus Hugo quæ etiam a prædictis monachis possidentur, | ||
| + | |||
| + | |**00000248**| 50 - Hubertum fratrem ejusdem Alberici. Arpennum etiam vinee dedit qui in terra Buxiole consistit. Habebat autem domnus Hugo duos nepotes filios Siguint fratris sui, quorum unus qui major natu erat Fredericus vocabatur et Paganus Rufus cognominabatur; | ||
| + | |||
| + | |**00000249**| - - 51 Levinus famulus Sci Arnulfi. Hoc factum est anno Incarnati Verbi Mo XCO VIIo indictione va, vivente atque regnante Philippo rege et Willelmo Parisiaco episcopo, tempore domni Hugonis abbatis Cluniacensis et Ursionis prioris æcclesiæ Sci Martini de Campis. Benedictus Deus qui fecit mirabilia in celo et in terra. (B. N. Ms. lat. 10977, fol. 8). V Donations de Gautier Tirel et de Geofroi d' | ||
| + | |||
| + | |**00000250**| 52 ibidem degentibus, ecclesiam videlicet Sci Dyonisii de Bunduflo, et atrium, et sepulturam, et totam decimam, scilicet et de Fluriaco et de omnibus locis sicut pertinet ad ecclesiam ipsam Bundufli, excepto fisco suorum militum... Quod supradictus Isembardus ex sua parte donat, domnus Fredericus ex cujus patrimonio movetur concessit. Hec igitur dona que isti duo faciunt, concedunt parentes isti: Aremburgis mater ejusdem Frederici, et fratres ejusdem Frederici, videlicet isti: Gaufredus et Bego similiter et Gauterius Tyrellus et Machildis soror eorum similiter. Hoc igitur beneficium factum est in Corboylo castro, cujus testes subscribuntur isti: Fredericus filius Gaudrici, et Isembardus cognomento Paganus filius Anselli de Stampis, qui hoc donum faciunt. Gaufredus frater ejusdem Frederici. Gauterius Tyrellus frater similiter Frederici. Bego clericus similiter frater ejus. Arenburgis mater eorum. Machildis filia soror eorum. Arraudus de Milleio. Gauterius Trosardus. Hugo de Sesiaco. Ricardus filius Herberto Pinelli. Vivianus filius Richerii de Tigeriaco. Teunfus de Litiis. Hugo Brito. Hugo de Monte Oberti. Isti omnes quos prescripsimus sunt milites. Post hec, die ipsa qua factum est donum istud, venit isdem Fredericus ad Longumpontem et posuit donum beneficii super altare Sce Marie cum duobus phylacteriis ejusdem ecclesie. Quod viderunt testes isti : Symon miles de Marciliaco et Arnulfus miles frater ejus. Burchardus miles de Arione. Girardus filius Girardi de Stampis; Raginaldus de Bunduflo serviens ejus, et Johannes frater ejus. Rivoldus vicecomes. Aymo miles Angevinus. Balduinus miles filius Rainardi. Item Aaliz soror ejusdem Frederici uxor supradicti Isembardi, hoc donum de Bunduflo in manu Henrici prioris cum quodam parvulo ligno dedit et... concessit... Testes... Benedictus presbiter. Raginaldus dispensator ejus. Hugo de Ingenvilla. Hugo de Valentum. Godefredus de Corberosa. Sit et hoc preterea non est omittendum... quod Odo comes Corboilensis ex cujus fisco est prescripti beneficii donum, Deo et Sce Marie cum quodam frusto berilli concessit, atque illud prior Henricus ex ejus manu accepit... Testes... Fredericus filius Gaudrici et Isembardus de Stampis qui Paganus dicitur qui hoc donum fecerunt. Guido Lisiardus. Galterius Lisiardus. Yvo de Merlo filius Gisleberti. Odo miles jamdicti Yvonis. | ||
| + | |||
| + | |**00000251**| 53 - Hugo de Valentun. Arraudus de Milliaco. Galterius Trosardus. Vivianus de Tigeriaco, Hainardus filius Aldonis, et alii multi tam milites quam clientes. (Ibid. nº 180. Suit la donation de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000252**| 54 - S. Mathei camerarii. Constabulario nullo. Data per manum Hugonis cancellarii (scellé en cire rouge). (B. N. Mss. lat. 5469, fol. 47 (copie de Gaignières). cription fautive se trouve aux Arch. Nat. K 192, nº 130). Une transIX Vicecomes Gillebertus remittit omnes consuetudines Corbolii transeuntium. (Entre le 20 avril 1158 et le 11 avril 1159). In nomine... Ego Ludovicus Dei gratia Francorum rex. Quecumque religiosis domibus conferuntur a fidelibus, decet nos conservare et testificari, | ||
| + | |||
| + | |**00000253**| - - 55 XI Affranchissement par le vicomte Anseau. (1149) Notum sit o. t. f. q. p. quatinus donnus Ansellus vicecomes, et uxor Breta necnon Radulfus frater ipsius vicecomitis et Aales soror uxoris vicecomitis, | ||
| + | |||
| + | |**00000254**| 56 - S. Mathei camerarii. S. Radulfi constabularii. Data per manum Hugonis cancellarii (Mon. royal). Et scellées sur double queue du grand sceau de cire jaune. (Luchaire, Actes de Louis VII. - Copie coll. Arch. Nat. K 192, nº 133. B. N. Mss. lat. 5469, fol. 88). XIII Le vicomte Payen approuve un don de son oncle Henri. (1199) Noverint omnes tam futuri quam presentes quod pie memorie Henricus Ripeniaus dedit hospitali Corboilensis (sic) pro remedio anime sue decem arpennos terre in territorio Serviniaci in perpetuam possessionem. Quod donum Gaufridus Espaulart ad cujus hereditatem terra spectabat supradicta, omni remota calumnia voluit et concessit. Hoc idem concesserunt fratres dicti Galfridi, Ansellus scilicet de Tigeri et Adam milites. Hujus vero muneris et concessionis testes sunt: Petrus et Johannes capellani, fratres hospitalis, et Manesseir, et Adam li Pevres, et Hugo de Bez milites, fratres hospitalis, et frater Reginaldus, et Johannes de Corbolio, et Petrus de Donjunno, et Guillelmus de Guillervile. Quod ut ratum habeatur nec aliqua possit deleri vetustate, ego Paganus vicecomes Corboilensis nepos dicti Henrici, prior natu inter fratres, in confirmatione hujus muneris et concessionis sigillo proprio presentem paginam confirmavi. Actum anno incarnationis Dni Mo Co XCO IXO. (A. N. S 5145 в, по 66). XIV Donation du vicomte Payen à St Lazare de Paris. (1203) Notum sit... quod ego Paganus vicecomes Corboilensis concessimus in eleemosinam ecclesie Sti Lazari Parisiensis illud quod habebamus de jure in vinea de Bernardo que sita est in Prato Sti Gervasii, salvo tamen censu et decima, in perpetuo possidendam quam Hersendis de Figularia leprosa eidem domui donaverat; et hoc voluit Guido filius noster et laudavit. Pro hac concessione habuimus xxx sol. de beneficio dicte domus... Anno ab Incarnatione Dni M° CCO III°. (Α. Ν. MM 210, fol. XLVI). XV Payen et Gui approuvent la vente de la dime de Soignolles. (1221) Ego Paganus vicecomes Corboliensis n. f. o. p. 1. i. quod ego et Guido, filius meus primogenitus, | ||
| + | |||
| + | |**00000255**| 57 - decime de Coignoles (1) granchiam et totum porprisium cum muro; que decima est de feodo nostro. Quam decimam Theobaldus Buignele et Petrus, filius ejus, miles, vendiderunt capitulo Parisiensi... (2). Actum anno Domini M. CC. XXº, mense marcio. (Guérard, Chartularium ecclesiæ Parisiensis, | ||
| + | |||
| + | |**00000256**| 58 - conjunx Burchardi de Maceiaco, cui hec decima competebat jure hereditario, | ||
| + | |||
| + | |**00000257**| - 59 fidem interposuit, | ||
| + | |||
| + | |**00000258**| - - 60 Fredericus vero, frater Johannis, super hoc donum calumpniam imposuit: hec autem calumpnia ante presentiam nostram ventilata est, quam, pro Dei et nostri amore, penitus dimisit, et fide sua interposita se contra omnem calumpniam defensorem promisit, et consilio nostro a canonicis ecclesie x lib. habuit. Hoc idem donum Baldoinus de Corboilo qui filiam Johannis receperat, concessit. Quod ne valeat oblivione deleri, scripto commendari precepimus, et ne possit a posteris infringi, sigilli nostri auctoritate et nominis nostri karactere subterfirmavimus. Actum Parisius publice anno Incarnati Verbi Mo Co XXX JIo, regni nostri XXIIIIO, Ludovico in rege sublimato anno IIo. Astantibus in palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt et signa. S. Radulphi dapiferi. S. Guillermi buticularii. S. Hugonis camerarii. S. Hugonis constabularii. (Monogramme royal). Data per manum Stephani cancellarii. (Arch. d' | ||
| + | |||
| + | |**00000259**| - 61 censu hospitum quos habebat apud Bunduflum, et quicquid inde amplius cresceret, et boscum mortuum in silva sua, ad quicquid necesse fuerit monachis habitantibus in jamdicto loco. Et de hoc misit donum super altare Sce Marie predicta Eustachia cum filio suo Frederico nomine, quem habuerat ex anteriori marito suo, Balduino scilicet de Belvaco; qui Fridericus hoc libenter concessit... Testes... Galterius Tirellus. Ansellus nepos ejus. Guillelmus miles de Hierra. XXII (B. N. Mss. lat. 9968, nº 183). Donation de Ferri d' | ||
| + | |||
| + | |**00000260**| 62 - siarum pertinere dinoscuntur, | ||
| + | |||
| + | |**00000261**| 63 - Actum anno ab Incarnatione Dni millo ducentesimo primo, mense marcio. (A. N. S 2249 nº 64. Sceau équestre, le bouclier sans armoiries: rond, de 60 mill. en cire brune. ... GILLVM BALDVINI DE DUNIV... Contre-sceau: | ||
| + | |||
| + | |**00000262**| - - 64 ... XXVIII Lettres de Thibaut, évêque de Paris, au sujet de la dime de Combs. Ego T. Dei gratia Parisiensis ecclesie episcopus n. f. volo tam posteris quam pr. quod Adam miles de Chailli decimam ville que Cons appellatur, duas scil. partes totius decime ipsius ville majoris et minoris preter vini, sicut laicus de nostro feodo possidebat. Quas ambas partes, quicquid vid. sui juris esse videbatur, ecclesie B. Victoris cujus juris parrochialis ecclesia ejusdem ville et reliqua tercia pars totius decime esse dinoscitur, in presentia nostra et per manum nostram pro XL lib. par. monete invadiavit. Quod et fide sua firmavit garentare (sic) prefate ecclesie erga omnes homines; assensu filiorum suorum Alberti scilicet militis, qui sicut pater suus fide firmavit, et Theobaldi clerici qui, ut clericus, laudavit et concessit. Determinatum quoque ibidem fuit quod eam nullo modo nisi de suo proprio redimeret; et si eam ex toto aliquo tempore dimittere voluerit, c. sol. minus ab ecclesia S. Victoris quam ab alio, pro ipsa accipiet. Affuerunt tunc in presentia nostra testes : Germundus et Bernardus archidiaconi nostri. Hugo de Campoflorido. Durannus sacerdos. Et laici: Gilo de Tornela. Bertolomeus de Paris. Odo de Monte Sti Petri. Rainaldus de Sto Mederico. Bestisi, et Laurentius, et Radulfus, servientes nostri. Promisit etiam quod uxorem suam hoc ipsum concedere faceret. Quod et fecit Corboili in presentia magistri Bernardi, archidiaconi nostri (1) ac subscriptorum testium: Balduini de Corboilo. Hugonis Malapunctura. Milonis de Orgeniaco. Galteri de Viri. Evrardi de Paris. Copini. Simonis de Manassi. Gaufridi majoris de Ulmeio. Hugonis filii Hildebert. Galberti Dandernas. Evrardi. Bedevini. Quod ne valeat si posterum oblivione deleri, scripto commendavimus ac sigilli nostri impressione eidem ecclesie firmando roboravimus. (Beau sceau de Thibaut, en cire jaune, A. N. L 899). Un second texte de la même pièce comprend en outre l' | ||
| + | |||
| + | |**00000263**| 65judices nostros et fratres B. Victoris appellavit, sed ab appellatione sua sicut a jure ex toto defecit. Hoc igitur in posterum firmum et ratum permaneat, etc. (Sceau de Thibaut. A. N. L 899). XXIX Lettres du même prélat au sujet d'un don d' | ||
| + | |||
| + | |**00000264**| 66 conversus. Hunoldus infirmus. Henricus. Gaufredus. Theoldus. Robertus. Actum est hoc anno Incarn. Verbi M. C. LXX. IIII. (A. N. LL 1599 в, fol 99). XXXI Lettres de Jean de Corbeil pour le moulin d' | ||
| + | |||
| + | |**00000265**| - - 67 et mariti sui Guidonis de Caprosia, Renaldo de Corboilo fratre meo laudante, etc. Actum an. 1196. In aliis litteris Adelæ reginæ, Johannes et Balduinus filii dicti Joh. de C. 1196. Lre alie Droconis archidiaconi Parisiensis et Thecelini magistri Ludovici regis junioris (VIII). Johannes junior de Corboilo, Baldouinus et Hugo fratres ejus confirmant. Testes Baldouinus de Grigni, Willelmus de Aquila. (Coll. Baluze, t. LV, fol. 282.) XXXIV Cession des bois de Noisy. (1200) In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Noverint universi quod ego Johannes de Corbolio et Johanna Carcasona cognomine, uxor mea, concessimus ecclesie Bti Germani Antissiodorensis Parisius, nemora de Noisiaco, videl. brocas in quibus jus venationis habebamus, libere et quiete possidenda et absque aliqua conditione in perpetuum, vel ad terram arabilem, vel ad quodlibet alium usum predicte ecclesie canonici voluerint extirpanda, propter remedium animarum nostrarum et antecessorum nostrorum. Verumptamen jamdicta ecclesia, de mera liberalitate sua, nobis sex libras concessit. Et hoc firmum est de voluntate et assensu filiorum et filiarum nostrarum, videlicet Johannis, Baldoini, Hugonis, Symonis, Milonis, Marie. Quod ut ratum et firmum perseveret, auctoritate sigilli nostri fecimus roborari. Actum anno ab Incarnatione Dni M° CC°. - (A. N. Cart. de St Germain l' | ||
| + | |||
| + | |**00000266**| - 68 XXXVI Fondation d'une chapellenie à Yerres. (1208) Petrus miseratione divina Par. episc... Dnus Johannes de Corbolio ex voluntate Carcasone sponse sue, et Dni Baldevini et Milonis filiorum suorum et Aveline et Helisant filiarum suarum, ad sustentacionem capelle Sti Nicholai in curia sanctimonialium de Edera, redditum decem librarum par. dedit... et pressorium quod habebat apud Seintri cum toto pressuragio ad ipsum pertinente, videl. in censu de Pucei in die Sti Remigii LX solidos, ex quibus constituit xx s. ad luminare capelle, et in censu de Chancoille LX sol. et in censu de Dravel LX sol. et in censu Sti Ferreoli xx sol., ita tamen quod unaquaque quatuor filiarum suarum que sunt in eadem abbatia, et Emelina filia Dni Balduini de Luny singulis annis vite earum xx sol. de predicto censu habebit, et post decessum earum pecunia abbacie remanebit. In anniversario autem suo de ipso redditu constituit singulis annis XL solidos conventui dari. Abbatissa vero et conventus caritatis intuitu, ad hostias sacras et ad eucharistiam consecrandam, | ||
| + | |||
| + | |**00000267**| - - 69 Parisiensis, | ||
| + | |||
| + | |**00000268**| - - 70 XLI Fondation de Jeanne de Lorris (1265) Ego Johanna domina de Loriaco... de assensu... Margarete filie mee tempore quo vivebat... decimam de Lueriis pertinentem ad prioratum de Dulcicampo, que erat de feodo nostro, amortizamus et liberavimus ab omni jugo et servitio feodali... ita tamen quod... singulis annis quamdiu vixero, in octabas Assumptionis B. Marie pro me unam missam de Beata Virgine Maria celebrare tenebuntur, et post obitum meum... anniversarium meum... in perpetuum... necnon ex nunc quatuor alia anniversaria cunctis diebus... scilicet Dni Johannis de Corbolio sponsi mei in crastino B. Bartholomei Apostoli... defuncti Ade quondam dni de Loriaco patris mei in crastino festivitatis B. Dionysii... defuncte Dne Agnetis matris mee... in crastino Assumptionis... dicte Margarete quondam filie mee et defuncti Dni Radulfi Le Bouteiller quondam mariti predicte Margarete in crastino octabarum festivitatis B. Martini hiemalis. Datum Anno Dni 1265, in crastino Nativitatis Dni Johannis Baptiste. (Extrait du Cart. de St Euverte d' | ||
| + | |||
| + | |**00000269**| 71 III в. Officialis Parisiensis. Quod Hugo de Auxona miles, in cujus censiva sita est prefata vinea, omne jus et dominium, censum et omnia que in dicta vinea habere poterat, remisit penitus et quittavit. Anno quo supra. III c. R. de Cramouello canonici Sti Exuperii, de cujus feodo tenebat Hugo de Auxona miles. Qui quittavit feodum et omnia que reclamare poterat in dicta vinea quoquomodo. Eodem anno. IIII A. Carcassone de Corbolio et B. filii sui. Quod Simon de Perreto et Genovefa ejus uxor vendiderunt ecclesie Karoliloci quandam peciam vinee (en blanc) continentem sitam in Clauso Gilardi, inter vineam que fuit Dni Guillelmi Pasté et vineam que fuit Guidonis Crassin. Qui venditionem concesserunt, | ||
| + | |||
| + | |**00000270**| DOCUMENTS POUR SERVIR A L' | ||
| + | |||
| + | |**00000271**| 73 - roi au mois de septembre 1467, qui prouvent qu'en présence d'une armée composée de plus de dix mille combattants, | ||
| + | |||
| + | |**00000272**| 74 - II LE RAVITAILLEMENT DE L' | ||
| + | |||
| + | |**00000273**| 75 - tissait alors au Haut-Pavé devant l'Ecce homo, mais laissant libre toute la partie située du côté de la rivière, état de choses qui permettait aux assiégés de se ravitailler en fourrages. Si l' | ||
| + | |||
| + | |**00000274**| - - 76 que nous trouverons en estat de fournir ne manqueront point dordres. M. Le Tellier mescrit quil envoye trois charpentiers et que six autres les suivront bientost, jauray soing de les faire conserver (1). J' | ||
| + | |||
| + | |**00000275**| 77 lerie sont à Dourdan où ils ont achepté de quoy faire 20.000 rations; ils ne trouvent pas de quoy employer le reste de leur argent ny des moulins pour avoir des farines, ce qui les embarrasse. Il est venu aujourdhuy du camp 15.000 rations et autant en arriveront demain de Chartres, avec quoy nous avons quelque avance, et suivant la disposition des affaires nous continuerons' | ||
| + | |||
| + | |**00000276**| - - 78 Vostre Eminence a décidé une question en faveur de lartillerie contre les intendants de larmée par lordre quelle me donne de ne prendre plus cognoissance des travaux, je la supplie auparavant que dexiger l' | ||
| + | |||
| + | |**00000277**| UNE FÊTE A ATHIS EN 1798 PROCEST VERBALE de la Fête de la Souveraineté du peuple qui a été célébrée dans la commune Dathis sur Orge contformément a larrêté du Directoire Exécutif du vingt-huit pluviose et de larticle huit de larrêté de ladministration municipal du canton en datte du dix-huit ventose an six de la République française une et indivisible (1). Aujourdhuit trente ventose an Six de la République (2) à onze heures du matin le peuple s' | ||
| + | |||
| + | |**00000278**| 80 himne et chant patriotique au son de la musique ce qui faisoit une melodie extraime. Etant arivé a lautelle de la patrie les jeune gens qui portest les banniere les on planté de chaque côté. Les vieilliards on formé le demi cercle de lautelle dela patrie et après eux les fonctionnaire publique et linstituteur avec ces éllève, et la gard nationale occupeoit lextérieur. Apres avoir réuni leurs baguettes, un des vielliards prenan la parole adit: La souveraineté du peuple est inaliénable; | ||
| + | |||
| + | |**00000279**| SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**00000280**| 82 - M. Dufour annonce la mort de M. Th. Vacquer, ancien sous-conservateur du Musée Carnavalet et membre de la Société de CorbeilEtampes. Les regrets unanimes du Conseil accueillent cettre triste communication. Le Conseil prononce ensuite les admissions suivantes : M. Joyeux (André) à Essonnes, présenté par MM. Lasnier et Dufour. M. Thirrouin père, maire de Lisses, présenté par MM. Boucher et Dufour. M. Verdage (Emile), à Corbeil, présenté par MM. J. Leroy et Dufour. M. Hudelot, juge de paix du canton de Corbeil, présenté par MM. Cothereau et Dufour. M. Gaudin, négociant à Corbeil, présenté par MM. Lasnier et Dufour. M. Barthélemy (Louis), rue d' | ||
| + | |||
| + | |**00000281**| - 83le premier bulletin de 1899 qui doit paraître très prochainement et qui contiendra une étude fort remarquable de M. Joseph Depoin sur les Vicomtes de Corbeil et les Chevaliers d' | ||
| + | |||
| + | |**00000282**| 84 - MUSÉE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**00000283**| 85 - M. le Trésorier donne ensuite un aperçu très satisfaisant de la situation financière de la Société. Le Conseil remercie M. Lasnier de son intéressante communication, | ||
| + | |||
| + | |**00000284**| RIVALITÉ ENTRE MONTLHÉRY ET ARPAJON LORS DE LA CRÉATION DU CHEF-LIEU DE CANTON APRÈS 1789 AVEC LA LISTE DES JUGES DE PAIX DU CANTON D' | ||
| + | |||
| + | |**00000285**| - - 87 lieu d'un ancien comté, d'une ancienne châtellenie, | ||
| + | |||
| + | |**00000286**| 88 Le canton d' | ||
| + | |||
| + | |**00000287**| - 89cause de ses relations avec les autres communes du même arrondissement, | ||
| + | |||
| + | |**00000288**| - - 90 C'est l' | ||
| + | |||
| + | |**00000289**| 91 Bretigny-sur-Orge, | ||
| + | |||
| + | |**00000290**| 92 Avant l' | ||
| + | |||
| + | |**00000291**| - 93 Veuf en premières noces de Marie Deloche, il avait épousé MariePierre Chesneau, qui lui survécut dans un état peu fortuné. On trouve dans l' | ||
| + | |||
| + | |**00000292**| 94 Dès 1809, l' | ||
| + | |||
| + | |**00000293**| - 95 de Rambouillet, | ||
| + | |||
| + | |**00000294**| - 96 <<< | ||
| + | |||
| + | |**00000295**| 97 plaidant à Joigny (Yonne), il fut, le 15 février 1881, promu juge au tribunal civil de Tonnerre, et en 1884 à celui de Pontoise (Seineet-Oise). Par décret présidentiel du 21 avril 1891, il a été nommé Président du tribunal civil de Coulommiers (Seine-et-Marne). Atteint par la limite d'âge comme membre d'un tribunal civil, ce magistrat a été nommé juge de paix du canton de Marly-le-Roi, | ||
| + | |||
| + | |**00000296**| PIÈCES JUSTIFICATIVES ANNEXE N° r Exposé succinct des motifs sur lesquels la ville de Montlhéry et le bourg de Linois demandent à l' | ||
| + | |||
| + | |**00000297**| 99 du nombre de neuf, qu'ils ne peuvent excéder, et que déjà les géographes ont présenté un plan qui, s'il était adopté, ruinerait leurs espérances. Qu'il leur soit permis de faire quelques réflexions sur ce projet. Il en résulterait que tous les districts, autres que celui de Versailles, seraient établis aux extrémités du département, | ||
| + | |||
| + | |**00000298**| 100 comporte au moins huit mille habitants, avec Bailli, Lieutenant, Procureur-Fiscal, | ||
| + | |||
| + | |**00000299**| - ΙΟΙ - d' | ||
| + | |||
| + | |**00000300**| 102 - nal de judicature, tandis que Montlhéry, sa démarcation prit-elle d' | ||
| + | |||
| + | |**00000301**| ÉTAT des Paroisses qui forment l' | ||
| + | |||
| + | |**00000302**| 104 - NOMBRE DES PAROISSES NOMS DES PAROISSES 25 Lardy. 26 Bouray. 27 Itteville. 28 Torfou. 29 Boissy-sous-St-Yon. 30 Saint-Yon. OFFICIERS DES JUSTICES Justice exercée de tous les temps par les officiers d' | ||
| + | |||
| + | |**00000303**| NOTES SUR GRIGNY AUX XVIe et XVIIE SIÈCLES. LES MERCIER, SEIGNEURS DES BORDES ; LE CULTE RÉFORMÉ EN 1599 (*). Lorsque Henri IV, en 1598, accorda l' | ||
| + | |||
| + | |**00000304**| 106 - therine de Bourbon. Le jour de Noël 1598 il y eut, probablement dans la salle des cariatides de Jean Goujon, « quatre presches avec si grande affluence de peuple que, pour la multitude des communiants, | ||
| + | |||
| + | |**00000305**| | ||
| + | |||
| + | |**00000306**| GRIGNY AU XVIIS SIECLE Croquis Topographique d' | ||
| + | |||
| + | |**00000307**| 107 - Autrefois, à en juger d' | ||
| + | |||
| + | |**00000308**| - - 108 à Angers, y fut tué en 1562 (1). Le hameau du Plessis-le-Comte touche au territoire de Grigny, sur celui de Fleury-Mérogis (2). Antoine Chevalier, élève du célèbre hébraïsant Vatable, fut nommé professeur à Genève le même jour que Th. de Bèze (1559), précédemment prieur de Saint-Éloi, | ||
| + | |||
| + | |**00000309**| 109 - de Saumaise, « le prince des doctes, le phénix des critiques, l' | ||
| + | |||
| + | |**00000310**| 110 fin d' | ||
| + | |||
| + | |**00000311**| 111 fait abjuration de son hérésie > le 18 avril 1673, et communia publiquement deux jours après; mais le 23 septembre il paraît être mort << estant dans l' | ||
| + | |||
| + | |**00000312**| 112 - Le clergé protesta vivement contre cette autorisation de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000313**| - - 113 unes des terres qui se trouvent en leur possession au XVII siècle. Toujours est-il que les commissaires députés pour l' | ||
| + | |||
| + | |**00000314**| - - 114 la bénédiction en fut faitte avec les cérémonies ordinaires, prédication dans l' | ||
| + | |||
| + | |**00000315**| LE SERMENT CONSTITUTIONNEL DU CLERGÉ A MONTGERON A l' | ||
| + | |||
| + | |**00000316**| 116 - deur et de sainteté, je crois devoir vous rappeler que, en prêtant le serment qui est inscrit sur vos registres, j'ai ajouté: Je déclare et professe que la voix de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000317**| - - 117 fonctionnaires publics ecclésiastiques qui auraient prêté le serment et se seraient rétractés ou se rétracteraient à l' | ||
| + | |||
| + | |**00000318**| - - 118 Après ce réquisitoire, | ||
| + | |||
| + | |**00000319**| RECHERCHES SUR LA NAVIGATION D' | ||
| + | |||
| + | |**00000320**| 120 - I Avant la domination romaine, toute la Gaule n' | ||
| + | |||
| + | |**00000321**| 121 pula, Stapulæ, qui a la double signification d' | ||
| + | |||
| + | |**00000322**| 122 couvrirent de bois. La Gaule redevint alors aussi sauvage qu' | ||
| + | |||
| + | |**00000323**| - - 123 Châlo-Saint-Mard et Etampes et se jette dans la Chalouette aux Portereaux. Son cours est de 8 kilomètres. La Chalouette prend sa source à l' | ||
| + | |||
| + | |**00000324**| - 124 leur grande et puissante ville en pourroit être abondamment pourvue, si le transport en étoit facile, jugèrent après plusieurs réflexions et consultations de personnes intelligentes, | ||
| + | |||
| + | |**00000325**| 125 - <<< | ||
| + | |||
| + | |**00000326**| - - 126 roi Louis XII, ayant été depuis tuteur de Gaston de Foix, fils de Jean, son neveu, avoit en administrant le bien de ce pupille, approuvé tout ce que le père de ce jeune comte avoit donné et disposé dans le comté d' | ||
| + | |||
| + | |**00000327**| - - 127 . duquel j'ay obmis le surplus, contenant seulement les plaidoyers des parties ». << Præfata curia nostra per suum judicium, sententiam et appel- << lationes prædictas, absque emenda, et expensis hujusmodi causæ << appellationes adnullavit, atque adnullat, et ex causa, et per idem << judicium eadem curia nostra, quod dictus processus absque in- << quirendo veritatem factorum in dictis reprobationibus contento- << rum, bene judicari poterat declarando, prænominatas partes, vide- <<< | ||
| + | |||
| + | |**00000328**| 128 << cari faciendi eundemque locum curandi. In possessione, | ||
| + | |||
| + | |**00000329**| 129 lieux, et d'une amende de dix marcs d' | ||
| + | |||
| + | |**00000330**| - - 130 d' | ||
| + | |||
| + | |**00000331**| 131 - Villeroy, seigneur engagiste du domaine de Corbeil. Après plusieurs arrêts et expertises favorables à son projet, de Lamberville fut autorisé, au mois de septembre 1642, à reprendre ses travaux qu'il poussa jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**00000332**| 132 et de la Ferté-Alais dans l' | ||
| + | |||
| + | |**00000333**| - - 133 dit d' | ||
| + | |||
| + | |**00000334**| - - 134 au moullin de Selle, au moullin Richard, au moulin de Gomet (?), au moullin de la Bruyère, au moullin de Lespine, au portereau du Bouchet, au portereau de la vieille rivière, au moullin Charion, au moullin de Mennecy, au moullin d' | ||
| + | |||
| + | |**00000335**| - - 135 << Par le bon marché des transports on pourra mener à Paris: tuiles, chaux et sable d' | ||
| + | |||
| + | |**00000336**| - - 136 çois Voisot, Charles Perier, Charles Rivet, Etienne Rivet, Antoine Perrot, Louis Bondeau, Voltigen (?), Samson, Nicolas Tollet, Gédéon Gouvet, Nicolas Chevallier, Joseph Mainfroy, tous marchands et demeurant à Etampes. <<< | ||
| + | |||
| + | |**00000337**| 137 portereaux en bon état pour y passer les bateaux et nacelles » (1). Cette requête n'eut aucune suite. Les guerres qui survinrent alors détournèrent de cet objet qui est resté dans l' | ||
| + | |||
| + | |**00000338**| - - 138 alors d'une fortune brillante. Ils passèrent ensemble plusieurs traités dont le dernier est du 25 février 1756. Les trois associés choisirent chacun un conseil: Floquet réserva le sien. Darau nomma le sieur Dubois de la Rouance, avocat. Tralaigue choisit le sieur Petit de Boulard, aussi avocat. Mais pour éviter les ressentiments du sieur Yvonnet, et par acte du même jour, le marquis de Tralaigue le fit comprendre pour le premier et principal emploi et deux sols sur les cent vingt qui composaient le fond de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000339**| - - 139 Avant de s' | ||
| + | |||
| + | |**00000340**| - - 140 Remard, de Juine et d' | ||
| + | |||
| + | |**00000341**| - 141 courcie de plus d'une lieue et rendue plus belle, plus aisée et plus chariable par les montoirs de Torfou, Linas, Longjumeau, Arpajon et dernièrement par ceux d' | ||
| + | |||
| + | |**00000342**| 142 pour en demander l' | ||
| + | |||
| + | |**00000343**| 143 - tait prise, fit porter l' | ||
| + | |||
| + | |**00000344**| - - 144 rivière de Juine, dite d' | ||
| + | |||
| + | |**00000345**| - - 145 adressée à M. Campan, secrétaire du cabinet de la reine, dans laquelle il s' | ||
| + | |||
| + | |**00000346**| 146un mémoire appuyé par le comte de Polignac, qui n'eut pas plus de succès. En 1791, la dame de Sainte-Colombe, | ||
| + | |||
| + | |**00000347**| 147 - ou inconvénient de les rendre flottables et navigables, ainsi que des devis et détails estimatifs et frais à faire pour le succès de ladite entreprise. Les députés des bailliages d' | ||
| + | |||
| + | |**00000348**| - - 148 unanimes pour reconnaître l' | ||
| + | |||
| + | |**00000349**| 149 - nº 2, et au sieur Paisselier, ses droits résultant des deux décrets des 10 août et 13 septembre 1791. L' | ||
| + | |||
| + | |**00000350**| PIÈCES JUSTIFICATIVES A Procès-verbal de visite depuis le port jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**00000351**| 151 fange, par ce faisant, que la marchandise ne puisse estre gastée; lesquelles 640 toises vallent et reviennent à la somme de 1280 livres tournois. Fault faire une muraille de dedans et juste le bord desdictz fossés dudict port où sont les bateaulx en l' | ||
| + | |||
| + | |**00000352**| 152 rivière, de 20 toises de long, commençant au droit de la muraille dudict hospital Sainct Jacques, tirant aval la rivière pour ce que aucunes fois les bateaulx, quand ilz descendent et remontent, ilz demeurent aggravez et demeurez. Et vault ce que dessus à faire 100 livres tournois. Aussi, depuis le sault du pré de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000353**| 153 Au-dessoubz de la dicte planche de Morigny est besoing curer la dicte rivière jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**00000354**| 154 - l' | ||
| + | |||
| + | |**00000355**| 155 Juisne et de La Ferté les facent eslargir dans un mois avec les escluzes nécessaires sans chevestres, et pour leur desdommagement des fraiz et entretien desdits portereaux, Nous leur avons accordé et accordons huict solz pour chacun batteau ou nacelle chargés passant aux dits portereaux, et à faulte de faire les dits ouvrages par les dits propriétaires dans ledit temps, nous avons permis audit sieur marquis de Villeroy, ses fermiers ou ayans cause de faire le travail des dits portereaux et de prendre les dits huict solz pour chaque batteau ou nacelle chargés qui passeront aux dits portereaux pour ses frais et entretien d' | ||
| + | |||
| + | |**00000356**| 156 - C Acte stipulant la portion des droits, prérogatives, | ||
| + | |||
| + | |**00000357**| 157 projet, comme aussi il lui sera alloué une somme de vingt-cinq mille livres de rentes annuelles et perpetuelles reversibles à ses successeurs, | ||
| + | |||
| + | |**00000358**| 158 - rante mille livres, faisant un total de quatre millions montant du devis du sieur Mansard, le surplus en seroit réparti aux associés chacun au prorata de son intérêt; les huict sols cédés à M. Mansard devant avoir part à cette répartition; | ||
| + | |||
| + | |**00000359**| | ||
| + | |||
| + | |**00000360**| | ||
| + | |||
| + | VI IV V III II 91 | ||
| + | |||
| + | |**00000361**| ADDITIONS A LA NOTICE SUR LES VICOMTES DE CORBEIL (1) : Il nous a paru intéressant de documenter, au point de vue sigillographique, | ||
| + | |||
| + | |**00000362**| - 160 ..... RCASONE DE CORBOL ..... (Sigillum Carcasone de Corbolio) .. Appendu à un accord entre les Hospitaliers et <<< | ||
| + | |||
| + | |**00000363**| - - 161 Nous avions signalé la présence, en 1226, de Renaud L' | ||
| + | |||
| + | |**00000364**| 162 Jacques de Corbeil est indiqué comme père de Jean, bourgeois de Paris de 1313 à 1321 (1). Ce Jean de Corbeil nous paraît être le même qui exerça les fonctions de prévôt de Paris en 1297 (2). Quant à JEANNE DE SOYECOURT, d'une famille noble de Picardie, elle appartient à une période trop éloignée de celle que nous avons voulu étudier pour entrer sur elle dans des détails tout à fait en dehors de notre sujet. Depuis l' | ||
| + | |||
| + | |**00000365**| 163 - rius, Bernoldus frater ejus, Balduinus Guido, Martinus filius Constancie, Girelmus, Herbertus filius Galterii, Milo filius Ansoldi, Ogerius filius Theoderici, Rainoldus filius Fulcherii, Richerius, Martinus frater ejus, Vitalis filius Tecem, Hernoldus frater ejus, Aszo d' | ||
| + | |||
| + | |**00000366**| - 164 - MM. de Dion et Paul Pinson nous ont signalé une erreur du P. Anselme, relative à Amicie du Donjon. Voici le texte de la rectification de M. de Dion; elle constitue une analyse de la très intéressante et très complète biographie d' | ||
| + | |||
| + | |**00000367**| 165 d' | ||
| + | |||
| + | |**00000368**| BIBLIOGRAPHIE BERNARD (Alfred). - La lignée de Chalo-Saint-Mard. Vannes, imp. Lafolye, 1899, 33 pp., in-4°. Extrait de la Revue des questions héraldiques, | ||
| + | |||
| + | |**00000369**| 167 - versité de Sofia. On y trouve quelques détails en français, intéressant notre région. Nous avions déjà signalé cet ouvrage dans la bibliographie de 1898, mais n' | ||
| + | |||
| + | |**00000370**| 168 - Le champ de naviots. Toinon. tier etc. Les gens qui sont à Paris. La chanson de printemps du Chemineux. Un bon métier. - La La chanson de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000371**| - - 169 LARGEMAIN (le lieutenant-colonel). — Bernardin de Saint-Pierre, | ||
| + | |||
| + | |**00000372**| - - 170 Société archéologique de Rambouillet. Mémoires. T. XIII, 1898. Page 394. Arrêté du représentant Crassous, en date du 27 février 1794, relatif à la célébration du Décadi dans le département de Seine-et-Oise. Pages 407 à 415. La rivière l' | ||
| + | |||
| + | |**00000373**| 171 et emprisonné à Fontainebleau. Ce sont ses tribulations en Seine-et-Marne que le sympathique bibliothécaire de Melun a racontées dans cet article. L' | ||
| + | |||
| + | |**00000374**| Chronique MARCOUSSIS. - Un récent arrêté a classé une belle statue en marbre, du XVe siècle, la Vierge et l' | ||
| + | |||
| + | |**00000375**| 173 Cette portion de territoire qui formera dorénavant la commune de Plessis-Trévise, | ||
| + | |||
| + | |**00000376**| | ||
| + | |||
| + | |**00000377**| TABLE DE LA 5º ANNÉE Statuts et réglement de la Société Liste des membres. Conseil d' | ||
| + | |||
| + | |**00000378**| - - 176 Recherches sur la navigation d' | ||
per/shaceh.05.1899.1763874336.txt.gz · Dernière modification : de bg