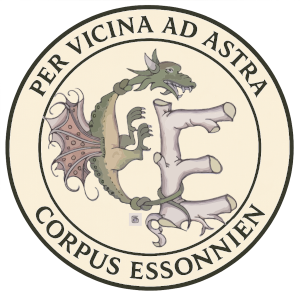per:shaceh.18.1912
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| per:shaceh.18.1912 [2025/11/23 06:11] – créée bg | per:shaceh.18.1912 [2025/11/24 00:11] (Version actuelle) – bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | **[[bul.shaeh|SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | ======Bulletin n°18 (1912)==== | ||
| + | |||
| + | ======PAGE EN CONSTRUCTION====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHEOLOGIQUE DE CORBEIL D' | ||
| + | |||
| + | SOMMAIRE DU 1er BULLETIN DE 1911 Statuts et règlement de la Société Liste des membres. Conseil d' | ||
| + | |||
| + | BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL D' | ||
| + | |||
| + | SOMMAIRE DU 2 BULLETIN DE 1911 Promenade archéologique du 26 juin 1911, à ChâteauLandon. Evry-sur-Seine et les châteaux de Petit-Bourg et de Mousseaux. 65 71 · La paroisse de St-Martin d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL D' | ||
| + | |||
| + | SOMMAIRE DU 1er BULLETIN DE 1912 Statuts et règlement de la Société Liste des membres. Conseil d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL D' | ||
| + | |||
| + | SOMMAIRE DU 2 BULLETIN DE 1912 Compte-rendu des séances. Assemblée générale de 1912 La Paroisse de St-Martin d' | ||
| + | |||
| + | |**I**| | ||
| + | |||
| + | BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**II**| MONTDIDIER. IMPRIMERIE J. BELLIN | ||
| + | |||
| + | |**III**| BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL D' | ||
| + | |||
| + | PARIS ALPHONSE PICARD ET FILS, ÉDITEURS LIBRAIRES DES ARCHIVES NATIONALES ET DE LA SOCIÉTÉ DE L' | ||
| + | |||
| + | |**IV**| | ||
| + | |||
| + | |**V**| | ||
| + | SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**VI**| | ||
| + | Les mineurs ne seront admis dans la Société que sur le consentement soit de leurs parents, soit de leur tuteur. ART. IV. Le titre de fondateur est acquis: 1° aux signataires des présents statuts, 2° à tout membre qui fait don à la Société d'une somme de cent francs au moins. ART. V. Chaque sociétaire paie une cotisation annuelle de dix francs; cependant cette cotisation est réduite à cinq francs pour les personnes appartenant au clergé et à l' | ||
| + | |||
| + | |**VII**| | ||
| + | ART. XIII. En cas de dissolution de la Société, les membres titulaires, réunis en une Assemblée générale spécialement convoquée à cet effet, seront appelés à statuer sur la liquidation de l' | ||
| + | |||
| + | |**VIII**| | ||
| + | RÈGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**IX**| | ||
| + | ART. V. Le Secrétaire rédacteur rédige les procès-verbaux des séances et est chargé de tout ce qui se rapporte à la correspondance. - ART. VI. Le Trésorier est chargé du recouvrement des cotisations annuelles; il paie les dépenses ordonnancées et donne, chaque année, à la séance générale, un état de la situation financière de la Société. - ART. VII. Le Conseil se réunit tous les trois mois ; cependant le Président peut le convoquer chaque fois que les intérêts de la Société l' | ||
| + | |||
| + | |**X**| | ||
| + | ART. XV. - Les Sociétaires ont droit à toutes les publications de la Société à partir de l' | ||
| + | |||
| + | |**XI**| | ||
| + | LISTE DES MEMBRES Les noms précédés d'un astérisque (*) sont ceux des MEMBRES FONDATEURS qui ont racheté leur cotisation. MM. ALLAIN, Maire de Soisy-sous-Étiolles, | ||
| + | |||
| + | |**XII**| | ||
| + | BIBLIOTHÈQUE (la) COMMUNALE DE CORBEIL, représentée par M. Dufour, bibliothécaire. MM. +BIZEMONT (le Comte de), au Château du Tremblois (M.-et-M.). * BIZEMONT (le Comte de), 8, rue Girardet, à Nancy (M.-et-M.). BLONDEAU, Architecte à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne). BOBIN, pharmacien à Étampes. BOËTE, Instituteur, | ||
| + | |||
| + | |**XIII**| | ||
| + | MM. CHEVALIER (Léon), Conseiller-Maître honoraire à la Cour des Comptes, à Soisy-sous-Étiolles, | ||
| + | |||
| + | |**XIV**| | ||
| + | MM. DELABRECQUE, | ||
| + | |||
| + | |**XV**| | ||
| + | MM. FROMAGEOT, avocat, II, rue de l' | ||
| + | |||
| + | |**XVI**| | ||
| + | MM. HOUSSOY (le Comte du), au château de Frémigny, par Bouray, (S.-et-O.), et 5, rue Beaujon, à Paris (VIII). HUET (Edmond), 12, rue St-Jacques, à Étampes. HUTTEAU (Léonce), 3, rue Saint-Jacques à Etampes. * JACQUEMOT (l' | ||
| + | |||
| + | |**XVII**| | ||
| + | MM. LEPROUST (l' | ||
| + | |||
| + | |**XVIII**| | ||
| + | MM. PAISANT, Président honoraire du Tribunal de Versailles, 47, rue Neuve à Versailles. PALLAIN, gouverneur de la Banque de France, Hôtel de la Banque, à Paris (Ier). PAPIN, Agent des Assurances générales, | ||
| + | |||
| + | |**XIX**| | ||
| + | MM. RICHEMOND, Boulevard Malesherbes, | ||
| + | |||
| + | |**XX**| | ||
| + | MM. VALLET (l' | ||
| + | |||
| + | |**XXI**| | ||
| + | MEMBRES HONORAIRES CORRESPONDANTS MM. COÜARD (Emile), Archiviste de Seine-et-Oise, | ||
| + | |||
| + | |**XXII**| | ||
| + | LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D' | ||
| + | |||
| + | |**XXIII**| | ||
| + | SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES Société de l' | ||
| + | |||
| + | |**XXIV**| | ||
| + | |||
| + | |**1**| SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**2**| | ||
| + | M. Brinon, de Pussay et Mme veuve Barthélemy, | ||
| + | |||
| + | |**3**| | ||
| + | pondre au désir émis par le Conseil lors d'une séance précédente, | ||
| + | |||
| + | |**4**| | ||
| + | débris de bases de colonnes, un ou deux chapiteaux très mutilés, et quelques autres morceaux de pierre qui échappent à toute désignation. Tout cela est dans un triste état et ne vaudrait pas le transport. Cependant, M. Dufour fit connaître à Mme Pascal qu'il était chargé par l' | ||
| + | |||
| + | |**5**| | ||
| + | aussi de nos plus modestes églises de villages. Tous ces monuments auxquels les populations sont si attachées, forment la plus grande partie du trésor artistique de la France. La Société de CorbeilEtampes a reçu un exemplaire de cette pétition, avec prière de la signer et de la faire parvenir ensuite à M. le Président de la Chambre des Députés. Le Conseil d' | ||
| + | |||
| + | |**6**| | ||
| + | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Tenue le lundi 22 Mai 1911, à l' | ||
| + | |||
| + | |**7**| | ||
| + | Ces vides, hélas ! ne seront pas entièrement comblés, car je ne puis leur opposer aujourd' | ||
| + | |||
| + | |**8**| | ||
| + | Nous avons une observation à faire au sujet de cette gravure: elle est encartée, mais non cousue, dans le 2me bulletin de 1910, mais elle appartient au premier, c'est pourquoi nous l' | ||
| + | |||
| + | |**9**| | ||
| + | Nécrologie qui donne les noms, avec une courte notice biographique, | ||
| + | |||
| + | |**10**| | ||
| + | une bienveillante approbation qui m' | ||
| + | |||
| + | |**11**| | ||
| + | Report. 20 CONCERNANT la Société Frais d' | ||
| + | |||
| + | |**12**| | ||
| + | Libres. Répartition des fonds Réservés, comme provenant du rachat de cotisations de 26 membres fondateurs. 1.062 25 2.600 Certifié exact, Le Trésorier, POPOT. Avant de proposer l' | ||
| + | |||
| + | |**13**| | ||
| + | droit les objets non classés se trouvant dans notre région et qui pourraient être reproduits dans le second volume. Plusieurs membres présents signalent des objets intéressants et qui méritent d' | ||
| + | |||
| + | |**14**| | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | |**15**| | ||
| + | LES AVED DE LOIZEROLLES (1702-1845). SI L' | ||
| + | |||
| + | |**16**| | ||
| + | cette dernière vue à mi-corps filant au rouet; ces deux portraits gravés par J.-J. Baléchou. Le Petit Almanach parisien de 1762-1764, place parmi les plus célèbres peintres, c' | ||
| + | |||
| + | |**17**| | ||
| + | Vers 1765, il épousa Elisabeth-Geneviève Marteau, et fut appelé, grâce au mérite dont il avait fait preuve, à présider la chambre royale de l' | ||
| + | |||
| + | |**18**| | ||
| + | Marie-Antoinette, | ||
| + | |||
| + | |**19**| | ||
| + | an II (26 juillet 1794), à sept heures, François entendit appeler Loizerolles père: Loizerolles père au greffe! criaient les guichetiers. Avant de quitter Saint-Lazare pour la Conciergerie, | ||
| + | |||
| + | |**20**| | ||
| + | doute jamais éclairés. D' | ||
| + | |||
| + | |**21**| | ||
| + | qu'ils aient leur nombre! Au surplus je ne fais pas tort à mon fils; tout le bien est à sa mère. Si au milieu de ces orages il arrive un jour serein, mon fils est jeune, il en profitera. Je persiste dans ma résolution! > Le chevalier de Loizerolles fut condamné avec vingt-deux de ses co-accusés, | ||
| + | |||
| + | |**22**| | ||
| + | bunal révolutionnaire, | ||
| + | |||
| + | |**23**| | ||
| + | l' | ||
| + | |||
| + | |**24**| | ||
| + | voit dans la récapitulation des noms portés en l'acte d' | ||
| + | |||
| + | |**25**| | ||
| + | ciation du jugement, se trouvent les mots Jean-Simon Loizerolles ; » Considérant que l'acte d' | ||
| + | |||
| + | |**26**| | ||
| + | public ne le fit pas retirer des débats ?... En m' | ||
| + | |||
| + | |**27**| | ||
| + | a jamais eu aucun dévouement de la part de Loizerolles père pour son fils, qui n'a jamais été dénoncé, à ma connaissance, | ||
| + | |||
| + | |**28**| | ||
| + | livre XII, chapitre Iv, intitulé la Terreur à son apogée) dans une foule de livres, et vu retracée dans un des tableaux historiques de la Révolution, | ||
| + | |||
| + | |**29**| | ||
| + | de l' | ||
| + | |||
| + | |**30**| | ||
| + | Pierre Larousse avaient ici leur place, ne serait-ce que pour recevoir de tout ce qui précède une réfutation nécessaire. Avant M. Louis Blanc, MM. Alboize et Maquet avaient déjà écrit que le tribunal révolutionnaire avait frappé la victime réellement visée et que le chevalier de Loizerolles n' | ||
| + | |||
| + | |**31**| | ||
| + | Loizerolles se trouva être l'une des 1315 victimes qui furent immolées à la barrière du Trône, dite alors la barrière renversée, en moins de sept semaines du 26 prairial an II (14 juin 1794) au 9 thermidor (22 juillet). Enfouis et dissimulés dans un coin de terre n' | ||
| + | |||
| + | |**32**| | ||
| + | A ceux qui demandaient qu'il fût passé par les armes avec d' | ||
| + | |||
| + | |**33**| | ||
| + | Nous connaissons de lui les ouvrages suivants : Vers élégiaques sur les arbres funèbres plantés autour du tombeau du naturaliste Valmont de Bomare (auteur du dictionnaire d' | ||
| + | |||
| + | |**34**| | ||
| + | O charmante retraite ! ô champêtre Saintri! Tu m' | ||
| + | |||
| + | |**35**| | ||
| + | |||
| + | =====LA FÊTE A LA RAISON A CORBEIL 1793===== | ||
| + | |||
| + | Nous donnons ci-après un curieux compte-rendu d'une fête révolutionnaire qui eut lieu à Corbeil le 30 Novembre 1793, la Fête à la Raison et l' | ||
| + | |||
| + | |**36**| | ||
| + | COMPTE-RENDU DE LA FÊTE A LA RAISON ET DE L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000079**| 37 - -- fête qu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000080**| 38 --- 1 trahison nous y attire, et la mort nous y attend ; mais le saint enthousiasme dont Marat a rempli tous les cœurs, nous fait surmonter les dangers. Le fer, le feu, des tourbillons de fumée, des monceaux de cadavres, n' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000081**| 39 --- point la dissimulation: | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000082**| - 40 avoient déjà porté la révolte, qu'ils vont chercher l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000083**| 4.1 -- des âmes pures, jouit de cet heureux changement; il pouvoit seul nous rendre de vrais Républicains. Jurons donc tous par lui, par Le Pelletier, par leurs mânes révérés, d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000084**| 42 Traitres, brigands, perfides; Vous poignardez Marat, Et vos bras parricides Sont pour l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000085**| 43 -- Brutus et Rousseau, portés chacun par quatre Vestales, et entourés de plusieurs autres. Au milieu de ces bustes, étoit un vieillard portant les Tables de la Loi. Après étoient les jeunes enfants, au milieu desquels quatre portoient, sur un autel antique, quatre couronnes civiques. Plus loin, venoit une charrue sur laquelle étoit un vieillard, ayant sur la tête une couronne d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000086**| 44 - endroits qu'ils nous avoient meurtris, pour les laisser retomber ailleurs. La Bastille s' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000087**| 45 - parmi nous, et toi seule désormais recevras nos hommages. C'est pour toi que ce Romain immortel brava la puissance odieuse des Rois, et qu'il fit couler le sang de ses propres enfants. C'est pour toi qu'un autre Romain du même nom plongea un poignard dans le sein de son père. C'est à toi que ce Philosophe sensible consacra ses veilles ; c'est pour toi qu'il souffrit une longue et douloureuse persécution et qu'il déposa, dans un ouvrage à jamais célèbre, les titres qui ont enfin rendu à l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000088**| 46 page; Marat, par ses écrits philosophiques, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000089**| 47 étoit favorable; l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000090**| - - 48 dû le dérober aux fureurs des ses ennemis; mais la vengeance n' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000091**| 49 sera qu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000092**| - - 50 Elle est conçue en ces termes : Chanson Patriotique Quels accens! Quels transports! partout la gaîté brille; La France est-elle donc une même famille ? Aux lieux mêmes où les Rois étaloient leur fierté, On célèbre la Liberté. Est-ce une illusion? Suis-je au siècle de Rhée ? J' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000093**| 51 Après cette chanson, la Citoyenne Vandet qui avoit part active dans la Fête, s' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000094**| 52 Jurez, jurez ensemble, En vous donnant tous la main : Le cœur seul nous rassemble, Oui, tout est Républicain. Vos sermens étant sincères, Aimez-vous donc à jamais, Soyez un peuple de frères, Ne vous divisez jamais. Les Citoyens : Soyons un peuple de frères, Ne nous divisons jamais. La Liberté, Citoyens, tient son empire de la Raison; rendre un hommage à la Raison, c'est donc servir la Liberté. Sous l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000095**| LA PAROISSE DB SAINT-MARTIN D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000096**| 54 - la date du 19 Février 1791, nous montre exactement quelle était cette étendue à la fin du xvir siècle, et ce qu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000097**| 55D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000098**| 56 1582 et moy soubsignez. La table des baptesmes est à la fin du registre. (Cette table manque). L'an 1584, messire Guy de Vérambroys, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000099**| 57 -- L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000100**| 58- - 1652. - Registre des mortuaires de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000101**| -- 59 le 1er janvier 1668 jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000102**| 60 -- hier, 13, par le Sr de Gomberville, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000103**| - 61 · - 1580. - De Laporte. 1582. - Moulin. 1583. Pierre Feillet, qui ne signe qu'un seul acte. 1584. Wavet et Langlois, ce dernier jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000104**| 62 a donné la description. On nous saura peut-être gré de copier ici l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000105**| - 63 - 1615. -- Foucquet, mentionné comme desservant de Pussay en la même année. 1615. 1619. - Prangeay, qui était curé de cette même paroisse en --- 1617. — J. Hochereau; en 1656, Jacques Hochereau est curé de Fontaine la Rivière. Peut-être cependant n' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000106**| 64 et m' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000107**| SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000108**| - 66 Le départ de Corbeil eut lieu par un temps un peu gris, mais agréable, vers huit heures et quart. Jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000109**| - 67 l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000110**| - ― 68 persuadé à l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000111**| - - 69 vous savez tous que rien ne se fait sans son assentiment dans cette Société, dont il fut le père et dont il est devenu l'âme à vous parler des projets de votre bureau pour les excursions à venir. - Nous avons à Paris un groupe de sociétaires assez nombreux et tout à fait sympathique pour lequel nous devons témoigner de la déférence et de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000112**| - - 70 Nous reconduisons à la gare de Souppes les excursionnistes qui rentrent à Paris, et nous retournons à Nemours. Ceux qui ne les ont pas visitées le matin vont voir les curiosités de la ville, pendant que d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000113**| EVRY-SUR-SEINE (¹) ET LES CHATEAUX DE PETIT-BOURG ET DE MOUSSEAUX L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000114**| - - 72 événements dont ils ont été les témoins, qu'il y a nécessité de les lier étroitement. Leurs commencements paraissent avoir eu la même source. Avant le onzième siècle, si ces cantons n' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000115**| 73 - Rivière, ambitieux personnage qui domina le duc d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000116**| - - 74 témoigna le désir qu'on abattît un petit bois. L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000117**| - 75 de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000118**| — — 76 - Audigé vendit à M. Bouchinet, dont le fils, aussi poursuivi par la passion du jeu, s' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000119**| LA PAROISSE DE SAINT-MARTIN D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000120**| --- 78 Vicaires : 1653. Jacques Petit, diacre et chanoine de Sainte-Croix. 1653. Mazille. 1654-55. Duchesne. 1656. Fr. René Rislé et Joseph Champ. - Le nouveau curé de Saint-Martin Guill. Fortier, signe son premier acte le 31 août 1656; ses vicaires sont Zichnoir et J. Marin Lemaire. Il est remplacé, en 1661, par Louis Fizillié, qui demeurait devant l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000121**| - 79 - 1678. Guitton. Pierre Ingouf est cité comme vicaire le 23 janvier 1680. Elie Ferry, << curé chefcier de Saint-Martin » rédige son premier acte le 2 Avril. Il ne reste en fonctions que quelques mois. << Le 28 septembre 1680, inhumation dans le chœur, du corps de messire Elie Ferry, prestre de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000122**| 80 - En décembre 1706, on voit quelques signatures « Daubray, prestre, en l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000123**| 81 desservent la paroisse jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000124**| - 82 à la municipalité, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000125**| 83 monies patriotiques. Le 3 octobre 1792, il prête, à l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000126**| - 84 Quelques jours plus tard, il demande et obtient un emploi dans les bureaux de la Ville. Il continue d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000127**| - - 85 1710. Etienne Lautié. - - · • Jacques Barbier. — 1711. Pierre Godin, notaire à La Forêt Sainte-Croix, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000128**| - 86 - Célestins de Marcoussis et leur agent d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000129**| -- 87 Item, pour un glas de la grosse cloche avec l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000130**| - — 88 — 1718.10 juillet. A comparu devant nous, curé et marguilliers, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000131**| RECHERCHES SUR LES ENSEIGNES ET LES VIEILLES HOTELLERIES DE CORBEIL Suite (¹) Rue Notre-Dame La rue Notre-Dame, qui, de la place Galignani (2) donne accès à la place du Marché, doit sa dénomination à l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000132**| -- ―― 90 laire, ce monument fut cédé à la ville par arrêté du 20 frimaire an II, des représentants du peuple Musset et Delacroix, portant que : «< | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000133**| - - 91 - Saint-Spire, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000134**| 92 — bâtiments, cours et jardins sur l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000135**| - 93 maison contiguë, dénommée l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000136**| - - 94 << de la ville et faulxbourgs de Corbueil, payez à Jehan Le Dan, paveur, demeurant << à Longemeau, la somme de trente solz tournois, pour avoir par led Le Dan, << pavé en la rue Nostre Dame dudict Corbueil, devant la court appartenant à la- << dite ville, environ trois toises de pavé, au prix de cinq solz tournois pour chacune << toise... >> Signé : DUPRÉ (syndic) (¹). Depuis cette époque la ville a entretenu le pavé, notamment en 1748, et jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000137**| - - 95 Rue neuve Notre-Dame Cette rue privée, qui appartient aux riverains, va de la rue NotreDame au quai Mauzaisse. Elle a été ouverte en 1822 par Messieurs Pinard et Magdelain dans l'axe de la nef de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000138**| - - - 96 - Rue Notre-Dame Côté droit ou côté de la Seine. LE CHAPEAU ROUGE. Emplacement actuel, nº 6. La maison du Chapeau rouge, appelée aussi dans certains actes Maison Rouge, tenait d'une part et aboutissait par derrière à l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000139**| -- - 97 << Pierre Pya et Simon Fauvelier, eschevins de la ville de Corbeil », et autres habitants et paroissiens de cette église. Une rente annuelle et perpétuelle de douze livres tournois à prendre chacun an, le jour Saint Martin d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000140**| - - - 98 - moitié du cens, qui s' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000141**| 99 -- «seigne les trois Pucelles, assiz en la dicte ville de Corbueil, en la rue Nostre- « Dame, tenant d'une part à l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000142**| 100 - Un compte de 1461, de la fabrique de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000143**| ΙΟΙ la maison contiguë portant l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000144**| 102 - pend pour enseigne « Le Petit Signe » pour la fonte des 1 et 3° cloches, hors d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000145**| - - 103 Les deux maisons dont l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000146**| ― ― 104 LA FORGE, puis les PETITS CARNEAUX. Emplacement actuel, no 18. La maison appelée La Forge, connue au commencement du règne de Charles VII, attenait à l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000147**| - ― 105 Sous les murs et grand hourdeis, Et aux carneaux larges alées, Fors bailles, fors tours carnelées ('). L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000148**| 106 sonne Claude Moreau, hôtelier, demeurant au faubourg de Paris, du côté de la porte de Paris, de la maison appliquée à hostellerie ou pend pour enseigne les Grands Carneaux, avec ses circonstances et dépendances (¹). Nicolas Barré, huissier, était maître des Carneaux, en 1683. Le 23 mai 1714, Louis Charles Clignet et Enguehard, tous deux avocats au parlement de Paris, se rendirent acquéreurs, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000149**| - 107 licitation, la maison des Créneaux fut adjugée à Madame Vian, sa fille, née Louise Pauline Dancongnée, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000150**| -- - 108 La ville de Corbeil fit démolir cet immeuble pour l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000151**| -- 109 l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000152**| 110 Moricet Rouleau aliéna cette maison à Denis Privé, prêtre, chanoine de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000153**| - III - LA BONNE FOI. Emplacement actuel, nº 7. L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000154**| ---- 112 En 1544, cette maison était indivise entre Nicolas Barré, Jehan Gilbert, boulanger, à cause de Jehanne Barré, sa femme, et Michelle Barré, tous héritiers de Pierre Barré. Nicolas Fauvelier, propriétaire de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000155**| - 113 Il relevait de la censive de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000156**| - 114 entre les héritiers de ce dernier, au nombre desquels figurait Nicolas Le Sainctier. Le 3 juillet 1618, Simon Cordeau, marchand à Corbeil, confesse avoir reçu de Noël Jobidon, sergent royal en la même ville, 800 livres tournois pour le rachat de 40 livres de rente, due à raison d'un bail consenti à ce dernier, le 20 mars 1611, « d'une maison couverte de thuilles, contenant deux corps d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000157**| 115 - Une opposition datée d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000158**| UNE FAMILLE D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000159**| 117 - lettes à Paris », donnèrent aux Carmes Billettes (¹) la nue propriété de biens désignés comme suit : « Une maison size au village du Plessis-Chesnay, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000160**| - 118 Aux côtés de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000161**| CONTRIBUTION A L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000162**| 120 — C'est un curieux inventaire des pièces d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000163**| 121 - « «<lons, des brides de fer ou même des cordes. Le pointage ne s' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000164**| JULES BELLIN La mort vient de nous enlever un ami sûr et dévoué et, à notre Société, un maître et un collaborateur éminent. C'est une vérité que nous tenons à affirmer, car lorsque nous fûmes appelé au poste de Secrétaire général de notre Société de Corbeil, Etampes et Hurepoix, M. Bellin, qu'on nous avait indiqué, suppléa à notre inexpérience et fut pour nous un initiateur dans ces fonctions auxquelles nous n' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000165**| -- 123 Jules Bellin a succombé le 20 Octobre 1911 à une opération rendue nécessaire par une douloureuse maladie, conséquence d'un surmenage prolongé que lui imposait le sentiment du devoir, poussé jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000166**| 124 — instruction que sa mémoire et la souplesse de son intelligence rendaient chaque jour plus étendue. Il avait appris le latin, s' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000167**| BIBLIOGRAPHIE (1910-1911) ALLIOT (l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000168**| 126 - CAIN (G.). -- Environs de Paris, ouvrage orné de 123 illustrations et de trois plans anciens. Paris, Flammarion, 6º mille, 1911. Un vol. grand in-16 de 375 pp. • 5 fr. DES CILLEULS (A). L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000169**| - - 127 - DEPOIN (J.). — Chartrier de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000170**| _ - 128 - FORTEAU (Ch.). — Etampes ancien, éclairage public, plaques indicatrices des rues, numérotage des maisons, à la fin du xvIIIe siècle. Etampes, 1911, in-12 de 15 pp. - FORTEAU (Ch.). - L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000171**| 129 de Saint-Victor de Paris. Ecole Nationale des Chartes, positions des thèses, année 1911, pp. 79-84. MALLET (Ernest). - Registre des délibérations municipales de la ville de Pontoise, 1643-1660, 2° fascicule, règne de Louis XIV. Pontoise, 1911. Un vol. in-4°. Des documents édités par la Société historique du Vexin. MAREUSE (Edgar). - Table décennale des mémoires de la Société historique de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000172**| 130 POUPARDIN (R.). Une nouvelle édition de la vie de SainteGeneviève. Nogent-le-Rotrou, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000173**| 131 ... -Bulletin de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000174**| 132 sang-sur-Orge, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000175**| CHRONIQUE 14 Mai 1911. - Cérémonie de la pose de la première pierre de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000176**| - 134 Ce n' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000177**| - - 135 Les tambours battent aux champs, puis M. Calliet, président de la 413º section des Vétérans, prononce un discours patriotique, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000178**| - - 136 - 2 Juillet 1911. ― Saint-Paul. Bénédiction de la cloche de la nouvelle église Cette cloche a été baptisée sous les noms de Marie-Simone. Le parrain était M. Emile Radot, d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000179**| ― 137 Aux écoles. Goûter et rafraîchissements. Guignols avec trois sujets successifs et distincts. Distribution aux enfants de 4000 objets-réclame. Place du marché. Chevaux de bois gratuits pour tous les enfants participant à la fête. Vin d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000180**| - ---- 138 illisible de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000181**| NÉCROLOGIE Nous voici arrivé à ce chapitre de la Nécrologie qui doit terminer ce second Bulletin de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000182**| - 140 C' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000183**| TABLE DE LA 17 ANNÉE Statuts et règlement de la Société Liste des membres. Conseil d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000184**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000185**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000186**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000187**| BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000188**| MONTDIDIER. IMPRIMERIE BELLIN | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000189**| BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL D' | ||
| + | |||
| + | CONFFIL STAMPE PARIS A. PICARD, ÉDITEUR, LIBRAIRE DES ARCHIVES NATIONALES ET DE LA SOCIÉTÉ DE L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000190**| 1 | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000191**| SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000192**| VI Les mineurs ne seront admis dans la Société que sur le consentement soit de leurs parents, soit de leur tuteur. - ART. IV. Le titre de fondateur est acquis: 1° aux signataires des présents statuts, 2° à tout membre qui fait don à la Société d'une somme de cent francs au moins. ART. V. Chaque sociétaire paie une cotisation annuelle de dix francs; cependant cette cotisation est réduite à cinq francs pour les personnes appartenant au clergé et à l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000193**| VIJ - ART. XIII. En cas de dissolution de la Société, les membres titulaires, réunis en une Assemblée générale spécialement convoquée à cet effet, seront appelés à statuer sur la liquidation de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000194**| RÈGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000195**| IX - ART. V. Le Secrétaire rédacteur rédige les procès-verbaux des séances et est chargé de tout ce qui se rapporte à la correspondance. - ART. VI. Le Trésorier est chargé du recouvrement des cotisations annuelles ; il paie les dépenses ordonnancées et donne, chaque année, à la séance générale, un état de la situation financière de la Société. ART. VII. Le Conseil se réunit tous les trois mois ; cependant le Président peut le convoquer chaque fois que les intérêts de la Société l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000196**| X — ART. XV. Les Sociétaires ont droit à toutes les publications de la Société à partir de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000197**| LISTE DES MEMBRES Les noms précédés d'un astérisque (*) sont ceux des MEMBRES FONDATEURS qui ont racheté leur cotisation. MM. ALLEZ, au château de Belesbat, par Boutigny (S.-et-O.) et à Paris, rue de Berri, 5 bis (VIIIe). ALLORGE, Professeur de dessin à Montlhéry (S.-et-O.). AMIOT, avocat à la Cour, 207, Boulevard St-Germain, Paris (VII). AMODRU, député, 66, avenue des Champs-Elysées, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000198**| XII BIBLIOTHÈQUE (la) COMMUNALE DE CORBEIL, représentée par M. DUFOUR, bibliothécaire. MM. BIZEMONT (le Comte de), au Château du Tremblois (M.-et-M.). * BIZEMONT (le Comte de), 8, rue Girardet, à Nancy (M.-et-M.). BLONDEAU, Architecte à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne). BOBIN, pharmacien à Étampes. BONNEFILLE, ancien Sénateur de Seine-et-Oise, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000199**| XIII Comptes, à Soisy-sous-Étiolles, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000200**| XIV MM. DELAUNAY, propriétaire à Saintry, par Corbeil, et à Paris, 39, Boulevard Beaumarchais (III). DELESSARD (Mme Edouard), 16, rue Gay-Lussac, à Paris (Vº). DELESSARD (Ernest), Ingénieur civil, à Lardy (S.-et-O.). DEPOIN (Joseph), Secrétaire général de la Société historique de Pontoise, 50, rue Basse, à Pontoise, et à Paris, 150, boulevard St-Germain (VIe). DESRUES (l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000201**| XV MM. FROMAGEOT, avocat, II, rue de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000202**| XVI MM. HUET (Edmond), 12, rue St-Jacques, à Étampes. HUTTEAU (Léonce), 3, rue Saint-Jacques à Etampes. * JACQUEMOT (l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000203**| XVII MM. LELONG, notaire à Corbeil. LEMAIRE (A.), adjoint au Maire à Corbeil. LEMAY (l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000204**| XVIII PAISANT, Président honoraire du Tribunal de Versailles, 47, rue Neuve à Versailles. MM. PALLAIN, gouverneur de la Banque de France, Hôtel de la Banque, à Paris (Ier). PAPIN, Agent des Assurances générales, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000205**| XIX MM. RESVE, chef d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000206**| XX MM. *TREUILLE (Raoul), 156, rue de Rivoli, à Paris (Ier). TREILHARD (le Comte), au château de Marolles-en-Hurepoix, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000207**| XXI MEMBRES HONORAIRES CORRESPONDANTS MM. COUARD (Emile), Archiviste de Seine-et-Oise, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000208**| XXII LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000209**| XXIII SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES Société de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000210**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000211**| LA PAROISSE DE SAINT-MARTIN D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000212**| - baye de Morigny-lez-Estampes », qui fait suite aux « Antiquités de la Ville et du Duché », par dom Basile Fleureau. Cet auteur dit qu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000213**| -- - 3 1649.- 24 mai, « vénérable et discrette personne Pierre Assadé, diacre, prieur de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000214**| - de Sendéry, ministre de la Trinité, convoqué parmi les membres du clergé, se fait représenter aux assises par Fr. Philippe Charpentier, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000215**| - 5 entre Jean Chevallier, fils de Pasquet et de Barbe Sibillon, de la pe Saint-Martin, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000216**| - 6 - - - 1774. 1776. 22 janvier, Philippe Dufresne, prêtre, prieur des Mathurins célèbre un mariage dans la chapelle du couvent, en présence du Sr Doches, curé de Saint-Gilles, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000217**| 7 17 mars, jour auquel il vint déclarer son départ à la municipalité, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000218**| - 8 aux armes de Guy de Sève de Rochechouart, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000219**| 9 d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000220**| - - 10 nicipal qui possède aussi une statuette en bois représentant le Bon Pasteur, provenant du même endroit. Il est de tradition locale que Ravailhac passant à Etampes pour aller à Paris, aiguisa son poignard régicide sur le socle de l'Ecce Homo. Une autre légende se rattache à cet événement. Un habitant, entre autres, aurait été témoin du fait et aurait entendu l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000221**| - II Villette, sr de Blanville, et de demoiselle Michelle Vaillant; parrain, Nicolas Guillotin, procureur du Roi; marraines, damoiselles Françoise Prevost et Katherine Chandoux. -- 1586. Avril, Magdelaine Darras, épouse de vénérable et sage et discrette personne M. Estienne Chardon, lieutenant de M. le Prévost d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000222**| - 12- - 25 Août. Alain Guibourt, valet de chambre du Roy, et Georges Guibourt, mesureur à la gabelle. - 1599. 20 Août, Venerabilis et circonspectus vir M. Guydo de Verambroys, per et in eadem prochiali et Baudry, pber. 1600.10 Décembre, Elisabeth, fille de N. H. Jacques Hochereau, archer des Gardes du Corps du Roy de France, et de Marie Garnier; marraine, damoiselle Elisabeth du Val, veuve de feu N. H. François Montagne, luy vivant secrétaire de feue la Royne, mère du Roy; parrain, François Hérault, procureur. - 1601. Lundy 23 avril, Pierre, fils de Jacques Monsault, archer du prévost des Maréchaux, et de Françoise Le Roy; parrain, N. H. Pierre Conchon, prévost des Maréchaux d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000223**| 13 - de la psse de Saint-Mard, et Pierre Conchon, prévots des Maréchaux; marraine, dame Marie de Coutes, femme de N. H. Jehan Camus, bailly et gouverneur d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000224**| - 14 ordinaire de la Cie du Roy sous la conduite de M. de Guise; marraines, Claude Griard et Marie Rémy. 1618. - 21 Janvier, damoiselle Geneviève Le Verrier, et damoiselle Marie Petit, fille de Jehan Petit, capitaine des Guides du Roy. Lundy 2 Août, noble homme Jehan Myron, conseiller 1621. du Roy. - 1622. Lundy 4 Avril, François, fils de N. H. Jacques Montagne et de damoyselle Elisabeth Foullon. Parrain, N. H. Jean de Sève (¹), Sr de Villiers, conseiller au Parlement de Paris. Mardy 25 Octobre. N. H. Gaspard Gelon, conseiller, notaire et secrétaire du Roy, maison et couronne de Navarre et de son domaine et grenetier au grenier à sel d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000225**| - 15 D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000226**| 16 - - 1654. ― Fontaine. 28 juin, parrain, Jacques Hochereau, prestre, curé de 5 Décembre, Simon Gorlidot, Sr de Grandmaison, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000227**| -― 17Rousse, fille de Jean Rousse, conseiller du Roy, lieutenant de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000228**| 18 - 1690. 19 février, Marc Antoine Lamy, avocat en Parlement (¹), et Marie Delambon, épouse de M. Charles Vassor, notaire et principal tabellion. 12 septembre, parrain, Henry Nicolas de Franqueville Lemoine, receveur du bureau des consignations (il signe : Lemoyne). 1692.3 mars, Gabrielle, fille de Jean Renard, maistre des postes, et de Marguerite Martin; parrain, Gabriel de Bry, Sr d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000229**| -19 - marraine, Marie Madeleine Guitard, fille de M. Guitard, chirurgien. 1708. -1er octobre, Pierre Sirou, officier chez M. Delpech à Méréville. 4 octobre, François Le Sourd, chapelain de Sainte-Croix ; Perrine Louise Le Sourd, fille de M. Le Sourd, greffier de la Maréchaussée. 1710.2 janvier, Jean Collard, très digne curé de la pse d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000230**| 20 selle Anne Renée Guyot, fille de M. Julien Guyot, Sr de la Barre. 10 novembre, Jean Baptiste Pérotel, concierge de Chalou (¹). -― 1728. 15 mars, baptême de Françoise, fille de Louis Charpentier et de Françoise Gidoin; parrain M. Simon Gidoin, receveur de Monnerville; | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000231**| - 21 - gneur du grand et du petit Boinville, de Chalo Saint-Mard en partie; damoiselle Madeleine de Saint-Pol. 1757. — 15 décembre, Charles Soubenau de Montgeorge. - 1761.15 avril, le sieur de Sourches (Guy de Sourches), prêtre, chanoine régulier de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000232**| UNE ARRESTATION A MONTGERON LE 12 JANVIER 1794 « Aujourd' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000233**| 23 qu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000234**| - - 24 chacun dix livres pour les indemniser seulement des frais de route. Signé Thierry, municipal, Reymond, municipal, Hervieu, agent national, Detenre, maire ». Il est à supposer que le corps municipal, y compris Detenre, ne connaissait pas les marquis de Condorcet et de Grouchy, car il eût insisté davantage sur les renseignements fournis par François Parquet. Quiconque a quelque peu étudié l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000235**| DE CORBEIL A PARIS L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000236**| -- - 26 place était de 4 francs et il fallait la retenir au moins 8 jours à l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000237**| - - 27 matin et arrivait à Paris entre 2 et 3 heures de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000238**| - - - 28 des places était en moyenne de 1 fr. à 1 fr. 50 et l'on a vu, par suite de la concurrence, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000239**| - 29 de prospérité qui n'a pas cessé de s' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000240**| - 30 habitants de la ville; le prix, pour les souscripteurs, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000241**| 31 - était de donner à notre bulletin un document absolument inédit que l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000242**| 32 - « de vins, et autres marchandises arrivant sur le port de Corbeil. Il << en obtint arrest du Conseil contre le prévost des marchands et < | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000243**| - - 33 - de la Seine en remontant. Le terrier de Villeroy auroit pu donner aussi des éclaircissements sur cette matière, mais ce greffe et celui de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000244**| 34 - les bords de la Seine, tels qu'ils étoient vers 1650: mais un autre écrivain, dans la même langue, plus de cent ans après, fait ainsi le tableau de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000245**| 35 - - reliques de Saint-Spire au Tremblay; outre ce tableau, d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000246**| - 36 - - où étoit en effet le meilleur abordage qu'il put avoir pour la commodité des habitants. Fermiers et directeurs : - Lecourt Jacques, - Trecol, Richard, frères, Turlin. -- Richard, fils, --- Chamousset, Viote, Chanteclair, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000247**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000248**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000249**| PEINTURE MURALE DANS L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000250**| 38 - représente le martyre de Sainte Julienne et c'est elle que nous nous proposons d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000251**| - --- 39 et celle-ci parvint à se rendre maîtresse du démon, lui lia les mains derrière le dos et le battit avec ses chaînes à elle; finalement elle parvint à le traîner dehors et le jeter dans une latrine. Cependant le préfet mécontent << fit étendre Julienne sur une roue qui lui broya tous les os jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000252**| - - 40 - Ces hommes sont barbus et coiffés de bonnets. Leur costume se compose de haut-de-chausses collant, rouge pour l'un, vert pour l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000253**| 41 - Trodes dont j'ai parlé ci-dessus, et à plus forte raison, avec le vitrail de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000254**| 42 - les reliques aujourd' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000255**| 43 - Un inventaire d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000256**| NOTES POUR SERVIR A L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000257**| - - 45 << M. N. O. du plan, une quantité considérable de scories de bronze, << mêlées à des charbons, à des morceaux de fer calciné, à de la << cendre et jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000258**| --- - 46 - lement reconnue et appréciée. Il a trait à des « documents manuscrits et imprimés de leur collection permettant d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000259**| - 47 de cloche n' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000260**| - 48 la question qui nous occupe. Nous en voulons néanmoins retenir ce point, à savoir qu'aux termes de l'art. 11 de la loi du 6 Août 1791 pour la fabrication des nouvelles espèces, le métal de cloches << devait être allié à une portion égale de cuivre et que les flans qui << en proviendraient seraient frappés ». Cette particularité n' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000261**| - - 49 Mais n' | ||
| + | |||
| + | 1913.-I. | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000262**| LA FORÊT DE SÉQUIGNY ET LE CHATEAU DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS C'est une forêt charmante que cette forêt de Sainte-Geneviève des-Bois, s' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000263**| 51 preuve, sinon scientifique, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000264**| -- 52 1561, 3 juillet 1603, 1er Juillet 1626, 26 août 1647, 1er Mai 1719. Les réclamations et procès se continuèrent pendant la Révolution ; on en trouve la trace dans les cahiers des doléances des communes de la Prévôté et Vicomté de Paris hors les murs. Pendant la Révolution, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000265**| - 53 Au mois d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000266**| 54 - sa dette, déjà rondelette, il se hâta de faire enlever toutes les barrières et entraves qu'il avait fait établir dans la forêt. Aujourd' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000267**| - 55 - Un ami m' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000268**| 56 - -- M. le Cle de Bertier, qui est un érudit distingué, ne s'y refuserait certainement pas. Pour vous donner une idée des pièces intéressantes que l'on rencontre dans cette collection, je vous adresse une réduction d'un grand plan des Seigneuries de Sainte Geneviève, Morsang, Villemoisson et le Perray dont j'ai pu prendre copie, grâce à l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000269**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000270**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000271**| SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000272**| 58 - MM. Henri Haro, de Paris. Gustave Guyot, de Paris. Allain, ancien avoué, de Paris. A. Mallet, de Laroche • • 7 mai 1911 · 8 mai 1911 · 16 juin 1911 · · 5 juillet 1911 11 9bre 1911 1911 · • 25 xbre 1911 Boëte, instituteur, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000273**| 59 Le secrétaire annonce ensuite que le retard produit dans nos publications, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000274**| ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Tenue le lundi 10 Juin 1912, à l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000275**| - - – 61 - M. Duval, de Morsang, membre fondateur de notre Société, M. Canoville, de Mennecy, 25 décembre 1911; et notre très regretté imprimeur, M. J. Bellin, de Montdidier, qui présidait à nos publications, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000276**| 62 - M. Gautier, Entrepreneur de travaux à Corbeil; M. Cuginaud, Conservateur des Hypothèques, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000277**| - - - 63 · a fait bénéficier notre bulletin ; nous devons l'en remercier et lui souhaiter de continuer ce qu'il a si bien commencé. Ce bulletin se continue par une intéressante étude de M. C. Cochin intitulée : une famille d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000278**| 64 - rembourser par la ville, la somme déboursée pour cette acquisition. En outre on m'a promis un autre tableau que je recevrai prochainement ; c'est un grand portrait du célèbre peintre Eugène Delacroix. Il est grandeur nature et a deux mètres de haut sur 1 m. 55 de largeur. La difficulté est de le faire venir et mettre en place, mais on en viendra à bout, j' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000279**| - - - 65 Report. 2º CONCERNANT LA SOCIÉTÉ Frais d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000280**| 66 Ces deux rapports sont approuvés à l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000281**| 67 - possible de sociétaires prendre part à la visite de Provins, la plus ancienne peut-être des villes de la région, qui, par ses monuments civils et religieux du plus haut intérêt, par ses admirables remparts qui peuvent être comparés à ceux de Carcassonne, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000282**| LA PAROISSE DE SAINT-MARTIN D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000283**| --- -- 69 maire de Chalo Saint-Marc (1) et de feue Françoise Denizard (2). La cérémonie est faite par le curé d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000284**| 70 - 1758.25 février, Louis Raveton et Marie Gabrielle Boivin, fille mineure de défunt Nicolas Boivin, hôtelier à Longjumeau, et de défunte Anne Gabrielle Davoust, de la psse Saint-Gilles. - Vu la mainlevée donnée par devant François Venard, notaire royal à Etampes, par Nicolas Boivin, md hôtélier, demeurant à Etampes, psse NotreDame, en présence de Charles Hautefeuille, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000285**| 71 tier, avocat, fils de deffunt Alexis Théodore Charpentier, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000286**| --- 72 - droite à costé des deux grandes tombes en l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000287**| 73 - - 6 août, Magdeleine Aubert, femme de Noël Mouchet mire mareschal. 20 octobre, Pierre Papillon. 1669.16 juillet, au devant de la chapelle de Notre-Dame, Pierre Carton, fils de Fleurant et de damoiselle Louise de Lardy, sa femme présente, ainsi que Darras, vicaire. 31 juillet, Pierre Montagne, en présence de Pierre, son fils. 11 novembre, Noël Jeanne, meusnier du moulin de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000288**| 72 droite à costé des deux grandes tombes en l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000289**| - - 73 6 août, Magdeleine Aubert, femme de Noël Mouchet mire mareschal. 20 octobre, Pierre Papillon. 1669. 16 juillet, au devant de la chapelle de Notre-Dame, Pierre Carton, fils de Fleurant et de damoiselle Louise de Lardy, sa femme présente, ainsi que Darras, vicaire. 31 juillet, Pierre Montagne, en présence de Pierre, son fils. 11 novembre, Noël Jeanne, meusnier du moulin de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000290**| 74- - 1682, 29 mars, Germain Carnevilliers. 4 mai, Sébastien Laquo-la-Chapelle, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000291**| -- 75 1694- - 24 janvier, Anne Venambre, femme de Robert Chauvin. 2 février, Etienne Bonnivet, 27 ans, fils de M. Bonnivet et de Jeanne Paris. 4 avril, Jeanne Monceaux, veuve de Sébastien Laquo, archer en la maréchaussée, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000292**| - 76 - 6 septembre, Louis Antoine, fils d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000293**| - 77 !7II. - 16 juillet, Claudin Blandin, 55 ans. 31 octobre, Marie Trochot, fme de Henry Rossé, 30 ans. - 1713. — 1er juin, damoiselle Louise Catherine Petit, fille de Jacques Petit, sr de Mézières, et de Catherine Peschart (enfant en nourrice). 10 juin. — Jacques Montier, courrier du Roy (mort assassiné). 23 avril, Louis Hamouy, 10 ou 12 ans (sic), fils de Mathieu, - 1714. laboureur. 1715.7 mars, Henry Rossé, md papetier, époux d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000294**| 78 - 7 octobre, Marie Jeanne Papillon, 2 ans. 19 décembre, Elisabeth Carnevilliers, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000295**| 79 - 20 juin, dans l'aile gauche à côté du chœur, Charles Chaumet, mtre serrurier, hme veuf de Anne Blanchet, 72 ans. 25 juin, dans la nef, Magdeleine Le Haut, femme de Jérome Rousseau, meunier, 34 ans. 1742.24 juillet, Marie Madeleine de Malizieux, 22 ans, femme de M. Guérin de Vauderay. 1744. 20 février, Cantienne Laumosnier, I an. - 21 février, Pierre Carnevilliers, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000296**| 80 - 25 juillet, Pierre Force (enfant). 8 août, Marie Jeanne Force, sa sœur, 2 ans. Le même jour, Antoine Auguste Robineau, 21 mois. 1759. 4 décembre, dans la chapelle Saint-Pierre, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000297**| - - 81 13 juin, dans la chapelle Saint-Pierre, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000298**| - - 80 25 juillet, Pierre Force (enfant). 8 août, Marie Jeanne Force, sa sœur, 2 ans. Le même jour, Antoine Auguste Robineau, 21 mois. - 1759. 4 décembre, dans la chapelle Saint-Pierre, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000299**| - - 81 13 juin, dans la chapelle Saint-Pierre, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000300**| - - 82 - mareine Loyse Archambault. Et fust ledict Pierre baptisé à la Huguenoterie et y fut porté le dix-septiesme du mois d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000301**| - --- - 83 - du capitaine; tous du pays de Sareuse? (Suisse), catholiques du canton de Fribourg, soldats, etc. Citation: 1594, Gilles Besnard, maître chirurgien; Pierre Boudeaux, procureur; Simon Compotier, receveur général du Domaine; 1602, Esprit Moyret, procureur au bailliage; Etienne Buchon, receveur et collecteur des tailles de la ville d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000302**| - -- 84 1643.2 mars, sont parrains, un soldat et un sergent du régiment de Vaudétour. - En 1645. 27 mars, Jean Maheult, premier sergent de la compagnie de Mr de Maray, du régiment de Mr le Cardinal de Mazarin. 17 décembre, baptême d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000303**| - - 85 l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000304**| 86 - - 1677. Pierre Michelet, receveur de la terre et seigneurie de Saint-Cyr; 1682, inhumation au cimetière, le 14 février, de Luce Rousseau, femme de feu Pierre Desmazures, maîtresse de postes à Monnerville; | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000305**| - --- 87 les sables et pavés ; Marie Chauvet, femme de Jean Lecopé, officier de madame la duchesse de Bourgogne ; François Gautier, receveur des entrées. 1704. 20 juin, a esté inhumé dans l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000306**| 88 1717. 4 mars, inhumation au cimetière de Jacques Echard, laboureur, demeurant psse de Creusi, diocèse d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000307**| -- 89 de la pse de Gosocourt-en-Artois, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000308**| -- - 90 Saint-Marcel, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000309**| 91 - - cureur général. En marge, on lit : « le susdit étranger s' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000310**| 92 Grégy, clerc tonsuré âgé de 21 ans, en présence de messire François Grégy, vicaire de Saint-Basile, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000311**| 93 - peu de chose. C'est pourquoi il serait avantageux de la démolir et d'en vendre les matériaux. Ce qui fut fait. On imposa aux adjudicataires des travaux l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000312**| - 94 Jacques Vallot, maître écrivain; 1785, Charles Itier, garde-chasse de S. A. Mgr le duc de Chartres; Jacques Geoffroy, receveur de la régie; Louis Mercier, maître d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000313**| LA PLUS ANCIENNE VUE D' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000314**| 96 - - allemand inséré dans un ouvrage in folio de la fin du xvr® siècle (¹) et que Léon Marquis catalogue de la manière suivante : « N° 170 = Von der Statt Estampes, largeur o" 13, hauteur o™08. << Gravure sur bois qui nous paraît un peu fantaisiste représentant << Etampes au xvie siècle ». Fantaisiste! oh combien ! Notre confrère est même fort modeste. << Un peu fantaisiste est d'une indulgence grande. Énormément fantaisiste, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000315**| 97 - relations où la mémoire jouait un rôle, et dont il fallait réunir dans un seul cadre, plus ou moins étroit, tous les éléments. L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000316**| 98 - 3 Et c'est tout. Passons maintenant au dessin. Au premier plan, un petit monticule dénudé au bas duquel coule une rivière <<< | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000317**| Von Gallia. 245 Viel gedachte Statt wirdt der Statt Paris Romfaßten genannt. Ward Anno Chrifti vnsers Herzen 1591. den 19. Aprilis/von König Heinrich dem Vierdeen/ | ||
| + | |||
| + | 00 Diese Statt ligt an einem schönen vnd Fruchtbaren orth/ist aber zu jh:er grösse nicht sonders lich bewohnet. Das Schloß vnd vnser Frawen Kirchen daselbst hat König Robert gebawet. Wardeewanein Gaffschafft: | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000318**| | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000319**| - - 99 Irons-nous alors jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000320**| - -―― 100 -- paysage Rivière d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000321**| 101 - Marigery? Morigny ?... N' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000322**| PROMENADE ARCHÉOLOGIQUE A PROVINS (1er JUILLET 1912) L' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000323**| 103 - Au rendez-vous, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000324**| - 104 figure, à la place de celle de son maître, au bas de toutes les pièces. officielles du temps. Tous les « Louis » qui signent les brevets, les édits, sont de la main de Rose, qui fut de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000325**| - - 105 << En effet, la population diminuant, il n'a pas fallu, comme dans tant d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000326**| - 106 la restauration entreprise était nécessaire, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000327**| - - 107 Le vaisseau est magnifique, clair; le chœur est bordé d'un triforium roman du dessin le plus pur. M. Antheaume nous fait admirer les beautés de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000328**| - - 108 engageons dans les fossés des remparts, mais la pluie reprend et gêne singulièrement notre promenade. Nous admirons néanmoins, malgré le mauvais temps, les tours, les portes, les échauguettes, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000329**| QUATRE LETTRES AUTOGRAPHES DE JACQUES BOURGOIN DE CORBEIL (1652) Nous avons eu à plusieurs reprises l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000330**| - - J10 Colonel de ce même régiment et passa plus tard, avec le même grade, au régiment de Gévaudan. Nous ne suivrons pas ici M. de Corbeil dans sa carrière militaire qui fut particulièrement brillante, notamment en Italie, au siège et à la prise de Cazal, nous dirons seulement que rentré en France après de glorieuses campagnes, il fut nommé par Louis XIV gouverneur de Corbeil, sa ville natale. Ce n' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000331**| III dès ausytot quil arrivera. J'ai dit au comis de la munision quil tienne du pain tout prest, mais je vous dirai, monseigneur, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000332**| 112 ont eu ordre, de Mr de Monbas, de s'en aller se saizir du poste de Charenton; il n'ont pas voullu recognoitre les ordres de Mr de Monbas, et ce qui les oblige à demeurer issy, c'est quils ont pris neuf bateaux à une lieue de ceste ville, qui descendaient, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000333**| 113 le tout l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000334**| - - 114 lement que les marchans ont donné tous ensemble cent et quelques pistolles qui ne seront distribués que par vostre ordre, et sy vous plaît, Monseigneur, | ||
| + | |||
| + | โลเคล | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000335**| BIBLIOGRAPHIE (1912) ALLORGE (Paul). -Seine et Oise artistique et pittoresque. Cartes postales représentant les anciens monuments, églises, châteaux, maisons, halles, abbayes, calvaires, croix de cimetières, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000336**| 116 COCHIN (Henry) Lamartine en Flandre, par Henry Cochin, député Paris, Plon, 1912; un vol. in-8° avec huit gravures du Nord. hors texte. - Ce livre, écrit par un maître, nous fait connaître une période presque inconnue de la vie de notre grand poëte, alors que, tout jeune, il s' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000337**| - - 117 mont. Coulommiers, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000338**| 118 - M. Monira, commis aux Archives. - Versailles, imp. coopérative La Gutenberg, 1912. Plaquette grand in-4º de 51 pp. LESORT (A.). Rapport sur le service des Archives départementales, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000339**| -- - 119 à Dourdan (S.-et-O.), fondatrice de la Congrégation des Sœurs de la Présentation de la Sainte-Vierge. vol. grand in-8° de 584 pp. Portraits, vues de Dourdan, Sainville, etc. - Paris, Lethielleux, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000340**| -- - 120 ANONYMES Catalogue des monnaies, jetons et médailles du musée municipal d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000341**| 121 - Almanach-annuaire de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000342**| 122 - La Semaine religieuse du diocèse de Versailles, 8° année. Versailles 1912, pet. in-8° (hebdomadaire). La Revue de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000343**| CHRONIQUE LE CHATEAU DE DRAVEIL Les anciens et beaux domaines de nos environs disparaissent l'un après l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000344**| - -- 124 de quinconces, de bassins et bosquets, ornés eux-mêmes de statues et de groupes dûs aux grands artistes de ce temps, Girardon, entre autres. A la fin du XIX• siècle, le Château de Draveil était habité par la famille de M. Dalloz, le jurisconsulte bien connu pour ses ouvrages de droit. LA FÊTE DES ÉCOLES a ESSONNES le 21 juillet 1912 Corbeil ayant eu sa fête des Ecoles en 1911, Essonnes ne pouvait rester en arrière; il a donc, lui aussi, célébré la fête des Ecoles le 21 juillet 1912. Le programme, très chargé d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000345**| -― - 125 LOUIS ROBERT Les journaux de Paris ont publié, à la date du 10 juin 1912, la note suivante : « On a inauguré hier, à Vernouillet, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000346**| -- 126nière, en amont du pont, se trouvait le quai de l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000347**| 127 — nement son titre par sa situation en hauteur, entre la Seine qu' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000348**| NÉCROLOGIE 1912 Chaque année nous accomplissons le triste devoir de saluer la mémoire des Collègues que la mort nous a enlevés. C'est un tribut que nous payons à la règle commune et nous devons nous incliner devant la loi inexorable qui régit l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000349**| - - 129 Nous dirons plus loin ce qu'ils ont été pour nous et à quel titre nos regrets sont justifiés. M. Rubens Duval, de Morsang-sur-Seine, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000350**| - ―― 130 intéressants pour l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000351**| 131 - ― pendant la guerre de 1870. Appartenant à la classe de 1867, il fut incorporé le 1er juillet 1868 dans la garde mobile de Seine-et-Oise. Après la déclaration de la guerre, à la formation des cadres, il fut nommé sergent à la compagnie de Méréville, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000352**| - 132 Mesdames, Messieurs, Le digne homme auquel nous venons rendre les derniers devoirs était un membre très actif de notre Société archéologique de Corbeil-Etampes, | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000353**| - - 133 portant et rendra de réels services à ceux qui viendront après lui. Entre temps notre ami publiait des notices intéressantes sur divers sujets qui touchent tout particulièrement votre bonne ville d' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000354**| - - 134 MONSIEUR CHARLES MOTTHEAU M. Ch. Mottheau fut des nôtres tout à l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000355**| 135 - tion est étranger à la commune et n'en connaît ni l' | ||
| + | |||
| + | |**UCAL_$B769661_00000356**| TABLE DE LA 18° ANNÉE Statuts et règlement de la Société Liste des membres. . Conseil d' | ||