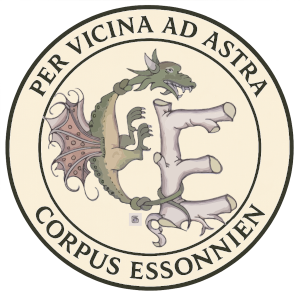per:shaceh.19.1913
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| per:shaceh.19.1913 [2025/11/23 16:28] – [PAGE EN CONSTRUCTION] bg | per:shaceh.19.1913 [2025/11/24 00:03] (Version actuelle) – bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | **[[bul.shaeh|SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | ======Bulletin n°19 (1913)==== | ||
| + | |||
| + | ======PAGE EN CONSTRUCTION====== | ||
| + | |||
| + | BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | MONTDIDIER. IMPRIMERIE BELLIN | ||
| + | |||
| + | BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL D' | ||
| + | |||
| + | PARIS A. PICARD, ÉDITEUR, LIBRAIRE DES ARCHIVES NATIONALES ET DE LA SOCIÉTÉ DE L' | ||
| + | |||
| + | |**V**| | ||
| + | SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**VI**| | ||
| + | Les mineurs ne seront admis dans la Société que sur le consentement soit de leurs parents, soit de leur tuteur. - ART. IV. Le titre de fondateur est acquis: 1° aux signataires des présents statuts, 2° à tout membre qui fait don à la Société d'une somme de cent francs au moins. ART. V. Chaque sociétaire paie une cotisation annuelle de dix francs; cependant cette cotisation est réduite à cinq francs pour les personnes appartenant au clergé et à l' | ||
| + | |||
| + | |**VII**| | ||
| + | ART. XIII. En cas de dissolution de la Société, les membres titulaires, réunis en une Assemblée générale spécialement convoquée à cet effet, seront appelés à statuer sur la liquidation de l' | ||
| + | |||
| + | |**VIII**| RÈGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**IX**| ART. V. Le Secrétaire rédacteur rédige les procès-verbaux des séances et est chargé de tout ce qui se rapporte à la correspondance. ART. VI. Le Trésorier est chargé du recouvrement des cotisations annuelles ; il paie les dépenses ordonnancées et donne, chaque année, à la séance générale, un état de la situation financière de la Société. ART. VII. ---- Le Conseil se réunit tous les trois mois ; cependant le Président peut le convoquer chaque fois que les intérêts de la Société l' | ||
| + | |||
| + | |**X**| | ||
| + | ART. XV. Les Sociétaires ont droit à toutes les publications de la Société à partir de l' | ||
| + | |||
| + | |**XI**| | ||
| + | LISTE DES MEMBRES Les noms précédés d'un astérisque (*) sont ceux des MEMBRES FONDATEURS qui ont racheté leur cotisation. MM. ALLEZ, au château de Belesbat, par Boutigny (S.-et-O.) et à Paris, rue de Berri, 5 bis (VIII). ALLORGE, Professeur de dessin à Montlhéry (S.-et-O.). AMIOT, avocat à la Cour, 207, Boulevard St-Germain, Paris (VII). AMODRU, ancien Député, 66, avenue des Champs-Elysées, | ||
| + | |||
| + | |**XII**| | ||
| + | BIBLIOTHÈQUE (la) COMMUNALE DE CORBEIL, représentée par M. DUFOUR, bibliothécaire. MM. +BIZEMONT (le Comte de), au Château du Tremblois (M.-et-M.). * BIZEMONT (le Comte de), 8, rue Girardet, à Nancy (M.-et-M.). BLONDEAU, Architecte à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne). BOBIN, Pharmacien à Étampes. BONNEFILLE, ancien Sénateur de Seine-et-Oise, | ||
| + | |||
| + | |**XIII**| | ||
| + | MM. CHEVALIER (Léon), Conseiller-Maître honoraire à la Cour des Comptes, à Soisy-sous-Étiolles, | ||
| + | |||
| + | |**XIV**| | ||
| + | DECAUVILLE (Mme), au Châlet Labrousse, à Saint Germain-lèsCorbeil. MM. DELABRECQUE, | ||
| + | |||
| + | |**XV**| | ||
| + | MM. FROMAGEOT, avocat, 11, rue de l' | ||
| + | |||
| + | |**XVI**| | ||
| + | MM. Houssoy (le Comte du), au Château de Frémigny, par Bouray, (S.-et-O.), et 5, rue Beaujon, à Paris (VIII). HUET (Edmond), 12, rue St-Jacques, à Étampes. HUTTEAU (Léonce), 3, rue Saint-Jacques à Etampes. * JACQUEMOT (l' | ||
| + | |||
| + | |**XVII**| | ||
| + | MM. LEPROUST (l' | ||
| + | |||
| + | |**XVIII**| | ||
| + | OUDIOU (Mme), 12, avenue Darblay, à Corbeil. PAILLARD, Huissier, à Brie-Comte-Robert (S.-et-M.). PAISANT, Président honoraire du Tribunal de Versailles, 47 rue Neuve à Versailles. MM. PALLAIN, Gouverneur de la Banque de France, Hôtel de la Banque, à Paris (Ier). PAPIN, Agent des Assurances générales, | ||
| + | |||
| + | |**XIX**| | ||
| + | MM. RESVE, Chef d' | ||
| + | |||
| + | |**XX**| | ||
| + | MM. *TREUILLE (Raoul), 156, rue de Rivoli, à Paris (Ier). TREILHARD (le Comte), au Château de Marolles-en-Hurepoix, | ||
| + | |||
| + | |**XXI**| | ||
| + | MEMBRES HONORAIRES CORRESPONDANTS MM. COÜARD (Emile), Archiviste de Seine-et-Oise, | ||
| + | |||
| + | |**XXII**| | ||
| + | LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D' | ||
| + | |||
| + | |**XXIII**| | ||
| + | SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES Société de l' | ||
| + | |||
| + | |**XXIV**| | ||
| + | |||
| + | |**1**| | ||
| + | SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D' | ||
| + | |||
| + | |**2**| | ||
| + | M. le Président dit que ces trois décès constituent pour la Société une perte cruelle, qu'en particulier M. Mottheau, par sa belle histoire de Brunoy, avait contribué à donner à nos publications l' | ||
| + | |||
| + | |**3**| | ||
| + | sera peut être pas supérieur à celui du premier volume déjà paru : 2 fr. 10. Le Conseil décide à l' | ||
| + | |||
| + | |**4**| | ||
| + | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Tenue le lundi 2 Juin 1913 à l' | ||
| + | |||
| + | |**5**| | ||
| + | port, aussi bien que par nos notices nécrologiques, | ||
| + | |||
| + | |**6**| | ||
| + | M. Mariez, Directeur de l' | ||
| + | |||
| + | |**7**| | ||
| + | peinture murale de l' | ||
| + | |||
| + | |**8**| | ||
| + | lettres, dont trois sont autographes, | ||
| + | |||
| + | |**9**| | ||
| + | et permettez-moi d' | ||
| + | |||
| + | |**10**| | ||
| + | Report. 834-80 Frais d' | ||
| + | |||
| + | |**11**| | ||
| + | compétence et le zèle qu'ils apportent à l' | ||
| + | |||
| + | |**12**| | ||
| + | Les membres du Comité de publication sont maintenus, à l' | ||
| + | |||
| + | |**13**| LA VOIE ROMAINE DE LYON A BOULOGNE ET UN CIMETIÈRE MÉROVINGIEN A VILLENEUVE-SAINT-GEORGES I Lorsque les Continents, en général, eurent reçu la forme qu'ils présentent actuellement, | ||
| + | |||
| + | |**14**| | ||
| + | cette voie venant en ligne directe de Condate (Montereau), | ||
| + | |||
| + | |**15**| | ||
| + | été seul pendant sa vie il voulait être seul après sa mort. Il se trompa, car il repose au milieu d'un ancien cimetière frank. Lors des travaux de plantation des arbres près de son tombeau, on trouva des squelettes entourés de fragments d' | ||
| + | |||
| + | |**16**| | ||
| + | posés actuellement à l' | ||
| + | |||
| + | |**17**| | ||
| + | |||
| + | =====LA PAROISSE DE SAINT-MARTIN D' | ||
| + | |||
| + | ===XI. HOTELLERIES ET MOULINS=== | ||
| + | |||
| + | Dans son excellent ouvrage sur les Rues d' | ||
| + | |||
| + | |**18**| | ||
| + | Cette auberge était tenue, en 1670, par François Baudet. La Pie. -30 Mai 1685, inhumé dans l' | ||
| + | |||
| + | |**19**| | ||
| + | 1742-1747-1763. - Pierre Davoust, aubergiste. 1746. 14 Mars, baptême, fait par le curé de Guillerval, de Pierre, fils de Pierre Davoust et de Jeanne Courtois ; parrain, ledit curé Pierre Courtois; marraine, Barbe Duverger. ; 1754.22 Septembre, inhumation de Françoise Davoust, veuve de Charles Boivin, âgée de 55 ans, en présence de Charles Boivin, prêtre, son fils. 1760 (acte de Saint-Gilles). Transporté au cimetière de la porte Saint-Martin, | ||
| + | |||
| + | |**20**| | ||
| + | moulins, au faubourg Saint-Martin, | ||
| + | |||
| + | |**21**| | ||
| + | 1650. - Jehan Conty, meunier du moulin de l' | ||
| + | |||
| + | |**22**| | ||
| + | Le moulin à tan est cité en 1739: « Pierre Charpentier, | ||
| + | |||
| + | |**23**| | ||
| + | niqué M. Dujardin et qui est intitulé: «Etat des terrains faisant partie des remparts et fossés de la ville et faux bourgs d' | ||
| + | |||
| + | |**24**| | ||
| + | Les héritiers de la fille Hamouy possèdent une partie de ces mêmes fossés derrière leurs jardins. Le nommé Aubert, maçon, rue Reverseleux, | ||
| + | |||
| + | |**25**| | ||
| + | Fossés du moulin de Chauffour, depuis les moulins dits Branleux, la Porte brûlée, jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**26**| | ||
| + | mant partie de la ville: tels sont les Belles-Croix, | ||
| + | |||
| + | |**27**| | ||
| + | 3 CHESNAY ་ Chesnay ou le Chesnay, l' | ||
| + | |||
| + | |**28**| | ||
| + | Gédéon des Mazis, escuyer, Sr de Challau¹; marraine, Geneviève Bonart, femme de Mtre Simon Egal, procureur du Roy dudit Estampes, de la paroisse Saint-Basile. 1598.15 février, Geneviève; marraine, damoiselle Geneviève Le Verrier, femme de N. H. Jacques Petau; parrain, N. H. Nicolas Cousté, lieutenant civil dudit bailliage; et madame Hélène, fille de feu N. H. Nicolas Petau, luy vivant bailly et gouverneur d' | ||
| + | |||
| + | |**29**| | ||
| + | En la même année 1629, le registre de Saint-Basile mentionne Martin de Veillard, fils de feu Guillaume. -- 1632. Lundy 23 Juin, marraine, damoiselle Elisabeth de La Tranchée, femme de N. H. François Hurault, Sr de Bonnes '. Charles de Veillard paraît s' | ||
| + | |||
| + | |**30**| | ||
| + | Il est cité, pour un aveu, dans l' | ||
| + | |||
| + | |**31**| | ||
| + | damoiselle Marie Des Mazis, fille de messire Pierre Des Mazis, Sr de Brières-les-Scellés. 1644. 4 novembre, Pierre ; parrain, Pierre Mortier, conseiller aumosnier du Roy, prieur du prieuré Saint-Thomas de la Rame; marraine, damoiselle Anne de Brizay. Le 15 Janvier 1654, le seigneur de Méréville acquit la métairie et les terres de Chesnay moyennant la somme de 1800 livres tournois, lisons-nous dans l' | ||
| + | |||
| + | |**32**| | ||
| + | sabeth Hurault, veuve de Charles de Veillard, Sr du Chesnay grand' | ||
| + | |||
| + | |**33**| | ||
| + | Charles, S' du Chesnay, et de damoiselle Elisabeth Hurault, de la paroisse Saint-Basile, | ||
| + | |||
| + | |**34**| | ||
| + | lard; marraine, Magdelaine de Normandin, fille de René et de Marguerite de Veillard. 1694.25 Janvier, mariage à la chapelle de Chesnay entre messire Pierre de Fiètes, chler, Sr de Chantonville, | ||
| + | |||
| + | |**35**| | ||
| + | 4 LHUMERY Lhumery, dévasté et incendié par les Anglais du Prince Noir, est, comme Chesnay, un village très ancien, dont le seigneur en partie était au xv° siècle, Jehan de Godainville, | ||
| + | |||
| + | |**36**| | ||
| + | René de Villezan, Sr de Guillerval; marraine, damoiselle Louise Poisloup (de Poilloue). 1637.20 Septembre, Paul de Marolles est parrain à Saint-Basile d'un enfant de Hugues Gaultier, receveur des Célestins. Il agit en la même qualité à Saint-Martin, | ||
| + | |||
| + | |**37**| | ||
| + | d'azur à deux épées d' | ||
| + | |||
| + | |**00000068**| - -- 38 - la ruelle du Petit Mesnil Girault, place Dauphine, et vis à vis la rue des Oisons, rue de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000069**| 39 - ville, faubourgs et villages circonvoisins, | ||
| + | |||
| + | |**00000070**| PINARD (THÉODULE) 1803-1871 Parmi les historiens de Corbeil, il serait injuste de ne pas citer Théodule Pinard, né à Corbeil le 4 février 1803 et mort à Paris, chez les Frères Saint-Jean de Dieu, le 19 novembre 1871. Pinard appartenait à une ancienne famille de Corbeil; son père, maître charpentier, | ||
| + | |||
| + | |**00000071**| - 41 ressante Chapelle du xiie siècle, une biographie de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000072**| 42 n'a pas été suivi d' | ||
| + | |||
| + | |**00000073**| BOISSY-SAINT-LÉGER Boissy, chef-lieu du canton, doit cet avantage à sa position au centre du pays. Ce petit bourg est assis au plus haut point d'une colline élevée ; et, malgré les dix-huit kilomètres qui le séparent de Paris, le regard étonné y embrasse le magique panorama de la grande cité. Son nom vient des mots latins Buxus ou Boscus. L'un indique l' | ||
| + | |||
| + | |**00000074**| --- - 44 dans la vie qu'il a donnée de Saint-Germain, | ||
| + | |||
| + | |**00000075**| -- ---- 45 la parole, au doux concert des anges terrestres qui chantaient dans le sanctuaire de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000076**| 46 - corer la chapelle de famille. Les tons de la peinture sont heureux. On admire, au plafond, quatre médaillons qui représentent saint Léger, saint Alexandre, saint Hubert et sainte Françoise, inspirés par Rubens, dont tout le monde connaît la Sainte Famille, œuvre capitale, dont est décorée l' | ||
| + | |||
| + | |**00000077**| - -- 47 du petit séminaire et reçut le titre de chanoine honoraire ; plus tard, il fut nommé chanoine titulaire de la métropole, et professeur à la faculté de théologie de Paris. L' | ||
| + | |||
| + | |**00000078**| 48 qu'ils avaient sur son domaine du Piple. On trouve dans les anciens documents de cette communauté, | ||
| + | |||
| + | |**00000079**| 49 La vue dont on y jouit est des plus exceptionnelles : Paris lui fait horizon. Madame la baronne Hottinguer, née Stéphanie MadeleineCaroline Delessert, a donné le jour, le 8 septembre 1846, au château du Piple, à Henri-François Hottinguer. GROSBOIS Ce qu'on trouve de plus ancien touchant la terre de Grosbois, qui donna naissance à un village et à une paroisse annexés à Boissy, est une fondation que le roi Charles V fit en faveur des Macicots ¹ de la Cathédrale de Paris. Ce prince leur assigna cent livres de rente sur cette terre, par des lettres données à Paris au mois de juillet 1367. Grosbois est un démembrement de Villecresnes; | ||
| + | |||
| + | |**00000080**| 50 pris son nom du fief de Harlay, dans le Vexin français. Né Calviniste, il se fit catholique parce que, disait-il, il fallait être de la religion de son prince, maxime qui donne la juste mesure de son caractère. D' | ||
| + | |||
| + | |**00000081**| | ||
| + | |||
| + | |**00000082**| | ||
| + | |||
| + | |**00000083**| - - 51 pescher de bastir toujours quelques maisonnettes; | ||
| + | |||
| + | |**00000084**| 52 -- Lorraine, Duc de Joyeuse, mort en 1654. La duchesse lui survécut jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**00000085**| 1 ECHARCON ¹ Le hasard des recherches m'a fait rencontrer dernièrement le procès-verbal d'une fête révolutionnaire qui eut lieu, à Echarcon, près de Mennecy, le 20 nivôse, an second de la République (jeudi 9 janvier 1794); et il m'a paru que ce récit devait faire suite aux notices révolutionnaires, | ||
| + | |||
| + | |**00000086**| --- - 54 Mais ces regrets sont stériles, hélas ! et nous ne pouvons que pardonner à ces hommes enivrés par les évènements extraordinaires auxquels ils se trouvaient tout à coup mêlés et qui, mûs par des sentiments généreux et un enthousiasme invincible, brûlaient un jour ce que la veille ils avaient adoré. A. D. UNE FÊTE RÉVOLUTIONNAIRE A ECHARCON Aujourd' | ||
| + | |||
| + | |**00000087**| 55 les deux pilastres, le citoyen Housta ayant chanté un hymne en l' | ||
| + | |||
| + | |**00000088**| ― -- - 56 - EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA MUNICIPALITÉ DE LA COMMUNE DE CORBEIL. Séance publique du 18 Prairial, an 3me de la République française une et indivisible (6 juin 1795). Il s'est présenté à la séance plusieurs habitants de cette commune et nommément les Citoyens Massé, Duperray, Philipon, Gauthier, Ory, Bezard, Charon, Davier, Milon, l' | ||
| + | |||
| + | |**00000089**| LE VOYAGE DE LOUIS XIV ET D'ANNE D' | ||
| + | |||
| + | |**00000090**| 58 - - allons essayer de tracer l' | ||
| + | |||
| + | |**00000091**| - 59 Le 7, la Cour devant faire son entrée à Bourges entre trois et quatre heures, un exempt des gardes du corps et les échevins sommèrent de la Rozière, gouverneur de la grosse tour, de la rendre, ce qu'il fit après avoir cependant manifesté, d' | ||
| + | |||
| + | |**00000092**| 60 - cour n'y descendit pas au château Raoul, propriété du prince de Condé, mais à l' | ||
| + | |||
| + | |**00000093**| - - 61 Le même jour, 27 mars, Mathieu Molé se présente avec le Conseil du roi aux portes d' | ||
| + | |||
| + | |**00000094**| 62 troupes qu'il avait à Briare ce qu'il peut rassembler de celles dispersées par Condé. Celui-ci comptait 12.000, Turenne n'en avait que 4.000. Les deux adversaires se rencontrèrent entre les bois du lieu dit Dreux et l' | ||
| + | |||
| + | |**00000095**| - 63 Princes, composée de Rohan, Chavigny et Goulas, lesquels furent admis dans la balustrade du lit de la Reine, et le roi les conduisit à Mazarin, avec lequel ils conférèrent. Celui-ci leur déclara que la volonté expresse du roi et de la Reine était de le conserver comme premier ministre. Le Parlement promettait son concours à Condé s'il ne demandait que l' | ||
| + | |||
| + | |**00000096**| - - 64 Le 24 mai, elle alla de St-Germain à Corbeil et c'est ce même jour que Turenne alla assiéger Etampes à la tête de 10.000 hommes. Tavannes, lieutenant de Condé, n'en comptait plus que 6 à 7.000. Il commandait les troupes de Condé, Valon celles du duc d' | ||
| + | |||
| + | |**00000097**| 65 plus Delaporte le pressait pour savoir ce qu'il en avait fait et moins le roi avait envie de le dire. Enfin, raconte Delaporte, je devinai, et lui dis n' | ||
| + | |||
| + | |**00000098**| 66 << à la frontière et qu'on lui fournirait des étapes convenables. << Ce traité ¹ fut exécuté de la part du roy, mais le duc de Lorraine << temporisa pour complaire aux Princes qui luy firent entendre << qu' | ||
| + | |||
| + | |**00000099**| ― - 67 contre leurs auteurs reconnus coupables: la foule devenue furieuse avait en effet chargé les magistrats à coups de poings, de bâtons et même de fusils: aucun ne fut tué, mais beaucoup furent blessés ou gravement maltraités. La Cour, dans les derniers jours de juin, quitta Melun pour aller à Saint-Denis, | ||
| + | |||
| + | |**00000100**| - --- 68 son mari! Mademoiselle de Montpensier avait, malgré la différence d' | ||
| + | |||
| + | |**00000101**| -- ―― 69 sort de France, et d' | ||
| + | |||
| + | |**00000102**| 70 comme tel sa démission, ne voulant pas, avait-il dit, être un obstacle à la réconciliation du corps de ville avec le roi. Cette assemblée provoquée par les six corps des marchands le 24 septembre, et qui se tint au Palais royal, avait dénoncé Condé comme la cause de tous les maux dont souffrait la France. << Il s'y entassa plus de 4.000 personnes, bourgeois, conseillers du << Parlement, gentils hommes et menu peuple, on y vota le refus de << toute taxe imposée par les princes, une députation au roi pour le << prier de revenir à Paris, le droit de courir sus aux troupes de << Condé et l' | ||
| + | |||
| + | |**00000103**| 71 renne, et arriva le soir à Paris au milieu des acclamations universelles et s' | ||
| + | |||
| + | |**00000104**| LE MIRACLE DE LA VISITATION DE NOTRE-DAME ET L' | ||
| + | |||
| + | |**00000105**| 73 Tout le mystère était raconté dans un petit livre rarissime dont, en fait, on signale un seul exemplaire, conservé à la Bibliothèque Mazarine; imprimé, en 1610, sous la signature H. B. T., l' | ||
| + | |||
| + | |**00000106**| 74 - que, à cette période de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000107**| 75 - 1562, ils brûlèrent des livres de médecine en assez grand nombre, semble-t-il. Enfin, à l' | ||
| + | |||
| + | |**00000108**| ― 76 jouvenceaux et d'une jeune pucelle. Cecy augmente davantage son estonnement et recognoissant que tout cela n' | ||
| + | |||
| + | |**00000109**| - 77 Tout n'est pas légendaire et mystérieux dans le récit: on distingue parfaitement les points vraisemblables et même ceux dont le caractère est encore plus franchement véridique; c'est bien un évènement, | ||
| + | |||
| + | |**00000110**| 78 - car la de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000111**| 79 lontiers en lui la circonstance qui a précipité la construction du croisillon sud, en faisant afffuer les dons, le fait qui a si fortement agité les âmes que pour élever cette partie du transept on a délibérément osé appuyer le nouveau mur occidental du croisillon contre l' | ||
| + | |||
| + | |**00000112**| 80 jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**00000113**| 81 cesse, mais inutilement. Les articles des conciles fourmillent d' | ||
| + | |||
| + | |**00000114**| 82 --- refuge aux habitants. En résumé, l' | ||
| + | |||
| + | |**00000115**| | ||
| + | |||
| + | |**00000116**| | ||
| + | |||
| + | NOTRE-DAME DE VISITATIONS PETIT GROUPE EN BOIS DANS L' | ||
| + | |||
| + | |**00000117**| 83 - Un dernier petit détail du récit doit aussi retenir l' | ||
| + | |||
| + | |**00000118**| 84 - ne remonte pas plus haut que le xvi siècle ¹, l' | ||
| + | |||
| + | |**00000119**| -- 85 sera pas possible de faire autrement; on ne conçoit guère comment on peut mettre deux malades dans des lits de trois pieds ». Trois pieds, cela équivaut à un mètre : c'est peu de largeur, en effet. M. Paul Pinson a expliqué que les lits-doubles avaient quatre pieds et étaient divisés en deux couchettes égales par une cloison triangulaire dressée au milieu. Ainsi, non seulement les malades n' | ||
| + | |||
| + | |**00000120**| LA PAROISSE DE SAINT-MARTIN D' | ||
| + | |||
| + | |**00000121**| - - - 87 - LE PETIT SAINT-MARD Le nom de ce hameau est écrit « le Petit S. Mars», selon l' | ||
| + | |||
| + | |**00000122**| 88 Quelques-unes d' | ||
| + | |||
| + | |**00000123**| - --- 89 et du Petit Villiers, comme il est dit dans l'un de nos premiers chapitres. De ce second mariage sont issus : 1655. --12 jour d' | ||
| + | |||
| + | |**00000124**| go 1662 30 mars, Pierre; parrain, N. H. Pierre Demazis; marraine Françoise Hochereau, femme d' | ||
| + | |||
| + | |**00000125**| - - 91 Dubain, conseiller receveur des tailles de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000126**| 92 - seiller du Roy, lieutenant particulier au baillage; marraine, Louise de Laumoy, fille de messire Louis de Laumoy, chevalier, seigneur de Gironville-sous-Buno . Louis de Poilloue mourut en 1721, à l'âge de 55 ans ; il fut inhumé dans l' | ||
| + | |||
| + | |**00000127**| 93 - lieutenant général de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000128**| 94 - fille, Charlotte, mariée à M. Hery de Sabrevois, qui prit le titre de seigneur de Baudeville. Ils eurent un fils, mort à l'âge de 10 ans, en 1739, et inhumé en l' | ||
| + | |||
| + | |**00000129**| - 95 gages de 3.000 livres par an; - quittances de 45.000 livres payées pour le dit office par le chevalier de S. Périer qui déclare avoir emprunté sur cette somme 15.000 livres à Joseph Desfèvres, et 10.000 à Thimoléon Duman, tous deux bourgeois de Paris, et de 252 livres pour le droit du marc d'or de la première provision. de « Lettres de Louis XV nommant le chevalier de S. Périer, maréchal camp à l' | ||
| + | |||
| + | |**00000130**| 96 - - marraine dame Jeanne Catherine Quantin, épouse de messire Pierre René de Brizay, chevalier comte de Denonville, brigadier des armées du Roy, lieutenant général du pays chartrain. 8° Chatrine (Catherine), | ||
| + | |||
| + | |**00000131**| - - 97 son neveu, de M. Thomas Lucien de Bouraine, receveur des tailles. 1761. - 16 décembre, parrain, César Joachim de Poilloue, Sr de S. Mars et de Simpérier; marraine, damoiselle Charlotte Clémence Angélique Julie de Poilloue de Valnay. Ce baptême a été administré par Louis René de Poilloue de S. Mars, prêtre. - 1767. — 3 mai, acte de mariage qui porte les signatures de Françoise Poilloue de S. Mars, Aimée Geneviève de Bonnevaux, Catherine Poilloue de S. Périer. 1769. — 11 janvier, baptême de Jean-Baptiste, | ||
| + | |||
| + | |**00000132**| BOISSY-SAINT-LÉGER I (Suite) ¹ Samuel Bernard n' | ||
| + | |||
| + | |**00000133**| 99 - les Carmes de la place Maubert. De son mariage avec Anne Cahouet, il eut un fils et trois filles: Charles-Louis, | ||
| + | |||
| + | |**00000134**| 100 moins importants de sinistres présages; et pourtant il refusa plusieurs fois de se rendre à la cour, que venait de créer le premier consul. Impliqué dans la conspiration de Pichegru et de George, le général Moreau fut arrêté, mis en jugement et condamné le 10 juin 1804. Il obtint de se retirer aux Etats-Unis. Son épouse, voulant partager son infortune, vendit Grosbois au maréchal Berthier. Après la restauration, | ||
| + | |||
| + | |**00000135**| ΠΟΙ Le château de Grosbois consiste en plusieurs corps de bâtiments d'un style général de décoration. La pierre et la brique ont été employées à sa construction. Son comble, recouvert d' | ||
| + | |||
| + | |**00000136**| 102 Paris pour lui faire leurs adieux, et le lendemain elle partait pour Vienne. C' | ||
| + | |||
| + | |**00000137**| - -- 103 Lacarrière. On a un arrêt du grand conseil du 9 janvier 1731, rendu en faveur de André de Vouges, écuyer, seigneur de Châteauclair, | ||
| + | |||
| + | |**00000138**| - 104 Des voisins à Grosbois; son épitaphe, au cimetière du Père-Lachaise, | ||
| + | |||
| + | |**00000139**| LES COSAQUES A ÉTAMPES EN 1814 ET LE PILLAGE DU CHATEAU DE BOIS-HERPIN Bien que la région d' | ||
| + | |||
| + | |**00000140**| 106 ― née à Etampes le 11 juin 1781, cinquième enfant de Jean-Baptiste de Poilloüe, comte de Bonnevaux, Sieur d'Izy, ancien garde du corps du Roi, et de Marguerite-Julie de Germay; elle est adressée à son frère Auguste-Jean-Baptiste de Poilloüe, comte de Bonnevaux, né à Etampes le 17 avril 1778, ancien officier d' | ||
| + | |||
| + | |**00000141**| 107 I les plus indisciplinés et les plus pillards ¹; le reste est campé audessus de Morigny. 2 Ils viennent de piller entièrement le château de Bois-Herpin dont les habitants sont accourus tous ici ; nous en avons onze, tant maîtres que domestiques, | ||
| + | |||
| + | |**00000142**| 108 - à 4 heures, Madame de G. et sa fille se jetèrent à leurs genoux et les prièrent de leur ôter la vie. Le chef prit la tête de Madame de Pillot dans ses deux mains avec un air de pitié et, d'un seul signe de main, fit sortir tout son monde. Les bonnes avaient sauvé les cinq enfants (dont un de six mois que la mère nourrit) dans un grenier à la Forêt 2 ; les autres domestiques s' | ||
| + | |||
| + | |**00000143**| 109 - Nous commençons à nous y faire. Plusieurs jeunes gens d'ici, voire même Saint Périer sont déjà allés à Paris se présenter et, dit-on, demander des places ; cela se dit à l' | ||
| + | |||
| + | |**00000144**| - 110 piller chez lui: le général lui fit donner tant de coups de corde (au cosaque) qu'il en est mort. Il est malheureux d' | ||
| + | |||
| + | |**00000145**| LES RUES DE CORBEIL SOUS LA RÉVOLUTION AVANT-PROPOS A l' | ||
| + | |||
| + | |**00000146**| J12 s'est trouvé, à cette époque, un homme aussi honnête qu' | ||
| + | |||
| + | |**00000147**| LES RUES DE CORBEIL PENDANT LA RÉVOLUTION La ville de Corbeil était autrefois divisée en quartiers.Sous la république, | ||
| + | |||
| + | |**00000148**| - --- 114 NOMS ANCIENS Rue de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000149**| www 115 NOMS ANCIENS Rue des Marines SECTION DE L' | ||
| + | |||
| + | |**00000150**| - -- - 116 - NOMS ANCIENS Rue du petit-Bercy des boucheries 19 Chemin de Soisy NOMS NOUVEAUX Rue des battoirs18 de la Charrue Chemin de Soisy SECTION DE LA FRATERNITÉ Rue de la porte de Paris des Bordes des petites bordes de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000151**| 117 NOMS ANCIENS Rue des rosiers et de la renard du grand pignon du petit St-Jean 25 de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000152**| - ― 118 NOMS ANCIENS Port Saint-Laurent 29 Saint-Guenault de la Pêcherie des Cavaliers 30 des boulangers 31 de la Motte 32 LES PORTS NOMS NOUVEAUX Port des connins des Coches des sans-culottes des Gendarmes de la liberté des libres des battoirs de Bercy 33 du Sabot des sabots à côté de Lepère des Jacobins PLACES Place d' | ||
| + | |||
| + | |**00000153**| - -- 119 quels, de toute antiquité, se tenaient fêtes, revues et cérémonies, | ||
| + | |||
| + | |**00000154**| PROMENADE ARCHÉOLOGIQUE A SENS (23 JUIN 1913) La société historique et archéologique de Corbeil-Etampes et du Hurepoix a fait, le lundi 23 juin, son excursion annuelle à Sens. Favorisée par un temps superbe, chaud sans excès, cette excursion a été on ne peut plus réussie, et a laissé, aux 41 membres de la société, qui y ont pris part, le souvenir le meilleur. L' | ||
| + | |||
| + | |**00000155**| 121 Plaçons ici la liste des excursionnistes. Venus de Corbeil en chemin de fer : M. Bataille, M. et Mme Bonnefoy (de Paris), M. Cros, M. et Mme Dameron, M. et Mme Darnet, M. Delaunay (de Saintry), M. Dufour, M. le général Durand, M. Fontaine (de Paris), M. et Mme Jarry; M. Lelong, M. et Mme Robin, M. et Mme Rousseaux. Venus de Brunoy en automobile : M. et Mme Fosse, M. Mme et Mlles Humbert. Venus de Corbeil en automobile : MM. Girard (père et fils), (de Montceaux), Maurice Mainfroy, l' | ||
| + | |||
| + | |**00000156**| 122 C où l'on retrouve les caractéristiques des architectures bourguignonne et champenoise. Nous remercions chaleureusement M. Perrin qui sut être à la fois si complet et si précis dans ses explications, | ||
| + | |||
| + | |**00000157**| - 123 historique et en parfait état d' | ||
| + | |||
| + | |**00000158**| ― ― 124 bre du conseil supérieur de la guerre, a bien voulu se joindre à nous. Je suis heureux de le saluer respectueusement, | ||
| + | |||
| + | |**00000159**| 125 A cette époque, Sens était la vraie métropole religieuse de la France et brillait d'un vif éclat par son école de théologie et par les arts religieux, principalement par la musique. Nous ne verrons pas un précieux manuscrit qui, depuis douze ans est enfermé dans la caisse du receveur municipal de Sens, le manuscrit de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000160**| - 126 M. l' | ||
| + | |||
| + | |**00000161**| - - 127 trop oublié, trop dénigré par quelques esthètes réfoi mateurs, qui n'ont d' | ||
| + | |||
| + | |**00000162**| - - 128 Dans une improvisation chaudement applaudie, M. Ch. Normand a rappelé le grand succès obtenu par la société qu'il préside : après des années d' | ||
| + | |||
| + | |**00000163**| BIBLIOGRAPHIE (1913) ALLIOT (l' | ||
| + | |||
| + | |**00000164**| 130 - DUFOUR (A.). Quatre lettres autographes de Jacques Bourgoin, dit de Corbeil. ―― 1562. In-8° extrait du Bulletin de 1912, de la Société de Corbeil-Etampes. ― DUFOUR (A.). canton de Corbeil. Echarcon, une fête révolutionnaire à Echarcon, In-8° extrait du bulletin de 1913. de la Société de Corbeil-Etampes. DUFOUR (A.). Le rétablissement du culte à Corbeil en 1795. In-8° extrait du bulletin de 1913 de la Société de Corbeil-Etampes. DUFOUR (A.). Monographie de Boissy-Saint-Léger, | ||
| + | |||
| + | |**00000165**| 131 GALTIER (Emile). ― Histoire de Saint-Maur-des-fossés depuis les origines jusqu' | ||
| + | |||
| + | |**00000166**| 132 MAREUSE (E.) - Chronique de l' | ||
| + | |||
| + | |**00000167**| 133 PÉRIODIQUES Abeille (L') de Seine-et-Oise, | ||
| + | |||
| + | |**00000168**| ― ― 134 4° année 7 février 1914-in-folio à 4 colonnes, paraissant tous les samedis. Administration, | ||
| + | |||
| + | |**00000169**| 135 Le Semeur, journal départemental hebdomadaire, | ||
| + | |||
| + | |**00000170**| CHRONIQUE 1913 L' | ||
| + | |||
| + | |**00000171**| 137 GRANDE FÊTE DE L' | ||
| + | |||
| + | |**00000172**| NÉCROLOGIE Chaque année nous payons un tribut douloureux à la loi commune, en inscrivant les noms des collègues disparus, en rappelant la place qu'ils tenaient parmi nous et en rendant justice à leurs mérites. C'est un triste devoir qui n'est adouci que par la pensée que ces pertes n'ont pas été trop nombreuses ; et c'est le cas pour 1913 qui ne nous a fait perdre que cinq collègues. En 1912 nous n'en avions perdu que trois. Les cinq collègues dont nous venons ici saluer la mémoire sont : Monsieur l' | ||
| + | |||
| + | |**00000173**| 139 M. Mallet était estimé et apprécié par delà nos murs, aussi sa perte a été vivement ressentie à Corbeil, à Paris et même dans les provinces éloignées. M. Roger d' | ||
| + | |||
| + | |**00000174**| TABLE DE LA 19° ANNÉE Statuts et règlement de la Société Liste des membres. Conseil d' | ||
| + | |||