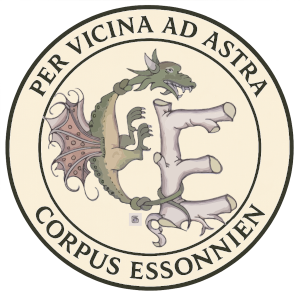Table des matières
Léon Marquis (1867)
Notice historique sur le château féodal d'Étampes
NOTICE HISTORIQUE
SUR LE
CHÂTEAU FÉODAL D'ÉTAMPES
L'une des curiosités archéologiques les plus remarquables des environs de Paris
PAR
Léon MARQUIS
PARIS AUG. AUBRY, LIBRAIRE, rue Dauphine, 16 DUMOULIN, LIBRAIRE, quai des Augustins, 13 CHEZ TOUS LES LIBRAIRES 1867 |2|
NOTICE HISTORIQUE
SUR
LE CHÂTEAU FÉODAL D'ÉTAMPES
| 4 | ÉTAMPES — IMPRIMERIE DE AUG. ALLIEN. | 5 |
NOTICE HISTORIQUE
SUR LE
CHÂTEAU FÉODAL D'ÉTAMPES
L'une des curiosités archéologiques les plus remarquables des environs de Paris
PAR
Léon MARQUIS
Les ruines fournissent au cœur de majestueux souvenirs,
et aux arts des compositions touchantes.
— Chateaubriand*, Génie du Christianisme, 3ᵉ partie, livre V, chap. 3.
PARIS AUG. AUBRY, LIBRAIRE, rue Dauphine, 16 DUMOULIN, LIBRAIRE, quai des Augustins, 13 ÉTAMPES — Chez tous les libraires 1867 |8| |9|
À MONSIEUR Th. Charpentier, Maire de la ville d'Étampes, Membre du Conseil général de Seine-et-Oise, Officier d’Académie, Chevalier de la Légion d'honneur.
Monsieur,
J’ai essayé, après bien d'autres, d’attirer l’attention publique sur les monuments archéologiques d’une cité à laquelle je tiens par les entrailles.
Le peu que je sais, le peu que je suis, je le dois à la générosité de l’administration municipale d’Étampes, et surtout à votre bienveillant appui, qui ne m’a jamais fait défaut. |10|
Aussi, Monsieur, en agréant l’hommage d’un modeste opuscule qui n’a peut-être d’autre mérite que les efforts qu’il m’a coûtés, vous me donneriez un nouveau témoignage d’intérêt dont je vous serais infiniment reconnaissant.
Léon MARQUIS |11|
NOTICE HISTORIQUE
SUR
LE CHÂTEAU FÉODAL D'ÉTAMPES
CHAPITRE Ier — PRÉLIMINAIRES
*La tour de Guinette. — Le manoir d’Estampes. — Origines. — Armoiries. — Étymologies.*
Le voyageur qui d’Orléans se dirige vers Paris aperçoit, sur sa gauche, à la station d’Étampes, une colline surmontée de ruines gigantesques, consistant principalement en une vieille tour désignée dans la localité, et au loin à la ronde, sous le nom de tour de Guinette.
Cette tour est le reste du donjon du castel d’Estampes, devenu à jamais célèbre par les souvenirs qui se rattachent à son histoire.
L’origine du château d’Étampes est restée inconnue. On croit que ce castel date de l’époque gallo-romaine, mais qu’il a été rebâti plusieurs fois, et que le bon roi Robert-le-Pieux lui a donné une grande importance.
La ville était alors divisée en deux parties : l’une, du côté de Paris, qui s’appelait *Estampes-le-Chastel* ou *Estampes-les-Nouvelles*, fut bâtie par Robert-le-Pieux, ou au moins considérablement agrandie par ce roi ; l’autre, la plus ancienne, qui |12| la plus ancienne, qui remonte à deux mille ans, nommée par cela même *Estampes-les-Vieilles*, comprenait du côté d’Orléans le bourg Saint-Martin 1).
Dom Basile Fleureau, dans son *Histoire des Antiquitez de la ville et du duché d’Estampes*, dit qu’on n’a pas de preuves suffisantes pour justifier que le roi Robert ait été le fondateur d’Estampes-les-Nouvelles ou Estampes-le-Chastel 2).
On voit dans l’*Histoire du Gastinois*, par dom Guillaume Morin, que :
« Le roi Robert fit construire à Estampes un château de forte structure,
y fonda l’église Notre-Dame où il mit un collège de chanoines,
et ordonna le comté d’Estampes à son frère naturel Amaury,
le même qui fit bâtir Montfort-l’Amaury. » 3)
André Du Chesne ne doute pas non plus que
« le roi Robert n’ait jeté les premiers fondements du chasteau d’Estampes. » 4)
Le chroniqueur Helgaud dit que
« la reine Constance, seconde femme de Robert-le-Pieux,
avait fait bâtir un beau palais et un oratoire au castel d’Estampes. » 5)
Avant le roi Robert, on ne trouve dans l’histoire aucune trace d’Estampes-le-Chastel. |13|
On doit donc conclure que le nom d’Estampes-le-Chastel fut donné à cette partie de la ville à cause de la construction d’une vaste forteresse.
Du reste, une tradition locale bien connue attribue la construction du châtel d’Étampes au roi Robert. Ainsi, cette forteresse a été bâtie ou reconstruite sous Robert-le-Pieux, vers l’an 1020.
Sur des pièces de monnaie en argent de Philippe Ier, on trouve ces mots latins :
CASTELLVM STAMPIS (c’est-à-dire : Estampes-le-Chastel) 6)
Il existe plusieurs modèles de ces pièces. Voici un dessin que nous extrayons des *Essais historiques sur la ville d’Étampes*, par M. Maxime de Mont-Rond 7) :
(Fig. 1) — Pièce de monnaie frappée à Étampes.
Voici un autre dessin tiré des *Monnaies féodales*, par Faustin Poey d’Avant :
 |14|
Poey d’Avant, que nous devons à l’obligeante communication de MM. Rollin, à Paris 8).
|14|
Poey d’Avant, que nous devons à l’obligeante communication de MM. Rollin, à Paris 8).
(Fig. 2) — Autre pièce de monnaie frappée à Étampes.
Il existe aussi des pièces analogues de Louis VI et de Louis VII.
Il est donc clairement établi que le château d’Étampes existait à la fin du XIe siècle.
L’histoire ne nous a laissé que très peu de documents sur le château. Néanmoins, quelques écrivains ont pu fournir récemment de précieux renseignements déduits d’un examen sérieux des ruines du donjon. Non seulement ils ont assigné une époque à cette construction, mais ils ont donné aussi de curieux détails sur ses dispositions intérieures.
Dans sa *Notice sur le donjon d’Étampes*, insérée dans le *Bulletin monumental*, M. Victor Petit en fait remonter l’origine à la fin du XIe siècle, et pour ainsi dire « à la première période du règne de Philippe-Auguste, de 1180 à 1200 » 9).
D’après M. Viollet-le-Duc,
« On ne doit assigner à la construction du donjon d’Étampes une époque antérieure à 1150,
ni postérieure à 1170. » 10) |15|
Tout ceci ne s’applique évidemment qu’au donjon, et ne contredit pas ce que nous avons dit sur l’origine du château. Comme le dit M. Victor Petit :
« On doit présumer que Philippe-Auguste,
qui pourvut à la défense des villes de ses États en les entourant de hautes murailles,
a achevé la forteresse commencée par Robert-le-Pieux
et bâti le donjon dont on admire encore les ruines. » 11)
Les emblèmes qui composent les blasons des villes ont généralement été adoptés pour perpétuer le souvenir des circonstances particulières de leur fondation ou de leur histoire. Les armes de la ville en sont un exemple frappant.
Plusieurs symboles ont été adoptés successivement pour les armoiries de cette cité ; ils rappellent sans contredit le castel qui a donné naissance à la nouvelle ville :
« De gueules, à un château maçonné de sable,
chargé d’un écu écartelé aux 1er et 4e de France,
aux 2e et 3e de gueules à la tour d’or crénelée d’argent. » 12)
« De gueules, à une tour crénelée d’or, flanquée de deux tourelles en forme de guérite,
aussi d’or ; la tour ouverte et ajourée de sable,
chargée d’un écusson d’azur à trois fleurs de lys d’or, deux et une,
et brisé en cœur d’un bâton raccourci et péri en bande de gueules,
chargé de trois lionceaux d’argent. » 13)
« De gueules, à une tour crénelée, flanquée de deux tourelles en forme de guérites,
le tout d’or, ouvert, ajouré et maçonné de sable ;
au-dessus de la porte de la tour, un écusson… »
Nous devons à M. Viollet-le-Duc les plus sincères remerciements pour ses conseils judicieux et pour les encouragements qu’il a bien voulu nous donner. |16|
« De gueules, à un château d’or crénelé et surmonté d’une tour carrée et crénelée du même,
chargée d’un écusson écartelé, au premier et au quatrième de France,
au deuxième et au troisième de gueules à une tour d’or. » 14)
« De gueules, à trois tours crénelées d’or, accolées ensemble et finissant en cul-de-lampe ;
celle du milieu plus haute et plus basse que les deux autres,
est chargée dans son milieu d’un écusson écartelé :
le 1er et le 4e d’azur à une fleur de lis d’or,
le 2e et le 3e de gueules à une tour crénelée d’or. » 15)
Dans chacun de ces symboles, qui ont entre eux une certaine ressemblance, on croit reconnaître la grosse tour en ruines de l’ancien château : l’un d’eux surtout mentionne une tour carrée, et le plan du donjon d’Étampes ne s’éloigne pas beaucoup de cette forme.
L’étymologie du mot *Guinette* est encore plus obscure que l’origine du château dont cette tour marque l’emplacement.
- Les uns disent que *Guinette* vient du seigneur Gui, fils de Hugues du Puiset,
et vicomte d’Étampes sous le règne de Louis-le-Gros.
- D’autres prétendent que ce nom est d’origine gauloise,
et croient reconnaître dans les vestiges du castel d’Étampes les ruines d’un temple druidique où se faisait la consécration solennelle du gui.
- Mais la plupart des étymologistes font venir avec raison *Guinette*
du vieux mot français *guignier* (voir de loin, observer), parce que la situation et l’élévation de cette tour la rendaient propre à cet usage. ((De Mont-Rond, t. I, p. 49.))
(1) Traversier, *Armorial national de France*, Paris, 1843, p. 27. (2) (3) (4)
| 17 |
CHAPITRE II — HISTOIRE
1. Le château sous les rois Robert-le-Pieux, Philippe Ier, Louis VI, Louis VII (1020–1193)
Chez Helgaud, on trouve l’anecdote suivante qui s’est passée au palais d’Étampes-le-Chastel, sous Robert-le-Pieux (1) :
La reine Constance avait fait bâtir un beau palais et un oratoire au château d’Étampes.
Quand ce palais fut construit, le roi, fort content, y vint dîner avec sa cour ;
et, voulant que rien ne manquât à la fête — ou plutôt que la fête en fût une pour tout le monde —
il ordonna que tous les pauvres qui se présenteraient fussent admis auprès de lui :
la salle du festin en fut bientôt remplie.
Pendant le repas, l’un d’eux se glissa sous la table comme un chien
et se coucha aux pieds du roi.
Pendant que Robert lui passait des vivres,
le pauvre profita de cette familiarité pour s’emparer d’un riche bijou
qui pendait au vêtement royal, puis s’esquiva.
Ce bijou avait une valeur de six onces d’or et s’appelait le *jabel*.
Le roi ne crut pas devoir remarquer le larcin.
Quand le repas fut fini, on ordonna à tous les pauvres de se retirer.
Le roi se leva de table, et la reine Constance, s’étant aperçue aussitôt de la lacune
dans la toilette de son royal époux, s’écria en colère :
« Ah ! bon seigneur, quel est l’ennemi de…
(1) On suppose que le château et le palais ne formaient alors qu’une seule et immense propriété.
| 18 |
> « Dieu, qui a déshonoré ainsi votre vêtement royal en le dépouillant de ce qu’il avait de plus précieux ? »
Le roi répondit :
« Personne ne m’a déshonoré ; celui qui m’a enlevé cet ornement en avait plus besoin que moi ;
ce vol, grâce à Dieu, lui profitera. »
Et, se réjouissant de la perte qu’il venait de faire, il se rendit dans son oratoire. Là étaient présents : Guillaume, abbé de Dijon, le comte Eudes et plusieurs grands du royaume. 16)
Quand le roi Robert passait à Étampes et dans quelques autres villes, il faisait distribuer abondamment du pain, du vin et des aliments à trois cents, et quelquefois à mille pauvres. Le Jeudi saint, il assemblait avec soin plus de trois cents pauvres ; et lui-même, à la troisième heure du jour, leur servait à chacun des légumes, des poissons, du vin, et leur donnait un denier.
À la sixième heure, après avoir fait de semblables aumônes à cent pauvres clercs et gratifié d’un denier douze d’entre eux, il chantait de cœur et de bouche les cantiques du roi-prophète ; puis, ceignant un cilice, il lavait les pieds des douze pauvres, les essuyait avec ses cheveux, et après le repas donnait à chacun deux sous. 17)
Un acte passé à Étampes-le-Châtel, en 1030, prouve que Robert-le-Pieux y séjournait quelquefois. 18)
Des prévôts, des baillis et des vicomtes commandèrent autrefois au château d’Étampes. Un vicomte en avait la garde vers l’an 1100, quand Louis VI, dit le Gros, fut associé au trône par Philippe Ier, son père, qui éprouvait le besoin de réprimer ses vassaux rebelles. Le jeune prince, âgé de vingt-deux ans, se signala aussitôt contre les barons du nord de Paris ; et plus tard, devenu roi, c’est du château d’Étampes qu’il partit pour |19| batailler contre ses grands vassaux, c’est-à-dire les sires de Montlhéry, du Puiset, de Rochefort, et d’autres seigneurs qui, maîtres d’une foule de places inexpugnables enserrant la capitale, interceptaient les communications de Paris à Orléans et bravaient impunément la colère des souverains. (1)
Qu’on lise La Tour de Montlhéry, de M. Viennet, et on aura une idée nette de la situation que les seigneurs féodaux avaient faite à nos rois en ce temps-là. (2)
En 1107, Louis-le-Gros fit mettre en prison dans la tour d’Étampes le seigneur Hombaus, châtelain de Sainte-Sévère, pour le châtier des outrages qu’il faisait subir aux habitants des campagnes. Tous les gens qui étaient renfermés dans le château de Sainte-Sévère furent pendus après qu’on leur eût crevé les yeux, et les bâtiments du seigneur rebelle furent détruits de fond en comble. Cette nouvelle répandit la terreur dans tout le pays. (3)
Ce fut sous Louis-le-Gros, en 1130, que se tint au château le quatrième concile d’Étampes, pour décider lequel avait été élu légalement à la papauté : Anaclet II ou Innocent II. Saint Bernard, ce simple moine, véritable chef du monde chrétien, se prononça pour Innocent II, qui fut reconnu par l’Église. (4)
(1) Le Puiset (près de Toury) est aujourd’hui en ruines. Montlhéry, dont la tour majestueuse est visible depuis la station de Saint-Michel, se trouve entre Étampes et Paris. Rochefort, à vingt kilomètres au nord-ouest d’Étampes, est également en ruines.
(2) Viennet, *La Tour de Montlhéry* ; Dulaure, *Histoire des environs de Paris*, 1828, t. VIII ; De Mont-Rond, t. I, p. 93.
(3) *Chroniques de Saint-Denis*, chap. XIV ; *Vie de Louis-le-Gros* par Suger ; *Recueil des historiens de France*, t. XII, p. 24.
(4) Cette assemblée est la plus importante de toutes celles qui furent convoquées à Étampes. L’histoire n’indique pas précisément dans quel…
| 20 |
2. Philippe-Auguste fait enfermer la reine Ingeburge dans le château d’Étampes — Histoire de cette princesse (1193–1207)
En 1200, le château d’Étampes servit de prison à la reine Ingeburge (1), princesse danoise dont les infortunes ont toujours excité les sympathies des cœurs généreux.
Ingeburge était fille de Waldemar Ier, dit le Grand, et sœur de Canut ou Knud VI, qui régnèrent en Danemark pendant le XIIe siècle. Le roi de France Philippe, ayant entendu vanter la beauté de la princesse, envoya l’évêque de Noyon en Danemark pour demander sa main, déclarant à Canut qu’il ne voulait d’autre dot que la cession qui lui serait faite, par le contrat, de l’ancien droit que les rois de Danemark avaient sur le royaume d’Angleterre, et un secours en vaisseaux.
Richard Cœur-de-Lion était alors captif en Allemagne, et Philippe voulut profiter de son absence.
Mais Canut et les états de Danemark préférèrent offrir une somme de dix mille marcs d’argent pour dot (2). Le roi souscrivit à cette condition.
Ingeburge partit pour la France. Philippe alla au-devant d’elle jusqu’à Arras, et leur mariage fut célébré à Amiens, la veille de l’Assomption de la Vierge de l’année 1193 (3).
(1) Ingeburge, en danois Ingebour, est quelquefois appelée Ingelburge, plus rarement Isamburge et Isburge. Le père Daniel, dans son Histoire de France, prouve, d’après des documents authentiques, que le vrai nom de la princesse danoise est Ingeburge.
(2) Environ 521 000 francs de notre monnaie.
(3) Anselme, Histoire généalogique de France, Paris, 1726, in-fol., t. I, p. 79. Sismondi, Histoire des Français, 1828, in-8°, t. VI, p. 154.
| 21 |
Le roi fit sacrer Ingeburge le lendemain par son oncle Guillaume de Champagne, archevêque de Reims. La cérémonie eut lieu en grande pompe, en présence de douze évêques suffragants de la métropole, d’une brillante assemblée de seigneurs et chevaliers, et d’une immense multitude de peuple.
Philippe, regardant la princesse pendant la cérémonie, commença par en avoir horreur : il trembla, il pâlit, et fut si troublé qu’il ne put attendre la fin du couronnement. Cependant, Ingeburge, âgée seulement de dix-huit ans, était aussi belle que vertueuse, et les historiens du temps s’accordent à dire qu’elle joignait à toutes sortes de qualités les grâces ingénues de son âge (1).
Voici le portrait de Ingeburge tracé par Étienne, évêque de Tournai :
« Elle est plus prudente que Sara, plus sage que Rebecca, plus gracieuse que Rachel, plus dévote qu’Anne, plus chaste que Suzanne, plus belle qu’Hélène, plus noble que Polixène… »
On n’a jamais su les motifs de l’antipathie étrange que le roi conçut inopinément pour elle, et que les contemporains attribuaient à un sortilège.
(1) Gérault Hercule, Mémoire sur Ingeburge de Danemark. Ce mémoire, couronné par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres le 11 août 1844, est inséré dans le tome I, 2ᵉ série, de la Bibliothèque de l’École des chartes (1844).
| 22 |
On se perd en conjectures sur les causes de cette subite aversion.
Philippe essaya de faire prononcer canoniquement le divorce, sous prétexte de parenté ou d’affinité aux degrés prohibés ; mais les prélats et les barons se montrèrent si peu disposés à partager le blâme d’une pareille mesure que le roi se vit obligé de temporiser. On lui persuada même de faire une tentative pour se réconcilier avec la reine. Il manda donc Ingeburge à Saint-Maur, près Paris, et entra seul dans sa chambre à coucher ; mais il en ressortit au bout de quelques instants, jurant que Ingeburge ne pouvait être sa femme et pénétré pour elle d’une aversion si profonde qu’à peine endurait-il qu’on la nommât devant lui 19).
Ingeburge fut renvoyée de la cour, et Philippe prit la résolution de se séparer d’elle, prétendant n’avoir jamais consommé le mariage, contrairement à la déclaration de Ingeburge. Le roi allégua la parenté existant entre sa première femme, Isabelle de Hainaut, et la reine Ingeburge, du chef de Charles-le-Bon, comte de Flandre, fils de Canut IV, roi de Danemark 20).
Dès que le caprice du roi fut connu, plusieurs seigneurs français, esprits serviles comme il y en a dans toutes les cours, se présentèrent à une assemblée présidée par l’archevêque de Reims, et qui eut lieu au château de Compiègne, quatre-vingt-deux jours après le mariage (5 novembre 1193). Là, ils affirmèrent par serment qu’il y avait parenté à un degré prohibé entre la première et la seconde femme du roi.
L’assemblée, intimidée par la présence des courtisans, jugea cet obstacle suffisant, quoique cette parenté éloignée ne fût pas comprise dans les prohibitions de l’Église, et elle prononça immédiatement la sentence du divorce 21).
La Danoise assistait à l’assemblée sans comprendre ce qui se disait. |23| Quand l’interprète le lui eut expliqué, elle s’écria tout en pleurs : « Mala Francia ! Mala Francia ! Roma ! Roma !… » (Méchante France ! Méchante France ! Rome ! Rome !…) pour faire entendre qu’elle en appelait au pape de la décision du concile.
Philippe voulut renvoyer Ingeburge en Danemark. Elle y consentit d’abord, mais quelques-uns lui ayant fait remarquer que quitter la France serait abandonner sa cause et se condamner elle-même, elle changea d’avis et se retira dans l’abbaye des chanoines réguliers de Cisoing, dans le diocèse de Tournai (Belgique).
Là, réduite à une pénurie extrême, elle vendit ses vêtements et sa vaisselle pour vivre. « Elle tendait la main, » dit Étienne, évêque de Tournai.
La décision du concile de Compiègne fut loin de rendre au roi sa tranquillité. Le roi de Danemark Canut, indigné d’apprendre le traitement qu’avait subi sa sœur, fit partir pour Rome son chancelier André et l’abbé Guillaume d’Eskil, génovéfain français, deux hommes qui avaient conseillé le mariage ; il les chargea de demander justice au pape (1194).
Sur ces entrefaites, Ingeburge fit entendre de son côté de justes plaintes à la cour de Rome. Célestin III, après avoir mûrement examiné la généalogie de Ingeburge, cassa la sentence du divorce et enjoignit à l’archevêque de Reims et aux autres prélats français de s’opposer, en vertu de l’autorité apostolique, à ce que le roi contractât un nouveau mariage (1195) 22).
Les deux envoyés danois obtinrent du Saint-Père une lettre qui fut portée au roi par le légat Censius. Mais le légat et la lettre furent fort mal reçus à la cour. Le chancelier André et l’abbé Guillaume, avertis d’un piège qui leur était tendu par les émissaires de Philippe, quittèrent subitement la capitale du royaume. |24|
Les deux envoyés danois traversèrent la France au milieu de mille dangers. Arrivés à Dijon, ils furent arrêtés par Eudes III, duc de Bourgogne, qui les enferma dans une étroite prison en leur enlevant des lettres du pape adressées au roi de France, au cardinal-légat Mélior, et au clergé de France. Outre les lettres originales du pape, les envoyés danois en avaient des copies qu’ils parvinrent à soustraire aux recherches de leurs ennemis.
Grâce à l’intercession des abbés de Citeaux et de Clairvaux, ils obtinrent leur liberté et se rendirent à Paris. Le prieur de Saint-Praxède vint en France avec des lettres du pape qui auraient remplacé au besoin celles dont le duc de Bourgogne s’était emparé.
Célestin ordonnait de convoquer un concile le 7 mai 1196, sous la présidence du cardinal Mélior ; mais ce concile, qui eut lieu à Paris, fut intimidé par la présence de la cour, et se sépara sans avoir rien décidé. Philippe, regardant cette issue comme une preuve en sa faveur, contracta un nouveau mariage avec Marie-Agnès, fille de Berthold, duc de Méranie (Tyrol) 23).
Le mariage fut célébré solennellement au mois de juin 1196, au mépris d’une bulle du pape Célestin III qui avait annulé le divorce et interdit au roi de se remarier sous peine d’excommunication.
Ingeburge renouvela ses plaintes, et le roi de Danemark les appuya.
Ce furent sans doute ces démarches qui déterminèrent Philippe à aggraver encore la position de sa malheureuse épouse. Arrachée du monastère où elle avait édifié le monde par toutes sortes de vertus, Ingeburge se vit enfermée dans une forteresse lointaine d’où elle adressa au pape de nouvelles peintures de ses malheurs (1198) 24). |25| Innocent III, successeur de Célestin III, soupçonnant que cette affaire n’avait pas été traitée dans les précédents conciles avec le discernement et l’équité nécessaires, embrassa avec chaleur la cause de Ingeburge.
Après plusieurs vaines démarches auprès du roi, il chargea son légat en France, Pierre de Capoue, d’assembler un troisième concile à Dijon pour juger la conduite du roi.
La cour de Rome voulait éloigner du roi Agnès de Méranie et lui faire reprendre Ingeburge, sa légitime épouse.
Innocent écrivit aux prélats des églises de France pour les exhorter à exécuter avec vigueur la sentence quelconque, soit d’interdit, soit d’excommunication, qui serait prononcée, sans se laisser déconcerter par un appel du roi en cour de Rome.
Ensuite le pape dépêcha lettres sur lettres au roi et à l’évêque de Paris, son diocésain, pour sommer Philippe « de rentrer dans le devoir et de renvoyer sa concubine. »
Le 6 décembre 1199, les archevêques de Lyon, de Reims, de Bourges, de Vienne ; dix-huit évêques ; les abbés de Cluny, de Vézelay, de Saint-Remi de Reims et de Saint-Denis se réunirent à Dijon, sous la présidence de Pierre de Capoue. Les commissaires de Philippe, prévoyant l’interdit, en appelèrent d’avance au souverain pontife, comme on s’y était attendu. Mais les prélats n’en tinrent aucun compte et la sentence fut formulée.
On jugea prudent d’en différer la promulgation, peut-être pour ne pas compromettre la sûreté du légat et des évêques.
Le vingtième jour de Noël, c’est-à-dire le 15 janvier 1200, Pierre de Capoue présida une nouvelle assemblée à Vienne sur le Rhône, parce que les prélats comptaient être plus libres dans une ville qui n’appartenait pas encore à la France. Là, en présence d’un grand nombre de prélats, dont quelques-uns étaient sujets de Philippe, le légat prononça solennellement l’interdit (1).
(1) Géraud, § 4.
| 26 |
La sentence qui soumettait à l’interdit tous les domaines du roi fut envoyée par le légat à tous les évêques du royaume, avec injonction de la publier et de la faire observer dans leurs diocèses, sous peine d’être suspendus de leurs fonctions et dépouillés de leurs bénéfices, et cita ceux d’entre eux qui refuseraient de se soumettre, à comparaître devant le Souverain Pontife à la prochaine fête de l’Ascension (1).
Voici la traduction littérale de cette sentence, que nous nous empressons de reproduire d’après M. Géraud :
« Que toutes les églises soient fermées ; que personne n’y soit admis, si ce n’est pour faire baptiser les petits enfants ; qu’on ne les ouvre jamais, sinon pour entretenir les lampes, ou lorsque le prêtre prendra l’eucharistie et l’eau bénite à l’usage des malades.
Nous permettons que la messe soit célébrée une seule fois dans la semaine,
le vendredi de grand matin ; on conservera les hosties pour les malades,
et on y admettra le clerc chargé d’assister le célébrant.
Que les prêtres prêchent le dimanche sous les portiques des églises,
et que, pour tenir lieu de la messe, ils répandent la parole de Dieu.
Qu’ils récitent les heures canoniques hors des églises,
sans que leurs voix puissent parvenir aux oreilles des laïques ;
lorsqu’ils liront l’épître ou l’évangile,
qu’ils se gardent de pouvoir être entendus des fidèles,
et qu’ils ne souffrent pas qu’on enterre,
ni même qu’on dépose les corps morts dans le cimetière.
Ils préviendront en outre les laïques
que c’est un abus et un grave péché d’enterrer les corps morts dans une terre non consacrée,
et que les fidèles s’arrogent, en le faisant, un droit qui ne leur appartient pas.
Ils interdiront à leurs paroissiens d’entrer dans les églises ouvertes dans les domaines du roi.
Ils ne béniront que hors de l’église les besaces des pèlerins.
Dans la semaine sainte, il ne sera point célébré d’offices. »
(1) Géraud, § 4.
| 27 |
> « Les prêtres attendront jusqu’au jour de Pâques,
et ce jour-là ils diront la messe en secret,
sans admettre d’autre personne que le prêtre assistant.
Qu’aucun fidèle ne communie, même au temps de Pâques,
s’il n’est malade ou en danger de mort.
Que durant la même semaine, ou bien le dimanche des Rameaux,
les curés préviennent leurs paroissiens de se rassembler le jour de Pâques,
au matin, devant la porte de l’église ;
là, on leur permettra de manger de la viande avec le pain béni du jour.
Nous défendons expressément que les femmes soient admises dans l’église pour les relevailles ;
qu’elles soient averties de prier, avec leurs voisins, hors de l’église,
le jour de leur purification,
et qu’ensuite elles n’y aient accès,
même pour tenir des enfants sur les fonts du baptême,
même lorsque, après la levée de l’interdit,
elles auront été introduites par le prêtre dans le lieu saint.
Ceux qui demanderont à se confesser seront entendus sous le portique de l’église.
Dans les églises dépourvues de portique,
on pourra, seulement lorsqu’il fera de la pluie ou du mauvais temps,
ouvrir une des portes et entendre les confessions sur le seuil,
en laissant dehors tous les fidèles, excepté celui ou celle qui se confessera ;
mais la confession aura lieu à haute voix,
de manière que le pénitent et le confesseur soient entendus de tous ceux qui seront hors de l’église.
Quand le temps sera beau, les confessions seront entendues devant les portes de l’église fermée.
On ne placera point hors des églises des vases contenant de l’eau bénite,
et les clercs n’en apporteront nulle part,
attendu que tous les sacrements sont prohibés,
à l’exception du baptême des nouveaux-nés et du viatique pour les mourants.
L’extrême-onction, qui est un grand sacrement, reste elle-même interdite. »
(1) Géraud, § 4.
| 28 |
3. L’interdit sur le royaume — Rapprochement de Philippe et d’Ingeburge (1200)
Pour bien comprendre la terreur que ce genre de choses jetait dans le pays, il faut se figurer à quel point la vie civile était alors enveloppée et absorbée par la vie religieuse.
Plusieurs évêques, entre autres ceux de Paris, de Senlis, de Soissons, se soumirent immédiatement à la sentence ; d’autres, à l’exemple de l’archevêque de Reims, en différèrent l’exécution ; mais ils se soumirent les uns après les autres, et l’interdit pesa sur le royaume dans toute sa rigueur.
Le clergé se trouva alors froissé entre deux hommes également inflexibles : d’une part, Philippe-Auguste, qui fit chasser de leurs demeures et dépouiller de tous leurs biens les évêques et les prêtres qui observaient l’interdit ; d’autre part, Innocent III, qui suspendit tous les prélats et les prêtres qui avaient hésité à se soumettre, les obligeant à venir à Rome pour y faire pénitence.
Le roi redoubla de hauteur envers ceux qui l’approchaient ; après avoir frappé le clergé, il exigea des chevaliers comme des bourgeois des tailles et des exactions inouïes, et regarda l’obéissance de ses sujets aux prêtres comme une révolte contre lui.
Les populations tournèrent leur irritation contre celui qui attirait sur elles les foudres de Rome. Partout on répéta un mot attribué à Innocent III : « Qu’il valait mieux qu’un seul fût puni que de faire périr tout un peuple. » On sollicita le pape de retirer l’interdit et d’excommunier le roi.
Comme pour braver la main qui le frappait, Philippe rendit plus étroite et plus dure la captivité de Ingeburge, qui était bien innocente du fléau (1200). Cette vengeance est une tache honteuse dans la vie glorieuse de l’aïeul de saint Louis.
Plusieurs vieux historiens disent que Ingeburge fut alors enfermée dans la tour d’Étampes, mais M. Géraud prouve qu’au mois de septembre 1200, la reine était encore prisonnière dans une forteresse lointaine, à plus de trois journées de Paris (1).
(1) Géraud, § 4.
| 29 |
Ce fut en vain que le roi adressa à la cour de Rome des sollicitations pour faire lever l’interdit. Il se vit obligé de fléchir sous les conditions qui lui étaient imposées, demandant un jugement et promettant de se soumettre à tout ce qui serait prononcé contre lui.
Cette promesse ne satisfit point Innocent : il exigea qu’au préalable, Philippe reprît Ingeburge et renvoyât Agnès. Alors Philippe céda ; le cœur brisé, il se sépara d’Agnès et reconnut la nullité de leur union. Ingeburge était en ce moment malade à plus de trois journées de la capitale. Philippe la fit conduire au château royal de Saint-Léger en Yveline, ancienne résidence des reines de France, située entre Étampes et Paris.
Le cardinal-légat Octavien, évêque d’Ostie, envoyé en France par le souverain pontife pour arranger toutes les affaires du roi, se rendit à ce château le 7 septembre 1200, accompagné d’une foule d’évêques. Le roi ayant fait mine de considérer Ingeburge comme sa femme, Octavien, après toutes les formalités, leva solennellement l’interdit qui pesait sur la France depuis huit mois. La même assemblée, qui avait vu Philippe tendre la main à sa femme, vit aussitôt ce prince solliciter ardemment l’examen juridique de la validité de son mariage (1).
Le cardinal Octavien, évêque d’Ostie, demanda à la cour de Rome, au nom du roi de France, que le procès de Ingeburge fût revu. Le pape répondit qu’il y serait fait droit dans un concile convoqué à Soissons, où le roi, la reine et les députés de Danemark furent sommés de se rendre dans un délai bizarre de six mois, six semaines, six jours, six heures. Le souverain pontife exprimait des doutes sur la légitimité des plaintes d’Ingeburge : il l’engagea à ne pas cesser de demander au ciel le retour de la tendresse de son mari.
À l’époque fixée (mars 1204), le concile de Soissons s’assem…
(1) Géraud, § 5.
| 30 |
4. Concile de Soissons — Philippe enlève Ingeburge et l’enferme à Étampes (1203)
… sous la présidence du cardinal Octavien, assisté du cardinal Jean de Saint-Paul, en présence du roi, de la reine et des ambassadeurs de Canut. Ces derniers firent valoir leurs droits : ils produisirent les engagements du roi et des seigneurs. Le roi s’était entouré d’une foule d’avocats qui s’empressèrent à l’envi de plaider et de développer les moyens propres à faire prononcer le divorce.
Personne n’avait osé parler pour Ingeburge. Un clerc inconnu se levant tout à coup du sein de la foule, demanda à prononcer quelques paroles en faveur de la reine. Ayant obtenu cette permission, il plaida alors avec tant de chaleur et d’éloquence la cause de l’infortunée princesse, qu’il excita l’admiration des cardinaux, des évêques et du monarque lui-même.
La multitude des questions qu’on adressa au roi et la longueur des débats qui duraient depuis plusieurs jours l’humilièrent et l’offensèrent tellement, qu’un matin, de très bonne heure, il prit tout à coup le parti d’emmener Ingeburge et d’envoyer dire aux prélats, au moment le plus vif de la discussion : qu’ils peuvent se retirer quand il leur plaira ; qu’il regarde Ingeburge comme sa femme ; que tout est fini.
Puis, mettant la reine en croupe sur son cheval, il la fit enfermer dans le château d’Étampes (1).
Cette résolution, qui soustrayait le roi aux ministres de Rome, fut considérée par ses amis comme une victoire, et par les cardinaux comme un affront (2).
La mort d’Agnès, arrivée en 1200, ne rapprocha pas Philippe d’Ingeburge, qui ne recouvra que son titre de reine et fut très malheureuse, au dire de tous les historiens.
Enfermée dans la tour du roi (3) à Étampes, Ingeburge était gardée aussi rigoureusement qu’une prisonnière d’État.
(1) Géraud, § 5. — Inutile de rappeler au lecteur la pièce bien connue de Legouvé dont une des scènes se passe au château d’Étampes. (2) *Chroniques de Saint-Denis*, chap. XIV. (3) La tour du roi, c’est-à-dire le donjon du château royal d’Étampes.
| 31 |
Les privations qui lui furent imposées, au printemps de l’an 1203, lui inspirèrent de sérieuses alarmes pour sa santé. La nourriture devint très irrégulière, quelquefois insuffisante. Les vêtements lui manquaient, et le peu qu’on lui en laissa était loin de convenir à son rang et à sa dignité. Les bains, la saignée, les conseils d’un médecin, tout ce qui peut servir à maintenir le corps dans un état sain et salubre, lui était sévèrement interdit.
Son cœur aimant et son âme pieuse eurent aussi une large part dans cette odieuse persécution. Les lettres par lesquelles Innocent III s’efforçait de consoler la reine et de relever son courage n’arrivaient pas jusqu’à elle. La prison nouvelle était plus étroite et plus dure que la précédente. Personne n’obtenait la permission de la visiter, pas même les envoyés du roi Waldemar II, son frère, successeur de Canut, qu’ils fussent ou non porteurs de lettres du Danemark.
Deux chapelains danois avaient seuls obtenu, avec beaucoup de peine, l’autorisation de l’entretenir une seule fois, en langue française, et devant les témoins désignés par le roi.
Philippe avait fait rayer le nom de Ingeburge des prières publiques qu’on avait coutume de chanter pour le roi et la reine dans toutes les églises de France. Rarement on lui accordait la permission d’entendre la messe ; quant aux autres offices, aux instructions pieuses, à la confession même, elle en était absolument privée.
Les serviteurs que lui avait donnés son royal époux avaient reçu des instructions particulières. Lors de la présence de la reine, ils témoignaient leur compassion pour ses malheurs ; mais, lorsque leur service les appelait auprès d’elle, loin de relever son esprit par des paroles encourageantes, ils imputaient à elle-même sa disgrâce et lui prodiguaient le reproche et l’injure.
Enfin, et ce dernier trait ne doit laisser aucun doute sur les coupables espérances du roi, des émissaires, habiles à déguiser sous le masque de la piété l’influence ennemie qui les faisait agir, s’introduisaient auprès de la reine et s’efforçaient, par leurs perfides conseils, de la…
| 32 |
5. Supplice moral de la reine — Détresse et correspondance avec le pape (1203)
…déterminer à violer volontairement les lois du mariage et à favoriser, de sa libre adhésion, la réussite des projets de son mari (1).
Ce système de vexations hypocrites plongea d’abord l’âme de la reine dans un morne désespoir.
« Mon père, s’écriait-elle en s’adressant au pape, je tourne mes regards vers vous, afin de ne pas périr. Ce n’est pas de mon corps, c’est de mon âme que je m’inquiète, car je meurs tous les jours, Saint-Père, pour conserver intacts les droits sacrés du mariage ; et — qu’elle me paraîtrait douce, bonne, suave, à moi, malheureuse femme, désolée et rejetée de tous, cette mort unique de la chair qui m’arracherait aux tourments des mille morts que j’endure ! »
Elle reprend bientôt courage ; elle demande au pape des consolations, et termine en priant Innocent de la dégager à l’avance de tout serment qui pourrait lui être arraché par la violence (2).
Le souverain pontife chargea l’abbé Casamario de porter sa réponse à la reine, et en même temps une lettre pour Philippe-Auguste, par laquelle il s’efforce d’éveiller dans l’âme de ce prince les sentiments de la honte et de la peur. Le pape demande aussi pour son légat la liberté de voir la reine et de lui offrir des consolations.
Philippe n’osa point refuser cette faveur, mais la situation d’Ingeburge n’en fut point améliorée ; car, le 9 décembre 1203, le pape se plaignait assez vivement au sujet des accusations que l’obstination du roi faisait tomber sur le Saint-Siège.
Philippe, trop occupé de la conquête de la Normandie (1204), oublia quelque temps ses projets de divorce, pour les reprendre en 1205. Il se montrait résolu à faire valoir, non seulement…
(1) Géraud, § 6. — Nous nous sommes empressés de recueillir ces documents et ceux qui vont suivre dans le savant mémoire de M. Géraud ; la plupart des historiens ne donnant presque plus de détails sur Ingeburge à partir de sa captivité dans la tour d’Étampes.
(2) Géraud, § 6.
| 33 |
…l’affinité qu’il prétendait exister entre sa femme et lui, mais encore l’ensorcellement dont ils étaient, disait-on, les victimes, et qui s’opposait invinciblement à leur union.
Le Saint-Père envoya aussitôt son chapelain au château d’Étampes. C’était un homme sage et discret, qui, en apportant à la reine les consolations du Saint-Siège, devait adroitement sonder les dispositions intimes de cette princesse opprimée, recueillir ses aveux et s’assurer de ses intentions, afin de mettre le souverain pontife en mesure de prononcer en toute justice sur la nouvelle prétention élevée par le roi.
Mais Philippe n’y donna aucune suite. Il essaya de répandre le bruit que des sortilèges l’empêchaient d’habiter avec sa femme, et la reine resta prisonnière à la tour d’Étampes.
Le 2 avril 1207, le pape écrivit au roi une nouvelle lettre pleine de sagesse et de raison, et qui semblait devoir le ramener à de meilleurs sentiments. Il désirait toujours une réconciliation complète. Toutefois, comme l’inutilité de ses démarches antérieures ne lui laissait pas grand espoir de réussir sur ce point, il s’attachait à faire sentir au roi la honte et la barbarie de sa conduite, non plus envers la reine et l’épouse légitime, mais envers la femme :
« Le roi, dit-il, s’expose non seulement à la colère de Dieu,
mais encore à la haine des hommes,
en traitant comme une vile esclave une princesse illustre,
d’origine royale, sœur, épouse et fille de rois. »
Cette lettre fit sans doute faire à Philippe-Auguste des réflexions sérieuses, car il fit, en 1207, une nouvelle tentative pour se rapprocher d’Ingeburge, ou plutôt, il feignit de vouloir se réconcilier avec sa femme ; car ces tergiversations continuelles accusent le peu de sincérité de ses intentions.
Il essaya ensuite de tirer parti des sentiments pieux de la prisonnière pour lui inspirer la résolution d’entrer en religion.
Ne pouvant rien par la force, il essaya la douceur en se relâchant un peu de la parcimonie avec laquelle il avait pourvu jusqu’alors à l’entretien d’Ingeburge ; la nourriture devint tolérable et les vêtements…
| 34 |
…décents. Mais la reine ayant refusé obstinément les propositions du roi, sa captivité devint bientôt plus étroite, ses serviteurs lui furent enlevés l’un après l’autre ; et enfin, on ne laissa plus pénétrer auprès d’elle que des personnes apostées qui lui van- taient les agréments de la vie monastique, lui faisaient, au nom du roi, les plus magnifiques promesses si elle se détermi- nait à prendre le voile, lui traçaient au contraire le tableau le plus sinistre des privations et des tourments qui l’attendaient si elle s’opiniâtrait dans sa résistance aux désirs du monarque. La malheureuse reine, abandonnée de tous, tourmentée par ces suggestions incessantes, par des promesses brillantes ou par de terribles menaces, finit par succomber, et jura d’embrasser la vie monastique.
Philippe, en avertissant le pape de l’incident, demandait la permission de contracter un nouveau mariage. Le souverain pontife reconnut quelque chose de suspect dans tous les moyens allégués successivement par le roi ; aussi, avant toute discus- sion, il prétendit que le roi devait commencer par rendre à la reine une liberté pleine et entière. Mais Philippe ne voulut pas courir les chances d’une procédure si habilement combinée par le souverain pontife (1208) (1).
Quatre années se passèrent sans faire avancer d’un pas la question, mais aussi sans introduire aucune amélioration dans la position de la reine. Une lettre du pape, datée du 7 mai 1210, ne lui porte encore, dans sa prison d’Étampes, que des espé- rances et des consolations. Le roi fit de nouvelles objections au pape ; mais, le 9 juin 1212, le Saint-Père répond qu’il ne voit aucun moyen de condescendre aux désirs de Philippe. Les re- lations charnelles de ce prince avec la reine sa femme sont allées si loin, elles sont si fréquemment prouvées par les fré- quents aveux d’Ingeburge, renouvelés en présence de plusieurs…
(1) Géraud, § 6.
| 35 |
dre une décision de son chef et sans le concours d’un concile, à moins de manquer à son devoir, d’encourir la colère de Dieu et de se déshonorer aux yeux des hommes. Il exhorte donc le roi à se défier des mauvais conseillers et à se rapprocher de la reine qui a bien racheté, par un long martyre, les bonnes grâ- ces de son époux. Il conjure le roi de ne plus importuner le Saint-Siège de cette affaire, parce qu’il semblerait vouloir pro- fiter de ses embarras pour arracher au pape ce que l’équité lui défend d’accorder.
Le souverain pontife faisait ainsi allusion à ses démêlés avec Othon de Brunswick, et surtout avec Jean-sans-Terre, roi d’Angleterre, récemment excommunié parce qu’il n’avait pas voulu reconnaître l’archevêque de Cantorbéry, nommé par le pape. Jean-sans-Terre persécuta les évêques de son royaume. Le 24 mars 1208, l’Angleterre fut soumise à l’interdit. Jean ne s’étant pas mis en peine d’apaiser la colère du souverain pontife, une sentence d’anathème fut lancée contre lui en 1211, et, une année s’étant écoulée sans qu’il demandât l’absolution et sa ré- conciliation avec l’Église, Jean fut déclaré indigne du trône et déposé en 1212. Dans une assemblée solennelle de prélats et de seigneurs qui eut lieu à Soissons en janvier 1213, et à la- quelle assistait le roi de France, on enjoignit à ce dernier et aux autres princes, en leur promettant la rémission de leurs péchés, de s’emparer de l’Angleterre, les armes à la main. Philippe, de son côté, n’avait pas besoin d’être excité à une conquête qu’il méditait depuis longtemps ; aussi, il s’empressa avec joie de faire les préparatifs de l’expédition qui devait partir de Boulogne. Philippe déclara de plus, en présence des évêques et des grands barons, qu’à partir de ce moment, il reprenait Ingeburge de Danemark, se réconciliait avec elle, et lui ren- dait la plénitude de ses droits d’épouse et de reine (1).
(1) Géraud, § 7.
| 36 |
Bibliographie
- Léon Marquis, Notice historique sur le château féodal d'Étampes, l'une des curiosités archéologiques les plus remarquables des environs de Paris (91 p., gravures), Paris, Auguste Aubry, 1867.