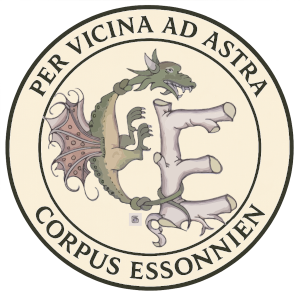Table des matières
SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D'ÉTAMPES ET DU HUREPOIX
Bulletin n°5 (1899)
PAGE EN CONSTRUCTION
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D'ÉTAMPES ET DU HUREPOΙΧ 1
IMPRIMERIE G. BELLIN, A MONTDIDIER
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL D'ÉTAMPES ET DU HUREPOIX 4º Année - 1898 1 re LIVRAISON
ZORBEIL THUNE POD ETAMPEST PARIS ALPHONSE PICARD ET FILS, ÉDITEURS LIBRAIRES DES ARCHIVES NATIONALES ET DE LA SOCIÉTÉ DE L'ÉCOLE DES CHARTES Rue Bonaparte, 82 1898
SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D'ÉTAMPES ET DU HUREPOIX
STATUTS
- Approuves par arrêté préfectoral en date du 19 février 1895
- ARTICLE I. - Une Société est fondée à Corbeil sous le titre de SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE Corbeil, D'ÉTAMPES ET DU HUREPOIX. Elle a pour but les études, les recherches et les publications concernant l'histoire et l'archéologie de notre contrée et des régions circonvoisines, ainsi que la description et la conservation des monuments anciens situés dans ces mêmes régions. Elle a son siège à Corbeil et tiendra ses séances soit à la SousPréfecture, soit à la Mairie, avec l'autorisation préalable du SousPréfet ou du Maire.
- ART. II. La Société s'interdit toutes discussions ou publications politiques ou religieuses.
- ART. III. La Société se compose de tous les fondateurs et, en nombre illimité, des personnes qui, adhérant aux Statuts, sont admises par le Conseil sur la présentation de deux membres. - Le Conseil peut aussi désigner des membres correspondants qui seront nommés par l'Assemblée générale. |VI| Les mineurs ne seront admis dans la Société que sur le consentement soit de leurs parents, soit de leur tuteur.
- ART. IV. Le titre de fondateur est acquis: 1º aux signataires des présents statuts, 2º à tout membre qui fait don à la Société d'une somme de cent francs au moins. ART. V. Chaque sociétaire paie une cotisation annuelle de dix francs: cependant cette cotisation est réduite à cinq francs pour les personnes appartenant au clergé et à l'enseignement. ART. VI. Tout membre adhérent qui aura effectué un versement de cent francs au moins sera exonéré du paiement des cotisations annuelles. ART. VII. - La Société est administrée par un Conseil composé de vingt-et-un membres, élus pour trois ans en Assemblée générale. Ce Conseil se renouvelle chaque année par tiers. Les membres sortants sont rééligibles. ART. VIII. Le Conseil, sur la proposition du Comité de publication, statue sur l'impression des travaux et la composition des Bulletins: il soumet aux auteurs les modifications qu'il juge nécessaires et détermine l'ordre des insertions. - ART. IX. Aucune dépense ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une délibération du Conseil. Le trésorier ne doit effectuer aucun paiement sans le visa du Président ou d'un Vice-Président. ART. X. La Société se réunit tous les ans au mois de mai, en Assemblée générale, soit à Corbeil, soit dans toute autre ville désignée par le Conseil. Cette assemblée nomme les Membres du Conseil. Elle entend les rapports qui lui sont présentés par le Conseil et qui sont relatifs à l'état des travaux et à la situation financière de la Société. Elle délibère sur toutes les propositions qui lui sont soumises par le Conseil. ART. XI. La Société pourra organiser des excursions archéologiques, faire exécuter des fouilles, établir une bibliothèque, un musée, acquérir, recueillir ou recevoir, à titre de dons manuels, tous les objets et documents qui l'intéressent. Toutes ces questions seront décidées par le Conseil. Les membres correspondants reçoivent les publiART. XII. cations de la Société et sont affranchis de toute cotisation. |VII|
- ART. XIII. En cas de dissolution de la Société, les membres titulaires, réunis en une Assemblée générale spécialement convoquée à cet effet, seront appelés à statuer sur la liquidation de l'actif social et sur la destination des collections appartenant à la Société.
- ART. XIV. Les présents Statuts pourront être modifiés par l'Assemblée générale, sur une proposition écrite et signée de dix membres au moins, mais aucune modification ne deviendra exécutoire qu'après avoir été autorisée par l'autorité compétente, en exécution de l'article 291 du Code pénal.
- ART. XV et dernier. Un règlement intérieur, adopté par l'Assemblée générale, arrête les conditions de détail propres à assurer l'exécution des présents Statuts et le bon fonctionnement de la Société.
- Vu par le Vice-Président: Vu et soumis à l'approbation de Monsieur le Préfet de Seine-et-Oise. Le Sous-Préfet de Corbeil, G. DE LINIÈRE. P. BOUCHER. Le Préfet de Seine-et-Oise, Chevalier de la Légion d'honneur, autorise la «< Société Historique et Archéologique de Corbeil, d'Étampes et du Hurepoix > à se constituer légalement, en vertu de l'article 291 du Code pénal et conformément aux présents Statuts. Fait à Versailles, le 19 février 1895. Pour le Préfet, Le Secrétaire-général délégué, DUFOIX.
| VIII |
RÉGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D'ÉTAMPES ET DU HUREPOIX Arrêté par l'Assemblée générale du 4 Décembre 1894 ARTICLE I. - Messieurs les Sous-Préfets de Corbeil et d'Étampes sont Présidents d'honneur de la Société. ART. II. Le Conseil, conformément à l'article VII des statuts, désigne, chaque année parmi ses membres, un Président, deux ou plusieurs vice-Présidents, un Secrétaire général, un Secrétaire rédacteur et un Trésorier. ART. III. - Le Président ouvre et dirige les séances, maintient l'ordre dans les discussions, fait exécuter les statuts et les décisions de la Société, la convoque pour les séances ordinaires et extraordinaires et ordonnance les dépenses. En cas d'absence des Président et vice-Présidents, le Conseil est présidé par le plus âgé des membres présents. ART. IV. Le Secrétaire général est chargé, sous la direction du Conseil, de la composition et de la rédaction du bulletin; il veille à l'impression et à la correction de toutes les publications de la Société; il se met en rapport avec les auteurs et leur soumet, s'il y a lieu, les observations approuvées par le Conseil, sur le rapport du Comité de publication. Il fait annuellement à l'assemblée générale un rapport sur les travaux de la Société, enfin il remplit les fonctions d'archiviste.
| IX |
ART. V. - Le Secrétaire rédacteur rédige les procès-verbaux des séances et est chargé de tout ce qui se rapporte à la correspondance. - ART. VI. Le Trésorier est chargé du recouvrement des cotisations annuelles; il paie les dépenses ordonnancées et donne chaque année, à la séance générale, un état de la situation financière de la Société. ART. VII. Le Conseil se réunit tous les trois mois; cependant le Président peut le convoquer chaque fois que les intérêts de la Société l'exigent. - ART. VIII. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des suffrages; pour qu'elles soient valables, sept membres au moins doivent être présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. ART. IX. Le Conseil statue sur les demandes d'admission et désigne la catégorie à laquelle doit appartenir chaque candidat admis, afin de déterminer le montant de sa cotisation, conformément à l'article V des statuts. Les délibérations du Conseil ont lieu au scrutin secret, et les noms des candidats refusés ne sont pas inscrits au procès verbal. ART. X. Les décisions du Conseil ordonnant une dépense sont transmises sans retard au Trésorier par un extrait du procès-verbal, signé du Secrétaire rédacteur. - ART. XI. Les fonds disponibles de la Société seront déposés à la caisse d'épargne de Corbeil ou dans toute autre caisse désignée par le Conseil. ART. XII. janvier. L'ouverture de l'année sociale est fixée au rer Tout candidat admis doit sa cotisation à partir du 1er janvier de l'année de son admission. ART. XIII. La Société publiera un bulletin périodique et, si ses ressources le lui permettent, elle pourra également publier des mémoires et des documents. ART. XIV. Un Comité de publication, composé d'un vicePrésident et du Secrétaire général, membres de droit, et de cinq membres choisis par le Conseil et renouvelables chaque année, proposera la publication, sous les auspices de la Société, des mémoires et documents dont il aura apprécié la valeur réelle.
| X |
ART. XV. - Les Sociétaires ont droit à toutes les publications de la Société à partir de l'année de leur admission. ART. XVI. - Tous les Sociétaires peuvent assister aux séances du Conseil, mais ils ne peuvent prendre part aux votes. Le Président peut leur donner la parole quand ils ont à faire des communications qui rentrent dans l'ordre des travaux de la Société. Cependant le Conseil peut se former en Comité secret sur la demande de deux de ses membres. ART. XVII. Les auteurs pourront faire exécuter, à leurs frais, des tirages à part des travaux publiés par la Société. Tout tirage à part devra porter la mention du volume dont il aura été extrait. Aucun tirage à part ne pourra être mis en circulation avant la publication par la Société du travail dont il est l'objet. - ART. XVIII. Les demandes de modifications aux statuts devront être adressées au Président quinze jours au moins avant l'assemblée générale; il en sera fait mention sur les lettres de convocation. ART. XIX et dernier. - Le présent réglement pourra être modifié par le Conseil sur la proposition et à la majorité de sept membres au moins.
| XI |
LISTE DES MEMBRES Les noms précédés d'un astérique (*) sont ceux des MEMBRES FONDATEURS qui ont racheté leur cotisation. MM. ALLAIN, Maire de Soisy-sous-Étiolles. ALLIOT (l'Abbé), curé de Bièvres. ALLORGE, Professeur de dessin à Montlhéry. *AUBRY-VITET, Archiviste-Paléographe, 9, rue Barbet de Jouy, à Paris. BARREAU (Eugène), Juge au tribunal de commerce de Corbeil, à Ris-Orangis. BARTHÉLEMY (André), à Villeneuve-le-Roi, par Ablon. BARTHÉLEMY (Jules), Géomètre-expert, rue Féray, à Corbeil. BARTISSOL, Maire de Fleury-Mérogis, par Saint-Michel. BASSERIE (Mlle), 49, rue St Vincent, au Mans (Sarthe). Bazin, au château de Villegenis, par Massy. BEGLET (Armand), à Corbeil et, à Paris, 162, boulevard Haussmann. *BÉRANGER (Charles), 82, avenue des Champs-Élysées, Paris. BESSIN, Conseiller d'arrondissement, à Corbeil. La BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE CORBEIL, représentée par M. DUFOUR, bibliothécaire. *BIZEMONT (le Vte Arthur de), au Château du Tremblois, par Bouxières-aux-Chênes (Meurthe-et-Moselle). BLAVET, Président de la Société d'Horticulture d'Étampes, 11, place de l'Hôtel-de-Ville, Etampes.
| XII |
XII MM. BLONDEAU, entrepreneur de travaux à Corbeil. BONNEFILLE, Sénateur de Seine-et-Oise, à Massy. BONNIN (l'Abbé), Curé d'Ablon. BOUCHER (le Dr Paul), Médecin en chef de l'Hôpital de Corbeil. BOUJU-TANDOU (J. Albert), au Château du Tremblay, à Corbeil et, à Paris, 45, avenue Marceau. BOULÉ (Alphonse), Juge de paix, à Pontoise. BUFFIER (Gaston), 146, rue des Vallées, à Brunoy. CALLIET, Président du tribunal de Commerce, à Corbeil. CAUVIGNY (l'Abbé), Curé de Ballancourt. CAUVILLE (Paul de), Sénateur, au château des Tourelles, par Évry-Petit-Bourg; à Paris, place d'Iéna, 8. CAYRON (l'Abbé), Curé de Lardy. CHAMBON, avoué à Corbeil. *CHATONEY (Eugène), 8, rue Rembrandt, à Paris. CHÉRON, à Lardy. CHERRIÈRE (le Dr), à Essonnes. CHEUVREUX, à Étiolles, par Corbeil, et 41, avenue de Friedland, à Paris. CHEVALIER (Léon), Conseiller-Maître à la Cour des Comptes, à Soisy-sous-Étiolles, et à Paris, 216, rue de Rivoli. CIBIEL (Alfred), Député de l'Aveyron, au château de Tigery, et 53, rue St-Dominique, à Paris. CLÉMENT, Architecte de l'arrondissement d'Étampes, à Etampes. COCHIN (Henry), Député du Nord, au château de Wetz, à St-Pierre-Brouck, par Bourbourg (Nord), et à Paris, 114, rue de la Boétie. COLAS (l'Abbé), Curé de Soisy-sous-Étiolles. COLAS (Albert), propriétaire à Villeneuve-le-Roi. COLLARDEAU DU HEAUME (Philéas), 6, rue Halévy, à Paris. COTHEREAU, Président du tribunal civil à Corbeil. *COURCEL (le Baron Alphonse de), Ambassadeur et Sénateur, au château d'Athis-Mons, et à Paris, 10, boulevard Montparnasse. *COURCEL (George de), à Vigneux, et à Paris, 178, boulevard Haussmann.
| XIII |
MM. *COURCEL (Valentin de), Maire d'Athis-Mons, et à Paris, 20, rue de Vaugirard. *CROS (Louis), Conseiller général de Seine-et-Oise, à Corbeil. DANGER, géomètre, à Étampes. *DARBLAY (Aymé), au château de St-Germain, par Corbeil. DARBLAY (Paul), au château de St-Germain, par Corbeil. DARNET (Jérôme), Greffier en chef du tribunal de Corbeil. DEBLED, artiste-peintre à Linas, par Montlhéry. DELESSARD (Edouard), Avoué honoraire près le Tribunal de la Seine, à Ris-Orangis. DELESSARD (Ernest), Ingénieur civil, à Lardy. DEPOIN (Joseph), Secrétaire général de la Société historique de Pontoise, 50, rue Basse, à Pontoise, et à Paris, 150, boulevard St Germain. DESRUES (l'Abbé), Curé Doyen de Limours. DEVERRES (l'Abbé), Curé de Boigneville. DEVOUGES (le Dr), Président de la Société d'Horticulture de l'arrondissement, rue Feray, à Corbeil. DION (le Comte de), Président de la Société archéologique de Rambouillet, à Montfort-l'Amaury. DUFAURE (Amédée), ancien député, au Château de Gillevoisin, par Étréchy, et 11, avenue Percier, à Paris. DUFOUR (M. A.), Conservateur de la Bibliothèque et des Archives de la ville de Corbeil, rue du 14 Juillet, 21, à Corbeil. DURANDET (l'Abbé), Curé de Ris-Orangis. *DUVAL(Rubens), Professeur au Collège de France, à Morsangsur-Seine, et à Paris, 11, rue de Sontay. FÉRAY (Ernest), 5, rue de Stockolm, à Paris. *FÉRAY (Georges), 58, Boulevard Malesherbes, à Paris. FLAMMARION (Camille), Directeur de l'Observatoire de Juvisy, à Juvisy, et à Paris, 16, rue Cassini. FORTEAU (Charles-Marie), Trésorier de la Caisse d'Épargne d'Étampes, à Étampes.
| XIV |
MM. FOUDRIER (l'Abbé), Curé de Morsang-sur-Orge, par Savignysur-Orge. FRITSCH (l'Abbé), Curé d'Étréchy. GALLET (le Chanoine), 16, rue Royale, à Versailles. GARNIER (Paul), 16, rue Taitbout, à Paris. GATINOT, inspecteur-primaire honoraire, à Montgeron. GÉHIN (l'Abbé), Curé de Chilly-Mazarin, par Longjumeau. GENET (l'Abbé), Curé de Méréville. GENTY (l'Abbé), Curé de Livry. GÉRARD (Octave), avoué à Corbeil. GIBERT, ancien percepteur, à Corbeil. GIBOIN, rue Orbe, à Libourne (Gironde). GIRARD Conservateur des Hypothèques à Corbeil. GLIMPIER (l'Abbé), Curé de Santeny. GRAND (Émile), avoué à Corbeil. GRANGE (le Marquis de la), Maire de Montgeron. GUÉBIN (Edmond), Avoué à Corbeil. GUÉNIN (Eugène), Critique d'art et sténographe au Sénat, . Villa des Fresnes, à Juvisy. GUILBERT (Denys), Avocat, au Château du Colombier, au Breuillet, par St-Chéron, et à Paris, 12, rue de Tournon. GUYOT (Joseph), au Château de Dourdan. HARO (Henri), Peintre-Expert, 20, rue Bonaparte, à Paris. + HAURÉAU (Barthélemy), Membre de l'Institut. Houssor (le Comte du), au Château de Frémigny, par Bouray, (S.-et-O.) et 81, rue de Lille, à Paris. HUMBERT-DROZ, Imprimeur à Étampes. *JACQUEMOT (l'Abbé), Curé-Doyen d'Argenteuil. JEANCOURT-GALIGNANI, Maire d'Étiolles, par Corbeil, et à Paris, 82, rue du faubourg St Honoré. JARRY (Henri), Pharmacien, Membre du Conseil départemental d'hygiène, à Corbeil. JOZON (Maurice), Notaire à Corbeil.
| XV |
MM. LACHASSE (Auguste), Adjoint au Maire de St-Germain-lèsCorbeil. LACOMBE (Paul), Trésorier de la Société de l'histoire de Paris, 5, rue de Moscou, à Paris. LADMIRAL (le Dr), au Château d'Étiolles, par Corbeil. LAINEY, Directeur des grands Moulins de Corbeil, 5, rue du Louvre, à Paris. LAROCHE (Mme Jules), rue Saint-Spire, à Corbeil. LASNIER (E.), Receveur des Finances en non activité, 28, rue de Champlouis, à Corbeil. LECACHEUR (Mme), rue Saint-Spire, à Corbeil. LÉGER (l'Abbé), Curé de Domont. LEGROS, Notaire, Maire de Boissy-St-Léger. LEMAIRE (Jules), homme de lettres, rue Féray, à Corbeil. LE PAIRE (Jacques-Amédée), à Lagny (S. et M.) LEPROUST (l'Abbé), 3, rue Pavée, à Étampes. LEROY (Jules), juge au tribunal de commerce de Corbeil. LORIN, Avoué, Secrétaire général de la Société historique de Rambouillet, à Rambouillet. MAILLE ST-PRIX, au Château de la Grange, par Evry-PetitBourg, et à Paris, 11, Square de Messine. MAINGUIN, professeur, à Corbeil. MALLET, Conseiller d'Arrondissement, à Corbeil. MARCHEIX, Bibliothécaire à l'École des Beaux-Arts, 47, rue de Vaugirard, à Paris. MAREUSE (Edgar), Secrétaire du Comité des Inscriptions parisiennes, 81, Boulevard Haussmann, à Paris. MARSAUX (le Chanoine), à Beauvais (Oise). MARTELLIÈRE, ancien Magistrat, à Pithiviers (Loiret). MASSUCHETTI (l'Abbé), Curé de Viry-Châtillon. *MAUBAN (Georges), à Soisy-sous-Etiolles, et à Paris, 5 bis, rue de Solférino. MICHELEZ (Léon), propriétaire à Lardy. MONTGERMONT (le Comte G. de), 62, rue Pierre Charron, à Paris, et au château de Montgermont, par Ponthierry (S. et M.) MORIZET (Emile), à l'Hôtel des Arquebusiers, à Corbeil.
| XVI |
MM. MOTTHEAU, 4, place St-Médard, à Brunoy, et à Paris, 18, rue le Verrier. MURET (l'Abbé), Curé de Brunoy. OUDIOU, Architecte de la ville, avenue Darblay, à Corbeil. PAILLARD (Julien), architecte, à Corbeil. PALLAIN, gouverneur de la Banque de France, Hôtel de la Banque, à Paris. PANNIER (le Pasteur Jacques), avenue Carnot, à Corbeil. PAPIN, agent des assurances générales à Corbeil. PASQUET (Alfred-Marc), Architecte de l'arrondissement, à Corbeil. PASTRÉ (Aymé), au Château de Beauvoir, par Evry-Petit-Bourg, et à Paris, 29, rue du faubourg St Honoré. PÉRIN (Jules), Avocat à la Cour d'Appel de Paris, Docteur en droit, Archiviste-Paléographe, à Ris-Orangis, et à Paris, 8, rue des Écoles. PINARD (André), au château de Champcueil, par Mennecy. PINAT, architecte à St-Germain, par Corbeil. PINSON (Paul), d'Étampes, 39, rue de Valenciennes, à Douai (Nord). PRESTAT, Receveur des finances de l'arrondissement de Corbeil. PRIVÉ, Directeur du moulin français à Salonique (Turquie). RABOURDIN (Charles), Maire de Paray, à la ferme de Contin, par Athis-Mons. RADOT (Émile), industriel, à Essonnes. RAVAUT (Paul), 94, avenue Victor Hugo, à Paris. RICHERAND (le Baron), Maire de Villecresnes. RILLY (le Comte de), au château d'Oyzonville, par Sainville (Eure-et-Loir), et 1, rue de la Chaise, à Paris. ROUSSELIN (l'Abbé), curé de Périgny (par Mandres). SABATIER, Maire de Viry-Châtillon. SAINT-MARC-GIRARDIN (Henri), au château de Morsang-surSeine, et à Paris, 15, rue du Cirque.
| XVII |
MM. SELVE (le marquis de), au château de Villiers, par la FertéAlais (S.-et-O.), et 36, avenue Hoche, à Paris. SÉRÉ-DEPOIN, Président de la Société historique de Pontoise, 56, rue Charles Laffitte, à Neuilly (Seine). SIMON (Paul), Architecte, à Villeneuve-St-Georges. SIMON (l'Abbé), vicaire à Argenteuil. SOUPAULT, Maire de Villeneuve-le-Roi, par Ablon. SWARTE (Victor de), Trésorier-Payeur-Général du Nord, à Lille. TANON (M. L.), Président de Chambre à la Cour de Cassation, 90, rue d'Assas, à Paris, et au château du Clos-Bernard, à Soisy-sous-Etiolles. TETON (Gabriel), instituteur à Épinay-sous-Senart, par Brunoy. TOURNEUX (Maurice), 14, rue du Cardinal-Lemoine, à Paris. Tourneville, ancien juge de paix de Corbeil, à Lyons-laForêt (Eure). *TREUILLE (Raoul), 156, rue de Rivoli, à Paris. TREILHARD (le Comte), au château de Marolles-en-Hurepoix, et 45, rue de Courcelles, à Paris. VACQUER, Architecte, chargé du service archéologique de la ville de Paris, 2, rue Boutarel, à Paris. VALLET (l'Abbé), Curé de Fleury-Mérogis, par St-Michel. VAUFRELAND (le Baron de), Maire de Morsang-sur-Seine, au château des Roches, commune de Morsang-sur-Seine, et à Paris, 38, avenue Gabriel. VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (la Commune de). VOLLANT (Louis), ingénieur civil, Villa Rochefort, à SaintGermain-lez-Corbeil. WARIN, Directeur des papeteries d'Essonnes, à Essonnes.
| XVIII |
MEMBRES HONORAIRES-CORRESPONDANTS MM. BOURNON (Fernand), Archiviste-Paléographe, 12, rue Antoine Roucher, à Paris. COUARD (Emile), Archiviste de Seine-et-Oise, à Versailles. DUTILLEUX (A.), Chef de division honoraire à la Préfecture de Seine-et-Oise, à Versailles. LEGRAND (Maxime), Avocat, rue de la Porte-dorée, à Étampes. MARQUIS (Léon), d'Etampes, 32, rue de la Clef, à Paris. PHARISIER, Rédacteur en chef de l'Abeille de Seine-et-Oise, à Corbeil. QUESVERS (Paul), à Montereau-faut-Yonne (Seine-et-Marne). STEIN (Henri), Archiviste aux Archives nationales, 38, rue Gay-Lussac, à Paris. LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION MM.. BARTHÉLEMY (Jules), de Corbeil. BLAVET, d'Étampes. BONNIN (l'Abbé), d'Ablon. BOUCHER (le Dr P.), de Corbeil. COLAS (l'Abbé), de Soisy. COURCEL (G. de), de Vigneux. COURCEL (V. de), d'Athis-Mons. DEPOIN (Joseph), de Pontoise. DUFOUR (M. A.), de Corbeil. DUTILLEUX (A.), de Versailles. GENTY (l'Abbé), de Livry. MM. JARRY (Henri), de Corbeil. LASNIER (E.), de Corbeil. LEGRAND (Maxime), d'Etampes. LEMAIRE (Jules), de Corbeil. MAREUSE (Edgar), de Paris. MARQUIS (Léon), d'etampes. MARTELLIÈRE, de Pithiviers. MOTTHEAU, de Brunoy. PASQUET (A. Marc), de Corbeil. PÉRIN (Jules), de Ris-Orangis.
| XIX |
BUREAU DE LA SOCIÉTÉ Présidents d'honneur: M. le Sous-Préfet de Corbeil. M. le Sous-Préfet d'Étampes. Président: M. François COPPÉE, de l'Académie française. Vice-Présidents: M. le Dr P. BOUCHER, Médecin en chef de l'hôpital de Corbeil. M. G. de Courcel, ancien officier de marine. M. BLAVET, Président de la Société d'horticulture d'Étampes. Secrétaire-Général: M. DUFOUR, Conservateur de la bibliothèque et des archives de la ville de Corbeil. Trésorier: M. LASNIER, Receveur des finances en non activité. Secrétaire-Rédacteur: M. JARRY, Membre du Comité départemental d'hygiène. COMITÉ DE PUBLICATION MM. le Dr P. BOUCHER, Vice-Président, membre de droit. A. DUFOUR, Secrétaire général, membre de droit. V. DE COURCEL, d'Athis-Mons. H. JARRY, Secrétaire rédacteur, de Corbeil. J. LEMAIRE, de Corbeil. J. PÉRIN, de Ris-Orangis. Léon MARQUIS, d'Étampes.
| XX |
SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D'ÉTAMPES ET DU HUREPOIX COMPTE-RENDU DES SÉANCES SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Tenue à la Sous-Préfecture de Corbeil, le 3 mai 1898. Présidence de M. le Dr BOUCHER, Vice-Président. Etaient présents: MM. le Dr Boucher, Lasnier, Dufour, G. de Courcel, Barthélemy, J. Lemaire, Marc Pasquet, Mottheau, V. de Courcel, Mareuse, l'abbé Colas et Jarry. Absents excusés: MM. J. Depoin et l'abbé Genty. Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté sans observation. M. le Président annonce le décès de M. Thomas Lot, de Brunoy; il est certain d'être l'interprète de tous ses collègues en exprimant les regrets causés par la perte de ce distingué collègue. Il espère que M. André Lot, son frère, maire d'Epinay-sous-Senart, voudra bien consentir à remplacer M. Thomas Lot comme membre de la Société. M. Mottheau de Brunoy est chargé de cette négociation. Le Conseil prononce l'admission, comme membres adhérents, de: M. Cothereau, président du tribunal civil de Corbeil, présenté par MM. Boucher et Dufour; M. le comte Meunier du Houssoy, au château de Fremigny, par Bouray (S.-et-O.), présenté par MM. de Montgermont et Aymé Darblay;
| XXI |
M. le comte de Rilly, au château d'Oysonville, par Sainville (Eure-et-Loir), présenté par MM de Montgermont et Dufour; M. le marquis de Selve, au château de Villiers, par la FertéAlais (S.-et-O.), présenté par MM. de Montgermont et Dufour; M. Allorge, architecte à Montlhéry, présenté par MM. Boucher et Dufour; M. Cibiel (Alfred), au château de Tigery, présenté par MM. Raoul Treuille et Aymé Darblay; M. l'abbé Simon, vicaire à Argenteuil, présenté par MM. Boucher et Dufour; M. le comte Treilhard, au château de Marolles en Hurepoix, présenté par MM. Aymé Darblay et Charles Béranger. Le secrétaire général informe le Conseil qu'il a été offert à la Société 19 volumes ou brochures dont il donne les titres. Ces ouvrages seront inscrits au catalogue de la bibliothèque de la Société, dont la première partie sera insérée dans un des prochains bulletins. Des remercíments sont votés aux généreux donateurs. Le Conseil décide ensuite que tous les volumes appartenant à la Société seront estampillés au moyen d'un timbre spécial dont le modèle reste à décider. M. le Président rappelle au Conseil que la réunion générale de 1897 n'a pu avoir lieu par suite de circonstances indépendantes de la volonté du Conseil, parmi lesquelles il faut compter la durée prolongée des travaux de l'église St-Jean; ces travaux étant maintenant terminés, il y a lieu de fixer dès à présent l'époque de la réunion générale de 1898, qui devra coïncider avec l'inauguration et l'ouverture du musée de St-Jean. Le Conseil consulté, décide de donner le plus d'éclat possible à cette cérémonie, en fixe la date au 13 juin prochain et dit que la réunion générale aura lieu dans l'église St-Jean en même temps que l'inauguration du Musée. Le Conseil délègue ensuite à une commission de sept membres la mission d'élaborer le programme de la journée du 13 juin prochain et d'en surveiller les préparatifs. Cette commission est ainsi composée: MM. Boucher, Dufour, Lasnier, Barthélemy, J. Lemaire, Marc Pasquet et Jarry. M. le Trésorier donne ensuite des renseignements sur la situation
| XXII |
financière de la Société au premier mai 1898. Cette situation est satisfaisante et se résume ainsi: Attribution au musée • Attribution à la Société. Total. 198.60. 3.443.25 3.641.85 M. Barthélemy entretient le Conseil des recherches qu'il a faites sur l'emplacement de l'ancien prieuré de Notre-Dame des Champs, à Essonnes; il ajoute qu'il serait désirable que des fouilles fussent entreprises dans toute l'étendue du Champ attenant à la gendarmerie d'Essonnes, où il existe un grand nombre de sépultures anciennes. Le Conseil voudrait pouvoir donner satisfaction à M. Barthélemy, mais il ne croit pas devoir statuer immédiatement sur cette question, attendu qu'il y a en jeu des intérêts privés. Parlant des travaux de la Société, M. le Secrétaire général annonce qu'il s'occupe en ce moment de la préparation du premier bulletin de l'année courante. Il indique les différentes notices que, d'accord avec le Comité de publication, il a l'intention d'y faire figurer. Il ajoute qu'il s'occupe aussi de la publication du tome II des mémoires de la Société, dans lequel paraîtra l'ouvrage de M. le Pasteur Pannier, qui a pour titre : Etudes historiques sur la Réforme à Corbeil et aux environs au XVIe siècle. Ces propositions sont approuvées par le Conseil. Monsieur l'abbé Colas, curé de Soisy, fait une communication intéressante sur des pièces de monnaie trouvées dans la propriété de Mousseau; il ajoute que M. Henry Cochin à l'intention d'offrir ces pièces à la Société. Le Conseil vote des remerciements à M. l'abbé Colas pour sa communication et à M. Henry Cochin pour ses bonnes intentions envers la Société. M. le Secrétaire général informe le Conseil que M. le curé de Boigneville prépare un travail historique sur Milly, qu'il a l'intention d'offrir à la Société. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
| 1 |
LES SCULPTURES DU CLOCHER DE BRUNOY
Le joli village de Brunoy, situé à 24 kilomètres de Paris, dans la belle vallée de l'Yerre et tout près de la forêt de Sénart, jouit auprès des Parisiens d'une réputation méritée; aussi l'étranger qui vient visiter ce petit Eden est-il surpris à la vue des coquets châlets et des élégantes villas qui se succèdent sans interruption et dont le nombre s'accroît sans cesse. Ce n'est pas d'aujourd'hui que Brunoy jouit de cette faveur, car, sans remonter bien loin, nous trouvons parmi ses seigneurs, le grand financier Pâris de Montmartel, dont le fils fut ce légendaire marquis de Brunoy qui étonna le monde par ses extravagantes folies. Le comte de Provence, qui fut plus tard Louis XVIII, devint ensuite possesseur de la terre et du château de Brunoy. Talma, le grand tragédien, habitait aussi ce charmant village. Mais, depuis la Révolution, les splendeurs de Brunoy ont disparu; on remarque encore dans l'église quelques vestiges des fantaisies ruineuses du trop célèbre marquis, et ceux qui visitent en détail s'arrêtent surpris en voyant sur le clocher des sculptures anciennes dont on ne s'est pas assez occupé jusqu'à présent et qui semblent un majestueux point d'interrogation posé devant les yeux surpris des visiteurs. C'est donc en vue de répondre à des questions souvent posées que, profitant des récents travaux de restauration de la tour, nous avons étudié de près ces curieuses sculptures qui ont été pour nous l'occasion de nombreuses recherches dans les dépôts d'archives; c'est le résultat de ces recherches que nous donnons ci-dessous, avec l'espoir que
| 2 |
nous aurons réussi à faire la lumière sur un point d'histoire locale, enveloppé d'obscurité, et à appeler l'attention sur ces sculptures du clocher de Brunoy, restées presque inconnues jusqu'à présent. Au milieu de la face ouest de ce clocher, on remarque un cartouche portant l'inscription suivante, qu'une restauration récente et maladroite a rendue incompréhensible: LANMIL: VC:XXXIX: LEXXIII:ME:DEIVNG: FUTASSIELAPREMIER TARNODIEDAMEFRANCOISE: DE ROVY VEFVEDEDEFFVIMESIRE PIEREDELAVNEYENSO C.Motthean NVIVAT LI EONLARDE BRUNEYSIVERIENBRYE 1896 Cette inscription doit être ainsi restituée: L'an mil cinq cent trente-neuf, le vingt-troisième de Juin, fut assise la première (pierre) par noble dame Françoise de Rouy, veuve de défunt messire Pierre de Lannoy (1) en son vivant seigneur de Brunoy, Sivry-en-Brie. (2) Sur le contrefort droit de cette face on voit un écusson aux sept fusées ou fuseaux, trois, trois et un, dans une couronne de (1) Nous avons trouvé ce nom de Lannoy écrit quelquefois Laulnoy, Laulnay, Laulney, Launoy, Launay, Launey; mais tous signaient Lannoy. (2) Sivry, Seine-et-Marne, canton du Châtelet.
| np |
CLOCHER DE BRUNOY, SCULPTURE DU CONTREFORT DROIT, COTÉ QUEST.
| np |
| np |
CLOCHER DE BRUNOY, SCULPTURE DU CONTREFORT GAUCHF, COTÉ QUEST.
| np |
| 3 |
laurier, supportés par un chérubin; les émaux ne sont pas indiqués. Celui de gauche porte un écusson en abîme accompagné de huit coquilles en orle. Ecu penché et soutenu par deux griffons, surmonté d'un heaume cimé d'une tête de griffon; le tout dans un vol de palmes. Enfin sur le contresort droit de la face nord, les mêmes deux écus mi-parti sont reproduits dans le même ordre, avec cette particularité que les fuseaux ont un support, tandis que les coquilles n'en ont pas. Pour un amateur, même peu versé dans la science héraldique, il est clair que les sept fuseaux sont les armes de la dame, comme les huit coquilles sont celles du mari, la règle constante étant de mettre les armoiries de la dame à droite et celles du mari à gauche; et puis, ces dernières étant surmontées d'un heaume, il ne peut y avoir confusion. Voilà ce que le raisonnement indiquait à Monsieur JeannestSaint-Hilaire quand, dans son ouvrage sur Brunoy et ses environs, il disait: « Sur les deux piliers de face sont sculptées en pierre les armes de la « famille de Lannoy ». Mais il avait mal vu ou ses souvenirs le servaient mal quand il ajoutait: « Sur le pilier septentrional se trouve un écusson sculpté portant «< huit coquilles; la barre du petit écu est en bosse. « Je crois que ces armes sont celles du prince d'Elbeuf » (1). Sans aucun doute cet auteur ignorait quelles étaient les armes de Charles de Lorraine, prince d'Elbeuf, né à Paris le deux novembre mil six cent cinquante et mort en seize cent quatre-vingtdix. Il était fils de Charles de Lorraine, duc d'Elbeuf, pair de France, gouverneur de Picardie et de Montreuil-sur-Mer, et de Anne Elisabeth, comtesse de Lannoy de la Boissière, veuve en premières noces de Henry-Roger du Plessis-Liancourt, comte de la Roche-Guyon et fille unique de Charles, comte de Lannoy, chevalier des ordres, gouverneur de Montreuil, morte à Amiens, à vingt-huit ans, le trois octobre seize cent cinquante-quatre. (1) Itinéraire de Paris à Sens, Brunoy et ses environs, Paris, 1848.
| 4 |
Nous reproduisons ci-dessous son blason, d'après le Père Anselme (1).
GA Nous partagions l'avis de M. Jeannest-Saint-Hilaire quant aux écus de la face ouest et, nous appuyant sur l'inscription centrale, nous inférions que l'écu en abîme et les huit coquilles en orle étaient les armes de Lannoy et les sept fuseaux celles de Rouy; que l'écusson de la face nord était la confirmation de notre induction, puisque ces mêmes armes y sont reproduites mi-parti. Le malheur a voulu que le Père Anselme ait donné au comte Charles de Lannoy, arrière-petit-fils de Pierre et de Françoise de Rouy, les armes des Lannoy de Flandres (Trois lions de sinople, couronnés d'or, armés et lampassés de gueules) (2). (1) T. 2, page 494. (2) Les Grands officiers de la Couronne, par le P. Anselme, T. 8, p. 72.
| np |
CLOCHER DE BRUNOY, SCULPTURE DU CONTREFORT DROIT, COTÉ NORD.
| np |
| 5 |
Comment contredire l'affirmation d'un auteur qui jouit d'une très grande autorité et qui écrivait presque au temps où vivait le comte de Lannoy de la Boissière? Tous les archivistes et bibliothécaires, auxquels nous soumettions notre avis et tout ce qui milite en sa faveur, nous répondaient: « Parce qu'il y a sur un clocher de village un écusson en abîme «< et huit coquilles en orle, va-t-on prétendre, sans apporter de «« documents irréfutables, que ce sont là les armes de la famille de « Lannoy de la Boissière que le Père Anselme aurait confondue « avec les Lannoy de Flandres ? »> Vainement nous avions consulté tous les ouvrages traitant des armoiries, tous les généalogistes, l'armorial de Picardie, celui de Normandie et les anciens aveux de l'lle-de-France. Après trois années de patientes recherches, comme nous désespérions de trouver jamais la preuve que nos déductions n'étaient pas chimériques, le hasard nous fit mettre la main sur l'inventaire, fait par G. Demay, des sceaux de la collection Clairambault, et à la lettre L nous trouvions la description des titres ci-après (1). 5066 - DE LANNOY, Guillaume, chevalier, seigneur de la Boissière, enseigne de 80 lances sous le duc de Vendôme. Signet rond de 15 mill., Ecu à l'écusson en abîme, accompagné de huit coquilles en orle, sans légende. C'est un reçu de gages, daté de 1550, dont voici la copie exacte (2): « Nous Guille de Laulnoy, chevalier, seigneur de la Boissière, «< porte-enseigne de quatre-vingts lances fournies des ordonnances «< du roi notre seigneur, étant sous la charge et conduite de Mon- «< sieur le duc de Vendosmoys, confessons avoir eu et reçu comp- « tant de maistre Jacques Veau, conseiller du roi et trésorier « ordinaire de ses guerres, par les mains de Eustace de Corbie, « payeur de la dite compagnie, la somme de cent cinquante livres « tournois tant pour nostre estat et gaiges anciens de porte-enseigne «< de la dite compagnie que pour l'acquisition puis naguères « ordonnée par ledit seigneur à sa gendarmerie au lieu des vivres « en espèces que soulloit ci-devant fournir le peuple es-garnisons, (1) Bibliothèque nationale, département des manuscrits. (2) Collection des sceaux de Clairambault, reg. 171, cote 81.
| 6 |
« et ce pour le quartier de juillet, aoust et septembre mil cinq cent « cinquante devant passé. De laquelle somme de cent cinquante « livres tournois nous nous sommes tenu et tenons pour content «< et bien payé et en avons quitté et quittons lesdits trésoriers Veau «< et Corbie payeur, dessus nommés. « En témoing de ce nous avons signé les présentes de nostre « main et a ycelles faict mectre le cachet de nos armes le troisiesme « jour de novembre mil cinq cens cinquante ». (Signé) G. de Lannoi.
Ce Guillaume était le fils aîné de Pierre de Lannoy et de Françoise de Rouy. A la mort de son père, il fit l'aveu au roi des fief et seigneurie de Brunoy, à Paris le vingt novembre quinze cent trentehuit (1). 5065. - DE LANNOY, Chistophe, seigneur de la Boissière, gentilhomme ordinaire de la chambre, guidon de soixante lances sous monsieur de Villequier. Ecu en abîme accompagné de huit coquilles en orle, entouré de trois palmes; sans légende. Reçu de gages daté de 1581. « Nous Christophle de Launoy, seigneur de la Boissière, gen- «< tilhomme ordinaire de la chambre du roi, guidon de la com- « pagnie de soixante lances de ses ordonnances sous la charge de «< monseigneur de Villequier, gouverneur de Paris et élu de «< France, confessons avoir eu et receu comptant de maistre «< Estienne Galmet, conseiller du dit seigneur et trésorier de l'or- «< donnance de ses guerres, par les mains de Prosper Brosseau « payeur de ladite compagnie, la somme de quatre-vingt-six écus « deux tiers, en quarts d'écus de quinze sols parisis, à nous ordonnée «« pour nostre estat et place de guidon susdit, de deux mois dix-huit (1) Archives nationales, série P. 3, cote 15.
| 7 |
« jours du présent quartier d'avril, mai et juin, en moins les treize « jours dudit mois d'avril, et finissant le dernier jour de juin en « suivant, qui est à raison de soixante écus pour ledit quartier et «< quarante sols par jour de notre dict état de guidon et de quarante «< écus pour ladite place aussi à raison de vingt-six sols six deniers « par jour. De laquelle somme de quatre-vingt-six écus nous nous « tenons content et en avons quitté et quittons ledit Galmet tré- «< sorier susdit et tous autres. « En témoing de quoi nous avons signé le présent de nostre «< main le dix-septième jour dudict mois de juin mil cinq cent qua- «< tre-vingt et un (1). 1 (Signé) Crestofle de Lannoy.
[Tous les sceaux de la collection Clairambault ayant été surmoulés sur les originaux et ces moulages déposés aux archives nationales, nous nous sommes fait délivrer un exemplaire de chacun des signets de Guillaume et Christophe de Lannoy, lesquels ont servi à la reproduction ci-dessus]. Enfin aucun doute ne pouvait plus subsister, les armoiries sculptées sur le pilier gauche de la face ouest de notre clocher sont incontestablement celles de Lannoy de la Boissière. Restait à établir aussi incontestablement que l'écu aux sept fusées sont celles de Rouy. C'est ce que nous avons tenté sans avoir encore su y parvenir. Tout ce que nous avons pu découvrir de relatif à cette famille, c'est que: Jean de Rouy, seigneur de la Boissière, colonel des légions de Picardie, maria sa fille Barbe, par contrat du 19 décembre 1525, à Antoine de Conflans (souche des vicomtes d'Ouchy, seigneurs d'Armentières) (2). (1) Collection des sceaux de Clairambault, reg. 171, cote 82. (2) Les Grands officiers de la couronne, T. 6, p. 148.
| 8 |
Françoise de Rouy, qui nous occupe, était, tout probablement, la fille aînée de ce Jean et devint, après lui, dame de la Boissière (1). Elle laissa cette seigneurie à son fils aîné Guillaume de Lannoy qui, le premier des seigneurs de Brunoy, est qualifié de seigneur de la Boissière. Aucun ouvrage généalogique, et nous les avons tous consultés, ne parle de cette famille de Rouy de la Boissière. L'armorial de Picardie, établi et révisé en 1688, n'en souffle mot; ce qui laisse à croire que Jean fut le dernier du nom. On ne peut contester que l'écu aux sept fusées ne soit celui d'une dame mariée à un de Lannoy, seigneur de Brunoy, puisque nous voyons sur le premier contrefort de la face nord ces mêmes sept fusées mi-parti avec les coquilles de Lannoy. Les fusées seules reposent sur un sol; ce qui semblent signifier que la dame était veuve; or, l'inscription que nous avons citée au début de cette notice nous apprend que le vingt-troisième de juin 1539 noble dame Françoise de Rouy était veuve de défunt messire Pierre de Lannoy. N'est-ce pas vraisemblable? Veut-on prétendre que les sculptures du pilier droit de la face ouest et celles de la face nord sont antérieures à 1539, ou bien qu'elles ont été exécutées postérieurement? Tout d'abord nous ferons remarquer que les ornements qui accompagnent ces écussons semblent indiquer l'époque de la Renaissance et que (nous appuyons sur cette circonstance), aucune des dames alliées à la famille de Lannoy, avant ou après Pierre, n'avait de fuseaux dans ses armes. Pour l'édification du lecteur, nous lui soumettons par ordre chronologique la nomenclature des dames de Brunoy, de 1447 à 1649, année de la mort du dernier du nom de Lannoy, avec la reproduction des armes de chacune d'elles. - 1447. Isabeau de Braye, fille d'Arthus et de Jehanne de Gaillonnel, du chef de son père et de sa mère dame de Brunoy en partie, du Colombier (2), de Villememain (3), de Civry, et de Dannemois (4), mariée à Jehan de Lannoy dit Lamon, (1) La Boissière, village de la Somme entre Montdidier et Roye. (2) Le fief du Colombier était situé à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne). (3) Villememain, aujourd'hui Villemain, terre et château près Brie-comte-Robert. (4) Dannemois, autrefois Dampenois, sur la rivière d'Ecole (Seine-et-Marne).
| 9 |
écuyer puis chevalier. Elle portait de… à deux haches de… adossées et posées en pal (1). 1477. 1515. Marie de Braye, mariée à Rogerin de Lannoy dit Lamon, chevalier, seigneur de Brunoy, du Colombier, et de Civry. Mêmes armoiries que la précédente. - Françoise de Rouy, mariée à Pierre de Lannoy, seigneur de Brunoy, de Civry et du Colombier. 1548. - Anne Jouvenel des Ursins, mariée en 1548 (2) à Guillaume de Lannoy, sgr de Brunoy et de la Boissière, veuve en 1561. Bandé d'argent et de gueules de six pièces, au chef d'argent chargé d'une rose de gueules, boutonnée d'or, soutenue de même (3).
(1) Collection Clairambault, reg. 22, D. 1576. (2) Archives de Seine-et-Oise, série A. nº 1189. (3) Les Grands officiers de la couronne, Tome 6, page 406.
| 10 |
Remariée à Louis d'Ongnies, comte de Chaulnes, elle prend alors les armoiries ci-dessous. D'azur au chevron d'or chargé de trois clous d'argent (1). 1580. Anne des Ursins a joui de la terre de Brunoy et de celle de Civry jusqu'à sa mort arrivée en août 1597 (2). Charlotte de Villers-Saint-Pol, dame d'honneur de la reine Anne d'Autriche et gouvernante de Madame Henriette, sœur de Louis XIII, mariée à Christophe de Lannoy, seigneur de Brunoy et de la Boissière. D'argent à la bande de sable chargée de trois fleurs de lis d'or et accompagnée d'une merlette en chef et d'une étoile en pointe (3).
(1) Nobiliaire de Picardie. (2) Archives de Seine-et-Oise, série A, nº 1189. (3) Collection Clairambault, reg. 114, D. 9536.
| 11 |
1610. - Anne d'Aumont, veuve d'Antoine Potier, seigneur de Bourg-la-Reine, mariée à Charles comte de Lannoy de la Boissière. D'argent à un chevron de gueules, accompagné de sept merlettes de même, posées quatre en chef, deux et deux, et trois en pointe, une et deux (1). 1649. - Anne Élisabeth comtesse de Lannoy, fille unique du comte Charles, avec laquelle s'éteint le nom de Lannoy de la Boissière. De l'examen de ces blasons ne découle-t-il pas que les armes sculptées sur le contrefort droit de la face ouest du clocher de Brunoy ne peuvent être attribuées à aucune des dames de Brunoy mariées à un Lannoy si ce n'est à Françoise de Rouy? Nous ajouterons, pour ne laisser subsister aucun doute, que nous avons recherché les armoiries des seigneurs et des dames de Brunoy depuis 1333 jusqu'à la révolution et que pas un de ces blasons ne se rapproche de celui aux sept fusées. Donc, pour nous et jusqu'à preuve irréfutable du contraire, l'écusson aux sept fusées est celui de Françoise de Rouy, veuve de Pierre de Lannoy. Profitant des échafaudages nécessités par les réparations faites l'an dernier au clocher, nous avons, avec l'aide de quelques habitants de Brunoy, que nous remercions de la sympathie qu'ils nous (1) Le P. Anselme, T. 4, page 876. 3
| 12 |
ont toujours témoignée, fait surmouler les armes de Lannoy tout en regrettant que nos ressources ne nous aient pas permis de mieux faire. Trois exemplaires de ces armoiries ont été exécutés sous la direction et avec le concours de Monsieur Paul Simon, architecte à Villeneuve-Saint-Georges. L'un de ces moulages doit rester au presbytère de Brunoy, un autre fait partie des collections du musée Saint-Jean de Corbeil et le troisième va être envoyé à Versailles pour faire partie du musée de la commission des antiquités et des arts de Seine-et-Oise. Les amateurs auront donc ainsi les plus grandes facilités pour étudier ce panneau, qui, sans remonter à une haute antiquité, n'en est pas moins curieux comme document héraldique de la fin de la chevalerie. Brunoy, septembre 1897. Ch. MOTTHEAU.
| 13 |
LA FÊTE DE LA FÉDÉRATION A MONTGERON (14 juillet 1790)
La révolution de 1789 fut accueillie avec enthousiasme par la population de cette commune, qui entrevoyait par là le terme de ses souffrances, exprimées dans le cahier des États généraux de la paroisse. L'allégresse générale atteignit son apogée lors de la fête de la Fédération, premier anniversaire de la prise de la Bastille. A cet effet, la municipalité de Paris avait adressé une circulaire à toutes celles du royaume les priant de s'unir personnellement à elle pour « le pacte auguste et solennel que la nation allait contracter. » « Ce sera, disent ces instructions, le 14 juillet, à l'heure précise de midi, que le signal de la cérémonie sera donné à Paris. La com mune de la capitale invite toutes les municipalités du royaume à rassembler le même jour et à la même heure les communes respectives, conjointement avec les troupes de ligne qui se trouveraient dans leurs arrondissements, afin que le serment fédératif soit prononcé de concert et au même instant par tous les habitants et dans toutes les parties de cet empire… ». En communiquant cet avis à ses concitoyens, le procureur de la commune de Montgeron déclare que cela n'était pas nécessaire pour stimuler leur civisme et leur patriotisme; mais que, cependant, pour donner aux frères de Paris un témoignage de l'affection sincère qu'on leur porte et qu'ils ont si bien méritée puisqu'ils sont les premiers restaurateurs de la liberté, il demande que la municipalité fasse publier et afficher une ordonnance tendant à ce que: « 1º à compter de ce jour, M. le commandant de la garde nationale ordonne de monter la garde, nuit et jour, autant pour recevoir, comme il convient, les frères fédérés qui passeront par cette
| 14 |
route pour se rendre à la confédération générale que pour en imposer, par l'appareil de la force, aux brigands qui pourraient déserter Paris dans la circonstance et se répandre dans les environs. «< 2º vu la solennité du grand jour, 14 juillet, expresses inhibitions et défenses soient faites à tout citoyen de ce lieu de vaquer à aucune œuvre servile; « 3º l'on célèbre ce jour par une fête aussi complète que peuvent le permettre les faibles moyens de la grande partie des habitants. »> Ce réquisitoire fut exécuté à la lettre ainsi que le constate le rapport suivant envoyé aux administrateurs du district: «< La garde nationale demandée a été accordée; et c'est avec le plus vif plaisir que nous avons vu nos frères fédérés nous payer par leur reconnaissance au delà de ce que nous pouvions leur offrir. « La fête a été annoncée à quatre heures du matin, par une salve de notre petite artillerie (1), par le son de nos cloches et par le bruit de nos tambours. A cet appel, les cultivateurs, oubliant les instruments aratoires, le marchand négligeant son commerce, tous, sans distinction d'âge, de sexe et de condition, à l'imitation de nos concitoyens de Paris, se sont rendus à notre place d'armes pour y travailler à la construction de l'autel champêtre sur lequel devait être fait le pacte fédératif. « L'autel de la patrie élevé, la garde nationale, réunie à la maréchaussée, vers les onze heures du matin, s'est transportée à l'hôtel commun pour prendre MM. de la municipalité et diriger sa marche vers l'église paroissiale. De là le cortège s'est rendu, suivi de tous les citoyens, au lieu où devait être célébrée la fête de la Fédération. « Trois coups de canon ont annoncé le commencement, le lever Dieu et la fin de la messe. Après le dernier, le célébrant, aumônier de la garde nationale, vicaire de la paroisse de Montgeron (2) a prononcé le remarquable discours suivant: Chers Concitoyens, « C'est dans ce jour à jamais mémorable, jour dont l'époque tiendra la première place dans l'histoire de la liberté des peuples, qu'appelés de toutes les (1) Espèce de boîtes, enlevées par les Allemands, en 1870. (2) C'était l'abbé Pigeard qui, plus tard, devint prêtre constitutionnel et « abdiqua publiquement le sacerdoce ».
| 15 |
parties de l'empire, nos frères d'armes, nos compatriotes et trois de nos concitoyens à qui leurs vertus civiques ont mérité le titre glorieux de français confédérés, se rallient courageusement autour de la loi et s'obligent par le plus solennel et le plus sacré des serments à favoriser de tous leurs moyens le maintien d'une constitution qui assure notre bonheur comme elle fait notre gloire. « C'est dans ce moment précieux que se fait cette civique et fraternelle union de tous les citoyens, de tous les soldats de la liberté, de toutes les troupes destinées à la défense de notre commune patrie! « C'est à ce moment qu'ils mettent à l'abri de leurs drapeaux et sous la garde de leurs armes la nation, la loi, le roi; qu'ils jurent en présence de l'Éternel, de ne plus former qu'une garde nationale, animée d'un même esprit pour défendre les libertés publiques, pour faire respecter la loi de l'empire et l'autorité légitime du monarque. « Quel beau jour que celui de l'alliance des Français, un peuple de frères, les régénérateurs de l'empire, un roi citoyen, réunis pour un serment commun à l'autel de la patrie! Quel spectacle imposant et nouveau pour les nations ! « Quelle gloire pour nos législateurs d'entendre autour d'eux un peuple immense répéter à l'envi le cri de: Vive la loi ! cette loi, chef-d'œuvre de l'humaine sagesse, fruit de leurs pénibles veilles et de leurs infatigables travaux ! « Quelle jouissance pour notre auguste monarque de voir l'élite de ses enfants se presser autour de lui, élever un cri de vive le roi! prononcé par l'amour! « Ah! cette fête à jamais célèbre nous unit tous par les liens les plus sacrés et les plus doux; les 25 millions d'âmes qui couvrent la surface de la France ne vont plus former qu'une société, qu'une famille. « Soumission à la loi et au roi, son organe, voilà désormais notre devoir; amour et fraternité, voilà les sentiments qui doivent nous animer. C'est sur ces bases que reposent la paix, la prospérité, le salut de l'État. Notre union fait notre force, resserrons-en aujourd'hui les nœuds de la manière la plus authentique. « Ce vœu est celui qu'expriment en ce moment, sous les murs de la capitale, tous nos frères et confédérés, tous nos concitoyens, de toutes les parties de ce vaste royaume. « Réunissons-nous à eux d'esprit et d'intention. Que le cri général, que le cri unanime soit aujourd'hui celui de: Vive la nation, la loi, et le roi! Que ce cri soit à jamais celui de ralliement des amis de la patrie, et la terreur de ses ennemis! « Qui, pénétrés de la nécessité où nous sommes d'être tous inséparablement unis pour voir, avec l'anéantissement des coupables espérances des malveillants, renaître partout le calme et la tranquillité qui font le bonheur public, nous jurons tous, sur l'autel de la patrie et en présence de l'Étre suprême, de maintenir de tout notre pouvoir la constitution du royaume, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi! « Vous, nos dignes chefs, investis par nos suffrages d'une partie de l'autorité
| 16 |
publique, vous jurez d'exécuter et de faire exécuter les décrets de l'assemblée nationale, sanctionnés ou acceptés par le roi! « Vous milice citoyenne, gardes nationaux à qui la vertu civique a fait prendre les armes, vous jurez de prêter main forte à l'exécution des mêmes décrets, sur la réquisition des officiers civils; d'obéir fidèlement à vos chefs et à toutes les règles de la discipline militaire; d'être inviolablement attachés au grand principe de la liberté individuelle; de protéger les propriétés particulières et les propriétés déclarées nationales; d'assurer et de seconder la perception de tous les impôts ordonnés pour le maintien de la chose publique; de rétablir partout où vous serez appelés l'ordre, l'harmonie, la concorde, la paix, sans lesquels les sociétés se détruisent au lieu de se perpétuer! « Vous, pères et mères, citoyens et citoyennes de toutes les classes et de toutes les conditions, vous jurez de rappeler à leurs devoirs, par vos sages avis, ceux de vos enfants indociles, ceux de nos frères égarés qui confondent la liberté avec la licence. Ah! ils ignorent sans doute que la liberté élive l'âme, pour ainsi dire, au-dessus d'elle-même, dirige et soutient invariablement l'homme dans le chemin de la vertu et de l'honneur, symboles caractéristiques du vrai patriote, et que la licence au contraire, l'avilit et le dégrade, le précipite d'abus en abus, de crimes en crimes, et le rend pernicieux dans la société! (1). « Nous jurons, enfin, tous, de regarder, comme ennemis de la patrie et de la constitution, tous ceux qui se porteraient à des excès indignes de l'homme, indignes du chrétien. « Et vous, Seigneur, qui tenez en vos mains la destinée des nations et de chacun des individus qui les composent, daignez agréer nos vœux, daignez recevoir nos serments; ils sont, nous n'en doutons pas, conformes à l'esprit de la religion sainte, que nous avons le bonheur de professer. Confirmez au milieu de nous l'ouvrage que nous avons si heureusement commencé avec vous; daignez surtout nous affranchir de la servitude de nos passions, source de tous les désordres, et nous fixer dans la pratique de toutes les vertus qui nous sont nécessaires dans ce nouvel ordre de choses! Ainsi-soit-il! Conformément à cet appel, tous, officiers civils, gardes nationaux et citoyens, les enfants même, à l'exemple de leurs pères, se sont avancés vers l'autel de la patrie et ont prêté serment, ainsi qu'il est indiqué plus haut. « Le pacte fédératif ainsi conclu, l'aumônier qui avait célébré la messe a entonné, au pied de l'autel, le Te Deum en actions de grâces, pendant lequel il a été fait différentes décharges d'artillerie; après quoi le clergé fut reconduit à l'église pour se dé- (1) Paroles prophétiques qui ne tarderont pas à recevoir leur accomplissement.
| 17 |
pouiller de ses habits sacerdotaux. Le même cortège revint sur la place d'armes où chaque chef de maison, riche et pauvre, sans aucune distinction, avait eu soin de faire apporter la quantité de comestibles que lui permettaient de fournir ses facultés. Neuf cents âmes environ ont participé à un repas frugal qui a paru d'autant meilleur qu'il était assaisonné par cette gaieté naturelle qu'inspirait un aussi beau jour. Ce repas n'a été interrompu que pour crier: Vive la constitution! pour porter des santés à l'assemblée nationale, au roi et à nos bons frères de Paris. Il a été suivi d'une danse champêtre, où les plus habiles se tenaient autour des restes de l'autel de la patrie. »> « Cette fête ayant été commencée par un hommage rendu à l'être suprême, on ne crut pouvoir la mieux finir qu'en se réunissant le soir dans le même ordre à l'église paroissiale pour y célébrer un salut solennel, suivi du Te Deum, annoncé par différentes décharges d'artillerie. Après le salut, la danse a recommencé, et les rues de notre village ont été illuminées. » «< De tous lesquels faits nous avons dressé le présent procèsverbal à Montgeron, lesdits jour et an, à neuf heures et demie du soir et avons signé: Paque; Vigoureux; Lemoine, maire; Loriot, Landrieux, Delaporte, officiers municipaux ». Il est à croire que ce rapport n'a pas été rédigé le 14 juillet, car ce ne fut qu'en novembre et après une lettre de rappel qu'il fut envoyé aux commissaires du district de Corbeil. Ces derniers faisaient observer que « cette fête ayant été celle de la réunion de tous les bons citoyens, il serait honteux qu'une municipalité ne mît pas de gloire à trouver son nom inscrit dans le procès-verbal qui sera fait de cette célèbre fédération. » (Extrait d'une monographie, en préparation). C. GATINOT.
| 18 |
RELATION DE LA RÉCEPTION FAITE A PHILIPPE V, ROI D'ESPAGNE A SON PASSAGE A ÉTAMPES (5 Décembre 1700)
M. Maxime de Montrond, dans ses Essais sur la ville d'Étampes, a consacré quelques pages aux différents passages dans la ville, pendant le cours du XVIIIe siècle, des princes et princesses de la famille royale. Le premier en date dont il parle est celui de l'Infante, Marie-Anne-Victoire d'Espagne, âgée de cinq ans, venue en France en 1722 pour épouser Louis XV (1). Mais antérieurement au passage de cette princesse, la ville d'Étampes avait reçu dans ses murs le roi d'Espagne, son père, lorsqu'il rejoignit ses États, et si l'auteur des Essais n'en parle pas, il est à présumer qu'il n'en a point eu connaissance ou qu'il n'a trouvé aucune pièce dans les archives de la ville pouvant le renseigner sur cet événement. Ayant en notre possession deux documents qui nous permettent de combler en partie cette lacune, nous croyons devoir les faire connaître à nos compatriotes. Par son testament du 2 octobre 1700, Charles II, roi d'Espagne, appela à lui succéder, Philippe, duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV et deuxième fils du Dauphin, à la condition qu'il renoncerait pour lui et ses héritiers à tous ses droits sur la couronne de France. Vingt-huit jours après avoir signé cet acte qui déshéritait sa maison, Charles mourut âgé de 39 ans. Le testament ayant été accepté par Louis XIV, décision terrible qui devait entraîner tant de guerres, de malheurs et placer Louis XIV au bord d'un abime, (1) Essais historiques sur la ville d'Étampes (Seine-et-Oise), avec des planches, des notes et des pièces justificatives. Étampes, 1836-1837, 2 vol. in-8°.
| 19 |
le nouveau roi d'Espagne prit le nom de Philippe V, et le 4 décembre 1700, il se mit en route pour rejoindre ses États, accompagné du duc de Bourgogne, père de Louis XV, du duc de Berry et d'une foule de seigneurs de la Cour. C'est au journal du voyage de ce prince qui se trouve inséré dans un ouvrage devenu rare, publié à Paris en 1769, sous le titre de Curiosités historiques, que nous allons emprunter les détails qui suivent concernant le passage à Etampes du roi d'Espagne (1). «< Nous partimes de Versailles le samedi quatrième décembre 1700, sur les onze heures, dans le carrosse du roi qui nous accompagna jusqu'à Sceaux. Là, étant entré dans le château, le roi d'Espagne lui dit adieu, et nous prîmes congé de lui avec beaucoup de larmes versées de part et d'autre. Nous montâmes alors dans nos carrosses. En sortant de Sceaux, nous trouvâmes, une grande demi-lieue durant, le chemin plein de beaucoup de monde, qui était venu pour voir le roi d'Espagne encore une fois. Nous traversâmes la plaine de Long-Boyau, nous passâmes à Longjumeau et à Linas, nous arrivâmes sur les quatre heures du soir à Châtres, petite ville à huit lieues de Paris et à sept de Versailles, qui fut notre première couchée (2). (1) Il existe une autre relation du voyage du roi d'Espagne faite par JosephFrançois Duché de Vanci, secrétaire du comte d'Ayen, qui l'accompagna jusqu'à l'île de la Conférence, frontière d'Espagne, et publiée sous ce titre: Lettres inédites de Duché de Vanci. Paris, 1830, in-8°. (2) Voici ce que raconte Duché au sujet de l'arrivée du roi à Arpajon. « Le carrosse du roi d'Espagne et des Princes ayant été arrêté par un embarras sous la porte de Linas, cela leur donna l'idée de dessiner la tour de Montlhéry. Ce n'est plus qu'un reste d'une ancienne tour, dont il est fort parlé dans les anciennes guerres de Paris; ils n'en firent alors qu'une ébauche qu'ils mirent au net aussitôt qu'ils furent arrivés à Châtres. Le roi d'Espagne a été logé dans une maison assez jolie appartenant à M. Petit, valet de chambre du roi, et les Princes dans une hôtellerie vis-à-vis. < Le roi d'Espagne alla jouer après son souper aux échecs chez le duc de Bourgogne, avec M. le Comte d'Ayen, et les Princes jouèrent au brelan avec quelquesuns des jeunes Seigneurs qui les suivent dans ce voyage. Il n'a pas mal gelé cette nuit, mais nous avons fait bon feu. On nous a traités un peu roide sur le paiement, et on nous fait espérer que cela durera ainsi quelque temps sur cette route. On se lève le matin à 8 heures chez les Princes; je suis levé dès cinq heures. J'ai entendu la messe du père Confesseur. M. le marquis d'O et M. de la Marnallière y ont communié. < Le roi entendit la messe à la paroisse de Châtres. Il y eut un motet chanté par
| 20 |
« Il arriva dès ce jour du désordre dans les équipages, car les gens de Monsieur le maréchal de Noailles (1) ayant pris le chemin de Chartres pour celui de Châtres (2), n'arrivèrent qu'à dix heures du soir. Il serait difficile de remarquer la quantité d'équipages qui suivirent dans ce voyage, et je n'entreprends pas d'en faire le dénombrement: je me contenterai de dire seulement que le roi d'Espagne et moi nous avions chacun un carrosse du corps et deux des musiciens que le comte d'Ayen a pris soin de faire suivre. C'est Gaye qui est maître de cette musique et qui la conduit. L'abbé Gastelier, curé de Châtres, fit un compliment à S. M. C. à la porte de son église, qui fut assez approuvé; mais les rieurs font courir le bruit qu'il tint ce discours: « Sire, j'ai entendu dire que de longues harangues étaient souvent incommodes et ennuyeuses: V. M. me permettra de lui en faire une très courte », et qu'il se mit à chanter ces paroles: « Les bourgeois de Châtres et de Montlhéry Mènent tous grande joie de vous trouver ici; Petit-fils de Louis, que Dieu vous accompagne Et qu'un prince si bon Don, don, Cent ans et par de-là Là, Là Règne dedans l'Espagne. Au sortir de la messe, le roi et les princes montèrent tous trois en carrosses, S. M. C. à droite et le duc de Bourgogne à gauche dans le fond, le duc de Berry sur le devant vis-à-vis du roi, et le maréchal de Noailles à côté de ce prince. Quand le duc de Beauvilliers nous aura rejoints, il partagera cet honneur avec lui; l'autre aura la portière droite, et la gauche est alternativement pour MM. de Saumery et d'O, seigneurs qui sont par honneur auprès du duc de Bourgogne, MM. de Louville et de Razilly, comme sous-gouverneurs du duc de Berry. (1) Anne-Jules de Noailles, pair et maréchal de France, capitaine de la première compagnie des gardes du Corps, fut honoré par Louis XIV d'accompagner le roi d'Espagne jusqu'à la frontière de ses Etats. Ce maréchal mourut à Versailles le 2 octobre 1708, âgé de 59 ans. (2) On a remédié à l'inconvénient que causait l'équivoque de ces deux villes en érigeant par lettres patentes, en date du mois d'octobre 1720, Châtres en marquisat en faveur de Louis de Séverac, lieutenant général, marquis d'Arpajon, mort au mois d'août 1736. Par les mêmes lettres, ce seigneur obtint que Châtres s'appellerait à l'avenir Arpajon, et voici comment s'y prit le marquis pour vaincre la résistance que lui opposait une longue et vieille coutume: il se promenait souvent dans les terres, et quand il rencontrait quelqu'un, il lui demandait comment s'appelait la petite ville qu'on voyait là. Si on lui répondait Châtres, il s'emportait et donnait des coups de canne; si on lui répondait Arpajon, il vidait sa bourse et ne tarissait pas de flatterie. Ce moyen-là lui réussit et Châtres n'est plus dans le souvenir de personne.
| 21 |
de suite; et que M. de Beauvilliers (1) et M. de Noailles avaient aussi chacun quatre carrosses, et que plusieurs autres gens de qualité en avaient à eux, ou les avaient loués; il y avait beaucoup de chaises à une et à deux personnes. «< Le lendemain, dimanche 5, nous partîmes de Châtres à onze heures, et après avoir passé par Étréchy-le-Larron, nous arrivâmes sur les deux heures à Estampes. Cette ville est située sur la rivière de Juine ou d'Estampes, car la ville lui donna ce nom et est assez raisonnable, elle est fort longue et n'a presque qu'une rue. Nous y fûmes complimentés par les officiers du bailliage. Cette même ville est célèbre par le combat qui y fut donné du temps de la guerre civile (2). « Le lundi 6, nous partîmes d'Estampes à dix heures et nous entrâmes dans les plaines de la Beauce, après avoir passé par Monerville et Angerville; nous arrivâmes sur les trois heures à (1) Paul, duc de Beauvilliers, pair de France, grand d'Espagne, était alors gouverneur de Philippe V, de Louis, duc de Bourgogne et de Charles, duc de Berry, ses frères. C'était en cette qualité qu'il était de ce voyage. Ce grand seigneur, qui ne fut pas d'avis que le duc d'Anjou acceptât le trône d'Espagne, mourut en 1714. (2) Voici la relation de Duché relative à l'arrivée du roi d'Espagne à Étampes. « Nous partimes de Châtres à 9 heures, et nous arrivâmes à Étampes à midi: journée aussi longue que la première, mais plus beau chemin et aussi beau temps. Étampes est une petite ville située sur un ruisseau qui n'a point d'autre nom que la rivière d'Étampes. Depuis la porte de la ville jusques à l'hôtellerie des Trois-Rois, où le roi d'Espagne a logé, toute la bourgeoisie était sous les armes. Les trois rois que porte l'enseigne de cette hôtellerie, sont les trois derniers rois de France, Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, parce que tous les trois y ont couché dans leurs voyages. < Après que S. M. C. fut entrée dans sa chambre, les Echevins vinrent la haranguer et lui offrir pour présens de ville, du pain, du vin et des écrevisses que la rivière dont j'ai parlé produit en abondance, et les meilleures du monde. « Le roi et les Princes s'étaient amusés pendant quelques momens à tirer sur des pigeons; il y en eut trois de tués; et S. M. envoya trois pistoles à la maîtresse du logis pour l'en dédommager. Les Princes, après souper, mirent au net les dessins qu'ils avaient ébauchés en chemin: c'est une des choses auxquelles ils doivent s'occuper tous les jours dans leur voyage. « Les Cent Suisses de la garde prétendent qu'il leur est dû un minot de sel toutes les fois que le Roi passe par quelque ville où il y a un grenier à sel établi, et ils crurent le pouvoir exiger en cette occasion. Le receveur leur ayant contesté ce droit, l'affaire fut portée devant le roi d'Espagne, qui jugea que, supposé que cela fût dû aux Suisses, ce ne pourrait être que lorsque le Roi y était en personne; que pour lui il n'était qu'un roi étranger. On trouvera cette décision très judicieuse pour un jeune prince qui n'a encore eu aucun usage des affaires ».
| 22 |
Toury, qui n'est qu'un gros village à dix lieues d'Estampes, etc. etc. > On voit d'après ce qui précède que les officiers du bailliage d'Etampes complimentèrent le roi à son arrivée; mais le duc de Bourgogne, dans son journal, ne reproduit aucun passage des discours qui furent prononcés. Nous étions loin de penser, quand l'ouvrage dont nous avons parlé nous est tombé sous la main, d'avoir un jour la bonne fortune de connaître ces discours et même d'en posséder le brouillon, lorsque le hasard nous fit acquérir dans une vente publique de documents historiques, faite à Paris, un lot contenant un certain nombre de pièces sur la ville d'Etampes, plus ou moins intéressantes, parmi lesquelles nous avons trouvé les harangues prononcées par M. Liénard, Lieutenant général du bailliage, que nous reproduisons littéralement avec l'orthographe du temps: Sire, « Nous venons mesler notre joie aux acclamations des deux plus puissants peuples de l'Europe. Nous venons nous réjouir avec la France de l'élévation de Votre Majesté au Trosne d'Espagne, et féliciter en mesme temps les Espagnols de leur prochain bonheur d'être gouvernés par un prince tel que vous. La France, en vous perdant, ne peut que s'applaudir de vous avoir fait naître pour le bonheur de nos voisins et l'Espagne, dans la perte qu'elle vient de faire de son roy, a de quoy se consoler dans le choix judicieux qu'il a fait de Vostre Majesté pour lui succéder dans le gouvernement de ses États. «< La France admire en vous cette fierté noble et cette vivacité sage que l'on vante tant chez elle; et l'Espagne trouvera chez vous cette grandeur d'âme et cette gravité modeste qui a toujours été son partage. La nature a fait en vous l'heureux assemblage de tant de grandes qualités, le sang d'Espagne s'est meslé tant de fois avec celuy de vos ayeulx que vos sujets peuvent vous regarder comme un précieux dépost conservé parmi nous. «< Ces deux grands peuples, Sire, attendent de Votre Majesté de grandes choses. Vous devez à la France un prince digne de Louisle-Grand et de votre illustre Père; et vous devez à l'Espagne un Roy qui soit l'amour de ses Peuples; cette qualité, Sire, renferme toutes les autres: elle est la seule que doit ambitionner un grand Roy. Nous félicitons par avance les peuples qui vont être sous
| 23 |
votre domination du bonheur dont ils vont jouir; pour nous, nous allons faire mille vœux pour la durée de votre Empire, et pour la conservation d'un prince sy chéry du ciel. »> Comme l'on rend les mêmes honneurs aux Princes qu'au Roi d'Espagne, le lieutenant-général leur fit la harangue que voici: «< Messeigneurs, « Nous tenons tous à grand honneur d'être des premiers à venir vous rendre nos hommages; notre propre intérêt nous y conduit agréablement, flattés que nous sommes par le plaisir de voir en vous des princes qui sont aujourd'hui l'espoir de toute la France, et qui doivent faire un jour le plus parfait bonheur des cœurs vraiment français. »> Paul PINSON.
| 24 |
CHATRES-SOUS-MONTLHÉRY ÉRIGÉ EN MARQUISAT EN OCTOBRE 1720 ET DEVENANT ARPAJON
(1) La petite ville d'Arpajon (arrondissement de Corbeil) portait, avant 1720, le nom de Châtres-sous-Montlhéry, lequel apparaît dans notre histoire dès le x1º siècle. D'abord simple seigneurie, dépendant de la châtellenie de Montlhéry, Châtres lui-même devint châtellenie et finit par être érigé en marquisat. Il reçut en 1720 le nom d'Arpajon, qu'il quitta quelque temps, aux pires jours de la Révolution, pour celui de Franc-Val. Les premiers seigneurs de Châtres descendaient de Bouchard Ier, baron de Montmorency, par Thibaut, dit File-Étoupe, son fils puîné. Après avoir été possédé par divers seigneurs, puis par le roi, auquel il avait fait retour, Châtres le fut par les Montagu, les Graville, les Balzac d'Entragues, auxquels succéda, en 1606, Camus de Saint-Bonnet. Les héritiers de ce dernier vendirent, en 1656, la seigneurie de Châtres à Jean Brodeau, seigneur de Candé, grand maître des eaux et forêts de France. Ce nouveau propriétaire commença à porter le titre de marquis de Châtres, sans doute de son autorité privée. En 1691, Jean-Baptiste du Deffand, marquis de la Lande, colonel de dragons et lieutenant général du roi dans ses provinces d'Orléanais, Dunois et Vendômois, fit l'acquisition de la terre de Châtres et continua de s'en intituler marquis, l'étant déjà de la Lande. Du Deffand et son fils vendirent, le 15 avril 1720, la terre de Châ- (1) Cette notice, due à notre confrère M. A. Boulé, a paru une première fois dans le bulletin de la Société de l'histoire de Paris; nous avons obtenu l'autorisation de la reproduire dans le nôtre, en raison du grand intérêt qu'elle offre pour notre région. N. d. 1. R.
| 25 |
tres à Louis d'Arpajon moyennant 347.000o livres en principal et 5.000 livres de pot-de-vin. Ce nouveau propriétaire possédait déjà la Bretonnière et d'autres terres situées dans le voisinage, telles que la prévôté de SaintGermain, les fiefs du Mesnil-Brécourt, les grands et les petits Cochets. Au mois d'octobre 1720, il obtint des lettres patentes, enregistrées le 12 décembre suivant au Parlement, séant alors accidentellement à Pontoise, et, le 19 du même mois, à la Chambre des comptes (1). Les lettres du roi érigeaient Châtres, la Bretonnière, Saint-Germain et tous leurs fiefs en marquisat, sous le titre de marquisat d'Arpajon, nom que la ville de Châtres devait porter à l'avenir. Ce nom, dès lors, allait appartenir à deux paroisses du royaume (il y avait, en effet, un autre Arpajon près Aurillac). Louis d'Arpajon avait succédé, le 12 août 1715, au duc de Noailles comme gouverneur neur des duché et province de Berry, fonctions qu'il garda jusqu'en 1736. Il appartenait à une famille issue des anciens comtes de Toulouse. Fils de Jean-Louis d'Arpajon, marquis de Séverac et vicomte de Calmont, il avait pour grand-père Louis d'Arpajon, comte de Rodez, marquis de Séverac, vicomte de Montal, baron de Salvagnac et duc de Montclar. Ce dernier avait été un des remarquables hommes de guerre qui secondèrent Louis XIII et Louis XIV dans leur lutte contre la maison d'Autriche (2). Louis XIII, pour récompenser ses services, l'avait fait, en 1633, chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit, et, en 1651, Louis XIV avait érigé en duché-pairie, sous le nom d'Arpajon, le marquisat de Séverac, la vicomté d'Hauterive et les baronnies de Dolan et de Saint-Chely (3). Comme son grand-père, Louis d'Arpajon avait pris part à de nombreuses campagnes. En 1691, il était au siège de Mons, en 1692, à celui de Namur, en 1693, à la bataille de Nerwinde. Fait colonel du régiment-infanterie de Chartres en 1696, puis brigadier en 1703, il se trouva à la bataille d'Hochstett de cette année et à celle du même nom de 1704. Devenu maréchal de camp en 1709, il alla servir en Espagne jusqu'après la paix d'Utrecht, qui fut (1) Le texte de ces lettres a été imprimé tout au long dans l'Histoire généalogique du P. Anselme (1730), t. V, p. 884-887. Cf. aussi l'Histoire du diocèse de Paris de l'abbé Lebeuf (1757), t. X, p. 228. (2) Saint-Simon en parle dans ses Mémoires. (3) Histoire génealogique du P. Anselme, t. V, p. 878-882.
| 26 |
signée le 11 avril 1713. Philippe V, roi d'Espagne, le fit chevalier de l'Ordre de la Toison d'or. Il assista encore au siège de Barcelone, dont la capitulation (13 septembre 1714) devait signaler la fin de la guerre dite de la Succession d'Espagne, et il couronna sa carrière militaire par le grade de lieutenant général des armées du roi, lequel venait après celui de maréchal de France. Ce fut le Régent qui le lui conféra, le 8 mars 1716. Son mariage (mars 1715) avec Anne-Charlotte Lebas de Montargis, fille de Claude Lebas de Montargis, conseiller d'État, le fit se fixer dans le Hurepoix. Son beau-père y possédait le Bouchet, Valgrand, Valpetit, Montaubert, Lespine, les Renouillières et autres lieux. D'après un plan du marquisat d'Arpajon, gravé par Lucas et malheureusement sans date, en tout cas postérieur à 1721, plan conservé à la Bibliothèque nationale, Arpajon était fortifié et comptait six portes, dites: de Paris; Maurant (on écrit aujourd'hui Morand); d'Étampes; Saint-Denis; de Corbeil; Saint-Germain. Son enceinte fortifiée s'arrêtait à un bras de la Remarde (après la porte Maurant), et reprenait à la rive gauche de l'Orge, un peu avant la fausse porte ouvrant sur le chemin allant au moulin Cerpied, pour continuer jusqu'à la porte d'Étampes. Entre cette dernière et la porte Saint-Denis existait une autre fausse porte sur le chemin d'Avrainville dite de la Fontaine. De la porte de Corbeil à la porte Saint-Germain, l'enceinte cessait d'exister, tout l'emplacement intermédiaire étant occupé par le château d'Arpajon-laVille et ses jardins. L'église Saint-Clément avait déjà son parvis, tel qu'il existe aujourd'hui, dégagé des constructions anciennes. De nombreuses auberges bordaient surtout la grand'rue (dite d'un bout rue de Paris et de l'autre rue Étampoise), d'autres les abords de la halle (la légende du plan les nomme pour la plupart); c'étaient: Les Trois-Maillets, Les Singes, Le Grand-Monarque, Les Bons-Enfants, La Licorne, Le Duc-de-Berry, Les Trois-Maures, La Duchesse-de-Berry, Les Trois-Roys, La Ville-d'Arpajon,
| 00000059 |
| 00000060 |
| 00000061 |
| 00000062 |
| 00000063 |
| 00000064 |
| 00000065 |
| 00000066 |
| 00000067 |
| 00000068 |
| 00000069 |
| 00000070 |
| 00000071 |
| 00000072 |
| 00000073 |
| 00000074 |
| 00000075 |
| 00000076 |
| 00000077 |
Societe HISTORIQUEAT ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL NOREPO1X TAMPES D'ETAMPES ETDU HUREPOix Penu Du Déjeuner DU 13 Juin 1898 HORS D'ŒUVRE VARIÉS SMATELOTTE D'ANGUILLES DESEINE À LA MONTGARDE POULETS DE DANENTARCK ALA REINE ISBURGE FILET PIQUÉ MONTEYPAN AU CRESSON DELA FONTAINE AUX SOULIERS POMMES NOUVELLES D'ETIOLLESAU BEURRE DES.GERMAIN Petilspois ChanTerejne JAMBON DYORCK GLACÉ À LA VILLEROY SALADES DO Moulin-GALANT FROMAGE À LA CRÈME DEVILLEDEDOR FRAISES DE PETIT-BOURG Vins GATEAU-POMPADOUR COTEAU DES ROCHES DE MORSANG, ROUGE ET BLANC CISSAC DES CHEVALIERS DE SAINT-JEAN 1893 CATE-Liqueurs
| 00000078 |
| 00000079 |
| 00000080 |
| 00000081 |
| 00000082 |
| 00000083 |
| 00000084 |
| 00000085 |
| 00000086 |
| 00000087 |
| 00000088 |
| 00000089 |
| 00000090 |
| 00000091 |
| 00000092 |
| 00000093 |
| 00000094 |
| 00000095 |
| 00000096 |
| 00000097 |
| 00000098 |
1
| 00000099 |
| 00000100 |
| 00000101 |
| 00000102 |
k 380 Menhir d'Itteville. 60 MENHIR DE MILLY B Ce monolithe est connu, dans la localité, sous le nom de la pierre Droite. Il est situé à i kilom, environ de la ferme de Paly, dans la direction de Buno. Sa hauteur est de 4 mètres, sa largeur
| 00000103 |
| 00000104 |
| 00000105 |
Aide Mortiffor La Roche-qui-tourne, à Lardy (Seine-et-Oise). Vue prise du N.-E. Échelle: 1 m. 70 c. Les anciens du pays se rappellent avoir entendu raconter par leurs ancêtres que « tous les jours à midi précis, arrive un pigeon blanc qui fait tourner la roche». Suivant une autre version, ce serait non à midi mais à minuit, que la pierre effectuerait son tour sur elle-même et seulement à la nuit de Noël. Ce qu'il y a de certain, c'est que dans toute la région on tenait beaucoup à cette pierre. Nous savons par M. Peccadeau de l'Isle que, lors de la construction du chemin de fer de Paris à Orléans, les habitants du pays s'opposèrent énergiquement à sa destruction. Afin de l'épargner, les ingénieurs de la compagnie modifièrent un peu le tracé. Par suite de l'exploitation d'une carrière de pavés, au pied du monument et des remblais faits par le chemin de fer, les fouilles, autour de la Roche qui tourne, sont devenues impossibles. On a signalé autrefois, tout auprès, l'entrée d'une caverne très importante, mais dans l'état actuel du terrain les recherches ne permettent pas d'en retrouver l'emplacement,
| 00000106 |
| 00000107 |
| 00000108 |
| 00000109 |
| 00000110 |
| 00000111 |
| 00000112 |
| 00000113 |
| 00000114 |
| 00000115 |
| 00000116 |
| 00000117 |
| 00000118 |
| 00000119 |
LA REINE ISBURGE Statue en cuivre qui ornait son tombeau
| 00000120 |
| 00000121 |
| 00000122 |
| 00000123 |
| 00000124 |
| 00000125 |
| 00000126 |
| 00000127 |
| 00000128 |
| 00000129 |
| 00000130 |
| 00000131 |
| 00000132 |
| 00000133 |
| 00000134 |
| 00000135 |
| 00000136 |
| 00000137 |
| 00000138 |
| 00000139 |
| 00000140 |
| 00000141 |
| 00000142 |
| 00000143 |
| 00000144 |
| 00000145 |
| 00000146 |
| 00000147 |
| 00000148 |
| 00000149 |
| 00000150 |
| 00000151 |
| 00000152 |
| 00000153 |
| 00000154 |
| 00000155 |
| 00000156 |
| 00000157 |
| 00000158 |
| 00000159 |
| 00000160 |
| 00000161 |
| 00000162 |
| 00000163 |
| 00000164 |
| 00000165 |
TORBEIL HURE POI ETAMPEST PARIS ALPHONSE PICARD ET FILS, ÉDITEURS LIBRAIRES DES ARCHIVES NATIONALES ET DE LA SOCIÉTÉ DE L'ÉCOLE DES CHARTES Rue Bonaparte, 82 1899
| 00000166 |
| 00000167 |
| 00000168 |
| 00000169 |
| 00000170 |
| 00000171 |
| 00000172 |
| 00000173 |
| 00000174 |
| 00000175 |
| 00000176 |
| 00000177 |
| 00000178 |
| 00000179 |
| 00000180 |
| 00000181 |
| 00000182 |
| 00000183 |
| 00000184 |
| 00000185 |
| 00000186 |
| 00000187 |
| 00000188 |
| 00000189 |
C
| 00000190 |
| 00000191 |
| 00000192 |
| 00000193 |
| 00000194 |
| 00000195 |
| 00000196 |
| 00000197 |
| 00000198 |
| 00000199 |
| 00000200 |
| 00000201 |
| 00000202 |
| 00000203 |
| 00000204 |
| 00000205 |
| 00000206 |
| 00000207 |
| 00000208 | 12 - Gui épousa Isabelle: tous deux, en 1237, firent accord avec St-Denis au sujet de terres au Pré St-Gervais (36). En 1248, Simon de Poissy approuve la donation à St-Denis par son père « de toto feodo quem nobilis domina vice comitissa Corboliensis ab ipso patre meo tenebat in feodum ». C'est toujours au Pré St-Gervais, et cela laisse supposer que la vicomtesse dont il est question doute Laurence, femme de Payen était de la famille de Simon de Poissy le père. On se souvient que ce chevalier épousa en secondes noces Agnès de Garlande, veuve d'Aubert d'Andreselles, descendant au 5º degré de Gaudri (37)., sans Nous arrêtons ici cette étude limitée, d'après son titre même, au XIIe siècle, mais, pour prouver à nos lecteurs que la matière n'est pas épuisée, nous citerons comme annexe un passage de M. Morize dans son Étude Archéologique sur l'abbaye de N. D. des Vaux de Cernay. Il y reproduit (planche XXXIX) le dessin de la dalle funéraire imagée de Jean le Vicomte de Corbeil, mort en 1323. Voici la description de ce monument: Cette tombe a été découverte en 1873 devant la petite chapelle du transept méridional: nous en avons, dès cette époque, communiqué le dessin et la description à nos collègues de la Société archéologique de Rambouillet. Cette dalle est longue de 2m 20 centimètres, large de Im 20 centimètres en haut, et de 1 mètre seulement en bas, du côté qui était placé au levant. L'angle supérieur à la droite du défunt a été brisé et perdu. L'épitaphe, en majuscules gothiques, gravées par une main inhabile, commence au milieu du côté supérieur; on lit: CI GIST MO | NSEIGNEUR JEHAN LE VICOUNTE DE COURBUEL JADIS CHEVALIER QU | I TRESPASSA L'AN DE GRAC | |||
| 00000209 |
A:PIL:aaa:e6:222III:LEX&IOVR:DEWAY:POVR 00:251 91 D IGRESPASSA LAN:DE G-RAC 0 NS 1 CHAR: LEVICOVNGE:DECOVRBVELIADISCHEVALIER:QV Pierre tombale de Jehan le Vicomte de Corbeil, inhumé à l'Abbaye des Vaux-de-Cernay en 1333. Pierre. long. 2m 16; larg. 1 19 à la tête; rm of aux pieds. (Extrait du Recueil des inscriptions de la France, T. V, p. 296)
| 00000210 |
| 00000211 |
| 00000256 |
| 00000257 |
| 00000258 |
| 00000259 |
| 00000260 |
| 00000261 |
| 00000262 |
| 00000263 |
| 00000264 |
| 00000265 |
| 00000266 |
| 00000267 |
| 00000268 |
| 00000269 |
| 00000270 |
| 00000271 |
| 00000272 |
| 00000273 |
| 00000274 |
| 00000275 |
| 00000276 |
| 00000277 |
| 00000278 |
| 00000279 |
| 00000280 |
| 00000281 |
| 00000282 |
| 00000283 |
| 00000284 |
| 00000285 |
| 00000286 |
| 00000287 |
| 00000288 |
| 00000289 |
| 00000290 |
| 00000291 |
| 00000292 |
| 00000293 |
| 00000294 |
| 00000295 |
| 00000296 |
| 00000297 |
| 00000298 |
| 00000299 |
| 00000300 |
| 00000301 |
| 00000302 |
| 00000303 |
| 00000304 |
| 00000305 |
| 00000306 |
| 00000307 |
| 00000308 |
| 00000309 |
| 00000310 |
| 00000311 |
| 00000312 |
| 00000313 |
| 00000314 |
| 00000315 |
| 00000316 |
| 00000317 |
| 00000318 |
| 00000319 |
| 00000320 |
| 00000321 |
| 00000322 |
| 00000323 |
| 00000324 |
| 00000325 |
| 00000326 |
| 00000327 |
| 00000328 |
| 00000329 |
| 00000330 |
| 00000331 |
| 00000332 |
| 00000333 |
| 00000334 |
| 00000335 |
| 00000336 |
| 00000337 |
| 00000338 |
| 00000339 |
| 00000340 |
| 00000341 |
| 00000342 |
| 00000343 |
| 00000344 |
| 00000345 |
| 00000346 |
| 00000347 |
| 00000348 |
| 00000349 |
| 00000350 |
| 00000351 |
| 00000352 |
| 00000353 |
| 00000354 |
| 00000355 |
| 00000356 |
| 00000357 |
| 00000358 |
| 00000359 |
| 00000360 |
VI IV V III II 91
| 00000361 |
| 00000362 |
| 00000363 |
| 00000364 |
| 00000365 |
| 00000366 |
| 00000367 |
| 00000368 |
| 00000369 |
| 00000370 |
| 00000371 |
| 00000372 |
| 00000373 |
| 00000374 |
| 00000375 |
| 00000376 |
| 00000377 |
| 00000378 |