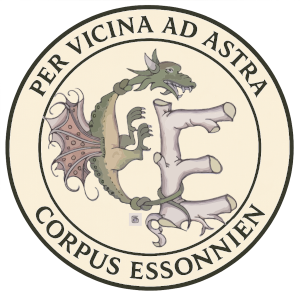Table des matières
SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D'ÉTAMPES ET DU HUREPOIX
Bulletin n°6 (1900)
PAGE EN CONSTRUCTION
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D'ÉTAMPES ET DU HUREPOIX
MONTDIDIER. - IMPRIMERIE BELLIN
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL D'ÉTAMPES ET DU HUREPOIX 6e Année 1900 1 re LIVRAISON
CORBEIL THURE POLY ETAMPES PARIS ALPHONSE PICARD ET FILS, ÉDITEURS LIBRAIRES DES ARCHIVES NATIONALES ET DE LA SOCIÉTÉ DE L'ÉCOLE DES CHARTES Rue Bonaparte, 82 1900
| 00000010 |
| V |
| VI |
Les mineurs ne seront admis dans la Société que sur le consentement soit de leurs parents, soit de leur tuteur. ― ART. IV. Le titre de fondateur est acquis: 1°º aux signataires des présents statuts, 2º à tout membre qui fait don à la Société d'une somme de cent francs au moins. ART. V. Chaque sociétaire paie une cotisation annuelle de dix francs; cependant cette cotisation est réduite à cinq francs pour les personnes appartenant au clergé et à l'enseignement. - ART. VI. Tout membre adhérent qui aura effectué un versement de cent francs au moins sera exonéré du paiement des cotisations annuelles. ART. VII. — La Société est administrée par un Conseil composé de vingt-et-un membres, élus pour trois ans en Assemblée générale. Ce Conseil se renouvelle chaque année par tiers. Les membres sortants sont rééligibles. ART. VIII. — Le Conseil, sur la proposition du Comité de publication, statue sur l'impression des travaux et la composition des bulletins; il soumet aux auteurs les modifications qu'il juge nécessaires et détermine l'ordre des insertions. — ART. IX. Aucune dépense ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une délibération du Conseil. Le trésorier ne doit effectuer aucun paiement sans le visa du Président ou d'un Vice-Président. — ART. X. La Société se réunit tous les ans au mois de mai, en Assemblée générale, soit à Corbeil, soit dans toute autre ville désignée par le Conseil. Cette assemblée nomme les Membres du Conseil. Elle entend les rapports qui lui sont présentés par le Conseil et qui sont relatifs à l'état des travaux et à la situation financière de la Société. Elle délibère sur toutes les propositions qui lui sont soumises par le Conseil. ART. XI. — La Société pourra organiser des excursions archéologiques, faire exécuter des fouilles, établir une bibliothèque, un musée, acquérir, recueillir ou recevoir, à titre de dons manuels, tous les objets et documents qui l'intéressent. Toutes ces questions seront décidées par le Conseil. - ART. XII. Les membres correspondants reçoivent les publications de la Société et sont affranchis de toute cotisation.
| VII |
ART. XIII. En cas de dissolution de la Société, les membres titulaires, réunis en une Assemblée générale spécialement convoquée à cet effet, seront appelés à statuer sur la liquidation de l'actif social et sur la destination des collections appartenant à la Société. ART. XIV. Les présents Statuts pourront être modifiés par l'Assemblée générale, sur une proposition écrite et signée de dix membres au moins, mais aucune modification ne deviendra exécutoire qu'après avoir été autorisée par l'autorité compétente, en exécution de l'article 291 du Code pénal. ART. XV et dernier. — Un réglement intérieur, adopté par l'Assemblée générale, arrête les conditions de détail propres à assurer l'exécution des présents Statuts et le bon fonctionnement de la Société. Vu par le Vice-Président : Vu et soumis à l'approbation de Monsieur le Préfet de Seine-et-Oise. Le Sous-Préfet de Corbeil, G. DE LINIÈRes. P. BOUCHER. Le Préfet de Seine-et-Oise, Chevalier de la Légion d'honneur, autorise la « Société Historique et Archéologique de Corbeil, d'Étampes et du Hurepoix » à se constituer légalement, en vertu de l'article 291 du Code pénal et conformément aux présents Statuts. Fait à Versailles, le 19 février 1895. Pour le Préfet, Le Secrétaire-général délégué, DUFOIX.
| VIII |
RÉGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D'ÉTAMPES ET DU HUREPOIX Arrêté par l'Assemblée générale du 4 Décembre 1894 ARTICLE I. Messieurs les Sous-Préfets de Corbeil et d'Étampes sont Présidents d'honneur de la Société. - ART. II. Le Conseil, conformément à l'article VII des statuts, désigne, chaque année, parmi ses membres, un Président, deux ou plusieurs vice-Présidents, un Secrétaire général, un Secrétaire rédacteur et un Trésorier. - ART. III. Le Président ouvre et dirige les séances, maintient l'ordre dans les discussions, fait exécuter les statuts et les décisions de la Société, la convoque pour les séances ordinaires et extraor dinaires et ordonnance les dépenses. En cas d'absence des Président et vice-Présidents, le Conseil est présidé par le plus âgé des membres présents. - ART. IV. Le Secrétaire général est chargé, sous la direction du Conseil, de la composition et de la rédaction du bulletin ; il veille à l'impression et à la correction de toutes les publications de la Société ; il se met en rapport avec les auteurs et leur soumet, s'il y a lieu, les observations approuvées par le Conseil, sur le rapport du Comité de publication. Il fait annuellement à l'assemblée générale un rapport sur les travaux de la Société; enfin il remplit les fonctions d'archiviste.
| IX |
ART. V. Le Secrétaire rédacteur rédige les procès-verbaux des séances et est chargé de tout ce qui se rapporte à la correspondance. ART. VI. Le Trésorier est chargé du recouvrement des cotisations annuelles; il paie les dépenses ordonnancées et donne chaque année, à la séance générale, un état de la situation financière de la Société. - ART. VII. Le Conseil se réunit tous les trois mois; cependant le Président peut le convoquer chaque fois que les intérêts de la Société l'exigent. ART. VIII. – Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des suffrages; pour qu'elles soient valables, sept membres au moins doivent être présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. - ART. IX. Le Conseil statue sur les demandes d'admission et désigne la catégorie à laquelle doit appartenir chaque candidat admis, afin de déterminer le montant de sa cotisation, conformément à l'article V des statuts. Les délibérations du Conseil ont lieu au scrutin secret, et les noms des candidats refusés ne sont pas inscrits au procès-verbal. ART. X. Les décisions du Conseil ordonnant une dépense sont transmises sans retard au Trésorier par un extrait du procès-verbal, signé du Secrétaire rédacteur. - – ART. XI. Les fonds disponibles de la Société seront déposés à la caisse d'épargne de Corbeil ou dans toute autre caisse désignée par le Conseil. ― ART. XII. L'ouverture de l'année sociale est fixée au 1er janvier. Tout candidat admis doit sa cotisation à partir du 1er janvier de l'année de son admission. ART. XIII. La Société publiera un bulletin périodique et, si ses ressources le lui permettent, elle pourra également publier des mémoires et des documents. ART. XIV. Un Comité de publication, composé d'un vicePrésident et du Secrétaire général, membres de droit, et de cinq membres choisis par le Conseil et renouvelables chaque année, proposera la publication, sous les auspices de la Société, des mémoires et documents dont il aura apprécié la valeur réelle.
| X |
ART. XV. Les Sociétaires ont droit à toutes les publications de la Société à partir de l'année de leur admission. ART. XVI. - Tous les Sociétaires peuvent assister aux séances du Conseil, mais ils ne peuvent prendre part aux votes. Le Président peut leur donner la parole quand ils ont à faire des communications qui rentrent dans l'ordre des travaux de la Société. Cependant le Conseil peut se former en Comité secret sur la demande de deux de ses membres. ART. XVII. — Les auteurs pourront faire exécuter, à leurs frais, des tirages à part des travaux publiés par la Société. Tout tirage à part devra porter la mention du volume dont il aura été extrait. Aucun tirage à part ne pourra être mis en circulation avant la publication par la Société du travail dont il est l'objet. ART. XVIII. Les demandes de modifications aux statuts devront être adressées au Président quinze jours au moins avant l'assemblée générale; il en sera fait mention sur les lettres de convocation. ART. XIX et dernier. - Le présent réglement pourra être modifié par le Conseil sur la proposition et à la majorité de sept membres au moins.
| XI |
LISTE DES MEMBRES Les noms précédés d'un astérique (*) sont ceux des MEMBRES FONDATEURS qui ont racheté leur cotisation. MM. ALLAIN, Maire de Soisy-sous-Étiolles, 12, rue Godot de Mauroi, à Paris. ALLIOT (l'Abbé), curé de Bièvres. ALLORGE, Professeur de dessin à Montlhéry. *AUBRY-VITET, Archiviste-Paléographe, 9, rue Barbet de Jouy, à Paris. BARREAU (Eugène), Juge au tribunal de commerce de Corbeil, à Ris-Orangis. BARTHÉLEMY (André), à Villeneuve-le-Roi, par Ablon. BARTHÉLEMY (Jules), Président d'honneur de la Société des géomètres de France, rue Feray, à Corbeil. BARTHÉLEMY (Louis), ingénieur, 85, rue d'Hauteville, à Paris. BARTISSOL, Maire de Fleury-Mérogis, par Saint-Michel. BASSERIE (Mlle), 49, rue St-Vincent, au Mans (Sarthe). BEGLET (Armand), à Corbeil, et à Paris, 162, boulevard Haussmann. *BÉRANGER (Charles), 82, avenue des Champs-Élysées, Paris. BERNON (le Baron de), à Palaiseau, et à Paris, 3, rue des SaintsPères. BESSIN, ancien Conseiller d'arrondissement à Corbeil. BIBLIOTHÈQUE (la) COMMUNALE DE CORBEIL, représentée par M. DUFOUR, bibliothécaire. *BIZEMONT (le Vte Arthur de), au Château du Tremblois, par Bouxières-aux-Chênes (Meurthe-et-Moselle).
| XII |
MM. BLAVET, Président de la Société d'Horticulture d'Étampes, II, place de l'Hôtel-de-Ville, Étampes. BLONDEAU, entrepreneur de travaux à Corbeil. BOETE, Instituteur, à Villecresnes. BONNEFILLE, Sénateur de Seine-et-Oise, à Massy. BONNIN (l'Abbé), Curé d'Ablon. BOUCHER (le Dr Paul), Médecin en chef de l'Hôpital de Corbeil. BOUGIN (Louis), 5, rue d'Arcole, à Paris. BOUJU-TANDOU (J. Albert), 45, avenue Marceau, à Paris. BOULÉ (Alphonse), Juge de paix honoraire, à Lignières (Cher). BOURDON, Receveur des Finances, à Corbeil. BRUNOY (la Commune de). CALLIET, banquier, Maire de Corbeil. CARNOT (François), 16, avenue du Trocadero, à Paris. CAUVIGNY (l'Abbé), Curé de Ballancourt. *CAUVILLE (Paul de), ancien Sénateur, au Château de Coye (Oise), et, à Paris, 15, avenue Matignon. CAYRON (l'Abbé), Curé de Lardy. CHAMBON, avoué à Corbeil. *CHATONEY (Eugène), 8, rue Rembrandt, à Paris. CHERON, à Lardy. CHERRIÈRE (le Dr), à Essonnes. CHEUVREUX, à Étiolles, par Corbeil, et 41, avenue de Fried land, à Paris. CHEVALIER (Léon), Conseiller-Maître à la Cour des Comptes, à Soisy-sous-Étiolles, et à Paris, 216, rue de Rivoli. CIBIEL (Alfred), Député de l'Aveyron, au château de Tigery, et 53, rue St-Dominique, à Paris. CLEMENT, Architecte de l'arrondissement, à Étampes. COCHIN (Henry), Député du Nord, au château de Mousseau, par Evry-petit-Bourg, et à Paris, 5, avenue Montaigne. COLAS (l'Abbé), Curé de Soisy-sous-Étiolles. COLAS (Albert), propriétaire à Villeneuve-le-Roi, par Ablon. COLLARDEAU DU HEAUME (Philéas), 6, rue Halévy, à Paris. COPPÉE (François), membre de l'Académie française, 12, rue Oudinot, à Paris.
| XIII |
MM. COTHEREAU, Président du tribunal civil, à Corbeil. *COURCEL (le Baron Alphonse de), Sénateur, au château d'Athis-Mons, et à Paris, 10, boulevard Montparnasse. *COURCEL (George de), à Vigneux, et à Paris, 178, boulevard Haussmann., *COURCEL (Valentin de), Maire d'Athis-Mons, et à Paris, 20, rue de Vaugirard. *CROS (Louis), Conseiller général de Seine-et-Oise, à Corbeil, DAMERON, Architecte, rue Chantereine, à Corbeil. DAMOISEAU (l'Abbé), Curé de St-Germain-lès-Corbeil. DANGER, géomètre, à Étampes. +*DARBLAY (Aymé), au château de St-Germain, par Corbeil. DARBLAY (Paul), au château de St-Germain, par Corbeil. DARBLAY (Robert), au château de St-Germain, par Corbeil. DARNET (Jérôme), Greffier en chef du tribunal de Corbeil. DEBLED, artiste-peintre, à Linas, par Montlhéry. DECAUVILLE (Armand), Maire de Courcouronne, à la Ferme du Bois-Briard, par Ris-Orangis, DELESSARD (Edouard), Avoué honoraire près le tribunal de la Seine, à Ris-Orangis, et à Paris, 34, rue de l'Université. DELESSARD (Ernest), Ingénieur civil, à Lardy. *DEPOIN (Joseph), Secrétaire général de la Société historique de Pontoise, 50, rue Basse, à Pontoise, et à Paris, 150, boulevard St-Germain. DESRUES (l'Abbé), Curé Doyen de Limours. Deverres (l'Abbé), Curé de Boutigny. DEVOUGES (le Dr), Président de la Société d'Horticulture de l'arrondissement, rue Feray, à Corbeil. DION (le Comte de), Président de la Société archéologique de Rambouillet, à Montfort-l'Amaury. à DRAGICSEVICS, Professeur honoraire au Lycée Henry IV, Champrosay, par Draveil, et à Paris, 18, rue Saint-Simon. DUFAURE (Amédée), ancien député, au Château de Gillevoisin, par Étréchy, et 11, avenue Percier, à Paris. DUFOUR (M. A.), Conservateur de la Bibliothèque et des Archives de la ville de Corbeil, rue du 14 Juillet, 21, à Corbeil.
| XIV |
MM. DURANDET (l'Abbé), Curé de Ris-Orangis. *DUVAL (Rubens), Professeur au Collège de France, à Morsangsur-Seine, et à Paris, 11, rue de Sontay. FERAY (Ernest), 31, rue de la Baume, à Paris. *FERAY (Georges), 31, rue de la Baume, à Paris. FLAMMARION (Camille), Directeur de l'Observatoire de Juvisy, à Juvisy, et à Paris, 16, rue Cassini. FLIZOT, Instituteur, à Essonnes. FORTEAU (C.-M.), Trésorier de la Caisse d'Épargne, à Étampes. FOUDRIER (l'Abbé), Curé de Morsang-sur-Orge, par Savignysur-Orge. FRITSCH (l'Abbé), Curé d'Étréchy. GARNIER, négociant, quai de la Pêcherie, à Corbeil. GATINOT, inspecteur-primaire honoraire, à Montgeron. GAUDIN, entrepreneur de travaux, à Corbeil. GÉHIN (l'Abbé), Curé de Chilly-Mazarin, par Longjumeau. GENET (l'Abbé), Curé de Méréville. GENTY (l'Abbé), Vicaire général de Versailles. GÉRARD (Octave), avoué à Corbeil. GIBOIN, rue Orbe, à Libourne (Gironde). GIRARD, Conservateur des Hypothèques à Corbeil. GLIMPIER (l'Abbé), Curé de St-Sulpice de Favières, par Boissysous-St-Yon. GRAND (Émile), avoué à Corbeil. GRANGE (le Marquis de la), Maire de Montgeron. GUÉBIN (Edmond), Avoué à Corbeil. GUILBERT (Denys), Avocat, au Château du Colombier, par St-Chéron, et à Paris, 65, rue de Rennes. GUYOT (Joseph), au Château de Dourdan. HARO (Henri), Peintre-Expert, 20, rue Bonaparte, à Paris. HAUREAU (Barthélemy), Membre de l'Institut. Houssoy (le Comte du), au Château de Frémigny, par Bouray, (S.-et-O.) et 81, rue de Lille, à Paris. HUDELOT, juge de paix, à Corbeil. HUMBERT-DROZ, Imprimeur à Étampes.
| XV |
MM. *JACQUEMOr (l'Abbé), Curé-Doyen d'Argenteuil. JEANCOURT-GALIGNANI, Maire d'Étiolles, par Corbeil, et à Paris, 82, rue du faubourg St-Honoré. JARRY (Henri), Pharmacien, Membre du Conseil départemental d'hygiène, à Corbeil. JOYEUX (André), à Essonnes. JOZON (Maurice), Notaire à Corbeil. LACHASSE (Auguste), Adjoint au Maire de St-Germain-lèsCorbeil. LACOMBE (Paul), Trésorier de la Société de l'histoire de Paris, 5, rue de Moscou, à Paris. LADMIRAL (le Dr), au Château d'Étiolles, par Corbeil. LAFAULOTTE (L. de), à Bruyères-le-Châtel, et à Paris, 129, avenue des Champs-Élysées. LAINEY, Directeur des grands Moulins de Corbeil, 5, rue du Louvre, à Paris. LAROCHE (Mme Jules), rue Saint-Spire, à Corbeil. LASNIER (E.), Receveur des Finances en non activité, 28, rue de Champlouis, à Corbeil. LAVALLÉE (Pierre), au Château de Segrez, par Boissy-sousSt-Yon, et à Paris, 49, rue de Naples. LECACHEUR (Mme), rue Saint-Spire, à Corbeil. LÉGER (l'Abbé), Curé de Domont. LEGROS, Notaire, Maire de Boissy-St-Léger. LEHIDEUX (Ernest), à la Bégallière, à Brunoy. LEMAIRE (Jules), homme de lettres, rue Feray, à Corbeil. LE PAIRE (Jacques-Amédée), à Lagny (S.-et-M.) LEPROUST (l'Abbé), 3, rue Pavée, à Étampes. LEROY (Jules), juge au tribunal de commerce de Corbeil. LORIN, Avoué, Secrétaire-général de la Société historique de Rambouillet, à Rambouillet. MAILLE ST-PRIX, au Château de la Grange, par Évry-PetitBourg, et à Paris, 11, Square de Messine. MAINGUIN, professeur, à Corbeil. MAÏSTRE (Henri), 12, rue Antoine-Roucher, à Paris. MALLET, Banquier, à Corbeil.
| XVI |
MM. MARCHEIX, Bibliothécaire à l'École des Beaux-Arts, 47, rue de Vaugirard, à Paris. MAREUSE (Edgar), Secrétaire du Comité des Inscriptions parisiennes, 81, boulevard Haussmann, à Paris. MARSAUX (le Chanoine), 68, rue des Jacobins, à Beauvais (Oise). MARTELLIÈRE, ancien Magistrat, à Pithiviers (Loiret). MASSUCHETTI (l'Abbé), Curé de Viry-Châtillon. *MAUBAN (Georges), à Soisy-sous-Étiolles, et à Paris, 5 bis, rue de Solférino. MONTGERMONT (le Comte G. de), 62, rue Pierre Charron, à Paris, et au château de Montgermont, par Ponthierry, (S.-et-M.) MORIZET (Émile), à l'Hôtel des Arquebusiers, à Corbeil, et à Paris, 56, rue Meslay. MOTTHEAU, II, rue du Pont, à Brunoy, MURET (l'Abbé), Curé de Brunoy. OUDIOU, Architecte de la ville, avenue Darblay, à Corbeil. PAILLARD (Julien), architecte, 33, rue Delambre, à Paris. PALLAIN, gouverneur de la Banque de France, Hôtel de la Banque, à Paris. PANNIER (le Pasteur Jacques), avenue Carnot, à Corbeil. PAPIN, agent des assurances générales à Corbeil. PASQUET (Alfred-Marc), Architecte de l'arrondissement, à Corbeil. PASTRÉ (Aymé), au Château de Beauvoir, par Évry-Petit-Bourg, et à Paris, 29, rue du faubourg St-Honoré. PÉRIN (Jules), Avocat à la Cour d'Appel de Paris, Docteur en droit, Archiviste-Paléographe, à Ris-Orangis, et à Paris, 8, rue des Écoles. PINARD (André), au château de Champcueil, par Mennecy. PINAT, architecte à St-Germain, par Corbeil. PINSON (Paul), d'Étampes, 39, rue de Valenciennes, à Douai. PRESTAT, Receveur des finances à Boulogne-sur-Mer (Pas-deCalais). PRIVÉ, Directeur du moulin français à Salonique (Turquie). RABOURDIN (Charles), Maire de Paray, à la ferme de Contin, par Athis-Mons. 1
| XVII |
MM. RADOT (Émile), Président du tribunal de Commerce de Corbeil, à Essonnes. RAVAUT (Paul), 15, avenue Victor Hugo, à Paris. RICHERAND (le Baron), Maire de Villecresnes. RILLY (le Comte de), au château d'Oyzonville, par Sainville (Eure-et-Loir), et 61, rue de Varennes, à Paris. ROUSSELIN (l'Abbé), curé de Périgny (par Mandres). SABATIER, Maire de Viry-Châtillon. SAINT-MARC-GIRARDIN (Henri), au château de Morsang-surSeine, et à Paris, 22, rue François Ier. SELVE (le marquis de), au château de Villiers, par la FertéAlais (S.-et-O.), et 36, avenue Hoche, à Paris. SÉRÉ-DEPOIN, Président de la Société historique de Pontoise, 56, rue Charles Laffitte, à Neuilly (Seine). SIMON (Paul), Architecte, à Villeneuve-St-Georges. SIMON (l'Abbé), Curé de Leuville-sur-Orge, par Montlhéry. SOUPAULT, Maire de Villeneuve-le-Roi, par Ablon. SWARTE (Victor de), Trésorier-Payeur-Général du Nord, à Lille. TANON (M. L.), Président de Chambre à la Cour de Cassation, 90, rue d'Assas, à Paris, et au château du Clos-Bernard, à Soisy-sous-Étiolles. TETON (Gabriel), instituteur à Épinay-sous-Senart, par Brunoy. THIRROUIN père, Maire de Lisses, par Essonnes. TOURNEUX (Maurice), à Morsang-sur-Orge, clos de la Guérinière, et à Paris, 34, quai de Béthune. TOURNEVILLE, ancien juge de paix de Corbeil, à Lyons-laForêt (Eure). *TREUILLE (Raoul), 156, rue de Rivoli, à Paris. TREILHARD (le Comte), au château de Marolles-en-Hurepoix, et 45, rue de Courcelles, à Paris. TROCHU (Jules), propriétaire, à Arpajon. VALLET (l'Abbé), Curé de Ste-Escobille, par Authon-la-Plaine. VAUFRELAND (le Baron de), Maire de Morsang-sur-Seine, au château des Roches, commune de Morsang-sur-Seine, et à Paris, 38, avenue Gabriel. VAVASSEUR (l'Abbé), Curé de Livry. 2
| XVIII |
MM. VERDAGE (Émile), négociant à Corbeil. VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (la Commune de). VOLLANT (Louis), ingénieur civil, Villa Rochefort, à SaintGermain-lez-Corbeil. WARIN, Directeur des papeteries d'Essonnes, à Essonnes. WELTER (Henri), au Mesnil-Longpont, par Montlhéry, et 217, rue Saint-Honoré, à Paris. MEMBRES HONORAIRES-CORRESPONDANTS MM. BOURNON (Fernand), Archiviste-Paléographe, 12, rue Antoine Roucher, à Paris. COÜARD (Emile), Archiviste de Seine-et-Oise, à Versailles. DUTILLEUX (A.), Chef de division honoraire à la Préfecture de Seine-et-Oise, à Versailles. *LEGRAND (Maxime), Avocat, rue de la Porte-dorée, à Étampes. MARQUIS (Léon), d'Étampes, 54, rue de la Clef, à Paris. PHARISIER, Rédacteur en chef de l'Abeille de Seine-et-Oise, à Corbeil. QUESVERS (Paul), à Montereau-faut-Yonne (Seine-et-Marne). STEIN (Henri), Archiviste aux Archives nationales, 38, rue Gay-Lussac, à Paris. LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION MM. BARTHÉLEMY (Jules), de Corbeil. BLAVET, d'Étampes. BONNIN (l'Abbé), d'Ablon. BOUCHER (le Dr P.), de Corbeil. COLAS (l'Abbé), de Soisy. COURCEL (G. de), de Vigneux. COURCEL (V. de), d'Athis-Mons. DEPOIN (Joseph), de Pontoise. DUFOUR (M. A.), de Corbeil. DUTILLEUX (A.), de Versailles. GENTY (l'Abbé), de Versailles. MM. GIRARD, de Corbeil. LASNIER (E.), de Corbeil. LEGRAND (Maxime), d'Étampes. LEMAIRE (Jules), de Corbeil. MAREUSE (Edgar), de Paris. MARQUIS (Léon), d'Étampes. MARTELLIÈRE, de Pithiviers. MOTTHEAU, de Brunoy. PASQUET (A. Marc), de Corbeil. PÉRIN (Jules), de Ris-Orangis.
| XIX |
BUREAU DE LA SOCIÉTÉ Présidents d'honneur: M. le Sous-Préfet de Corbeil.-M. le Sous-Préfet d'Étampes. Président : Vice-Présidents: Secrétaire-Général : Trésorier: M. François COPPÉE, de l'Académie française. M. le Dr P. BOUCHER, Médecin en chef de l'hôpital de Corbeil. M. G. de COURCEL, ancien officier de marine. M. BLAVET, Président de la Société d'horticulture d'Étampes. M. DUFOUR, Conservateur de la bibliothèque et des archives de la ville de Corbeil. M. LASNIER, Receveur des finances en non activité. Secrétaire-Rédacteur: M. GIRARD, Conservateur des hypothèques, à Corbeil. COMITÉ DE PUBLICATION MM. le Dr P. BOUCHER, Vice-Président, membre de droit. A. DUFOUR, Secrétaire général, membre de droit. V. de COURCEL, d'Athis-Mons.. GIRARD, Secrétaire-Rédacteur, à Corbeil. J. LEMAIRE, de Corbeil. J. PERIN, de Ris-Orangis. Léon MARQUIS, d'Étampes.
| XX |
SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES La Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France. La Société historique et archéologique de Pontoise et du Vexin. La Société archéologique de Rambouillet. La Société historique et archéologique du Gâtinais. La Société archéologique de Sens. La Société des sciences morales, des lettres et des arts de Seineet-Oise. La Commission des antiquités et des arts de Seine-et-Oise. L'Académie Royale des belles-lettres, d'histoire et des antiquités de Stockholm (Suède). La Société des Amis des monuments parisiens. La Société française d'archéologie. La Société archéologique d'Eure-et-Loir. La Société historique et archéologique de Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne). LG
| XXI |
SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D'ÉTAMPES ET DU HUREPOIX COMPTE-RENDU DES SÉANCES SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Tenue à la Sous-Préfecture de Corbeil, le 3 Octobre 1899 Présidence de M. le Dr BOUCHER, Vice-Président. Étaient présents: M. le Dr Boucher; M. Horteur, Sous-Préfet; MM. J. Barthélemy, G. de Courcel, A. Dufour, Jarry, Mottheau, Lasnier, J. Périn et Marc-Pasquet. Absents excusés: MM. V. de Courcel et Mareuse. Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté sans observations. Le Conseil prononce l'admission de cinq membres nouveaux qui sont: M. Bourdon, receveur des finances à Corbeil, présenté par MM. Lasnier et Hudelot. M. Decauville (Armand), de Courcouronnes, présenté par MM. Lasnier et Boucher. M. Darblay (Robert), de Saint-Germain, présenté par MM. Vollant et Dufour. M. Dameron, architecte à Corbeil, présenté par MM. Boucher et Dufour. M. Dragicsevics, professeur honoraire au Lycée Henry IV, à Champrosay, présenté par MM. J. Périn et Dufour.
| XXII |
Le Secrétaire général annonce que les Sociétés historiques de Melun et de Brie-Comte-Robert ont demandé l'échange des publications à titre de sociétés correspondantes. Le Conseil décide de faire droit à la demande de ces deux sociétés et de faire avec elles l'échange des publications non épuisées. Plusieurs volumes ont été offerts à la Société, le secrétaire général en donne les titres et dit que ces ouvrages sont inscrits au catalogue de la bibliothèque de la Société, dont la première partie sera insérée dans un des prochains bulletins. M. J. Périn voudrait que tous les ouvrages de cette bibliothèque fussent estampillés et, dans ce but, il propose un modèle de cachet. Le Conseil adopte cette proposition et confie à MM. Dufour et M. Pasquet le soin d'arrêter le type définitif de ce cachet. M. le Président donne lecture d'une lettre de M. Soupault, maire de Villeneuve-le-Roi, par laquelle il offre à la Société, pour son musée Saint-Jean, un sarcophage de l'époque mérovingienne, récemment découvert à Villeneuve-le-Roi, dans le parc de la Faisanderie. Le Conseil estime qu'il serait difficile de transporter au musée Saint-Jean ce sarcophage déjà en partie brisé; il décline avec regret l'offre qui lui est faite par M. Soupault, tout en rendant hommage à la généreuse pensée qui l'a guidé.. Une réponse dans ce sens, avec remercîments, sera adressée à M. Soupault. L'ordre du jour appelle la fixation de la date et du lieu de la prochaine assemblée générale de la Société. Dans la précédente séance, il avait été décidé que cette assemblée aurait lieu à Dourdan, vers la fin d'octobre, mais le Conseil ne croit pas devoir maintenir cette décision; la saison est trop avancée et les jours trop courts pour aller, selon le projet primitivement adopté, visiter le château de Dourdan et l'église de Saint-Sulpice de Favières. Après une assez longue discussion, le Conseil décide que l'assemblée générale de 1899 aura lieu à Corbeil le 25 octobre prochain, et il fixe les points principaux du programme de cette journée; le bureau est chargé d'en préparer et assurer l'exécution. M. le Président informe le Conseil que M. Jarry, alléguant ses trop nombreuses occupations, demande à être relevé de ses fonctions de secrétaire-rédacteur, qu'il exerce depuis l'origine de la Société. Malgré les prières qui lui sont adressées, M. Jarry persiste à vouloir se retirer et le Conseil, tout en regrettant sa résolution,
| XXIII |
désigne, pour le remplacer, M. Girard, conservateur des hypothèques à Corbeil, dont le secrétaire général s'est préalablement assuré le concours. M. J. Périn estime qu'il appartient à la Société de faire établir et publier la carte topographique du Hurepoix, ancienne subdivision de l'île de France. Le Conseil, sans s'opposer à cette proposition qui est à étudier, décide de faire tout d'abord reproduire dans son bulletin la carte de la Châtellenie de Corbeil, dont un exemplaire, unique jusqu'à présent, est possédé par un des membres de la Société. M. le trésorier donne ensuite quelques renseignements sur les finances de la Société ; il résulte de ses explications que la situation financière de la Société est excellente ; il se propose d'ailleurs, conformément aux statuts, de donner tous les détails de cette situation à l'assemblée générale de 1899. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Par suite de circonstances imprévues, l'assemblée générale n'ayant pu avoir lieu en mai 1899, une décision du conseil d'administration du 3 octobre suivant a fixé cette réunion au 25 octobre de la même année. Cette séance s'est tenue à Corbeil, où nous avons pu recevoir, par un brillant soleil, ceux de nos collègues qui ont bien voulu se déranger pour se joindre à nous. D'autres, pour des motifs divers, n'ont pu venir, mais ils avaient envoyé leurs excuses; ce sont MM. Julien Paillard, de Paris; Casimir Cheuvreux, d'Etiolles; comte de Marsy, de Compiègne; Lorin, de Rambouillet; Oudiou, de Corbeil; V. de Courcel, d'Athis; Max. Legrand, d'Etampes; Girard, de Corbeil; Marc-Pasquet, de Corbeil, etc. Dès le matin, les Sociétaires de Corbeil se réunissent à la gare pour recevoir leurs invités; le train arrive et, après les salutations et les poignées de main, on prend place dans les voitures préparées par les soins de la Société, et l'on se rend à l'église St-Spire,
| XXIV |
la seule que Corbeil puisse montrer aujourd'hui après en avoir possédé un assez grand nombre. On visite assez rapidement cet édifice du XIIIe siècle, qui a conservé quelques parties romanes, on jette un coup d'œil sur ce qui reste de l'ancien cloître, c'est-àdire la belle porte ogivale qui y donnait accès; puis on remonte en voiture pour se rendre à St-Germain, où l'on admire la curieuse église paroissiale de la fin du XIIe siècle, si intelligemment et si richement restaurée par les soins de MM. Darblay. Les nombreuses pierres tombales relevées contre les murs et des inscriptions diverses retiennent surtout l'attention des visiteurs. Mais l'heure presse, les estomacs aussi, et au sortir de l'église, on renvoie les voitures à vide, afin de jouir de la délicieuse promenade du parc de St-Germain, dont l'aimable propriétaire a gracieusement ouvert les portes à la société. Il est superbe ce parc avec ses admirables perspectives, ses serres où les plantes des deux mondes sont réunies, ses belles allées où les feuillages sombres se mêlent et font contraste avec les tons chaudement colorés des feuilles d'automne. On admire surtout le beau groupe de marbre dû au ciseau de Barrias, qui est l'artistique expression d'un pieux et filial souvenir. Puis l'on descend toujours, car cette belle propriété s'étend sur le coteau qui domine la Seine et Corbeil, où l'on arrive en franchissant la petite porte du bas du parc, et l'on se dirige gaîment, accompagnés par les rayons d'un chaud soleil, vers l'hôtel de la Belle-Image où nous attend le déjeuner préparé à notre intention et désiré par tous. On s'empresse de prendre place autour d'une table bien servie et gracieusement décorée de fleurs. Combien y a-t-il de convives? Nous ne saurions les citer tous, car ils étaient nombreux; nous avons cependant inscrit les noms de MM. L. Cros, de Corbeil, conseiller général; J. Depoin, de Pontoise; J. Leroy, E. Verdage, Bourdon, Mallet, J. Barthélemy, Lasnier, A. Dufour, Hudelot, Lemaire, Dr Devouges, de Corbeil; Dragicsevics, de Champrosay; Chéron, de Lardy; Dr Ladmiral, d'Etiolles; Le Paire, de Lagny ; Delessard, de Lardy; Abbé Deverre, de Boutigny; Lachasse, Pinat, abbé Damoiseau, de St-Germain; Delessard, de Ris; Maurice Tourneux, de Paris; Mottheau père et fils, de Brunoy; Durant, de Tigery; G. de Courcel, de Vigneux; Ch. Normand, de Paris; J. Périn, de Ris; Charpentier, de Paris; etc. etc. M. le Dr Boucher présidait ce déjeuner, qui a été empreint de la plus parfaite cordialité, et qui s'est terminé par plusieurs toasts,
| XXV |
très flatteurs pour la société et plusieurs de ses membres en particulier. Après quelques instants laissés au personnel pour préparer la salle, l'on se réunit de nouveau pour la séance, qui est l'objet principal de l'assemblée générale. M. le Dr Boucher préside et, après avoir déclaré la séance ouverte, il prononce le discours suivant : Messieurs et chers collègues, En ouvrant la séance, mon premier devoir est de remercier tous ceux qui ont bien voulu se réunir ici et, par leur présence et leur nombre, sont venus affirmer la vitalité croissante de notre Société et l'intérêt qu'ils lui portent. Tous nos regrets aux absents et surtout aux nombreux collègues qui se sont excusés d'une façon si aimable et si sympathique pour nous. Ce n'est pas à Corbeil que devait se tenir notre réunion. N'oubliant pas que nous nous intitulons Société historique de Corbeil, d'Étampes et du Hurepoix, nous avions désiré, ayant déjà visité Étampes, nous réunir à Dourdan, visiter cette ancienne capitale du Hurepoix et l'intéressant château du moyen âge qui occupe une de ses places. Nous voulions, le même jour, aller voir la merveille architecturale et archéologique de notre contrée, la belle Église de Saint-Sulpice de Favières, cette sœur de la Sainte-Chapelle, due, peut-être, au génie et à la hardiesse du même architecte. Mais des causes nombreuses nous ont empêchés de faire plus tôt notre réunion: puis sont venus les vacances qui dispersent beaucoup d'entre nous et les jours courts qui ne nous permettaient plus de faire l'excursion longue et assez compliquée que nous avions projetée. Nous espérons qu'au printemps prochain nous pourrons organiser cette promenade et aller ensemble faire un pèlerinage artistique à Saint-Sulpice de Favières. Cependant l'article X de nos statuts nous imposait une assemblée générale dans laquelle nous devons vous rendre compte de nos travaux et de notre situation financière. Cette réunion n'a déjà été que trop retardée; c'est pourquoi nous vous avons convoqués à Corbeil, moins pour vous montrer les quelques richesses archéologiques de notre ville, que pour avoir l'occasion de nous réunir, de mieux nous connaître les uns les autres et d'affirmer notre amour commun pour notre pays et son passé historique et artistique. Notre dévoué secrétaire général, enfant de Corbeil et amateur passionné de son histoire, vous a montré, ce matin, la vieille église Saint-Spire, avec le tombeau d'Hémon, premier comte de Corbeil, et celui de Bourgoin, un bon soldat, enfant et bienfaiteur de notre ville, le beau portail de l'ancien cloître Saint-Spire, qui est certainement ce que nous avons de mieux à vous faire voir, malgré les mutilations et les diminutions qu'il a subies,
| XXVI |
Vous avez vu la belle et intéressante église de Saint-Germain-lès-Corbeil, dont la restauration intelligente et artistique fait le plus grand honneur à ceux qui l'ont inspirée et dirigée. En traversant le parc du château de Saint-Germain, gracieusement ouvert à notre Société, vous avez certainement remarqué et admiré le beau monument de marbre dû au ciseau de Barrias, élevé par la piété filiale à la mémoire d'AyméStanislas Darblay. Après notre séance, nous vous conduirons à l'Église Saint-Jean-en-l'Isle, qui tient une grande place dans l'histoire de notre ville. C'est le dernier vestige d'un prieuré et d'une commanderie des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui reçut la sépulture de sa fondatrice, Isburge de Danemarck, veuve de Philippe-Auguste. Comme celle de Saint-Germain, cette église a été l'objet d'une restauration complète et artistique. Vous y verrez de belles et curieuses pierres tombales, dont la recherche et la restauration ont exigé des soins minutieux pour arriver à une restitution exacte et intégrale. C'est dans cette église que sont placées les collections naissantes qui, plus tard, formeront notre musée, pour lequel nous ne craignons pas de faire appel au zèle et à la bienveillance des donateurs. Je ne veux pas empiéter sur le rapport que va vous faire notre secrétaire général en vous parlant de nos travaux, de l'étendue et de l'intérêt croissants de nos bulletins, en vous rappelant les pertes que notre Société a subies cette année, dont une surtout nous a été bien cruelle, car elle nous a privés d'un de nos membres fondateurs, le plus bienveillant, le plus généreux, un amateur fervent et éclairé de notre histoire locale. De très nombreuses adhésions sont venues à nous cette année. Merci et bienvenue à nos nouveaux collègues : nous souhaitons qu'ils fassent, à leur tour, d'autres recrues dont nous avons besoin pour la prospérité et l'avenir de notre Société. De chaleureux applaudissements saluent la péroraison de ce discours; puis M. le Président donne la parole au secrétaire général pour la lecture de son rapport sur la situation et les travaux de la société pendant l'année 1898. Ce rapport est ainsi résumé: Messieurs, Nos statuts veulent que chaque année, à l'assemblée générale, je vienne vous rendre compte de la situation et des travaux de notre Société pendant l'année écoulée, je ne me déroberai point à cette obligation, mais je tâcherai d'être bref pour ne pas abuser de vos instants. Une partie pénible de ma tâche consiste à vous parler des collègues disparus; ils ne sont pas nombreux heureusement et cependant notre Société a subi une perte irréparable dans la personne de M. Aymé Darblay, qui avait été un des premiers membres fondateurs de notre Société et dont il fut, dès le commencement
| XXVI |
et sans se lasser, le généreux bienfaiteur. Je ne vous rappellerai pas tous les titres qu'il s'était acquis à notre reconnaissance, vous les avez lus dans la notice émue que lui a consacrée notre Vice-Président M. le Dr Boucher, notice qui a été insérée dans le 1er Bulletin de cette année; mais je ne puis m'empêcher de renouveler ici les regrets que sa mort nous a causés et de déplorer le grand vide qu'il a laissé au sein de notre Société; il avait déjà beaucoup fait pour elle et il se proposait de faire plus encore; c'est pourquoi sa mémoire nous sera toujours chère. Depuis, mû par un louable sentiment de piété filiale, son fils aîné, M. Robert Darblay, a demandé à se faire inscrire sur la liste des membres de notre Société et nous sommes heureux de le compter parmi nos collègues. Je dois encore vous signaler la perte regrettable de M. le chanoine Gallet, de Versailles, décédé dans le courant de cette année ; c'était un homme de bien et un érudit, très aimé et apprécié de tous ceux qui l'approchaient. Il a laissé dans le monde savant, à Versailles surtout, des regrets qui ont été éloquemment exprimés dans des notices où il était apprécié comme il le méritait. Le chanoine Gallet était né tout près de nous, à Arpajon; aussi portait-il un vif intérêt à notre Société, dont il avait tenu à faire partie. Vous voyez, Messieurs, que si nos pertes sont graves, nous devons nous féliciter qu'elles ne soient pas plus nombreuses. Il faut y ajouter deux ou trois radiations pour refus de paiement de la cotisation annuelle, c'est ce qui arrive dans toutes les Sociétés. Malgré tout, le nombre de nos adhérents a suivi une marche ascendante; nous étions 164 lors de notre dernière assemblée générale, nous sommes aujourd'hui 181; il y avait l'an passé 15 membres fondateurs, ils sont maintenant 17. Vous savez que les membres fondateurs versent 100 fr. une fois donnés et sont par la suite affranchis de toute cotisation. A ce sujet, je dois vous signaler un fait assez rare et très honorable pour son auteur: un de nos membres honoraires, qui, à ce titre, n'était assujetti à aucune cotisation, a tenu à devenir fondateur et a versé dans ce but la somme de 100 fr. Permettez-moi de vous le nommer: c'est M. Maxime Legrand, l'érudit historien d'Étampes, que nous ne saurions trop remercier pour cet acte de généreuse sympathie envers notre Société. J'ai maintenant à vous rendre compte de nos travaux pendant l'année 1898. Les deux bulletins afférents à cette année sé composent de 142 pages et renferment différentes notices dont voici le détail : Les sculptures du clocher de Brunoy, intéressante monographie due à notre infatigable confrère M. Ch. Mottheau, qui poursuit sans se lasser ses études sur son pays natal, et qui a richement illustré son travail de 13 gravures dont trois hors texte. M. Gatinot, de Montgeron, nous a donné le curieux récit de la fête de la Fédération à Montgeron, le 14 juillet 1790, qu'il a su retrouver et qu'il a bien voulu extraire pour nous d'un travail sur Montgeron qu'il prépare en ce moment,
| XXVIII |
M. P. Pinson, qui possède tant de documents sur Étampes, sa ville natale, nous a donné, cette année, une relation inédite de la Réception faite à Philippe V, roi d'Espagne, à son passage à Étampes, le 5 décembre 1700. Notre confrère M. Boulé est d'Arpajon, et il ne néglige rien de ce qui touche à l'histoire de cette ville; c'est ainsi qu'il a enrichi notre bulletin d'une savante notice intitulée: Châtres-sous-Montlhéry, érigé en marquisat en octobre 1720 et devenant Arpajon. On ignorait jusqu'à ce jour la date et le lieu de la mort de D. Fleureau, l'historien d'Étampes, dont l'ouvrage est si rare et si recherché ; notre érudit confrère, M. Paul Pinson, a eu dernièrement la bonne fortune d'en rencontrer un exemplaire sur lequel un neveu de D. Fleureau avait écrit que son oncle était mort à Étampes au mois d'avril 1674. Cette heureuse trouvaille a permis à M. Pinson d'écrire pour notre bulletin un article sur la date de la mort de D. Fleureau, qui a vivement intéressé nos confrères d'Étampes. Vient ensuite le journal d'un bourgeois de Corbeil; c'est le récit fait par un habitant de cette ville des événements journaliers qui se passent sous ses yeux. Ce journal (1re partie) qui date de la première moitié du XVIIIe siècle, a fourni à l'éditeur l'occasion de nombreuses notes qui éclairent et complètent le récit. Voilà pour le 1er bulletin; le second débute par le compte-rendu de l'assemblée générale de 1898 et le récit de l'inauguration du musée Saint-Jean, à laquelle beaucoup d'entre vous ont assisté; il est suivi de la savante conférence faite à cette même inauguration par notre éminent confrère, M. E. Delessard, de Lardy, qui a magistralement traité, avec sa compétence habituelle, ce sujet qu'il connaît si bien et qui sert de titre à son travail, le Préhistorique en Seine-et-Oise. Cette notice est illustrée de sept gravures, dont deux hors texte. A la suite se trouve l'article la Reine Isburge et la Commanderie de Saint-Jean-enl'isle, lu à Saint-Jean, le même jour, par votre secrétaire général; il est accompagné d'une gravure représentant la statue de la veuve de Philippe-Auguste telle qu'elle était sur son tombeau. Le journal d'un bourgeois de Corbeil (suite et fin) vient ensuite, toujours accompagné des notes de l'éditeur. Ce bulletin, plus complet que les précédents, se termine par la bibliographie annuelle qui, elle aussi, est plus étendue que ses devancières, puisqu'elle n'occupe pas moins de 12 pages de ce bulletin. Voilà, mes chers collègues, ce que nous avons fait pour 1898; nous nous plaisons à espérer que vous en aurez été satisfaits. Pour l'avenir nous avons des promesses qui nous assurent des publications intéressantes. Vous avez reçu déjà le premier fascicule de 1899 qui, à lui seul, contient autant de matières, que deux bulletins des années précédentes; le second est sous presse, très avancé, et paraîtra sûrement avant la fin de l'année. Le deuxième volume de nos Mémoires et documents, déjà annoncé et retardé malgré nous, paraîtra çertainement dans les premiers mois de l'année prochaine; nous aurons alors
| XXIX |
regagné des retards involontaires, et nous n'aurons plus à nous occuper que des bulletins de 1900, qui viendront à leur heure. Vous voyez par ce qui précède que notre Société est en bonne voie de vitalité et de prospérité, continuez à l'aider de vos travaux et de vos cotisations, ameneznous surtout de nouveaux sociétaires qui augmenteront nos ressources et no us permettront de faire plus et mieux, et, de notre côté, nous vous serons reconnaissants des efforts que vous aurez faits en vue d'augmenter la prospérité de notre chère Société. Un mot encore avant de terminer, à propos du musée Saint-Jean. Nous n'avons pu encore, à notre vif regret, l'ouvrir au public, ce qui ne nous a pas empêché d'avoir assez fréquemment des visites particulières. La difficulté de l'ouverture publique provient de ce que nous n'avons pas de logement à offrir à un gardien; celui-ci, nous l'avons trouvé déjà et, en attendant que nous puissions le loger, nous étudions une combinaison qui nous permettra, nous l'espérons, d'ouvrir le musée au moins un jour par semaine. M. le Président donne ensuite la parole à M. le Trésorier pour lire son rapport sur la situation financière de la société. Nous donnons ci-dessous l'analyse de cet intéressant rapport, qui a une importance vitale pour la société et qui témoigne une fois de plus de la compétence et de l'ordre de M. le Trésorier. Ce document sera inséré in-extenso au registre des procès-verbaux, en voici le résumé: SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 1898 Excédent de l'exercice précédent. Recettes Complément d'une fondation de 1897. Cotisations encaissées en 1898 Intérêts de fonds placés. Cotisations arriérées. 2.885 fr. 51 50 I.280 65 IIS 41 A – — 39 Vente de bulletins. Versements pour le Musée. 150 Total des recettes. 4.586 fr. 90 Dépenses Frais d'impression Timbres-poste et de quittances Clichés, plans, gravures Frais de recouvrement. Dépenses du Musée. Total des dépenses. 702 fr. 35 94 55 201 — ΙΟ 29 80 58 - SS 1.086 fr. 35
| XXX |
L'excédent des recettes au 31 décembre 1898 s'élève donc à la somme de · représentée par un livret de la Caisse d'épargne de Corbeil, nº 74.695 se montant à . et en numéraire en caisse 3.328 fr. 87 171 68 — 3.500 fr. 55 Total égal. · 3.500 fr. 55 M. le trésorier fait observer que dans ce reliquat de 3.500 fr. 55, les fondations reçues jusqu'au 31 décembre 1898, figurent pour la somme de 1.500 francs. L'assemblée approuve les comptes ci-dessus et en donne décharge à M. le Trésorier, puis elle lui vote des remerciements, ainsi qu'à M. le secrétaire-général, pour leurs intéressants rapports. M. le Président dit ensuite que, pour obéir aux termes de l'article VII des statuts, l'assemblée générale doit procéder au renouvellement partiel d'un tiers, soit sept membres, du conseil d'administration. Cette année les membres, dont le mandat est expiré et qui sont rééligibles, sont MM. G. de Courcel, J. Depoin, Abbé Genty, Lasnier, Mareuse, Marc-Pasquet et Jarry. M. le Président propose à l'assemblée de renommer pour trois ans les membres ci-dessus, excepté M. Jarry, qui a donné sa démission d'administrateur et de secrétaire rédacteur et qui a été remplacé dans ces fonctions par M. Girard, Conservateur des hypothèques à Corbeil. A l'unanimité, l'assemblée nomme administrateurs pour trois ans MM. G. de Courcel, J. Depoin, Abbé Genty, Lasnier, MarcPasquet, Mareuse et Girard. Par acclamation, l'assemblée générale renouvelle ensuite pour une année, conformément aux articles II et XIV du réglement, les pouvoirs du bureau et du Comité de publication. Ces formalités terminées, M. Dufour lit la notice annoncée au programme sous le titre de Un condamné à mort au XVIIe siècle. Cette notice, qui concerne un illustre enfant de Corbeil, Jacques Bourgoin, sera insérée au rer bulletin de l'année 1900. L'ordre du jour' étant épuisé, M. le Président lève la séance, puis l'on monte en voiture pour se rendre au Musée St-Jean, où ceux qui ne connaissaient pas encore l'intéressant édifice qui le renferme, eurent grand plaisir à visiter cette vénérable église des Chevaliers de St-Jean de Jérusalem, où la reine Isburge, veuve de Philippe-Auguste, fut inhumée en 1236.
| XXXI |
Nous ne nous étendrons pas davantage sur ce curieux monument dont nous avons déjà amplement parlé dans le compte-rendu de l'inauguration du Musée St-Jean au mois de juin 1898 et dans la notice Saint-Jean et la Reine Isburge qui fut lue à cette occasion (1). L'heure s'avançant, on remonte en voiture pour rejoindre le train qui doit emmener nos visiteurs, puis l'on se sépare en se disant au revoir et en se félicitant mutuellement de la bonne journée qui vient de s'écouler et de l'imperturbable beau temps qui l'a favorisée. SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Tenue à la Sous-Préfecture de Corbeil, le 10 Mai 1900 Présidence de M. le Dr BOUCHER, Vice-Président. Étaient présents: M. le Dr Boucher, Vice-Président; M. Horteur, Sous-Préfet de Corbeil, Président d'honneur ; MM. Barthélemy, Abbé Colas, V. de Courcel, Dufour, Girard, Maxime Legrand, Mareuse, Marc-Pasquet, Lasnjer et Mottheau. Absents excusés: MM. G. de Courcel, Depoin, J. Lemaire et J. Périn. Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté sans observations. Le Conseil prononce l'admission des sept nouveaux membres suivants : M. Boëte (François), instituteur à Villecresnes, présenté par MM. le Bon Richerand et Dufour; M. Flizot, instituteur à Essonnes, présenté par MM. HumbertDroz et Dufour; M. Bougin (Louis), 5, rue d'Arcole, à Paris, présenté par MM. Cros et Dufour; M. Welter (Henri), au Mesnil-Longpont, par Montlhéry, et 217, rue St-Honoré, à Paris, présenté par MM. Allorge et Dufour; M. de Lafaulotte (Louis), au château de Bruyères-le-Châtel, et à Paris, 129, Avenue des Champs-Elysées, présenté par MM. Horteur, sous-préfet et Dufour; M. Maïstre (Henri), secrétaire de la rédaction de la Correspon- (1) Année 1898, 2° bulletin, pp. 43 à 55 et 75 à 86.
| XXXII |
dance historique, 12, rue Antoine-Roucher, à Paris, présenté par MM. Bournon et Dufour; M. Garnier, négociant à Corbeil, présenté par MM. le Dr Boucher et Marc-Pasquet. Par contre, le Conseil enregistre la démission de M. Garnier (Paul), rue Taitbout, 16, à Paris, et le décès de MM. Michelez, de Lardy et Gibert, de Corbeil. Au sujet de ces deux derniers, M. le Président s'exprime ainsi: « M. Léon Michelez est décédé à Lardy le 30 septembre 1899. « C'était un artiste distingué qui aimait passionnément l'intéres- « sante vallée qu'il habitait depuis longtemps et dont il a peint tous « les sites. Un de ses meilleurs tableaux, les bois de Chamarande, « était en la possession du peintre Berchère, son ami, qui l'a légué « au musée d'Étampes. « Quant à M. Gibert, qui fut pendant de longues années percep- « teur à Corbeil, nous l'avons bien connu et tous nous avons appré- « cié cet homme aimable dont le caractère toujours égal rendait le « commerce très agréable. Il est mort au commencement de cette « année, à la suite d'une longue maladie, courageusement suppor- « tée, ne laissant après lui que des regrets, et à nous particulière- « ment celui de perdre un collègue estimé que nous espérions « garder longtemps encore dans notre Société. » Les regrets unanimes du Conseil accueillent cette triste communication. Cinq volumes ont été offerts à la Société par la Direction des beaux-arts du ministère de l'instruction publique, ils ont été inscrits au catalogue; celui-ci sera inséré dans l'un des prochains bulletins. Sur leur demande, les Sociétés archéologiques de Brie-ComteRobert et d'Eure-et-Loir seront inscrites sur la liste des Sociétés correspondantes avec lesquelles l'échange des publications est autorisé; celle d'Eure-et-Loir a déjà envoyé 16 fascicules ou bulletins. Le Conseil autorise le Secrétaire-général à faire relier un certain nombre de brochures qui font partie de la bibliothèque de la Société. Le Secrétaire général rappelle au Conseil que le deuxième volume des Mémoires et documents a été récemment distribué; il ajoute que le 1er bulletin de 1900, dont une partie est déjà sous presse, ne tardera pas à paraître.
| XXXIII |
Il apprend encore au Conseil qu'il a envoyé au ministère de l'instruction publique, sur sa demande et en vue de l'exposition universelle de 1900, toutes les publications de la Société et un certain nombre de gravures séparées qui en proviennent. M. Dufour ajoute qu'il a été à même de constater que toutes ces publications figuraient au Champ de Mars, dans l'exposition collective des Sociétés savantes, groupe I, classe III. La question de l'ouverture au public du musée Saint-Jean donne lieu à des observations diverses. Après en avoir délibéré, le Conseil arrête les dispositions suivantes: Le Musée sera ouvert tous les dimanches et jours fériés à partir du 3 juin prochain, de 1 h. à 6 h. en été (1er avril-1er octobre) et de 1 h. à 4 h. en hiver (1er octobre-1er avril). Le public en sera informé par une insertion dans les journaux et un écriteau placé à la porte du musée. Le gardien, Filliau, recevra une allocation de deux francs par séance. Le Secrétaire général informe le Conseil que les six beaux chapiteaux romans qui étaient relégués sur le sol à l'entrée de l'église, se trouvent maintenant bien en évidence sur de solides appuis où l'on peut facilement les étudier, et il ajoute que cet heureux résultat est dû à la généreuse obligeance de M. P. Darblay. Le Conseil, appréciant tout l'intérêt de cette communication, charge son secrétaire général de transmettre ses remercîments à M. P. Darblay. M. le Président soumet ensuite au Conseil la question de la fixation de l'assemblée générale de l'année 1900, et il propose de la tenir à Dourdan, à la suite d'une promenade archéologique à SaintSulpice de Favières et Villeconin. Après un échange de vues entre MM. Barthélemy, M. Pasquet, Mareuse et M. Legrand, le Conseil décide que l'assemblée générale se tiendra à Dourdan le jeudi 5 juillet; le rendez-vous sera à la station du Breuillet, d'où l'on ira en voiture à Saint-Sulpice-de-Favières, à Villeconin et à Dourdan. Les détails de l'excursion seront réglés par le bureau et communiqués en temps utile à tous les intéressés. Le secrétaire général donne lecture de deux lettres; la première émane de M. Teton, instituteur à Epinay-sous-Senart, qui propose à la Société de lui envoyer sa monographie d'Epinay, proposition qui est acceptée avec reconnaissance. La seconde missive est de 3
| XXXIV |
M. le Comte Treilhard, conseiller général; cet excellent collègue assure le Conseil de son zèle et de son dévoûment envers la Société en vue de lui faire obtenir la subvention de 100 fr. qu'elle a sollicitée du département, et il termine en disant que cette affaire est en bonne voie et qu'une décision du Conseil général sera prise à ce sujet dans la session d'août prochain. Il est ensuite donné communication d'un projet de circulaire à adresser aux maires des localités voisines de Corbeil et d'Étampes pour leur demander l'inscription de leurs communes sur les listes de la Société. Le secrétaire général est chargé d'examiner cette proposition dont l'auteur est M. J. Périn, notre sympathique confrère et l'éminent fondateur de la Société historique la Montagne Sainte-Geneviève. M. Barthélemy exprime le désir qu'une inscription, placée par les soins de la Société, rappelle l'emplacement de l'ancien Prieuré de Notre-Dame-des-Champs à Essonnes, qui existait déjà du temps de Suger et dépendait de la célèbre abbaye de Saint-Denis. Le Conseil apprécie tout l'intérêt de cette demande, mais il voudrait d'abord savoir quel est le propriétaire du petit édicule déjà existant sur lequel M. Barthélemy propose de fixer l'inscription commémorative, afin de ne rien entreprendre sans y être autorisé; dans ce but, il charge M. Barthélemy de prendre des renseignements sur ce sujet intéressant. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
| np |
| np |
EE) Tombeau de Jacques Bourgoin dans l'église Saint-Spire de Corbeil. M..sc.
| np |
| np |
| 1 |
UN CONDAMNÉ A MORT Au XVIIe siècle JACQUES BOURGOIN, 1585-1661
La ville de Corbeil était autrefois riche en monuments anciens et elle n'avait rien à envier à ses voisines; mais tandis qu'Etampes, Melun, pour ne citer que celles qui sont proches, ont l'heureux privilège d'avoir pu conserver leurs anciens édifices, Corbeil a vu disparaître une à une toutes ses églises, qui, pendant des siècles, avaient fait la joie de nos pères et dont elle était fière à juste titre. Le siècle qui va finir en aura vu détruire six et non des moins intéressantes. Cette triste série s'ouvre en 1803 par la démolition de SaintJacques, qui était située dans le faubourg et dans la rue du même nom; Sainte-Geneviève, des Récollets, disparut ensuite, et l'année 1823 a vu s'achever la destruction de Notre-Dame, un admirable monument du XIIme siècle, qui serait aujourd'hui l'honneur de notre ville si nous le possédions encore. Dans ces dernières années, nous avons assisté à la disparition de la chapelle de l'Hôtel-Dieu, ancien reste de Saint-Jean-de-l'Ermitage, et des églises Saint Léonard et Saint-Guenault qui, toutes deux, dataient du XIIIme siècle. Et ce qui est le plus triste, c'est que le temps n'a été pour rien dans cette œuvre de destruction et que la main de l'homme est seule coupable de ces actes de vandalisme. De toutes nos églises, une seule nous reste, c'est Saint-Spire, qui remonte à l'époque romane et qui, à la suite d'un incendie, a été reconstruite en grande partie au XIIIme siècle. Ceux qui l'ont visitée ont certainement remarqué, dans la première chapelle du collatéral gauche, un monument funéraire en marbre |2| blanc, qui est un intéressant spécimen de la sculpture au XVIIe siècle (1). Ce cénotaphe est une épave de l'église Notre-Dame; lors de la destruction de celle-ci, il a été transporté à Saint-Spire, et la sépulture qu'il recouvrait a été abandonnée dans les caveaux de NotreDame, livrée aux plus viles destinations. Cette sépulture était celle de Jacques Bourgoin, un enfant du peuple, né à Corbeil en 1585, qui, par son mérite, atteignit un rang élevé dans les armées du Roi. Il servit sous Henri IV, Louis XIII et Louis XIV et eut l'occasion de rendre des services importants qui furent signalés dans des lettres Royales que nous aurons occasion de citer (2). Quand notre bon roi Henri IV eut définitivement conquis son royaume et qu'une ère de paix succéda aux longs troubles de la ligue, Bourgoin, qui n'aimait pas l'inaction, obtint du roi la permission d'aller servir en Suède. Là il devint colonel de la garde royale, sous les rois Charles IX et GustaveAdolphe, et pendant 16 ans qu'il resta dans ce pays, il guerroya sans cesse, rendant des services éminents qui furent hautement reconnus par Charles IX et Gustave-Adolphe. Nous possédons dans les archives de Corbeil une série de lettres, signées de ces deux rois, dans lesquelles ils font l'éloge de Jacques Bourgoin et de ses qualités militaires et reconnaissent les grands services qu'il leur a rendus. Revenu en France vers 1624, Bourgoin, ou plutôt M. de Corbeil, ainsi qu'on l'appelait toujours, reprit du service et entra au régiment de la Tour comme premier Capitaine, puis il devint lieutenantcolonel au même régiment, et passa plus tard avec le même grade au régiment de Gévaudan. Nous ne suivrons point ici M. de Corbeil dans sa carrière militaire, qui fut particulièrement brillante. C'est une biographie que nous ferons plus tard; nous nous arrêterons seulement à un événement qui causa de cruels soucis à notre compatriote et qui motive le titre de cette simple notice. Le 5 août 1628, le régiment de la Tour, dans lequel Bourgoin servait avec le grade de 1er capitaine, était en marche pour aller d'Orpières, en Dauphiné, à Vaynnes. C'était l'après-midi, Bourgoin était à cheval et discourait avec d'autres officiers du régiment. Tout (1) Le moulage de ce tombeau figure au musée de sculpture comparée du Trocadéro. (2) Voir les pièces justificatives, |3| à coup, à propos de la distribution des étapes, une querelle s'éleva entre lui et un autre capitaine nommé Jehan Jolly, sieur de la Houssaye. La querelle s'étant envenimée, celui-ci tira son pistolet et le déchargea à la tête de Bourgoin, qui ne fut pas atteint ; il voulut alors mettre l'épée à la main, mais Bourgoin le prévint en lui tirant un coup de pistolet qui le renversa à terre, grièvement blessé au côté gauche. Le procès-verbal de cet événement, rédigé le jour même par le Prévôt du régiment, dit que la Houssaye, se sentant mortellement atteint, avait déclaré « qu'il ne se pouvoit plaindre que de son « malheur, que c'estoit une punition du ciel et qu'il n'entendoit « pour ce regard qu'on fît aucune poursuite contre le Sr de Corbeil « auquel il pardonnoit de bon cœur ». Transporté au village de Merueil, près duquel le régiment se trouvait alors, la Houssaye mourut dans la nuit suivante et fut enterré dans l'église de ce village. Puis le régiment de la Tour poursuivit sa marche et fut envoyé au loin et même en Italie. Mais la famille de la victime, qui était puissante et hautement apparentée, avait porté plainte au Parlement de Grenoble contre Bourgoin qu'elle traitait d'assassin, réclamant justice de cet assassinat. Le coupable était loin, le télégraphe n'existait pas encore, et Bourgoin n'eut pas même connaissance des nombreuses assignations lancées contre lui; il en résulta qu'il fut considéré comme contumax et que la cour criminelle du Parlement de Grenoble rendit le 17 mars 1729 l'arrêt suivant : « La Cour, en retenant la cognoissance de la cause, ordonne que « Corbeille (sic), Cappitaine au régiment de la Tour, sera prins et « saisy au corps, conduit et mené dans la conciergerie du palais « pour y estre détenu jusqu'à ce que aultrement soyt ordonné, et « ou il ne pourra estre appréhendé, sera crié à trois briefs jours, « ses biens saisys et mis sous la main du Roy et de justice et se- «questre estably au régime d'iceux, pour le fait cy rapporté estre « prouvé ainsi qu'il escherra ». Et le 18 may suivant, la même cour rendait son jugement en ces termes, au nom du roi qui ne s'en doutait pas, mais c'était la formule : « Au nom du Roy, nostre dicte Cour a déclaré ledict Bourgoin |4| « vray défaillant et contumax, et tant pour le proffit de la dite con- « tumace que par ce que résulte des charges et informations contre « luy, l'a déclaré suffisamment convaincu du crime dont s'agit, « pour réparation duquel ordonne que lorsqu'il pourra estre appré- « hendé, qu'il sera livré entre les mains de l'exécuteur de la haulte « justice pour être par luy conduit en la place du Brueil (1) de « ceste ville et là pendu et estranglé en une potence qui sera dressée, « jusqu'à ce que mort s'en suive, et cependant, jusqu'à ce qu'il « puisse être appréhendé, ordonne qu'il sera exécuté en effigie, en « oultre a condamné ledict Corbeil en mil livres d'amende envers « les parties civiles, 500 livres envers le Roy et 100 livres en œuvres « pies… etc ». Quelques jours après, le jugement en effigie fut exécuté à Grenoble, sur la place du Brueil, par la main du bourreau. Bourgoin, prévenu enfin, adresse au Roi une requête au mois de juillet 1629, dans laquelle il invoque son éloignement et son service aux armées qui l'ont empêché d'avoir connaissance des assignations lancées contre lui. Dans ce même mois de juillet, le roi Louis XIII accordait à Jacques Bourgoin de Corbeil des lettres de grâce et de rémission qui annulaient le jugement rendu, et le déchargeait de toutes les peines portées contre lui, à raison, dit le roi « des grands services à luy rendus dans ses armées par le dit Bourgoin » (2). On pourrait croire que tout était fini: il n'en fut rien ; les lettres de grâce devaient être entérinées par le Parlement de Grenoble, et les héritiers de la Houssaye (frères et sœurs) poursuivant leur vengeance, s'opposèrent à cet entérinement, sous prétexte que Bourgoin n'avait pas purgé sa contumace en payant, dans les délais voulus, les amendes auxquelles il avait été condamné. Il s'ensuivit des procédures sans fin qui durèrent des années. Pendant ce temps, Bourgoin était en Italie, au siège de Pignerol et à Casal, ce qui laissait le champ libre à ses ennemis. Le 16 décembre 1633, le roi confirme au Parlement de Grenoble les lettres de grâces accordées par lui à J. Bourgoin (3). Les héritiers la Houssaye résistent par tous les moyens possibles, et demandent la nullité des lettres de grâce sous le prétexte qu'elles n'avaient pas été entérinées dans les délais voulus, mais ils ne (1) A Grenoble. (2) Voir aux pièces justificatives ci-après. (3) Pièces justificatives.
| 5 |
disent pas qu'ils s'étaient opposés eux-mêmes à cet entérinement. En septembre 1637, Louis XIII envoie au Parlement de Grenoble, comme suite à ses lettres de grâce et rémission, de nouvelles lettres d'abolition du jugement rendu contre Bourgoin, avec ordre de les faire entériner immédiatement (1). Mais ses adversaires ne désarment pas; ne pouvant plus s'en prendre à sa vie, ils l'attaquent en paiement des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui. En juin et juillet 1638, ils demandaient encore la nullité des prétendues lettres de grâce accordées à Bourgoin et sa condamnation. Enfin la Cour de Grenoble rendit un double jugement qui mit fin à cet interminable procès dont notre pauvre Bourgoin, toujours absent, ne put sortir indemne, on va le voir par les termes du deuxième jugement: « La Cour, entérinant les lettres d'abolition, met à néant le « jugemens précédens et décharge Bourgoin de toutes amendes « et dépens »; mais, par un second jugement, elle le condamne « à < 2.300 livres pour tous les dépens, dommages et intérests, et en « outre à une aumosne de 60 livres en faveur de l'église de Merueil « pour prier Dieu pour l'âme de la Houssaye ». Le 27 juillet 1638, M. de Corbeil fait payer par un tiers les 2.300 livres auxquelles il avait été condamné par la Cour de Grenoble, malgré les lettres de grâce et d'abolition du roi qui le déchargeaient de toutes peines et amendes (2). Cette résistance d'un parlement contre le roi est curieuse ; celui de Grenoble ne veut pas se rendre et si, par un premier jugement, qui lui est en quelque sorte imposé, il décharge Bourgoin des amendes et dommages-intérêts, immédiatement, par un second jugement, il le condamne aux mêmes amendes et dommages-intérêts; seulement, comme différence, il en augmente le chiffre ! Bourgoin, débarrassé enfin de tous ces soucis, poursuivit sa cárrière militaire et continua à rendre de sérieux services. En 1652, pendant les troubles de la Fronde, il est gouverneur de Corbeil; notre ville avait alors une grande importance stratégique, l'armée (1) Pièces justificatives. (2) Nous avons le reçu de cette somme dans les archives de Corbeil, il fait partie des nombreuses pièces de ce procès, il y en a 46 dont plusieurs très volumineuses. Toutes les lettres royales y sont aussi, avec les grands sceaux qui y sont attachés.
| 6 |
des Princes, venant d'Etampes, était à Ablon; Turenne était en face, à Villeneuve-Saint-Georges. Nos archives possèdent beaucoup de lettres de Turenne adressées à M. Corbeil, gouverneur de Corbeil, à Corbeil, qui témoignent de l'importance de notre ville à cette époque, et des services qu'y rendit notre compatriote Bourgoin. Mais il n'en avait pas moins été condamné à mort et exécuté en effigie. Après la Fronde, quand le calme fut revenu, Bourgoin quitta le service pour prendre un repos bien gagné ; il se retira dans sa maison du quai Saint-Laurent qu'on a depuis, peu intelligemment, dénommé quai de l'Instruction (1). C'est là qu'il mourut en 1661, laissant à sa ville natale sa maison et son jardin, ainsi que des rentes pour l'entretien du collège qu'il y fondait en vue de l'instruction de la jeunesse de Corbeil. Ce Collège, qui devait être et a été administré par les Messieurs de Sorbonne, a subsisté dans l'ancienne maison de Bourgoin jusqu'à la révolution, les écoles communales lui ont succédé dans le même local, et si les rentes laissées par J. Bourgoin ont disparu, on peut dire que ses intentions à l'égard de l'instruction de la jeunesse de Corbeil sont encore respectées. Le monument de Jacques Bourgoin dans l'église Saint-Spire est très malencontreusement placé devant un vitrail, ce qui a rendu difficile la reproduction que nous joignons à cette notice. Cette reproduction est forcément très réduite; mais afin de faciliter l'étude des détails, nous empruntons au Baron de Guilhermy la description qu'il en a donnée dans le tome IV de ses Inscriptions de la France. « Le monument est sculpté en marbre. Une figure de grandeur naturelle représente le défunt dans l'attitude de la prière, sur un monument décoré d'encadrements, de moulures, et d'une tête de squelette ailée entourée d'un linceul. Le costume se compose de l'armure de fer, encore d'usage au XVIIe siècle, de grandes bottes de cuir avec leurs éperons, de l'écharpe, attribut du commandement, et de l'épée. Les traits ont du caractère. Une petite calotte recouvre le haut de la tête. Le casque et les gantelets sont placés un peu en arrière de l'effigie. Un prie-Dieu armorié porte le livre d'oraisons ». (1) Ce changement de nom date de la révolution.
| 7 |
En dessous, sur une large plaque de marbre noir (1), on lit l'inscription suivante qui est, en raccourci, la biographie du brave guerrier que fut Bourgoin: Icy gist Jacques de Bourgoin de Corbeil, escuier, fondateur du Collège de cette ville, qui est né audict Corbeil, et y décéda le 12me jour de novembre 1661, aagé de 76 ans. Il commença de porter les armes soubs le Roy Henry le Grand, en la Franche Comté et au siège d'Amiens (2). Il fut envoyé par sa Majesté au service des Princes du Nort, où il se signala dans les commandemens des troupes Françoise, et gouvernemens des Places là où il a esté assiégé, et aux Ambassades qu'il y a gérées. Louis 13me, à son retour le mit en plusieurs nobles employs, tant en l'Infanterye qu'à la Cavallerye, entre autres dans la Lieutenance Colonelle du Régiment de la Tour, où il a rendu des services continuelz si mémorables qu'on leur doit attribuer la reprise des Illes Ste Marguerite et Ste Honnorat soubs M. le Comte d'Harcour (3), et mérita de commander, et courageusement deffendre la Citadelle de Cazal contre le Marquis de Leganez, Général de l'Armée d'Espagne. Le Roy Louis 14e luy a confié la ville de Corbeil durant les troubles de la France en 1652. Et parmy tous ses grandz employs il a tousiours conservé sa Religion pure et sa piété, au point que devant sa mort il a donné sa maison et un jardin audit Corbeil, et quinze cens vingt livres de rente pour la fondation dudit Collège soubs la direction de Messieurs de Sorbonne, où la jeunesse de la ville et faulx bourgs sera instruicte gratuitement en la crainte de Dieu et bonnes mœurs, escritures, et langue latine jusqu'à la Rhétorique inclusivement, conformément au contract de fondation passé par devant Barre et Tarteret, Notaires à Corbeil, le 30º Janvier 1656. Il a aussy fondé à perpétuité en cette église douze services solemnels par année pour le repos de son Ame, et une Aumosne aux pauvres de deux septiers de bled en pain à chacun service, moyennant cinq cens cinquante livres de rente, comme il est déclaré au contract de fondation passé pardevant Tarteret Nore le 2e janvier 1653, ce qu'il a faict, Passants, pour vous donner exemple et à ce que vous vous en souveniez et de prier Dieu pour luy. Requiescat in pace. Une autre inscription, sur marbre noir également, et rappelant les mêmes faits, mais en termes différents, est scellée dans un mur de l'ancien Collège, fondé par Bourgoin dans sa maison et trans- (1) Largeur: 110 c. Hauteur: 0™53. (2) En 1597. (3) Ces deux îles avaient été prises par les Espagnols en 1635 et elles furent reprises en 1637 par l'armée du roi, sous les ordres du Comte d'Harcourt et de l'Archevêque de Bordeaux, Henri d'Escoubleau de Sourdis. J. Bourgoin remplit le principal rôle dans cette reprise.
| 8 |
formé à la Révolution en écoles communales (1). Cette inscription, plus ancienne que celle du tombeau, a été faite du vivant de Bourgoin et certainement sous yeux; ce qui le prouve, c'est que les dates du décès et de l'âge sont restées en blanc; en outre il y est nommé Jacques Bourgoin, son vrai nom, tandis que sur son tombeau on lui a donné la particule, ce qui n'est pas exact, car sur les papiers que nous avons de lui, il a toujours signé Jacques Bourgoin. En outre, sur l'épitaphe du tombeau, où les dates sont remplies, ce qui indique une gravure postérieure au décès, on le dit âgé de 76 ans ; là encore il doit y avoir eu erreur, car, si on rapproche la date de sa mort, 1661, de l'âge indiqué, 76 ans, on trouve alors qu'il serait né en 1585. Il n'aurait donc eu que 12 ans quand il assistait au siège d'Amiens de 1597; c'est peu probable. D'ailleurs, ce brave homme avait passé sa vie dans les camps et ne s'était pas marié: il n'avait donc pas de famille proche, et, à sa mort, il ne se trouva personne pour renseigner exactement le graveur et lui faire éviter des erreurs qui ne sont pas rares dans ce genre de travaux. Nous pensons donc que l'inscription de l'ancien Collège, faite du vivant de Bourgoin, doit être regardée comme plus exacte que celle qui orne son mausolée, et, pour en faciliter la comparaison, nous l'ajouterons à la suite des pièces justificatives. A. DUFOUR, Bibliothécaire. (1) Ces écoles ont été entièrement reconstruites en 1878, mais sur le même emplacement de la maison de Jacques Bourgoin. L'inscription ci-dessus a été scellée de nouveau, sur le mur du vestibule d'entrée.
| 9 |
PIECES JUSTIFICATIVES
I LETTRES de pardon, abolition et rémission accordées par Louis XIII à Jacques Bourgoin de Corbeil, juillet 1629 (1). LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE, A TOUS PRÉSENZ ET ADVENIR, SALUT. Nous avons receu l'humble supplication de Jacques Bourgoin, Escuier, sieur de Corbeil, premier cappitaine de l'un de noz régimentz commandé par le sieur de la Tour, contenant que le cinquiesme aoust 1628, estant party à cheval du lieu d'Orpierre (2) en Dauphiné avec ledict régiment pour s'en aller à Veynnes (3), suivant l'ordrede nostre très cher cousin le mareschal de Crequy, nostre lieutenant général en ladicte province, et allant, causant avec Jean Jolly sieur de la Houssaye, aussy cappitaine audict régiment, Ilz seroient tombez sur le discours de la distribution des estappes et se seroient tellement eschauffez de parolles que ledict de la Houssaye auroit mis la main au pistollet qu'il portoit à l'arçon de la selle de son cheval et icelluy tiré contre la teste du suppliant, et l'ayant mancqué il voulut mettre la main à l'espée ce qui donna subject au suppliant, pour garantir sa vie, de tirer pareillement son pistollet dont il luy porta un coup duquel il brisa la poingnée de ladicte espée et blessa ledict de la Houssaye, duquel coup il décedda environ vingt-quatre heures après, à faulte de bon et prompt appareil, au grand regret de l'exposant qui avoit tousjours vescu en assez bonne intelligence avec luy, ainsy qu'auroit recongneu ledict de la Houssaye avant son décés, et qu'il estoit cause du malheur qui luy estoit arrivé, pour raison de quoy néantmoins, il y auroit eu informations faictes par le prévost dudict régiment et plusieurs poursuittes extraordinaires contre le suppliant, lequel craingnant rigueur de justice, a eu recours à nostre clémence, nous suppliant très humblement luy accorder noz lettres de grâce, rémission, pardon et abolition (1) Archives de la ville de Corbeil (ii. 5. p. 6). (2) Orpierre, Hautes-Alpes, arrondissement de Gap, chef-lieu de canton, ancien fief. (3) Veynes, Hautes-Alpes, arrond. de Gap, chef-lieu de canton.
| 10 |
sur ce nécessaires, a quoy inclinant volontairement, SCAVOIR FAISONS QUE Nous, désirans préférer miséricorde à rigueur de justice, mettant en considération les signalez services que nous a rendus le suppliant en noz armées de Piedmont, Dauphiné, Languedoc et autres, depuis quatorze ans, où il nous a rendu des preuves certaines de son affection, valeur et fidélité, dont nous avons tout subiect de contentement, Avons, à la supplication d'aucuns nos plus spéciaux serviteurs, audict suppliant, quicté, remis et pardonné, et de noz grâce spécialle, pleine puissance et authorité royale, quittons, remettons et pardonnons, pour la contravention à noz édits et ordonnances prohibitives du port d'armes à feu, esteint et aboly, esteignons et abolissons par ces présentes, signées de nostre main, le faict et cas ainsy qu'il est cy-dessus exposé avec toute peine et amande, corporelle, criminelle et civile, en quoy pour raison de ce il pourroit estre encouru envers nous et justice. Mettant au néant tous apperceux de ban, bannissement, deffaultz, sentences, jugemenz, arrestz et autres procédures quelconques qui pourroient estre ensuivis, et de nostre plus ample grâce, l'avons remis et restitué, remettons et restituons en sa bonne fame et renommée et en ses biens, non d'alieurs confisquez, satisfaction préalablement faicte à partie civile, si faicte n'a esté et s'il eschet, Imposant sur ce silence perpétuel. A NOSTRE procureur général, ses substitutz présens et advenir et tous aultres, SI DONNONS EN MANDEMENT A Noz amez et féaulx les gens tenant nostre cour de Parlement de Dauphiné à Grenoble au ressort de laquelle le faict susdit est arrivé, que de noz présentes grâce, rémission, pardon et abolition et du contenu cy-dessus, ils fassent, souffrent, et laissent ledict suppliant jouir et user plainement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschement à ce contraire, CAR TEL EST NOSTRE PLAISIR, et affin que ce soit chose ferme et stable a tousiours nous avons faict mettre nostre seel a ces dictes présentes. Donné à USEz au mois de JUILLET l'an de grâce Mil six cens vingt neuf et de nostre reigne le vingtième. Signé, par le Roy: PHÉLYPEAUX. II Extraict des registres du Conseil privé du Roy (1). SUR LA REQUESTE présentée au Roy en son Conseil par Jacques Bourgoin, escuïer, sieur de Corbeil, premier cappitaine d'un des régimentz de sa Majesté, commandé par le sieur de la Tour, tendant à ce que, pour les considérations y contenues, et qu'il ne pourroit pas procedder à l'enthérinement de la Grâce à luy accordée par sa Majesté dans le tanps porté par les lettres de surannation expédiées sur icelles, pour raison de la mort de deffunct Jean Joly, sieur de la Hous- (1) Archives de la ville de Corbeil (ii. 5. p. 8).
| 11 |
saye, arrivée d'un coup de pistollet tiré par ledict suppliant dont il pourroit estre contrainct et poursuivy par les héritiers dudict deffunct, Il pleust à sa dicte Majesté faire les expresses inhibitions et deffences aux héritiers dudict deffunct de faire aulcunes poursuittes allencontre dudict suppliant, au prévost dudict Régiment et aultres d'en prendre congnoissance et à tous huissiers et sergens d'attenter à sa personne et biens pour raison dudict faict pendant le temps de six mois, à peine de nullité et cassation de proceddures, despans, dommages et interests. Veüe la dicte requeste et les dictes lettres de grâce accordées par sa dicte Majesté audict suppliant du mois de Juillet 1629, les lettres de surannation sur icelles, par lesquelles il est enjoinct audict suppliant faire enthériner les dictes lettres dans six mois à peine d'estre descheu d'icelles, dudict VIIeme des présens mois et an, le tout addressé au parlement de Grenoble ; ouy le rapport, le Roy en son Conseil, A faict et faict inhibition et deffences aux héritiers dudict deffunct de faire aulcunes poursuittes allencontre dudict suppliant, au prévost dudict Régiment et aultres d'en prendre congnoissance et à tous huissiers sergenz d'attenter à sa personne et biens pour raison dudict faict, pendant le temps de six mois, à peine de nullité, cassation de proceddures, et despans, dommages et interests. Faict au Conseil privé du Roy tenu à St-Germain en Laye le seizième jour de Décembre, mil six cens trente-trois. Signé A. LETENNEUX. III Confirmation, sur requête de Jacq. Bourgoin, des lettres de grâce etc. du 16 décembre 1633 (1). LOUIS, PAR LA Grace de Dieu, Roy de France et de Navarre, Dauphin DE VIENNOIS, Comte de ValentINOIS ET DYOIS, Au premier nostre huissier ou sergent sur ce requis, Nous te mandons et commandons que l'arrest cy-attaché soubz le contre scel de nostre Chancellerie, cejourd'huy donné en nostre cour sur la requeste à nous présentée par Jacques Bourgoin, escuier, sieur de Corbeil, premier cappitaine d'un de noz régimentz commandé par le sieur de la Tour, et signiffié aux héritiers de deffunct Jean Jolly, sieur de la Houssaye, et aultres qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance, leur faisant de par Nous l'expresse inhibition et deffence de faire aulcunes poursuittes allencontre dudict Bourgoin; et au prévost du Régiment commandé par ledict sieur de la Tour et tous aultres, de prendre congnoissance du faict dont est question mentionné en nostre arrest; mesme à tous huissiers et sergens d'attenter à sa personne et biens pour raison dudict faict pendant le temps de six mois, à peine de nulité, cassation de proceddure, despans, dommages et interests; de ce faire te (1) Archives de la ville de Corbeil (ii. 5. p. 7).
| 12 |
donnons pouvoir sans demander aucun congé ni permission, Car TEL EST NOSTRE PLAISIR. Donné à St Germain en Laye le seiziesme jour de Décembre, l'an de grâce Mil six cens trente-trois et de nostre reigne le vingt-quatriesme. Par le Roy daulphin, en son Conseil, Signé : A. LETENNEUX. IV Nouvelles lettres de rémission accordées par Louis XIII à Jacques Bourgoin de Corbeil, septembre 1637 (1). LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET De Navarre, DauLPHIN DE VIENNOIS, COMTE DE VALENTINOIS ET DIJOIS, A TOUS PRÉSENZ ET ADVENIR SALUT. Nous avons reçeu l'humble supplication de Jacques de Bourgoin, Escuyer, de Corbeil, cy-devant cappitaine au régiment de la Tour, et a présent lieutenant-colonel au régiment de Gévodan, commandé par ledict sieur de la Tour, contenant que le cinquiesme aoust 1628, estant party à cheval du lieu d'Orpierre en Daulphiné avec ledict régiment pour s'en aller à Veynnes, suivant l'ordre de nostre très cher cousin, le mareschal de Cresquy, nostre lieutenant en ladicte province, et allant, devisant avec Jean Joly de la Houssaye, aussy cappitaine audict Régiment, ilz seroient tombez sur le discours de la distribution des estappes, et se seroient tellement eschauffez de parolles que ledict de la Houssaye auroit mis la main au pistollet qu'il portoit à l'arçon de la selle de son cheval et icelluy tiré contre la teste du suppliant et l'ayant mancqué il voulut mectre la main à l'espée, ce qui donna subject au suppliant, pour garantir sa vie, de tirer pareillement son pistollet dont il luy porta un coup duquel il brisa la poignée de ladicte espée, et blessa ledict de la Houssaye au corps, duquel coup il decedda environ vingt-quatre heures après, à faulte de bon et prompt appareil, au grand regret du suppliant qui avoit tousjours vescu en bonne intelligence avec luy, ainsy que l'auroit recongneu ledict de la Houssaye, et qu'il estoit cause de son malheur. Que le suppliant auroit quelque temps après eu recours à nostre clémence, et nous ayant faict exposer le faict tel que dessuz, nous luy aurions octroyé noz lettres de rémission au mois de juillet 1629. Desquelles il ne put lors poursuivre l'enthérinement, d'aultant que le sieur de la Tour ayant toujours esté absent dudict régiment, ledict suppliant a esté contrainct d'y demeurer pour nous servir jusqu'en l'année dernière, qu'il obtint lettre de surannation sur nostre dicte rémission, et faict assigner les héritiers dudict deffunct pour procedder sur l'enthérinement des dictes lettres avec commandement au greffier du prévost dudict régiment de porter au greffe le testament dudict deffunct de la Houssaye, et l'information qui avoit esté faicte par ledict prévost à l'ynstant de l'action. (1) Archives de la ville de Corbeil (ii. 5. p. 14).
| 13 |
Qu'ensuite le suppliant fut à Grenoble pour vous requérir l'enthérinement des dictes lettres, où il reçeut commandement d'aller en Languedoc, lever des recreues pour ledict régiment, ce qui l'empescha de comparoir à ladicte information. Que depuis il a eu advis que ces parties avoyent faict porter au Greffe des prétendues informations faictes par le juge du village de Meruel, non royal, où deux paysans ont déposé qu'ilz avoyent veu de loing que ledict sieur de la Houssaye et le suppliant, estant en cholère et parlant d'affection, auroient quicté leur chemin, seroient allez ensemble à travers champ, auroient mis pied à terre, que ledict deffunct auroit dict au suppliant: « Pardonnez-moi, Monsieur, donnez-moi le jour, je feray mon debvoir », que le suppliant répliqua : « Rien, rien », et lui présenta deux pistolletz, que ledict deffunct en prist un, puis s'escartèrent, que ledict deffunct tira le premier et le suppliant aussytost après, que icelluy deffunct tomba et que le pistollet du suppliant fit plus de bruit que l'autre ; que tout ce discours est sans apparence et a esté malicieusement inventé pour traverser le suppliant, qu'il est formellement contraire au testament dudict deffunct et aux dépositions dudict sieur de la Tour, et autres personnes de qualité qui en ont déposé, confirmées mesmes par aultres dépositions qui sont dans la mesme information dudict juge de Méruel, sur laquelle seule information on a contumacé le suppliant; lequel nous a encores faict remonstrer que la faulceté et nullité de ces deux déppositions lui tourneroit à grande longueur de prison et le priveroit de l'assiduité qu'il nous doibt à la conduite dudict régiment et particulièrement à la garde que nous luy avons commise de la Tour de la Croisette qui est à la veuë des Isles de Ste Marguerite et St Honorat, ce qui l'oblige tout de nouveau à recourir à nostre miséricorde et nous supplier très humblement qu'il nous plaise le remettre en pleine liberté de pouvoir continuer le reste de ses jours à nostre service et à cet effect lui vouloir octroyer noz lettres de grâce, pardon, rémission et abolition qu'il nous a très humblement requises. SUR QUOY, NOUSs, deuement informé dudict faict et cas cy-dessus, désirant favorablement traicter ceux qui ont vieilly dans noz armées et particulièrement le suppliant qui y a reçeu plusieurs blessures et nous a toujours fidellement et courageusement servy dans les employs qu'il a euz en divers lieux, et encore depuis peu en la prise des Iles de Ste Marguerite et St Honorat, où il a esté blessé; Eu esgard mesme que selon la dernière exposition cy-dessus cette action s'est passée dans la chaleur de la cholère, Nous, AVONS, en considération de ce que dessus, quicté, remis, pardonné audict suppliant et mesme de nostre grâce spéciale, plaine puissance et authorité royalle, esteint et aboly, quictons et remettons, pardonnons, esteignons, et abolissons par ces présentes, signées de nostre main, ledict faict et cas susdit avec toute peyne corporelle et amande, dont pour raison d'iceux il pourroit estre tenu envers nous et Justice; cassant et mettant au néant toutes poursuittes, contumaces, sentences, jugemens, décretz, arrestz et aultres proceddures quelconques qui pourroient avoir esté contre luy faictes et rendues pour raison de ce, le restituant en sa bonne fame et renommée au pays et en ses biens non d'alieurs confisquez, satisfaction préalablement faicte à partye civile, si faicte n'a esté et s'il eschet, imposant sur ce
| 14 |
silence perpétuel a noz Procureurs généraulx, leurs subtitudz présens et à venir, et tous aultres, le tout nonobstant quelques édits et ordonnances à ce contraires auxquels, en tant que besoing seroit, nous avons desrogé et desrogeons par ces présentes. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez et féaulx les gens tenans nostre cour de Parlement de Daulphiné à Grenoble, Que de noz présentes lettres de grâce, pardon, rémission et abolition et de tout le contenu cy-dessus, ils fassent, souffrent et laissent jouir ledict suppliant plainement, paisiblement, sans permettre, ny souffrir ores ny à l'advenir, luy estre faict pour raison de ce, en son corps ny en ses biens, aucun trouble ny empeschement en quelque sorte et manière que ce puisse estre, et si faict, nui ou donné luy estoit, le mectre incontinent et sans delay en pleine et entière délivrance et en son premier estat et deub, CAR TEL EST NOSTRE PLAISIR, et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, Nous avons faict mectre nostre seel à ces dittes présentes. DONNÉ A S. MAUR, au mois de septembre, l'an de grâce Mil six cens trente sept, de nostre reigne le vingt-huictiesme. Signé : LOUIS. V Seconde epitaphe de Jacques Bourgoin, scellée dans le mur du vestibule de l'ancien Collège de Corbeil, fondé par lui dans sa propre maison, et devenu à la Révolution l'école communale de la ville. Icy gist Jacques Bourgoing, Escuier natif de Corbeil, déceddé le Aagé de jour de M. VIC ans, lequel après avoir glorieusement servy trois de nos Roys consécutifs en plusieurs Honnbles emplois quil a eus, tant dans l'Infanterie que dans la cavallerie, est venu doucement achever sa vie où il l'a commencée. Ses premiers coups dessays au faict des armes, ont esté soubs Henry 4me en Franche-Comté et au siège d'Amiens, et depuis en ayant continué les exercices soubs Louis 13eme comme lieutenant colonel du régiment de la Tour, il a réussy sy advantageusement qu'il mérita de commander dedans la citadelle de Cazal lors que le Marquis de Leganes l'avoit assiégée avecq l'armée du Roy d'Espagne. Enfin il les coronna heureusement soubs Louis 14me par la conservation de Corbeil au service de sa Ma.te pendant les troubles de la France en 1652, Le Roy luy ayant donné le commandement en cette place de la dernière conséquance par ses lettres patentes. Mais ce n'est pas en cella seul qu'il a tesmoigné le zèle qu'il avoit pour sa chaire (sic) patrie, l'ayant encores très particulièrement signalé par deux fondations à perpétuité qu'il y a faictes par une piété toutte extraordinaire devant sa mort, l'une de cinq cens cinquante livres de rente en l'Églize de céans, pour prier Dieu pour luy, et pour donner aux pauvres tous les ans deux muids de bled, qui font par chacun mois deux septiers, comme il est déclaré par le contract de ladite fondation passé pardevant Tarteret Notaire à Corbeil le 2eme janvier 1653, et l'autre d'un collège en sa maison propre, pour y
| 15 |
instruire la jeunesse de la ville et fauxbourgs de Corbeil gratuitement, tant en la crainte de Dieu et bonne moeurs qu'en lescripture et langue latine jusques à la Rhetoricque inclusivement, conformément au contract de ladite fondation passé pardevant Barré et le dit Tarteret notaires, le 30eme janvier 1656. De quoy Corbeil luy en demeurera éternellement obligé, sans que pour cella néantmoings, tu te doibve dispenser, passant, d'addresser quelque prière à Dieu pour le repos de son âme. Dieu s'est servy de luy pour la reprise des isles Ste Marguerite. Requiescat in pace. Marbre noir. - Hauteur om 46, largeur 1m 06.
Porte de l'ancien cloître Saint-Spire, à Corbeil.
| 00000060 |
| 00000061 |
| 00000062 |
| 17 |
de champart, au rouage et au bornage. Qui de nous sait où se trouvait le manoir seigneurial où nos pères venaient acquitter leurs redevances et régler leurs différends? Si vous demandiez à un habitant de Mandres : « Où donc était situé le fief de Paradis et d'Enfer? » A coup sûr, il vous serait répondu « L'enfer ?… connais pas! - Le Paradis, c'est dans le bout d'en bas, à gauche en allant vers Brunoy; passé la cour des Guerriers ». : Heureux pays où du Paradis, seul, on ait souvenance. C'est cet aimable village que notre très honoré président, Monsieur François Coppée, s'est vu contraint de quitter. C'est «le jardin de Paradis », qu'il appelait modestement « La Fraisière », qu'il a vendu l'an dernier. Oui! bonnes gens, les fiefs de Paradis et d'Enfer n'étaient pas situés où vous le supposez. Ce qu'improprement vous appelez aujourd'hui le Paradis n'était qu'une pièce de terre qui faisait partie du domaine de ces fiefs; et, je n'en veux pour preuve que cet extrait de l'aveu et dénombrement fait le dix-septième jour de Juin milsix cent et onze (1). « Fut présent en sa personne Louis de la Mothe escuier demou- « rant à Mandres sieur des fiefs de Paradis et d'Enfer lequel de son « bon gré et bonne volunté sans contraincte comme héritier des «< deffuncts Jean de la Mothe vivant escuier demourant audict « Mandres et damoyselle Roberde de Choisy ses père et mère « vivante demourant aussi à Mandres confesse et advoue et par « ces présentes a advoué tenir en plain fief et à foy et hommage « de damoyselle Lucresse de Montonvilliers veufve de feu Charles « du Val vivant escuier seigneur de Vaugraigneuse dame de Mandre « du fief de la Tour-grise et de Cersay en partie au lieu et comme « héritière seule et unique de deffunct Nicolas de Montonvilliers « vivant escuier son père seigneur dudict Mandre dudict fief de « Tour-grise et de Cersay en partie à cause des dictes seigneuries « les fiefs de Paradis et d'Enfer apartenances et dépendances qui « ensuivent lesdicts fiefs qui antiennement avec leurs dépendances «< souloient estre et apartenir à Messieurs les Mathurins à Paris. « Premièrement. Une masure qui antiennement estoit maison «cour et jardin apellé le Jardin d'Enfer le lieu comme il se pour- (1) Archives de Seine-et-Oise. Série A. cote 686,
| 18 |
« suit et comporte assis au village dudict Mandre près les Tours- « grises tenant d'une part et d'autre à ladicte dame de Mandres « abboutissant d'un bout audict sieur de la Mothe advouant et « d'autre bout à la Grand Rüe par laquelle on va dudict Mandre « à Villecresne. « Item. Un autre jardin apellé le Jardin de Paradis assis audict « Mandre proche devant et à l'opposite du lieu cy-dessus déclairé « la rüe entre deux tenant d'une part audict sieur de la Mothe « d'autre part à damoyselle Le Cyrier abboutissant d'un bout à la- « dite grand rüe et d'autre sur… « Item. Deux arpens de terre scis au terrouer de Mandres au « lieudict près la Fosse Poictevin ou les Piéreux tenant d'une part « et d'autre à Messieurs Les Chartreux d'un bout par bas sur le « chemin tendant d'Yerre à Boussy et d'autre bout par hault sur le « chemin de Mandres à Cersay ». C'est cette pièce de terre qui a fait donner à l'entrée de Mandres, vers Brunoy, le nom de Paradis. Tous les autres biens dépendant de ces fiefs étaient situés dans la plaine vers Villecresne, Le Boisd'Auteil et Santeny. Pour plus de clarté, sur la situation de ces fiefs dans le village, nous mettons sous les yeux du lecteur un extrait d'un plan de Mandres, daté de 1669, postérieurement à l'époque de sa confection que nous pouvons affirmer être au plus tard de 1618. Le plus ancien titre qui ait rapport à ces fiefs est une copie d'aveu fait au roi, vers 1364, par Thomas de Braye, chevalier, seigneur des fiefs de la Voulte et de Voisins à Brunoy, dans lequel il déclare que Jehan Grappin de la Bourde possède un arrière-fief à Mandres en Brie relevant de lui (1). Ce Jehan Grappin de la Borde était un personnage marquant de son époque; car, dans tous les titres que nous avons consultés et où il est question de lui, il est qualifié de Monseigneur. Ses possessions étaient nombreuses et importantes. Nous relevons entre autres dans un aveu de la Seigneurie de Viry, mouvante de la châtellenie de Tournan-en-Brie, fait le 8 avril 1346 par Jehan, sieur de Viry, chevalier (2). « Item. Un fief que monseigneur Jehan Grappin tient de moi, « séant à Cossigny ». (1) Archives Nationales. Série P. Vol. 128, cote 20. (2) Arch. Natles Série P. Vol, 471, cote 303.
| 19 |
Puis dans un autre de la seigneurie de Prégontier, mouvante aussi de Tournan, fait le 21 février 1370 par Jehanne Dofmon, femme de Mathieu du Boys (1). « Item. Environ soixante arpens que boys que paistis séant au- « dict lieu de Prégontier tenant d'une part à Monseigneur Jehan « Grappin et d'autre part au chemin de Chastres. « Item. Cent arpens de terre séant au lieu que l'on dict Les Bou- « loys, tenant aux hoirs dudict Monseigneur Jehan Grappin. « Item. Ung fié que tenoient antiennement les hoirs dudict Mon- « seigneur Jehan Grappin, séant es-environs Prégontier et Les « Bouloys ». Il existait autrefois dans l'église de Ferrolles (2) une pierre tombale, dressée sur le mur de droite, à l'endroit où s'élève aujourd'hui l'autel du Sacré-Cœur, qu'un témoin digne de foi nous a dit être celle d'un seigneur de Mandres. Monsieur l'abbé Deshogues, ancien curé de Ferrolles, par nous consulté, nous disait le 25 septembre dernier que lors d'une restauration de l'église, faite sous le ministère de l'abbé Rocherand, mort curé-doyen de Mormant, plusieurs grandes et belles pierres tumulaires furent cassées et employées à la bordure de la fontaine communale de Lésigny (3). Nous ne doutons pas que cette pierre tombale d'un seigneur de Mandres provenait de l'ancienne église d'Attilly (4) et était celle de Jehan Grappin, qui possédait en 1364 un fief à Mandres, mouvant de la seigneurie appartenant à Thomas de Braye. Nous ne doutons pas non plus que ce fief de Jean Grappin ne fût celui connu ensuite sous le nom de Paradis et d'Enfer; de même que la seigneurie suzeraine ne soit celle des Tours grises, quoique le titre soit muet sur ces appellations et qu'il semble indiquer que le fief de Jehan Grappin, situé à Mandres, mouvait des hostieux de la Voulte et de Voisins de Brunoy (5). Nous trouvons cette appellation de « Paradis » pour la première fois dans le dénombrement de la Seigneurie du Grez, fait le 23 (1) Arch. nationales, série P. Vol. 472, cote 52. (2) Seine-et-Marne, canton de Brie-comte-Robert. (3) Seine-et-Marne, canton de Brie-comte-Robert. (4) Seine-et-Marne, canton de Brie, réuni à Ferrolles. (5) Toutes les seigneuries de Brunoy, celles de la famille de Braye, celles des Gaillonuels comme celle du Prieuré d'Essonnes relevaient de la chatellenye de Corbeil.
| 20 |
février 1397 par Jacques des Essars, chevalier, seigneur de Mandres en partie (1). « Item. La femme de Jehan Heudé pour sept quartiers de terre « séant à Paradis ». Nous la retrouvons dans les aveux de 1399 et 1416 faits par Jehan du Plessies, seigneur de Conchy-la-Poterie et de Mandres en partie (2) ; et encore dans celui fait par Rogerin de Lannoy avant 1480 (3) « Item. Jehanne veuve Robin de Lourme et ses enfants, hoirs et «ayans cause dudit Robin pour demy arpent de terre derrière « Paradis, tenant à Jehan Arraut ». Dans ce dernier dénombrement, qui n'est pas daté, Rogerin de Lannoy, dit Lamon, écuyer, seigneur de Sivry et de Brunoy, avoue tenir, à une seule foi et un seul hommage, de très haut et très puissant prince et son très redouté Seigneur, Monseigneur le duc d'Orléans, de Milan et de Valois, comte de Blois et de Beaumont, Seigneur d'Aste et de Crécy, à cause de son chastel et chastellenye de Braye-comte-Robert; un fief avec les appartenances et appendances d'ycelui; lequel fief séant au terroir et finage de Mendres-lezPerrigny es-environs, en plusieurs pièces ; à lui venu et échu par le décès de feue damoiselle Isabel de Braye, sa mère, qui a elle fut venu et échu à cause de feu messire Arthus de Braye, son père (4). Rogerin de Lannoy n'avait pas à Mandres de manoir seigneurial. Les cens et rentes qui lui étaient dus devaient lui être payés, le jour de l'octave Saint-Denis, à l'hôtel d'un arrière-fief possédé alors par les héritiers de Jean de Lorris (5). Après avoir fait l'énumération des terres lui appartenant, il ajoute : « Item. Un fief tenu de moy à cause de mon dict fief, séant au « terrouer et finage dudict Mendres Cersay et es-environs, qui « fust antiennement à feu maistre Guy Broucher et depuis à Jehan «< de Loriz, en leur vivant seigneurs dudict Mendres en partie et « dont la déclairation s'ensuit : « Premièrement. Deux maisons séantes en la ville dudict Mendres- (1) Arch. nationales, série P. Vol. 55, cote 85. (2) Arch. nationales, série P. Vol. 56, cote 60, et vol. 59, cote 61. (3) Arch. nationales, série P. Vol. 652, cote 33. (4) Arthus de Braye était fils de Thomas, dont nous avons parlé plus haut. (5) A l'hôtel des Tours grises que ne possédait plus la famille de Braye.
| 21 |
«<lez-Braye-comte-Robert sous la souveraineté de la seigneurie « dudict Braye comte Robert, l'une d'ycelles maisons tenant aux « hoirs ou ayants-cause de feu messire Jehan du Plessie, chevalier « et de présent à Monseigneur l'audiencier (1) assise au bout de la « dicte ville de Mendres devant dicte devers Servon (2). L'autre «< maison tenant audict feu du Plessie ou ses hoirs ou ayants-cause « d'une part et à la ruelle d'emprès sa maison avec les cours jardins « colombier d'ycelle maison les apartenances et apendances (3). « Item. Trente arpens de terre ou environ et un arpent de pré « séant au terrouer de Mandres en plusieurs pièces et divers « lieux ». Guy Brocher possédait déja ce fief en 1397. Il est question de lui et de sa maison de la cave dans l'aveu de la Seigneurie du Grez par Jacques des Essars, de même qu'en ceux faits par Jean du Plessie en 1399 et 1416. Marc Cenesme, élu du roi sur le fait des aides en la ville et élection de Paris, Seigneur de Lusarches, dont le père avait acquis en 1480 la Seigneurie du Grez, échangea, dit le titre, le sept novembre 1488 la seigneurie qu'avait à Mandres Rogerin de Lannoy contre huit écus d'or à la couronne (4) de rente annuelle et perpétuelle, constituée sur la maison de Marc Cenesme, sise à Paris, rue de la Vieille monnoye. Dans ce contrat, il est expliqué que Rogerin de Lannoy ne donne aucune garantie à son acquéreur, au sujet de la main mise, par lui, sur le fief de Jean de Lorris, tenu et mouvant de sa seigneurie de Mandres, par faute d'homme et de droits et devoirs non faits et payés. Il n'est pas inutile de faire remarquer que, par erreur sans doute, le rédacteur de ce contrat appelle le fief cédé à Marc Cenesme « Le fief de Gaillonnel ». Nous avons vu que, vers le milieu de quatorzième siècle, Jean Grappin possédait à Mandres un fief (1) Jean Budé, seigneur d'Yerres, dont le père Dreux Budé avait acquis la seigneurie du Grez. Il la vendit en 1480 à Jacques Cenesme. L'aveu de Rogerin de Lannoy serait donc antérieur à cette date de 1480. (2) C'est le fief des Tours-grises tenant à celui du Grez (voir au plan nº 1ºr). (3) Le fief d'Enfer, mouvant des Tours-grises. (4) En 1460, l'écu d'or valait 18 sols parisis, le sol, 12 deniers. (foi et hommage par Ja Budé de 40 écus de rente annuelle sur la terre de Nangis. Arch. Nles série P. vol. 8, cote 305). Le sextier de blé, du meilleur, valait en 1409 deux deniers parisis. (Dénombrement des revenus à prendre sur les religieux de Saint-Quentin-les-Beauvais. (Arch. Nies série P. vol. 57, cote 2).
| 22 |
mouvant de celui de Thomas de Braye. Le fils de ce dernier, Arthus de Braye, eut de lui ses seigneuries du Colombier à Brie-comteRobert, de Villememain, de Brunoy et de Mandres; il épousa Jehanne de Gaillonnel qui, elle aussi, possédait une seigneurie et et le château de Brunoy ; ils n'eurent qu'une fille, Isabel, qui hérita des biens de son père et de sa mère et se maria à Jehan de Lannoy, père de Rogerin. Il n'est pas inadmissible, qu'après trois générations, le possesseur n'eût plus souvenir d'où lui venait ce bien. Les Mathurins de Paris, déjà propriétaires de terres à Mandres, acquirent les fiefs de Paradis et d'Enfer. Nous ne savons comment ni à quelle époque; mais, nous avons la conviction qu'ils les eurent après les héritiers de Jean de Lorris et ne les gardèrent que peu d'années ; car, dès 1556, ces fiefs étaient aux mains de Jean de la Motte et de Roberte de Choisy, sa femme. Nous basons notre conviction sur ces deux baptistaires, que nous relevons dans les registres de la paroisse de saint Thibault de Mandres. « Du 31 janvier 1556 fut baptisé Loys de la Mothe, fils de noble « homme Jehan de la Mothe, escuier, et de noble damoyselle « Roberte de Soisist. Ses parrains, noble homme Jehan du Postel « et noble homme Loys de Fleuris; sa marraine noble damoyselle « Marie de Sanguins » (1). « Du troisième jour de Novembre l'an 1558 fut baptisé Pierre de « la Mothe, fils de noble homme Jehan de la Mothe, escuier, et de « noble damoyselle Roberthe de Soysit. Les parins Pierre de la « Vinville et noble homme Claude des Estars; la mareine noble « damoyselle et dame Madame de Sivry (2) ». Le 17 juin 1611, Louis de la Mothe fit foi et hommage de ses fiefs de Paradis et d'Enfer. Nous saisissons cette occasion de mettre sous les yeux du lecteur la description du cérémonial imposé au vassal pour prêter le serment de fidélité à son suzerain. « Aujourd'hui date des présentes pardevant Vincent Meurdrac, « notaire royal à Mandres et dépendances, est comparu en personne « Louis de la Mothe, escuyer, demourant à Mandre, seigneur des «fiefs de Paradis et d'Enfer situés au dict Mandres, lequel de sa (1) Un sieur Antoine Sanguin possédait, à cette époque, par indivis, le fief de Dessusles-Fossés de Brie-comte-Robert. (Arch. Nies, série P. 39, cote unique). (2) Anne Jouvenel des Ursins, veuve de Guillaume de Lannoy et épouse en 2mes noces de Louis d'Ongnies, comte de Chaulne, dame de Brunoy et de Sivry-en-Brie,
| 23 |
« bonne volunté sans contraincte en la présence du dict notaire et « des tesmoins soubscripts s'est transporté au devant de la grand « porte et principalle entrée de l'hostel et maison seigneurialle de « Mandre, apartenant à damoyselle Lucresse de Montonvilliers, « veufve du feu sieur de Vaugraigneuse, dame dudict Mandres et « du fief de la Tour grise et de Cersay en partie au lieu et par le « décès et trespas de deffunct Nicolas de Montonvilliers escuier son « père, auquel lieu estant ledict sieur de la Mothe se seroit enquis « sy l'adicte dame estoit en son hôtel et maison seigneurialle, ou « autre pour elle qui eust charge de recepvoir es foy et hommage <«<les vassaux qui tiennent et relèvent d'elle, auquel sieur de la « Mothe auroit été faict response par Jean le Jude laboureur, de- « mourant audict lieu seigneurial, que ladicte dame estoit audict « lieu et qu'il luy alloit faire scavoir, sur ce ledict sieur de la Mothe « auroit dit et desclaré qu'il s'estoit illec transporté exprès à la « cause comme vassal d'ycelle dame pour luy jurer et porter à « cause des dicts fiefs d'Enfer et de Paradis apartenances et des- « pendances scis audict Mandres et es-environs et à luy advenus « et eschus par le décès et trespas de deffuncts Jeun de la Mothe « vivant escuier son père, seigneur desdicts fiefs et damoyselle Ro- « berde de Choisy sa mère, relevant en plain fiefs et à foy et hom- «mage de la dicte dame Lucresse de Montonvilliers à cause de sa « dicte seigneurie; et de faict ledict sieur de la Mothe, en signe « d'humilité, estant en debvoir de vassal la teste nue le genouil à « terre sans espée ny esperons, auroit au mesme instant à haulte « voye intelligible, par trois diverses foyes, dict en ces mots ou « semblablement « Madame de Mandres estes vous céans, si vous « desclare que je vous faict et porte comme vostre vassal les foy « et hommage que je vous suis tenu faire et porter pour mesdicts « fiefs d'Enfer et de Paradis relevant de vous et à moy apartenant « à cause de mes deffuncts père et mère Et en signe de quoi auroit « baisé le locquet de la porte. « Sur ce ladicte dame survenue auroit faict response audict sieur « de la Mothe que bénignement, voluntairement et de grace elle le « recepvoit en la dicte foy et hommage à la charge des droicts et « prouficts à elle deus à cause des dicts fiefs relevant de elle » (1). Peu de temps après en avoir rendu foi et hommage, Louis de la (1) Arch. de Seine-et-Oise, Série A, cote 686.
| 24 |
Mothe vendit ses fiefs de Mandres et la ferme qu'il avait à l'angle des chemins de Villecresne et de Santeny à Vincent de Meurdrac, qui, le 3 novembre 1625, céda, par contrat devant Garnier, commis à Boussy-Saint-Antoine, à Lucrèce de Montonvilliers, la masure, le jardin appelé le jardin d'Enfer et neuf quartiers de terre à la suite, qui furent réunis et enclos dans le parc du château de Mandres, la ferme de nos jours (1). C'est ainsi que disparurent les manoirs du Grez, des Toursgrises et du fief d'Enfer pour être remplacés par la maison seigneuriale qu'avait fait construire, sur l'ancien domaine des ducs d'Orléans, la dame de Mandres ou son père Nicolas de Montonvilliers. Vincent de Meurdrac resta possesseur du jardin de Paradis et de la ferme dite de la Mothe qui, elle, était en censive. Il eut deux filles qui se partagèrent sa succession. Catherine eut pour sa part treize arpents trois quartiers de terre, dont la pièce de deux arpents au lieudit les Pierreux proche la fosse Poictevine, qui a fait donner le nom de Paradis à l'entrée de Mandres vers Brunoy. Détruisons, en passant, une erreur qui tend à se propager. Catherine Meurdrac n'était pas d'extraction noble. Son père était substitut commis à Mandres du notaire royal de la châtellenie de Briecomte-Robert. C'est lui qui confectionna, en 1616 et 1617, le terrier de la seigneurie des Tours-Grises; moins cependant la déclaration le concernant personnellement, où il est qualifié de garde ordinaire des plaisirs du roi; c'est à dire garde-chasse (2). Tous ses biens étaient en censive de la seigneurie des Tours-Grises et de Réaulieu, fief situé à Cersay, et il y déclarait que, de son propre, il possédait un demi-arpent de terre au Charreton et quarante perches de vigne, en quatre pièces aux vinots, terroir de Mandres; ce qui laisse à supposer que, lui où tout au moins sa mère, était originaire de Mandres. Pour ses autres biens: des masures, 11 arpents 83 perches en terres, vignes et saussayes, situés à Mandres et des masures, jardins et prés à Cersay, il est dit qu'ils sont de son conquest. Catherine Meurdrac avait épousé Jean Mariot, écuyer, sieur de la Guette, dont elle était séparée quant aux biens en 1655, lorsque (1) Arch. de Seine-et-Oise. Série A, cote 686. Aveu par Annest Goutte du fief de Paradis. (2) Archives de Seine-et-Oise, Série A, cote 733, fulio 170, 19 janvier 1617.
| np |
Mandres Les fiefs & Paradis a d'Enfer. 1786. Archives de Serneet. Orse Serie A, cote 712 Rue Chantepe 49 £ Rue Mothe des Tours 080 Carrefour Gres Rue de Paillarderie Clos Grande el Maison seigneuriale dés Tours Grises. CMolthean mai 1898. Rue. Perches à 20 pieds. Ruelle des Champs
| np |
| 25 |
le 26 Juin elle vendit, moyennant 337 livres 10 sols, à Claude Duval, seigneur de Mandres, neuf quartiers de terre, au lieudit les murs d'Orléans « en censive dudict seigneur acquéreur » dit le contrat, passé devant Charles Gilles substitut commis à Mandres du notaire royal en la châtellenie de Brie (1). Il est vrai qu'elle a possédé, vers 1669, l'emplacement actuel de la propriété Fougace, qui était en la censive du fief de Saint-Thibault appartenant aux chartreux de Paris. Dans le dénombrement du fief de Paradis et d'Enfer, fait le 20 Juillet 1663, par Annest Goutte, son neveu, il est dit que madame Catherine Meurdrac (on ne lui donne même pas son titre de dame de la Guette) possède « le reste des héritages desdicts fiefs de Paradis « et d'Enfer qui ce consistent en unze arpents trois quartiers de terre « en plusieurs pièces ». Ainsi donc, Madame de la Guette n'a jamais possédé à Mandres plus de treize arpents de terres dépendantes du fief de Paradis et d'Enfer, lequel mouvait des Tours-Grises; elle a peut-être habité Mandres, mais alors son habitation était en censive du fief de Saint-Thibault; enfin, elle n'avait aucun droit de prendre le titre de dame de Mandres, puisque ses terres étaient dans la mouvance du fief d'Annest Goutte et ses autres biens, si elle en avait, en la censive de Saint-Thibault ou des Tours-Grises, les deux seules seigneuries de Mandres à l'époque qui nous occupe. Marie, qui eut dans son lot la ferme de la Mothe et le jardin de Paradis, épousa Guillaume Brisset et n'eut de lui qu'une fille, Charlotte, mariée en premières noces à Henry du Ranc, sieur de Vibrac, épouse en deuxièmes noces d'Annest Goutte, l'un des cent gentilshommes de la maison du roi; lequel, le 20 Juillet 1663, rendit foi et hommage du fief de Paradis à Claude du Val, aumônier du roi, et à ses sœurs, mesdames de Candé et de Lugny, enfants de Lucrèce de Montonvilliers et de Charles du Val, sieur de Vaugrigneuse (2). Annest Goutte, ou ses héritiers, vendirent leur fief de Paradis et la ferme de la Mothe à Georges Le Roy, avocat en parlement et à Louise Rousseau, sa femme, qui les laissèrent à leurs deux filles Magdeleine-Geneviève et Anne-Louise. Le onze Février 1736, devant Berruyer, notaire à Paris, les de- (1) Archives de Seine-et-Oise, Série A, cote 836. (2) Arch. de S.-et-O. Série A, cote 686.
| 26 |
moiselles Le Roy, alors majeures, demeurant rue du Cloître-saintJean, firent aveu du fief de Paradis à Achille de Thomassin, prêtre, docteur en Sorbonne, prévôt et chanoine de Saint-Nicolas du Louvre, seigneur de Mandres et de la Tour-grise (1). En mars 1782, Catherine Le Roy, veuve de Jacques François Le Sénéchal, secrétaire du roi, et Louise-Marguerite Le Roy de Vassy, seules héritières de Anne-Louise Le Roy, leur tante, vendirent et morcelèrent la ferme de la Mothe et le fief de Paradis, qui par le fait de cette vente, faite à charge de cens, tomba en rôture. Le huit août suivant devant Gondouin, notaire à Paris, les dames Le Roy firent à Monsieur, frère du roi, comte de Provence et duc de Brunoy, démission pure et simple de tous leurs droits de fief relatifs à celui de Paradis et d'Enfer, et consentirent à sa réunion au corps du fief des Tours-grises pour ne faire qu'un même fief comme il était avant l'érection et l'inféodation dudit fief de Paradis et d'Enfer (2). Le comte de Provence consentit cette démission moyennant six cent quatre-vingt-quinze livres douze sols six deniers et une rente foncière, seigneuriale, annuelle et perpétuelle, non rachetable, de trente-six livres, payable au jour de Saint-Denis, à partir de 1783. Jean François de la Porte, ancien commandant de brigade de la maréchaussée, et Marie-Anne Raymond, son épouse, demeurant à Montgeron, acquéreurs de la ferme de la Mothe, furent chargés d'acquitter cette rente de trente-six livres. Lors d'une visite que nous fîmes à notre président, alors qu'il habitait Mandres, nous lui avions promis de faire un jour l'historique de sa propriété, que nous savions avoir été autrefois une petite seigneurie : nous remplissons aujourd'hui, bien tardivement, notre promesse tout en déplorant que l'état précaire de sa santé nous ait privé d'un concitoyen aussi illustre que bienveillant. II LE FIEF DE SAINT-THIBAULT (1383-1791). Que de surprises sont réservées à ceux qui occupent leurs loisirs aux recherches historiques! Telle petite seigneurie avait dans sa (1) Arch. de Seine-et-Oise. Série A, cote 686. (2) Arch. de Seine-et-Oise. Série A,cote 886.
| np |
Mandres. 1618-1669. Le fief de Saint Chibault, Archives de Seinoet-Oise Série A. cote 868. De Antoine Jean Andiger Vobis Jerille. Merlet Samtel Pierre Pierre Olimer. Vandar Inad de la Roche Hocacar?. Jean Grand Rue. Planche Robert Planche. Drape Michel Galas Jian J Le Picard. Mad Masse Routin Join Moltean Mattes Clos de Mad: Masse legou ne To youne 6. Nervet Egl. 5 Thibaul Cimetie Freshyler. Claude Rossignol Pressoir et jardin faisant partie du manoir seigneurial de Saint-Thibault. Sentier de la Procession. Molthea Mai 1898. 10 20 Toises Chemin d'Yerres. themin du Marais. M. Legrand. Mad: Coguelet. Victor Lafille. Jacques Thuiller. Mad: Laguette. Ruelle L'Hostel seng de St Thibaul
| np |
| 27 |
mouvance d'autres seigneuries, souvent plus importantes, ou des fiefs quelquefois très éloignés. Dans nos environs les exemples ne font pas défaut, ainsi : d'Evry-en-Brie (Evry-les-Châteaux, Seine-etMarne), mouvaient la seigneurie de Perrigny-sur-Yerres et celle de Choisy-sur-Seine (Choisy-le-Roy, Seine) (1); du fief des VieillesVignes, situé à Neuilly-sur-Marne et relevant de Gournay, mouvait celui de la Borde-Grappin, situé autrefois sur le ruisseau le Réveillon, alors de la paroisse d'Atilly (Seine-et-Marne) (2); de BoussySaint-Antoine, qui relevait de la châtellenie de Corbeil, mouvaient quatre fiefs à Boussy même, un cinquième à Villemeneur (Villemeneux, près Brie-comte-Robert), deux autres et un arrière-fief à Etiolles, le fief de Maulny sur la paroisse de Limoges-Fourches, (Seine-et-Marne), et enfin, le fief de Saint-Thibault à Mandres, dont les possesseurs devaient remplir les devoirs de vasselage et payer les redevances au manoir seigneurial que l'abbaye de Chaulmes-enBrie, qui possédait Boussy, avait à Villemeneux (3). Le fief de Saint-Thibault était situé à l'entrée de Mandres vers Brunoy, dans le bout d'en bas, comme on disait encore dans notre enfance. Son hôtel seigneurial et l'enclos se trouvaient en face de l'église, entre la ruelle de Rochopt, ou mieux Rocheau, et la ruelle des Fontaines Saint-Thibault. Un jardin et verger qui en dépendait était situé de l'autre côté du chemin de Brunoy; il est aujourd'hui la propriété de M. Marichal. Avec la seigneurie du Grez, aussi située à Mandres, qui, elle, mouvait de la châtellenie de Brie-comte-Robert, il appartenait en 1397 à Jacques des Essars, chevalier, qui fit aveu et dénombrement de la seigneurie du Grez, au duc d'Orléans, châtelain de Brie-comteRobert, le 23 février (4). Jehan du Plessies ou du Plessier, chevalier, chambellan du roi, seigneur de Couchy-la-Poterie en Vermandois, les eut ensuite. Il fit, de la seigneurie du Grez, aveu le 15 mars 1399 et le renouvela le 4 juin 1416 (5). Puis ses héritiers vendirent leurs fiefs de Mandres (1) Archives Nationales, série P, Vol. 34, cote 17: Aveu et dénombrement de la seigneurie d'Evry-en-Brie, par Jehan Le Charron, 23 août 1511. (2) Arch. Nies, série P, Vol. 24, cote 92. 1 (3) Arch. N¹es série P, Vol. 129, cote 50: Aveu par Jehan, abbé de Chaulmes, du5 mars 1383. (4) Arch. Nies, série P, Vol. 55, cote 85. (5) Arch. Nies, série P, Vol. 56, cote 60 et Vol 59, cote 61.
| 28 |
à Dreux Budé, conseiller, trésorier et garde des chartes du roi et audiencier de sa chancellerie, seigneur de Viliers-sur-Marne, Yerres et Evry-en-Brie, qui fit aveu au roi du fief de Saint-Thibault en 1453 et le renouvela le 13 septembre 1461 (1). Les titres de l'abbaye de Chaulmes ayant été détruits pendant les guerres de la fin du XIVe siècle et du commencement du XVe, on ne sait comment le fief de Saint-Thibault fut soustrait à la suzeraineté de Boussy; mais les deux aveux au roi faits par Dreux Budé ne laissent aucun doute sur le fait accompli. Jehan Budé, son fils, père du savant philologue qui illustra cette famille, en fit foi et hommage au roi, le 16 juillet 1476 (2). La cédule de la chambre des comptes est ainsi conçue: « Pour raison dudict fief terre et seigneurie de Sainct-Thibault, « de la justice jusqu'à soixante sols et des apartenances et apen- « dances d'y-celuy, assis en la ville de Mandres-en-Brie. Tenu et « mouvant à une seule foy et hommaige à cause du chastel et de «< la chastellenye de Corbveil ». Déjà en 1480 Jehan Budé s'était défait de la seigneurie du Grez au profit de Jacques Cenesme, seigneur de Lusarches; lorsqu'en 1488 il échangea celle de Saint-Thibault avec les Chartreux de Paris, contre des terres et prés que ces derniers possédaient à Yerres et que leur avait donnés Jehanne d'Evreux, veuve de Charles IV le Bel, dame de Brie-Comte-Robert (3). Jusqu'à la Révolution, les Chartreux conservèrent le fief de Saint-Thibault, qui en leur faveur avait été amorti par le roi lors de leur prise de possession, ce qui leur permit de se qualifier de seigneurs de Mandres en partie. Ils jouirent donc des droits honorifiques attachés au fief et de ses revenus, nous ne dirons pas sans troubles, car, nombre de contestations furent soulevées par leurs officiers et collecteurs comme aussi par ceux de la seigneurie voisine; mais, ils eurent la sagesse et l'adresse d'éviter les procès; ainsi que le prouvent les transactions qu'ils firent, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, avec différents seigneurs de Mandres et qu'il serait sans intérêt d'analyser ici. On les trouvera aux archives du département de Seine-et-Oise, dans la série A, cote 886. (1) Arch. Nles, série P, Vol. rer, cote 174 et Vol. 17, cote 448. (2) Arch. Nies, série P, Vol. 1º, cote 275. (3) Lebeuf, hist. du diocèse de Paris, éd. de 1883. 3º Vol., p. 188 et suiv.
| np |
| np |
| 29 |
Tout ce que les Chartreux possédaient à Mandres fut vendu au district de Corbeil, le 19 avril 1791, comme biens nationaux, à un sieur Nicolas-Henri Nyon, imprimeur demeurant à Paris rue Mignon, paroisse Saint-André-des-Arts, moyennant cent vingt-deux mille livres payables en assignats, en dix annuités. Voici la désignation qu'en donne le cahier des charges du 4 avril 1771 (1): ARTICLE SEPT. Les Chartreux de Mandres « Le manoir et ferme du cy-devant fief Saint-Thibault, consistant « en bâtiments, grange, cour, jardin, clos derrière la grange; le « tout clos de murs. Un jardin devant ledit manoir, près celuy du « presbytère. « Cent quatre-vingt-six arpens de terres labourables y compris « un arpent de mauvaises vignes et trois arpens trois quartiers de « prez en plusieurs pièces, situés sur les terroirs de Mandres, Péri- « gny, Boussy-saint-Antoine et Brunoy ; et aussi y compris les che- <««mins qui traversent lesdites pièces, loués au sieur Dumesnil, « cessionnaire par bail passé devant Maître Clairet, notaire à Paris, « le 2 aoust 1787, pour neuf années qui ont commencé le 11 no- «vembre audit an 1787, moyennant quatre muids de froment, « mesure de Paris, à cinq sous, pris du meilleur, rendus à Paris, et « mille livres en argent » (2). Lorsque nous aurons dit que le fief de Saint-Thibault, qui paraît avoir été détaché de la paroisse de Boussy pour être ajouté à celle de Mandres, a été le prétexte de nombreuses et longues contestations soulevées aux XVIe et XVIIe siècles, par les curés de Villecresne, qui prétendaient que tout ce qui, à Mandres, n'était pas le fief Saint-Thibault était de leur paroisse et allaient jusqu'à la violence, dit-on, pour affirmer leur droit, nous aurons fait connaître ce que nous savons sur cette petite seigneurie. Paris, Avril 1898. CH. MOTTHEAU. (1) Arch. de S-et-Oise. Vente de biens nationaux au district de Corbeil, dossier n° 159 (2) Le muid, mesure pour les grains, était composé de 12 septiers de 12 boisseaux d'environ 14 litres. Le muid, mesure pour les vins, contenait 272 litres. En 1784, le septier de blé, du meilleur, valait 20 livres. (Etat des charges et revenus de l'abbaye de Jarcy en Brie annexé à la vente de la seigneurie de Jarcy à Monsieur, frère du roi, comte de Provence, devant Gondoin, Pierre, notaire à Paris, le 13 mai 1785).
| 30 |
DESCRIPTION DE L'HOTEL-DIEU DE LA VILLE D'ÉTAMPES EN 1785
(1) En 1785, l'Hôtel-Dieu de la ville d'Étampes avait pour médecin, depuis plus de trente ans, le docteur Boncerf, qui publia dans le Journal de médecine, chirurgie et pharmacie, la topographie de cet établissement hospitalier; c'est un document peu connu et important en raison des détails qu'il donne sur la configuration et les installations de l'hôpital à cette époque et sur les améliorations apportées dans le service. Cette description de l'Hôtel-Dieu a d'autant plus d'intérêt pour les Etampois, qu'elle les met à même de faire la comparaison de ce qui existait il y a un siècle avec ce qui est aujourd'hui et, partant, en tirer les conséquences qu'il convient au point de vue de l'hygiène et du confortable. Si le médecin Boncerf, comme praticien, n'a rien laissé dans la mémoire de la génération actuelle, il ne s'ensuit pas qu'il ait été dans son art un médecin inhabile et sans talents professionnels. Mais à Étampes, comme ailleurs, on oublie vite les personnes qui ont rendu des services à leurs concitoyens, soit par leur science, soit par leur dévouement à la chose publique. Pour prouver que le docteur Boncerf jouissait d'une réputation incontestée parmi ses confrères de la Faculté de médecine de Paris, nous ferons connaître qu'il a reçu d'eux, dans plusieurs circonstances, des éloges mérités, qui ont été consignés dans le Journal de (1) Cette notice a déjà paru dans le Réveil d'Etampes. Nous regrettons que l'auteur, qui est en même temps notre collègue, ne nous ait pas adressé d'abord son intéressant travail, qui eût été bien mieux à sa place dans une revue savante que dans un journal où tout est facilement perdu et oublié. C'est donc en vue d'éviter cet inconvénient que, d'accord avec M. P. Pinson, nous rééditons ici cette curieuse description de l'Hôtel-Dieu d'Etampes.
| 31 |
médecine, pour avoir obtenu des guérisons des plus difficiles en employant une méthode simple, mais efficace pour combattre les fièvres les plus rebelles à la médication employée à cette époque. Si notre savant compatriote, M. Maxime Legrand, entreprend un jour l'histoire de l'Hôtel-Dieu d'Etampes, nous sommes convaincu qu'il trouvera dans les archives de cet établissement des documents qui lui permettront d'établir la biographie de ce médecin, qui mérite de sortir du profond oubli dans lequel il est enseveli. Paul PINSON. TOPOGRAPHIE DE L'HOPITAL D'ÉTAMPES. Etampes, petite ville du diocèse de Sens et de la généralité de Paris, est située sur la pente d'une colline, qui s'élève au milieu d'une plaine agréable et variée. Sa longitude est de 19 degrés 45 minutes; sa latitude, de 48 degrés 25 minutes. Son sol est sec et sablonneux ; on y tire de ses environs un sablon assez abondant ; l'on peut dire, en général, que ce pays est plus fertile que le terrain ne semblerait l'annoncer. L'eau y est pure et saine; elle est fournie par trois petites rivières, la Juine, la Louette et la Chalouette. L'air y est perpétuellement renouvelé par les différents courants qui abondent de tous côtés; mais cependant les vents dominants sont ceux du nord et du sud. Lorsque le vent du nord règne trop longtemps, il donne de la roideur aux fibres, et dispose aux maladies inflammatoires : quand il est nord-ouest, comme dans les hivers froids et au commencement du printemps, le nombre des malades est beaucoup plus considérable, surtout dans la classe du peuple. Les maladies qu'on observe alors sont des catarrhes et des fluxions de poitrine de différente espèce. Le vent d'ouest est pluvieux et accompagné d'ouragans. Le vent du sud et du sud-ouest amène souvent des nuées d'orage, et c'est ordinairement dans le temps qu'il souffle le plus communément, c'est-à-dire avant et après la moisson, qu'on voit régner, dans les campagnes voisines, des dysenteries et des fièvres malignes. Au reste, il y a peu de maladies à Etampes que l'on puisse attribuer à la variété des saisons. Les maladies sont rares chez les habitants de la ville; elles y sont même, généralement parlant, douces et peu meurtrières. Les épidémies ne sont pas communes dans les f 5
| 32 |
villages des environs, et quand elles ont lieu, elles sont plutôt dues au peu de soins des habitants qu'à l'influence de l'atmosphère ; enfin l'air qu'on respire à Etampes est si salubre, que la population s'y accroit sensiblement et que l'on croit pouvoir assurer qu'il est peu d'endroits dans le royaume où il y ait tant de vieillards, relativement au nombre des habitants, et où ces vieillards jouissent d'une santé plus ferme et d'une tête plus saine (1). L'hôpital est situé à l'extrémité et au nord de la ville; sa façade principale et sa grande porte d'entrée sont du côté du sud, sur une rue spacieuse. Au sud-est, est placée l'église collégiale et paroissiale, ancien et vaste bâtiment qui n'est séparé de l'hôpital que par une petite rue, mais sans qu'il y ait aucun obstacle pour le courant d'air de ce même côté. Sur l'autre angle de la façade se trouve la chapelle servant au public, ainsi qu'aux religieuses de l'hôpital. Au nord-ouest est une rue qui se prolonge jusqu'au rempart. Les bâtiments de ce côté, en y comprenant la chapelle et la sacristie, ont environ 187 pieds de long; la façade a 92 pieds de large. On entre dans cet hôpital par une grande cour, au fond de laquelle on rencontre un bâtiment à un étage qui a sept croisées au sud et autant au nord. Autrefois, il y avait à droite le bâtiment du chapelain qui a été rasé depuis quelques années. A gauche de cette cour est la salle des hommes, élevée à six pieds du rez-de-chaussée, ayant 80 pieds de long, 21 de large et 16 de haut. A l'une des extrémités de cette longueur se trouve la sacristie et un autel entouré de balustrades qui y est adossé. On entre dans cette salle par un grand escalier près de l'angle qui unit cette aile au bâtiment qui est en face. Cet escalier sert pour le public et pour les religieuses; il y a au bout de cette salle deux autres portes, l'une pour se rendre à l'église et au choeur, l'autre à la sacristie. Il y avait autrefois une porte qui s'ouvrait vers le milieu de cette salle et donnait sur un perron, mais on l'a supprimée depuis quelque (1) Ce tableau de la ville d'Etampes, au point de vue de l'hygiène et de la pureté de l'air, est de la plus grande exactitude, et ce qui le prouve c'est que soixante-cinq ans plus tard, le savant docteur J. Bourgeois, qui fut aussi médecin en chef de l'hospice, dans son livre: Coup d'œil sur les deux épidémies de cholera asiatique qui ont sévi à Etampes et dans son arrondissement, 1851, in-8°, a confirmé la justesse des constatations faites par son ancien confrère.
| 33 |
temps, ce qui a procuré deux avantages : le premier, d'éviter l'air froid qui s'introduisait souvent par cette ouverture; le second, de gagner la place pour deux lits. La salle est éclairée par six grandes. croisées placées en opposition, les unes du côté du sud-est, les autres du côté du nord-ouest; autrefois cette salle était échauffée par une grande cheminée qui servait en même temps à favoriser la circulation de l'air. On y a suppléé nouvellement par un grand poèle, qui procurera les mêmes avantages, avec la certitude d'une chaleur plus constante et plus égale. Cette salle contient vingt-un lits, douze du côté de la cour et neuf de l'autre côté, et chacun de ces lits a trois pieds de large. A l'extrémité de cette salle, opposée à la sacristie du côté nord, est un vestibule où se fait le service pour la distribution de la soupe, du pain et des viandes. Ce vestibule, bien éclairé par deux grandes croisées qui sont au nord-ouest, est voisin de l'apothicairerie, et sépare la salle latérale de la salle du fond. Cette dernière salle a 48 pieds de long, sur 21 pieds de large ; elle a trois croisées sur la rue au nord-ouest, et deux au sud-est; mais il se trouve de plus, à son extrémité au nord-est, une grande croisée d'environ cinq pieds et demi de large sur quinze de haut, ouverture la plus favorable à l'hôpital, parce qu'il ne se trouve aucun bâtiment vis-à-vis d'elle, et qu'elle porte un air pur dans les deux salles. On a également substitué un poèle à la cheminée de cette salle. Mais une réforme plus avantageuse est celle qu'on a faite aux latrines elles étaient placées autrefois derrière le vestibule qui sépare les deux salles; mais, comme malgré tous les soins qu'on avait pris, elles répandaient de temps en temps des exhalaisons infectes, on les a placées au nord, à l'extrémité de cette seconde salle, et on y a pratiqué avec succès tous les moyens connus pour empêcher la mauvaise odeur de pénétrer dans les salles. Cette salle est occupée par douze lits, également de trois pieds de large elle servait autrefois pour les femmes; mais depuis quelques années, l'administration, pour se conformer aux vues du Gouvernement, et pour ne mettre qu'un malade dans un lit, y a placé des hommes, avec le projet de construire au-dessus une nouvelle salle pour les femmes qui, en attendant que cette construction soit faite, sont placées dans une petite salle au nord-ouest, laquelle avaitété longtemps consacrée aux militaires, aux ecclésiastiques et aux paysans honnêtes, que leur pauvreté obligeait d'entrer à l'hôpital.
| 34 |
Cette salle a trois lits, on s'en est servi plusieurs fois pour retirer des malades affectés de maladies contagieuses, comme la petite vérole. Une salle pareille est destinée aux femmes en couche. Ces deux petites salles ont chacune une cheminée, deux croisées au sudest et une au nord-ouest. Leur utilité a toujours été très grande; elles sont établies depuis 1748, et on les doit à la sage économie de l'administration, qui ne cesse pas de se conduire d'après les mêmes principes. On reçoit dans cet hôpital toutes sortes de malades, excepté les galeux et les vénériens. Les vieillards et les incurables y trouvent un asile momentané ; mais on ne pourrait les garder longtemps sans empêcher dans les salles la circulation nécessaire pour recevoir le plus grand nombre possible de malades affectés de maladies aiguës. L'hôpital d'Etampes est fondé en partie pour les habitants de la ville et des environs; mais une fierté mal placée les prive souvent de cette ressource. Autrefois on s'écartait rarement de l'intention des fondateurs; maintenant on reçoit dans cet hôpital presque tous ceux qui se présentent, lorsqu'il y a de la place. Les habitants des environs d'Arpajon, de Dourdan, de Pithiviers, d'Orléans, y fournissent plus de malades que le pays même et, la ville étant placée sur la grande route, les lits sont souvent occupés par des étrangers. Au mois de mars, par exemple, on y voit entrer beaucoup de soldats qui tombent malades en allant en semestre, ou en retournant rejoindre leurs régiments. L'hôpital est éloigné de la rivière ; l'eau dont on fait usage vient d'un puits de la maison, qui est sur un sol sablonneux, et cette eau est fort bonne. Les lits sont presque toujours remplis ; on est encore quelquefois obligé de mettre deux malades dans un même lit, surtout depuis quelques années que la cherté du bled a augmenté la misère. Le seul désir de secourir un plus grand nombre de malades les fait ainsi presser les uns à côté des autres; mais ceux qui sont affectés de fièvres putrides ou de blessures graves, sont toujours couchés seuls. En compulsant les registres de l'hôpital, on trouve que, depuis trente ans, le nombre des malades entrant s'est augmenté d'un tiers tous les dix ans ; de sorte que l'on y reçoit aujourd'hui trois
| 35 |
fois plus de malades qu'en 1755; et cependant la mortalité y a diminué progressivement. Cette proportion est même à tel point étonnante, qu'on ne peut l'attribuer qu'au grand nombre de passants ou d'étrangers qui entrent à l'hôpital plutôt fatigués que malades. Les malades sont tenus fort proprement. On donne aux convalescents de la soupe, du bouilli et du vin. Le soir, ils ont du rôti. On n'a point remarqué qu'il y eût aucun quartier de la ville qui fournît plus de malades qu'un autre ; mais la classe des habitants ; qui en fournit le plus, est celle des compagnons de toutes sortes de métiers, de domestiques, de charretiers, etc. Les autres hôpitaux et les renfermeries en donnent aussi quelques-uns. Il n'y a ordinairement de la ville que les plus misérables qui viennent à l'hôpital, et, parmi ceux-là, les tisserands y sont en plus grand nombre et ont les maladies les plus graves. Le soin des malades de la maison est confié à dix religieuses de l'ordre de Saint-Augustin, qui ont des domestiques pour les ouvrages les plus pénibles. On apprend par les antiquités de la ville que l'église collégiale a été bâtie par le roi Robert, au commencement du xre siècle. L'aile qui est au sud servait d'hôpital, à l'imitation des cathédrales des premiers siècles. Les malades y avaient leurs lits; mais ensuite les chanoines établirent dans leur cour un commencement d'hôpital qui était régi par un maître et par des frères ; ces frères s'étant mal acquittés de leurs devoirs furent renvoyés, et les maire et eschevins de la ville, de concert avec monseigneur l'archevêque de Sens, mirent à leur place, en 1654, quatre religieuses non cloîtrées. Cet hôpital est gouverné par dix administrateurs, sçavoir monseigneur l'archevêque de Sens, qui est le président-né de cette administration, le lieutenant général du bailliage,le procureur du roi, les maire et eschevins, un curé de la ville (tous les curés sont administrateurs alternativement), et trois habitants notables dont on fait choix. Il y a de plus un greffier et un receveur. Le bureau se tient tous les quinze jours. Il n'y a point de formules particulières pour les médicaments, mais on suit ordinairement celles de l'Hôtel-Dieu et de la Charité de Paris.
| 36 |
Cette topographie de l'hôpital d'Etampes est suivie des réflexions suivantes qui émanent de la direction du Journal de médecine. Ce que dit M. Boncerf sur les antiquités de la ville d'Etampes, rappelle l'origine d'un grand nombre de nos hôpitaux civils. Dans le commencement, les hôpitaux n'étaient que des maisons destinées à donner un asile à des pèlerins; mais, vers le xie siècle, la charité chrétienne, déjà plus éclairée, s'occupa de secourir particulièrement les malades indigents. Ces malades furent d'abord recueillis sous les portiques des temples, où la pieuse libéralité des fidèles venait déposer les offrandes destinées à leurs besoins. Bientôt on éleva à côté de ces temples des hospices auxquels on donna le nom d'Hôtels-Dieu. On retrouve encore aujourd'hui la plupart de ces hôpitaux dans l'enceinte des cloîtres, et l'on ne doit pas être surpris que les chanoines en aient été les premiers directeurs. Non seulement ces prêtres étaient dépositaires des aumônes et des fondations, dues souvent à leurs sollicitations et à leur exemple, mais ils étaient la plupart du temps les seuls qui pussent administreraux malades les secours dont ils avaient besoin pour leur guérison. Dans ces temps, les sciences n'étaient cultivées que par des clercs, et la médecine était unie au sacerdoce. La plupart des premiers médecins de la Faculté de Paris étaient des chanoines de la cathédrale, et quand la Faculté de médecine fonda une compagnie particulière, elle tenait ses assemblées auprès du grand bénitier de Notre-Dame, c'est-à-dire dans un lieu voisin de l'asile destiné aux malades. Ainsi, lorsqu'au dernier incendie de l'Hôtel-Dieu, nous vîmes, avec un attendrissement mêlé de respect, les malades transportés dans les ailes de l'église métropolitaine, c'était l'image touchante du tableau qu'offrit la piété religieuse de nos ancêtres, en jetant les premiers fondements des hospices consacrés aux malades, ou des hôpitaux connus sous le nom d'Hôtels-Dieu. L'hôpital d'Etampes a été, dès son origine, situé et construit d'une manière fort avantageuse. Un terrain sec qui a permis de placer les salles au rez-de-chaussée, les salles hautes et larges, des dégagements commodes, des cheminées servant de ventouses, de petites salles isolées pour les maladies contagieuses, ou pour les femmes en couches, tous les bâtiments servant aux différents offices de l'hôpital, placés à l'entour des salles et très commodément
| 37 |
pour le service des malades: tels sont les avantages que l'on trouve dans l'hôpital d'Étampes et qu'il est difficile de trouver réunis dans les anciens hôpitaux. Le manque d'eau vive, qui serait un défaut capital dans un hôpital plus considérable, est moins. sensible dans un hôpital médiocre, surtout quand les puits donnent une eau salubre. Cependant les réformes avantageuses opérées depuis quelques années dans cette maison, sont une preuve des défauts qui peuvent subsister au milieu des établissements les plus parfaits en apparence, et de la nécessité de les examiner sous tous les rapports. Ces réformes font l'éloge des personnes chargées de l'administration de cette maison, qui se sont empressées de seconder les vues du gouvernement, et qui y ont travaillé avec une attention continue et réfléchie. L'agrandissement et l'amélioration annuels et successifs de cet hôpital font voir ce que peut produire l'économie, quand elle est durable et bien réglée. Enfin, par une suite de cette progression d'économie et de bienfaisance, il y a lieu d'espérer que cet hôpital ne laissera plus rien à désirer dans quelques années, et que les malades y seront tous couchés seul à seul, ou du moins dans des lits doubles (1) quand il ne sera pas possible de le faire autrement; car on ne conçoit guères comment on peut mettre deux malades dans des lits de trois pieds. (1) On entend par lits doubles, des lits de quatre pieds exactement, divisés en deux couchettes égales par une cloison triangulaire qui s'élève du milieu de ce lit et qui va en diminuant de hauteur de la tête au pied. Les malades couchés dans ces lits, sont aussi bien isolés l'un de l'autre, que s'ils étaient dans des lits particuliers, et c'est le seul moyen de gagner de la place sans mettre les malades dans le même lit. ERRATA au IIe volume des Mémoires de la Société (2º partie, 1900). P. 4 bis P. 9, 1. 10 au lieu de 1598 lire: 1548. au lieu de Guillaume de Budé était seigneur, lire : appartenait à la famille des seigneurs d'Yerres. P. 10, 1. 28 au lieu de: Dreux… avec sa sœur Isabeau, lire: Isabeau était fille de Jean III Budé et de Jacqueline de Bailly (Voir l'Histoire de l'abbaye d' Yerres, publiée en 1899 par M. l'abbé Alliot, pp. 199 et 217).
| 38 |
LE PREMIER COURONNEMENT DE LA ROSIÈRE A ÉTAMPES EN 1789.
L'Almanach d'Etampes pour l'année 1791, rédigé par M. Mesnard du Montelet, vicaire nouvellement nommé de St-Basile, imprimé rue Darnatal, 27, chez Dupré (1) et Gamet, rapporte en tous ses détails, le couronnement de la Rosière qui eut lieu le Lundi de la Pentecôte 1790. Cette relation a été reproduite en substance par M. Léon Marquis dans son excellent ouvrage Les Rues d'Étampes. Il y est dit que ce fut la première cérémonie de ce genre dans la ville, et qu'elle était due aux bienfaits de Madame d'Escars, fille aînée de M. de Laborde de Méréville. Pour la première fois, en effet, on voyait le couronnement d'une rosière, mais l'année précédente, une fête à peu près semblable avait réuni dans l'église de St-Basile, l'élite de la population d'Etampes, convoquée par la Société philanthropique. Il s'agissait d'entendre une messe solennelle d'actions de grâces célébrée à l'occasion d'une fondation pieuse, créée à perpétuité par les libéralités de Madame Claude Charlotte d'Orval, fille de Guillaume Charles Viart d'Orval, seigneur de Boischambault, de Madeleine Thérèse Duris, veuve d'Adrien Esprit Constant Regnault de Barres, Chevalier, comte de Barres, Gouverneur, capitaine et grand bailli des Ville, Château et Gouvernement d'Etampes, et de M. et de Melle de Viart, ses neveu et nièce, « pour le soulagement de deux vieillards et le couronnement d'une rosière », élus précédemment (1) Claude Dupré, huissier à cheval au ci-devant Châtelet de Paris et au Tribunal du district d'Etampes, lieutenant dans la 2º compagnie de la garde nationale de Notre-Dame; imprimeur de la ville (acte de 1791).
| 39 |
en l'Hôtel de Ville. M. Haillard, curé de la paroisse, a laissé, de cette première cérémonie, un curieux procès-verbal que nous ne pouvons résister au plaisir de reproduire. C'est, pour ainsi dire, par hasard, en faisant des recherches dans les anciens registres de St-Basile, que nous avons trouvé ce document que nous croyons intéressant pour l'histoire de la ville; nous le copions textuellement. « L'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-neuf, le lundi de la Pentecôte, 1er Juin, a été par nous, prestre, curé soussigné, célébré en cette église une grande messe solennelle, en actions de grâces d'un établissement de piété fondé à perpétuité par les libéralités de Madame la Comtesse de Bar et de messire et damoiselle de Viart, pour le soulagement de deux vieillards et le couronnement d'une rosière, choisie entre cinq filles tirées des cinq paroisses de la ville, élection préalablement faite le 17 may en l'Hôtel de Ville, par voye de scrutin, présence de messire Jacques Julien François Picart, écuyer, seigneur de Noir-Epinay, la Marche et autres lieux, maire de la Ville, Président de la philantropie, de messire Jean Baptiste de Poilloue, seigneur de Bonneveau, ancien lieutenant de carabiniers, chevalier de l'ordre royal et militaire de St-Louis, vice-président de la philantropie, de MM. les commissaires, Officiers et membres de la maison et société philantropique. D'après les informations faites des vie, mœurs et conduite des vieillards et filles qui ont concouru à ladite élection, le sort est tombé sur Olivier, vannier, âgé de 74 ans, de la paroisse de Notre Dame, sur la veuve Losseron, âgée de 88 ans, de la paroisse de St Basile, et sur Marie Louise Dabouvart, 29 ans, aussi de cette paroisse, le billet tiré par un enfant et la proclamation faite par M. le Président. Lorsque les deux vieillards et rosière, assemblés en l'Hôtel de Ville à l'heure de 10 (sic), présence de tous les membres de la philantropie, précédés de la compagnie de messieurs les Chevaliers de l'Arquebuse, ont été conduits en cette église, sçavoir: Olivier par M. le Président, la veuve Losseron par M. le Chevalier de Bonneveau, Ier Vice-président, et Marie Louise Dabouvart, rosière, par M. l'abbé Chevalier, chef-chantre du Chapitre de Ste Croix de cette ville, 2º Vice-président, tous trois décorés d'une médaille d'argent (1) (1) Une pièce en argent sur laquelle seront gravés ces mots : « Prix d'un bon citoyen, accordé à ….. le ….. de l'année dans laquelle sera passé un anneau pour pouvoir la porter au côté. » (Extrait du réglement). ….
| 40 |
pour prix et récompense de leurs vertus, suivis des dame et demoiselle bienfaitrices, et chacun des aspirants et des pauvres assisté par un des membres de la maison, [et sont] arrivés en cet ordre à l'église qui était gardée par un détachement de soldats du régiment Colonel-Général-Dragons, cantonné dans cette ville pour protéger dans les marchés la vente du bled, et distribués aux différentes portes de l'église, Messieurs les Chevaliers de l'Arquebuse placés en haye dans le chœur, M. le Président arrivé à la porte du chœur, Nous, précédé de la Croix et accompagné de notre clergé, sommes présenté et avons harangué le cortège qui prit ensuite place chacun à l'endroit qui lni était destiné, sçavoir: MM. les Présidens, vieillards et rosière sur le même prie-Dieu, les bienfaitrices derrière, et le reste des philantropes dans le chœur. Après l'offertoire, le sermon a été prêché par M. le curé de St Martin, et le Te Deum chanté à la fin de la messe, présence des soussignés ». En marge est écrit : « Nota qu'on a gardé la nef vuide pour être remplie pendant le sermon par ceux qui occupaient le chœur ». On voit, à la fin de cet acte, de nombreuses signatures; celles du président, Picart de Noir-Epinay, du vice-président, Poilloue (1) de Bonnevaux, du secrétaire, Jacques Crosnier, substitut du procureur du Roi, des bienfaitrices et du bienfaiteur: la comtesse de Barres, Charlotte de Viart de Mézières (2) et Charles de Viart de Mézières, lieutenant au régiment de Conty, frère et sœur, et les suivantes qui sont évidemment celles des membres de la société philanthropique : Détacher, Angot, Jacques Angot fils, d'une famille d'orfèvres, Constance, Th. Petit, Jacques Guillaume Simonneau, négociant, qui succéda à M. Picart dans les fonctions. de Maire de la ville et qui fut assassîné sur le marché St-Gilles, le 3 mars 1792, Pierre Etienne Simonneau, son frère, lieutenant particulier du bailliage, Baron fils aîné, dont le père et le grandpère furent échevins, Perrier, avocat au Parlement, greffier en chef du bailliage, Foye, meunier au grand moulin, Trémeau de Fenneville, receveur du Grenier à sel, enfin Buttet, ancien curé de Rouvray St-Denis, Soulavie, vicaire de St-Basile, en même (1) Il signe : « Poillouve de Bonnevaux ». (2) Plus tard femme de M. de Lort, chef d'escadrons de carabiniers. Par son testament, en date du 14 juin 1821, devant Me Venard, cette dame a assuré jusqu'à nos jours la dotation de la rosière.
| 41 |
temps qu'administrateur spirituel de l'Hôtel-Dieu, et Haillard, curé. La signature de M. l'abbé Chevalier, 20 vice-président, manque ; ce ne peut être que par oubli qu'elle n'a pas été apposée au registre, puisqu'il était présent. La Société philanthropique avait été créée à Etampes le 19 septembre 1788, sous la protection du duc d'Orléans qui s'y intéressait par une cotisation annuelle de 2000 livres, destinée à secourir des vieillards, des infirmes et à donner de l'instruction aux enfants pauvres, et qui avait exprimé le désir que son réglement fût modelé sur celui de la ville d'Orléans. Les philanthropes s'engageaient à verser chacun 24 livres par an. Dans la même séance, le Président fit part à l'Assemblée de la proposition faite par Madame la Comtesse de Barres, sa nièce et son neveu, de donner à la Société une somme de 16000 livres dont le revenu devait être à perpétuité affecté au soulagement de l'humanité et à la récompense de la vertu, savoir: 12000 livres pour faire une pension annuelle et viagère de 250 livres à chacun des plus vertueux pauvres de la ville; et 4000 livres pour l'établissement d'une rosière. Une députation composée de MM. Picart, maire, l'abbé Véraquin, chanoine, et Simonneau, lieutenant particulier du bailliage, fut chargée d'aller remercier, au nom de la Société, les généreux donateurs, de les assurer qu'elle acceptait leur don avec reconnaissance et qu'elle approuvait les règles et conditions sous lesquelles ils le faisaient. Les malheurs causés par la grêle du 13 juillet 1788 empêchèrent l'exécution immédiate des dispositions du réglement établi le 19 septembre, que l'on peut lire en entier dans les registres de la municipalité d'Étampes, et firent remettre la première fête à l'année suivante, ainsi que nous venons de le voir. CH FORTEAU. 25 Avril 1900.
| 42 |
JEAN DE MONTAIGU* SEIGNEUR DE MARCOUSSIS. -- UNE ERREUR JUDICIAIRE AU MOYEN AGE.- REHABILITATION DU CONDAMNÉ.
C'est une erreur de croire que la procédure de révision des procès criminels et de la réhabilitation des condamnés sont choses modernes. Le principe de la révision, qui tend à réparer une erreur judiciaire, était déjà inscrit dans la loi pénale sous le nom de proposition d'erreur. Deux ordonnances royales, l'une de 1313, l'autre de 1344, s'en étaient occupées. Nous en trouvons deux exemples historiques au moyen âge, l'un qui a trait à Jean de Montaigu, seigneur de Marcoussis, l'autre, à la Pucelle d'Orléans, Jeanne d'Arc, dont les héritiers furent admis à purger sa mémoire (style du temps) par des lettres patentes de février 1449. Nous ne nous occuperons que du premier, dont la personnalité se rattache à un fief dépendant de notre comté du Hurepoix; mais avant, il est nécessaire de dire un mot sur Marcoussis. La création de Marcoussis remonte au viie siècle. Elle est due à l'établissement d'un prieuré fondé par la célèbre abbaye de SaintWandrille. Bien que la localité soit devenue simplement le siège d'une seigneurie et qu'on ait retenu les noms de quelques-uns de ceux qui la possédèrent, elle n'entre réellement dans l'Histoire qu'au XIVe siècle, alors que Jean de Montaigu, ministre de Charles VI, tout-puissant et au comble de la faveur, y fit construire, sur l'emplacement d'un vieux logis, nommé la Maison forte, une des plus importantes forteresses de l'époque. * La plupart des auteurs, entre autres Malte-Brun, dans son Histoire de Marcoussis (Paris, 1867), écrivent toujours Montagu.
| 43 |
Auprès de son château, Jean de Montaigu avait fondé un prieuré de Célestins, qui devint fort riche et fut célèbre, grâce au savoir . des religieux qui y résidèrent. Le prieuré fut supprimé en 1779, alors qu'il ne comptait plus que 11 Religieux. Le monastère, ou ce qui en restait, a été détruit pendant la Révolution. En 1409 Jean de Montaigu, seigneur de Marcoussis, avait été condamné à mort et décapité à Paris sur la place des Halles; sa mémoire fut réhabilitée et la confiscation de ses biens annulée. Voltaire, dans son commentaire sur le livre Des délits et des peines, de Beccaria, nous dit et nous citons textuellement: « L'ordonnance criminelle, en plusieurs points, semble n'avoir « été dirigée qu'à la perte des accusés; en Angleterre, un simple « emprisonnement, fait mal à propos, est réparé par le ministre « qui l'a ordonné, mais, en France, l'innocent qui a été plongé « dans les cachots, qui a été appliqué à la torture, n'a nulle conso- «lation à espérer, nul dommage à répéter contre personne, il « reste à jamais flétri dans la société ». Certes, notre ancienne procédure pénale était fort imparfaite, mais Voltaire paraît avoir ignoré que l'ancien régime admettait, avec une grande facilité, la révision des procès criminels, et que la procédure à suivre était formulée, sous le titre de proposition d'erreur, dans les ordonnances royales de 1313 et 1344. Jean de Montaigu, seigneur de Marcoussis, vidame du Laonnois, Grand-maître de l'Hôtel du roi, et surintendant des finances en 1408, sut mettre à profit le temps de sa faveur pour amasser une immense fortune. Un religieux de l'abbaye de Saint-Denis raconte que son château faisait honte au palais de nos rois par la magnificence de son architecture: le luxe de sa table, de la vaisselle, de ses ameublements effaçait celui des plus grands princes. Il ne reste plus de ce domaine seigneurial qu'une tour et quelques débris de murs. Le château, réédifié dans le style de la Renaissance, quand le Marquis de la Baume Pluvinel épousa la petite-fille de M. de Chastenet de Puységur, est une vaste et luxueuse demeure. Mais revenons à notre sujet. Jean de Montaigu, comme le surintendant Fouquet au xviie siècle, eut l'imprudence d'étaler ses richesses aux yeux jaloux, dans les fêtes somptueuses par lesquelles il célébra le mariage de son fils avec une fille du seigneur d'Albret, et la promotion d'un de ses
| 44 |
frères à l'évêché de Paris (un autre était déjà archevêque de Sens). « Le faste de Montaigu souleva beaucoup de murmures, les « Grands se rappelèrent l'origine obscure de ce bourgeois de « Paris, fils d'un secrétaire du roi ; ils se raillaient fort de sa mau- « vaise mine, de ses façons vulgaires et de son bégaiement » (1). Le duc de Bourgogne et le roi de Navarre profitèrent de la maladie de Charles VI pour faire arrêter son surintendant et le livrer à des commissaires (1409), comme coupable de sortilège, d'empoisonnement et de malversations. La dernière de ces imputations présentait seule quelques fondements, mais les autres ne contribuèrent pas moins puissamment à le faire condamner. La torture lui arracha des aveux qu'il rétracta ensuite. Il eut la tête tranchée aux Halles de Paris et son corps fut attaché au gibet de Montfaucon. Trois ans après, son fils Charles de Montaigu poursuivit la révision du procès de son père en vertu des ordonnances royales de 1313 et 1344. Cette procédure, connue sous le nom de proposition d'erreur, disaient nos très anciens jurisconsultes, est une concession faite par le souverain, sur la requête d'une partie, pour raison d'une erreur de fait contre un jugement qui peut être rétracté par la voie d'appel ou de nullité. Il fallait recourir au prince pour obtenir des lettres de proposition d'erreur. L'on disait communément que cette concession, tendant à détruire un jugement irrévocable, était une véritable grâce contraire au droit commun. Quoi qu'il en soit, Charles de Montaigu obtint la réhabilitation solennelle de la mémoire de son père et ses biens confisqués lui furent rendus. Les Célestins de Marcoussis firent à Jean de Montaigu de magnifiques funérailles et lui érigèrent un tombeau dont il ne reste aucun vestige. Quant à Charles de Montaigu, il trouva la mort, avec une partie de la noblesse française, à la bataille d'Azincourt. Comme souvenir de son fondateur, Marcoussis a conservé les armes de Montaigu d'argent à la croix d'azur, cantonnée de 4 aigles, au vol éployé, de gueules, becquées et membrées d'or. : (1) H. Martin. Histoire de France, t. II, p. 392. E. DELESSARD.
| 45 |
BIBLIOTHÈQUE DE LA SOCIÉTÉ CATALOGUE DES OUVRAGES OFFERTS
(1). I. 2. Ablon-sur-Seine, par l'abbé Bonnin, curé d'Ablon. Un vol. in-8°, gravures. Principaux droits de l'Abbaye de Saint-Germain-des-Prés en Seine-et-Oise, par M. l'abbé Bonnin. Un vol. in-12. 3. Les trois Etats du bailliage d'Etampes, par MM. Maxime Legrand et Léon Marquis. Deux vol. in-8°, portraits et 4. 5. 6. – - ― - – cartes. La noble maison de Saint-Ouen, par M. Léopold Pannier. Un vol. in-8°. L'ordre du procès-civil au XIVe siècle, par M. le Président Tanon. Un vol. in-8°. Méry-sur-Oise et ses Seigneurs, par M. Léopold Pannier. Un vol. in-8°. 7. Le témoignage du Saint-Esprit. Thèse, par M. le Pasteur Jacques Pannier. Un vol. in-8°. - 8. La Congrégation de Notre-Dame à Corbeil, par M. l'abbé E. Colas, curé de Soisy-sous-Etiolles. Brochure in-8°. Une page de l'histoire de Soisy-sous-Etiolles, par M. l'abbé E. Colas. Brochure in-8°. 9. 10. Note sur les cartes et plans de l'Ile-de-France, par M. Léopold Pannier. Brochure in-8°. OUVRAGES DE M. LE CHANOINE MARSAUX. II. La Chasuble de Viry-Châtillon. Brochure in-8°, gravures. Notes d'un voyage en Touraine. Brochure in-8°. 12. - ― 13. L'Abbé Longue-Epée, curé de Beaumont. Brochure in-8°. Autour de Dammartin, notes de voyage. Brochure in-8°, gravures. 14, (1) Tous les ouvrages qui font partie de ce catalogue ont été offerts à la Société par leurs auteurs, sauf ceux qui proviennent d'échanges avec les Sociétés correspondantes, dont l'origine est spécialement indiquée.
| 46 |
46 - 15. ― 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ― — - ― ―― Tournois de Chambly et de Bailleul-sur-Esches. Brochure in-8°. Vitraux de l'église de St-Martin de Groslay. Brochure in-8°. Etude sur les vitraux de Triel. Brochure in-8°. Stalles de l'Isle-Adam et de Presles. Brochure in-8°. Une description de l'église de Chambly au XVIIIe siècle. Brochure in-8°. La Fontaine de vie. Brochure in-8°, gravures. Une corporation sous le patronage du Saint-Sacrement. Brochure in-8°, gravures. Chapelle et pèlerinage des Saintes hosties à Marseille-lePetit (Oise). Brochure in-8°, gravure. Broderies conservées à l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry. Tribune de l'orgue de l'église de Château-Thierry. Brochure in-8°. De la place des Apôtres dans les monuments. Brochure in-8°, gravure. Dais d'autel de Sérifontaine (Oise). Brochure in-8°, gravure. Antependium de l'Hôtel-Dieu de Pontoise. Brochure in-8°, gravure. Anciens aournemens conservés dans le diocèse de Beauvais. Brochure in-8°. Les Confréries du Saint-Sacrement et du Sacré-Cœur dans le diocèse de Beauvais. Brochure in-8°. Diligences et Chemins de fer; 1842-1892. Brochure in-8°. Inscriptions de l'église de Bailleul-sur-Thérain. Brochure in-8°. 31. Un retable eucharistique au Musée de Cluny. Brochure 32. 33. 34. 35. 36. 37. – - - - in-12. Les testaments eucharistiques. Brochure in-8°. Les représentations allégoriques de la Sainte Eucharistie. Brochure in-8°, gravure. Voyage archéologique en Suisse. Brochure in-8°. Trésor d'Antoing (Belgique). Brochure in-4º, gravure. Chambly pendant la révolution. Brochure in-8°. — Un vitrail à Attainville (S. et O.). Brochure in-4°. (A suivre). mer ག
| 47 |
SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D'ÉTAMPES ET DU HUREPOIX COMPTE-RENDU DES SÉANCES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 JUILLET 1900 Excursion à Saint-Sulpice de Favières et à Dourdan. La Société historique et archéologique de Corbeil, d'Etampes et du Hurepoix a réalisé, le 5 juillet 1900, le projet formé depuis longtemps, de tenir son assemblée générale au cours d'une promenade à Saint-Sulpice de Favières et Dourdan. Le programme arrêté par le Conseil d'administration désignait, comme lieu de rendez-vous, la station de Breuillet, sur la ligne du chemin de fer de Paris à Tours, par Vendôme. A l'heure fixée, la cour de la gare prend un air de fête ; de nombreux touristes y échangent des salutations amicales. Dans les groupes, on remarque beaucoup de dames qui, par une innovation heureuse, ont bien voulu répondre à l'invitation du Conseil. On s'installe rapidement dans de confortables voitures, et aussitôt le départ a lieu. A travers des paysages rustiques, illuminés par un beau soleil, on se dirige vers Saint-Sulpice de Favières. La contrée est verdoyante à souhait; les eaux vives de la Remarde et de l'Orge y donnent aux prairies des tons d'une fraîcheur exquise. Plusieurs villages, Breux, Saint-Etienne, Jouy, animent cet aimable vallon, bordé de faibles ondulations de terrain où la récolte achevant de mûrir déploie en ce moment de somptueuses couleurs. 6
| 48 |
Après un tournant brusque du chemin, apparaît l'église de SaintSulpice de Favières, merveille inattendue en ce pays que rien ne semblait prédestiner à l'insigne faveur de posséder un tel monument. Sous la conduite de notre dévoué collègue, M. l'abbé Glimpier, curé de Saint-Sulpice, on visite ce chef-d'œuvre de l'art gothique; on admire son élégance, l'harmonie de ses proportions, la délicatesse des ornements dont la pierre est fleurie. Dans une causerie attachante, M. Glimpier, en résumant l'étude qu'il a publiée, laisse paraître le culte que son église lui inspire et communique à l'auditoire un peu de sa légitime ferveur. Ce remarquable spécimen d'architecture ogivale a donné lieu à de nombreuses descriptions techniques. Parmi les ouvrages qui les renferment, nous signalerons ceux de Patrice Salin, de M. Lisch (Encyclopédie d'architecture), de M. l'abbé A. Bouillet (1891) et enfin de M. l'abbé Glimpier (1899). Après un examen trop sommaire (à cause du temps qui nous est mesuré), d'objets d'art dignes d'attention, les verrières du XV. siècle, les stalles en bois sculpté des XVe et XVIIe siècles, le banc d'œuvre restauré nouvellement, on pénètre dans la chapelle des miracles. Ce serait le sanctuaire primitif, celui où des fidèles sans nombre venaient, des contrées les plus lointaines, s'agenouiller devant l'autel de saint Sulpice, pour demander au bienheureux aide et protection. Au XVIIe siècle, on y voyait des béquilles déposées par les pèlerins. Dans cet oratoire, transformé en sacristie, M. l'abbé Glimpier met sous nos yeux le Trésor de l'église; il se compose notamment de chasubles en soieries de Lyon, décorées de broderies chinoises; de fragments d'un vieil antiphonaire, et de divers ornements dont l'ancienneté augmente la valeur artistique. Avant de continuer la promenade, on jette un dernier coup d'œil sur le portail; malgré les mutilations que des iconoclastes lui ont fait subir, il garde encore sa belle ordonnance, et, en quelques parties, la finesse et la légèreté de sa décoration. Cependant on a repris ses places dans les voitures; on y laisse monter à la hâte des retardataires entraînés par le désir d'admirer un instant les futaies grandioses du parc de Segrez. Malheureusement, les rigueurs de l'horaire établi pour la journée ne permettent pas de consacrer la moindre parcelle de temps à une pérégrination
| 49 |
dans ce magnifique domaine, qui nous était ouvert et où résida le marquis d'Argenson. De Saint-Sulpice à Villeconin, on traverse une région boisée, fermée par des collines rocheuses et déshéritée, ce semble, au point de vue agricole. Le sol est indigent ou du moins impropre à la culture positive. Les champs de blé et d'avoine produisent surtout des bluets et des coquelicots, moisson de poète, dont les bonnes gens de la campagne ne saisissent pas le charme idyllique. A Souzy, une muraille percée de fenêtres ogivales appelle l'attention des touristes. C'est le dernier vestige d'une église incorporée au domaine de Souzy. On arrive à la seconde étape du voyage, Villeconin. Sa modeste église est en contre-bas; on y accède par une rampe de sept ou huit marches. L'édifice présente quelques particularités, un pilier roman, les armoiries de Michel Chrétien de Rotrou et la pierre de son tombeau, employée dans le dallage du chœur. Le château de Villeconin, déjà ruiné en 1763, est en ce moment. le siège d'une exploitation rurale. Il ne subsiste de l'ancien manoir qu'une tourelle et un bâtiment armé de machicoulis dont la muraille est sillonnée de rainures profondes, naguère utilisées pour la manœuvre du pont-levis. Parmi les seigneurs de Villeconin, on cite Jean de Montaigu, surintendant des finances, auquel l'inimitié du roi de Navarre et de Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne, valut d'être exécuté, aux Halles, le 17 octobre 1409; Talaru, marquis de Chalmazel et de Chamarande ; d'Estouteville; d'Anglure de Bourlemont. A proximité de Villeconin, sur la hauteur, se dresse la silhouette, farouche dans sa caducité, d'un manoir féodal; parmi les ruines amoncelées, le donjon est resté debout. En sa survivance opiniâtre, il a l'air de se souvenir qu'en d'autres temps il exerçait, sur le plat pays, un droit de suzeraineté. Ce sont les débris du château de la Grange-sur-Villeconin, ayant appartenu, comme la demeure seigneuriale dont nous venons de parler, au sire de Montaigu, au seigneur de Graville, au comte d'Ornaison. La société regagne les voitures. On franchit assez rapidement le plateau qui nous sépare de la vallée de l'Orge. Ici les champs, moins rebelles aux efforts de l'homme, ont déjà la plantureuse monotonie de la campagne beauceronne, dont les plaines se confondent au loin avec la ligne de l'horizon. Des villages disséminés le long
| 50 |
de la route, Montflix, Montdétour, Marchais, Roinville, donnent au paysage, sinon une grande animation, du moins quelque variété. La promenade en voitures se termine à Dourdan. Dès l'arrivée on se réunit à l'hôtel du Croissant, où se trouvent plusieurs membres de la société archéologique de Rambouillet, qui nous sont présentés par M. Lorin, secrétaire général. Cependant la table en fer à cheval, agréablement fleurie et décorée, se garnit avec une promptitude qui ne laisse aucun doute sur l'influence apéritive du grand air. Tandis qu'on fait honneur au menu heureusement composé et bien exécuté, nous dénombrons les convives; en voici la liste : M. le docteur Boucher, président; à sa droite, Mme Barthélemy, M. Dufour, secrétaire général, M. Barthélemy, Mme Loisel, M. et Mme Jarry, M. le docteur Ladmiral, M. Loisel, Mme MarcPasquet, M. et Mme Tartary, M. et Mme Monteil, M. Thouvenin, Mlle Pottier, M. Sainte-Marie, M. l'abbé Alliot, M. Dutilleux, M. Oudiou, M. J. Febvre, M. et Mme Leroy, M. et Mme E. Verdage, Mme Aubenas, M. et Mme Teton ; - à gauche du Président, Mme Girard, M. le docteur Devouges, Mme et Mlle Boucher, M. Lorin, M. G. Girard, M. Maillard, M. A Soupault, M. Gaston Palfrène, M. André Palfrène, M. et Mme Tourneux, M. A. Lachasse, M. l'abbé Damoiseau, M. l'abbé Géhin, M. l'abbé Colas, M. Ed. Delessard, Mme E. Michelez, Mlle H. Michelez, M. Er. Delessard, Mme G. Gruffy, M. J. Périn, Mlle M. Grand, M. l'abbé Glimpier, M. l'abbé Simon, M. Marc-Pasquet, M. Sabrou, M. Pinat, M. Vernholes, M. L. Darnet, M. Maxime Legrand, M. Allorge. Nous citerons encore parmi les touristes MM. Pharisier et Fousse. A la fin du déjeuner, dont la cordiale animation ne s'est pas ralentie un moment, M. le docteur Boucher remercie, dans une allocution chaleureuse, la nombreuse assistance qui a bien voulu se rendre à l'appel du comité. Il réserve une mention particulière aux dames que la longueur du voyage n'a pas empêchées de suivre l'excursion. Il n'oublie pas les absents et envoie l'expression des regrets communs à ceux qui n'ayant pu venir se sont excusés, notamment MM. de Courcel, Cheuvreux, Depoin, de Lafaulotte, Vollant, Dragicsevics, de Dion, J. Pannier, Gatinot. Ensuite M. le docteur Devouges se fait applaudir dans une de
| 51 |
ces improvisations charmantes, pleines d'esprit et de verve, dont il est coutumier. Après quoi M. Delessard, de Ris, lit des vers de Boileau dédiés. au président de Lamoignon. Enfin l'intermède gastronomique s'achève dans le bruit des conversations. On se dirige vers le château, où nous sommes accueillis, de la façon la plus courtoise, par le propriétaire, M. Joseph Guyot, annaliste érudit, qui a publié sous le titre de « Chronique d'une ancienne ville royale », une histoire de Dourdan, couronnée en 1870 par l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Quand on a franchi la poterne creusée dans l'épaisseur d'une muraille dominée par deux tourelles en poivrières, on a sous les yeux une vision inattendue l'huis un peu farouche et inquiétant, propre à suggérer quelque sombre tableau du moyen âge, s'ouvre sur un parterre délicieux. Les fleurs y abondent, entremêlées de feuillages, et leur grâce atténue la sévérité du donjon massif où dort le souvenir des grandes batailles d'autrefois. M. Guyot nous fait les honneurs de son domaine avec une aménité parfaite que ne lasse pas la curiosité des visiteurs. Il faut le remercier d'autant plus de son obligeance qu'il est venu tout exprès de Paris, afin de recevoir lui-même les membres de la Société. Devant le donjon, il nous rappelle, dans un abrégé substantiel, les événements dont le château fut le témoin: Edifié sur l'emplacement d'une habitation où résidèrent Huguesle-Grand et Hugues-Capet, il devint, sous Philippe-Auguste, vers 1220, un ouvrage de guerre très important. En 1240, le château de Dourdan est compris dans le douaire attribué à la mère de saint Louis. Jeanne de Bourgogne, en 1314, et la Hire, en 1430, y sont emprisonnés. Il appartient successivement à Philippe-le-Hardi, à Charles VI, à Philippe-le-Bon, à Jean de Nevers. Il est pillé en 1411 par Jean-Sans-Peur, et, en 1428, par Salisbury. Tour à tour il dépend du domaine royal et en sort par donation ou à titre d'engagement. François Ier en gratifie la duchesse d'Etampes. Pendant les guerres de religion, la forteresse eut à subir trois sièges, en 1562, 1567 et 1591. Ce dernier, entrepris par le maréchal
| 52 |
de Biron, se termina par la reddition de la place, malgré la belle défense du capitaine Jacques Dargiens. Le domaine est acheté, en 1597, par Nicolas de Harlay de Sancy; en 1600, par Sully. Sous Louis XIII il fait retour à la couronne ; puis il est dévolu à la famille d'Orléans, qui en est dépossédée par la Révolution. Maison centrale en 1791, le château est vendu, en 1852, à M. Amédée Guénée qui le transmet à M. Ludovic Guyot, père du propriétaire actuel, M. Joseph Guyot. Nantis de ces indications préalables, les visiteurs entreprennent l'ascension de la tour féodale. On admire, dans leur état de parfaite conservation, les deux salles en ogive, les murs construits en vue des longues résistances, la plate-forme d'où l'on domine l'agreste vallée de Dourdan. Après la descente, M. Guyot nous indique l'entrée des cachots où fut incarcérée la bande des chauffeurs d'Orgères, qui terrorisa le pays de Beauce de 1783 à 1800 et dont les entreprises scélérates ont défrayé longtemps le roman populaire. En continuant la promenade, on suit le chemin de ronde pratiqué au-dessus des douves. Dans ces bas-fonds, à demi comblés et déchus de leur aspect redoutable, on aperçoit des verdures potagères. M. Guyot nous conduit enfin dans les anciens bâtiments du grenier à sel, aménagés en élégante habitation. On y remarque des curiosités de haute valeur, des meubles rares et authentiques, des tapisseries, des médailles, des peintures. On n'a que le temps de s'émerveiller à la hâte; on remercie de nouveau le maître hospitalier de la demeure, et on se dirige vers l'église de Dourdan. L'édifice date de la fin du XIIIe siècle; il a donné lieu, notamment au XVe siècle et vers 1591, à des restaurations nombreuses qui n'ont pas été sans compromettre l'unité du style. Néanmoins le monument est remarquable par son élévation, l'ampleur de la nef, l'élégance des chapelles. Dans l'une d'elles, dédiée à la Vierge, Regnard, l'auteur du Légataire universel, a été inhumé le 6 septembre 1709. On se rend ensuite à l'assemblée générale, convoquée dans une des salles de la mairie de Dourdan. La séance est ouverte sous la présidence de M. le docteur Boucher,
| 53 |
Dans une brève allocution, le Président, en son nom et au nom de la Société, adresse de vifs remerciements à toutes les personnes qui ont bien voulu prendre part à l'excursion. Il se fait un devoir d'exprimer, d'une façon particulière, ses sentiments de gratitude envers M. Lorin, secrétaire général de la Société historique de Rambouillet, qui a sollicité l'adhésion de ses collègues, en leur envoyant des circulaires, et contribué, par son aimable initiative, au succès de la réunion. La parole est ensuite donnée au secrétaire général pour la lecture de son rapport sur la situation et les travaux de la Société, pendant l'année 1899. Messieurs, Nous tenons aujourd'hui notre assemblée générale de 1900 et je dois, nos statuts m'y obligent, vous rendre compte de la situation de notre Société et de ses travaux pendant l'année 1899; c'est ce que je vais faire aussi brièvement que possible afin de ne pas abuser de votre patience. Il est d'usage en pareille circonstance de saluer les disparus, c'est un devoir pénible auquel je ne veux pas manquer; mais notre assemblée générale de 1899 ayant eu lieu très tard (25 octobre) je n'aurai point à vous parler de la perte irréparable que nous avons faite en la personne de M. Aymé Darblay, décédé le 22 mai de cette même année 1899, plusieurs articles et une notice spéciale lui ayant été consacrés dans notre Bulletin. Les autres membres que nous avons perdus en 1899 sont M. Vacquer, sous-directeur du musée Carnavalet et chargé du service archéologique de la ville de Paris; c'était un homme d'une rare compétence; il laisse un vide qui ne sera pas comblé de sitôt. Nous avons encore perdu MM. Michelez, de Lardy, et Gibert, de Corbeil. Le premier était un artiste de talent, qni se plaisait à reproduire les sites de la belle vallée qu'il habitait. Quant à M. Gibert, qui fut pendant de longues années percepteur à Corbeil, vous l'avez tous connu et avez été à même d'apprécier les aimables qualités qui lui avaient conquis une sympathie universelle. Quelque douloureuses que soient ces pertes, estimons-nous heureux, chers collègues, qu'elles n'aient pas été plus nombreuses. Malgré les vides qui se produisent forcément dans toutes les Sociétés, la nôtre continue à suivre sa marche ascendante; le 25 octobre dernier je constatais, à l'assemblée générale de 1899, l'inscription sur nos listes de 181 sociétaires ; peu de mois se sont écoulés depuis et nous sommes maintenant 187, sur lesquels 17 sont fondateurs. Nous marchons donc sûrement vers ce nombre de 200 qui fut longtemps notre objectif et qui est très honorable pour une Société d'arrondissement qui se meut dans un champ forcément restreint; mais nous savons borner nos ambitions et, comptant sur les bienveillances qui ne nous ont pas manqué jus-
| 54 |
qu'à présent, nous espérons atteindre le but que nous nous sommes proposé et le dépasser même si nous le pouvons. Afin de suivre la tradition établie, je vais vous dire ce que nous avons fait en 1899, en passant rapidement en revue les deux bulletins que nous vous avons donnés en cette même année et qui, eux aussi, ont suivi une marche ascendante, car ils sont de plus en plus volumineux; en effet, nos deux bulletins réunis comptent 208 pages, tandis que ceux de l'année précédente, n'en avaient ensemble que 142. Vous avez sûrement apprécié la qualité du papier et la beauté de l'impression, cela nous coûte fort cher, mais nous ne reculons devant aucun sacrifice pour justifier votre confiance et mériter votre sympathie. Le premier Bulletin de 1899 débutait par une notice nécrologique consacrée à Aymé Darblay, dans laquelle notre sympathique président, M. le Dr Boucher, a retracé la vie si bien remplie de ce bon collègue, trop tôt disparu, hélas! et a si bien exprimé nos regrets à tous en rappelant avec émotion tout ce que nous devions à ce généreux bienfaiteur. Cette notice est illustrée d'un portrait d'Aymé Darblay, gravé sur cuivre ; c'est une véritable œuvre d'art dont la planche nous a été depuis demandée, dans un but de pieux souvenir, pour en tirer 3.000 exemplaires qui ont servi à illustrer un memento nécrologique qui a été distribué à tous ceux qui avaient connu et apprécié Aymé Darblay. Nous avons cru bien faire ensuite en offrant, au nom de notre Société, cette planche à la veuve du regretté défunt, en témoignage de notre juste reconnaissance. Les Vicomtes de Corbeil et les chevaliers d'Etampes au XIIe siècle, par M. J. Depoin, continuaient notre premier Bulletin. C'est une œuvre de haute érudition, appuyée sur des documents authentiques de l'époque même, elle fait grand honneur à son auteur et a été appréciée comme elle le méritait. Cette savante publication était ornée d'une belle gravure dont la planche nous a été gracieusement prêtée par l'imprimerie nationale. Notre collègue, M. Paul Pinson, a bien voulu, une fois de plus, extraire pour nous de son importante collection de documents, deux pièces inédites sur Etampes, sa ville natale : la reddition du Château d'Etampes au mois de juillet 1465, et le ravitaillement de l'armée royale à la fin du siège d'Etampes en 1652. Nous ne saurions trop l'en remercier. Ce bulletin se terminait par le récit de la fête de la souveraineté du peuple, célébrée à Athis-sur-Orge en 1798. Ge document a été retrouvé dans les archives de cette commune par un jeune chercheur qu'on ne saurait trop engager à continuer ses fouilles intéressantes. Le second bulletin commence avec une notice de M. Boulé, ancien juge de paix, natif d'Arpajon, sur la rivalité entre cette ville et Montlhéry, lors de la création du chef-lieu de canton après 1789. M. Boulé a ajouté à cette intéressante notice la liste des juges de paix d'Arpajon depuis l'origine. Nous devons ensuite à M. J. Pannier des Notes sur Grigny et ses seigneurs aux
| 55 |
XVIe et XVII siècles, accompagnées d'un plan de Grigny au XVIIe siècle. M. Gatinot, inspecteur primaire en retraite, a bien voulu emprunter, pour nous, à l'histoire de la commune de Montgeron, à laquelle il travaille depuis longtemps, quelques pages curieuses sur le serment constitutionnel à Montgeron pendant la Révolution. Nous avons encore à remercier notre savant confrère M. Paul Pinson, qui a enrichi ce second bulletin d'un chapitre fort intéressant intitulé : « Recherches sur la navigation d'Étampes à Corbeil depuis le XVe siècle jusqu'à la suppression en 1676, suivies d'un exposé historique des tentatives faites au XVIIIe siècle pour son retablissement ». On n'avait jusqu'à présent rien publié d'aussi complet sur ce sujet, qui intéresse Corbeil aussi bien qu'Etampes, et cette étude, très fouillée et très complète, accompagnée de pièces justificatives qui en augmentent la valeur, sera désormais consultée par ceux qui voudront écrire ou se renseigner sur ce sujet. M. J. Depoin nous a donné ensuite un appendice sigillographique à son savant travail sur les Vicomtes de Corbeil, accompagné d'une planche de six reproductions de sceaux de ces personnages. Une bibliographie et une chronique, plus importantes que les précédentes, complètent ce bulletin. Voilà, mes chers confrères, ce que nous avons publié en 1899; nous nous plaisons à espérer que ces travaux auront mérité vos suffrages. Sans vouloir empiéter sur l'année courante 1900, je vous rappellerai pour mémoire que nous vous avons donné, il y a deux mois environ, le T. II de nos Mémoires et documents, volume de 142 pp. sur lequel j'aurai à revenir l'année prochaine; mais je dois vous dire aujourd'hui que ce volume de 142 pages a été laborieux à établir et nous a mis en retard pour le premier bulletin de 1900, qui aurait déjà dû voir le jour; mais ce retard va être regagné, je l'espère, car ledit bulletin est déjà en grande partie imprimé, il ne tardera pas à paraître et, aussitôt après, nous mettrons le second sur le chantier afin qu'il puisse être mis en distribution le plus tôt possible. Vous voyez, chers confrères, que notre Société continue à prospérer et à travailler, à vous de l'aider et de la soutenir et par vos travaux et par la propagande que nous vous engageons vivement à faire afin de nous amener de nouveaux collègues; plus nombreux nous serons, plus nos ressources seront grandes et, par conséquent, plus nous pourrons vous donner. En effet, il nous faut de grandes ressources, car nous avons de grands besoins, non pas tant pour la Société elle-même, mais pour le musée que nous avons fondé dans la belle église St-Jean; il y a là de grosses dépenses à faire pour que nos collections puissent justifier le titre de musée. Je suis heureux de vous apprendre à ce sujet que le musée St-Jean a été enfin ouvert au public le 3 juin dernier. Un tableau, fixé sur la porte, indique qu'il est ouvert tous les dimanches, de 1 h. à 6 h. en été, et de 1 h. à 4 h. en hiver. On a compté plus de 1000 visiteurs I
| 56 |
pour les deux premiers dimanches. Le public s'arrêtait surtout devant le grand et beau tableau de M. Maille, offert par Mme Haro et qui donne la vue de Corbeil prise des hauteurs du Perray. Il est maintenant en place, habilement restauré, et fait le meilleur effet. Vous savez qu'en présence des exigences de l'ancienne municipalité, nous avions dû interrompre nos négociations avec la ville et attendre des temps meilleurs; aujourd'hui ces temps paraissent arrivés et nous avons renoué de nouveaux pourparlers qui nous permettent d'espérer à bref délai le résultat que nous désirons, c'est-à-dire l'appui financier de la ville et le dépôt dans notre musée des collections qui lui appartiennent et que j'ai recueillies depuis 25 ans à la mairie; je suis chargé d'en dresser l'inventaire, que je soumettrai au Conseil municipal lors de sa plus prochaine séance. En outre, nous avons adressé au Conseil général de Seine-et-Oise une demande de subvention; nous sommes assez bien apparentés de ce côté pour espérer le succès de notre démarche, et nous avons reçu à ce sujet de nos confrères, MM. Cros et le Cte Treilhard, tous deux conseillers généraux, les meilleures et les plus aimables assurances d'appui. Vous voyez, Messieurs et chers collègues, que, non contents de nous occuper des multiples détails des publications de notre Société, nous pensons encore à ses intérêts et à ses relations. Nous espérons donc que vous voudrez bien accorder aux termes de ce rapport la bienveillante approbation qui nous est nécessaire pour nous donner la force de poursuivre sans défaillance la mission que vous nous avez confiée. A. D. M. Lasnier, trésorier de la Société, étant absent de Corbeil, le Secrétaire général donne lecture de la situation financière de la Société au 31 décembre 1899, que M. Lasnier a établie avant son départ. Nous résumons ici ce rapport qui sera inséré in-extenso au registre des procès-verbaux. Situation financière au 31 décembre 1899 Recettes Excédent de l'exercice précédent . 2 fondations à 100 francs Cotisations de 1899 . Intérêts de fonds placés. Vente de bulletins. • Recettes diverses . Allocations au musée. 3.500 fr. 55 200 » 1.400 » 93 46 » 80 IS » 350 Total des recettes, • 5.639 fr. 01
| 57 |
Dépenses Frais d'impression. 942 fr. 70 Frais de gravures, clichés, etc. 259 50 Frais d'administration (timbres-poste et de quittances, recouvrements, chargements, etc.). . 166 40 Dépenses pour le musée. 209 55 Total des dépenses. 1.578 fr. 15 Balance Recettes. · · 5.639 fr. 01 Dépenses Laissant un excédent de. Représentés par le livret 74.695, (Caisse d'ép. de Corbeil) . Et numéraire en caisse. 1.578 IS 4.060 fr. 86 Total égal. • 3.622 fr. 33 438 53 4.060 fr. 86 M. le trésorier termine son rapport par la phrase suivante, qu'il est bon de faire connaître : « Je dois ajouter que MM. les membres de la Société ont acquitté leurs cotisations avec un empressement que je me plais à signaler ». M. le Président donne ensuite lecture de l'article VII des statuts dont voici les termes : « La Société est administrée par un conseil composé de vingt-et-un membres, élus pour trois ans en assemblée générale. — Le conseil se renouvelle chaque année par tiers. → Les membres sortants sont rééligibles ». - Le tiers du Conseil sortant cette année se compose de MM. J. Barthélemy, abbé Colas, docteur Boucher, A. Dufour, Maxime Legrand, Mottheau et J. Périn. M. le Président annonce qu'en exécution des statuts, il y a lieu de procéder à l'élection de sept membres du Conseil et il désigne aux suffrages de l'assemblée les candidats dénommés plus haut. A l'unanimité sont renommés administrateurs pour trois ans : MM. J. Barthélemy, abbé Colas, docteur Boucher, A. Dufour, Maxime Legrand, Mottheau et J. Périn. Par acclamation, l'assemblée générale renouvelle ensuite, pour une année, conformément aux articles II et XIV du réglement, les pouvoirs du bureau et du comité de publication, puis elle approuve les rapports du Secrétaire général et du trésorier, elle donne décharge à ce dernier et vote de chaleureux remerciements à tous deux pour leurs intéressants rapports,
| 58 |
Enfin pour achever de remplir le programme, M. Dufour lit la courte notice suivante. Il demande à l'assemblée d'excuser le sujet un peu léger de cette anecdote, qui a cependant son intérêt, car elle se rattache directement à notre contrée, et il peut en garantir l'exactitude, puisqu'il a très bien connu le héros de cette histoire. A l'époque où Bonaparte n'était encore qu'un jeune officier auquel l'avenir souriait plus que la fortune, il avait pour sellier un brave homme, du nom de Gagnery, qui était établi dans les environs de la Chaussée-d'Antin, peut-être bien, si je ne me trompe, dans la rue Chantereine, appelée plus tard rue de la Victoire. Quand Bonaparte fut nommé général en chef de l'expédition d'Egypte, il vint trouver Gagnery pour lui commander tout un équipage en rapport avec son nouveau rang. Mais, lui dit-il, je te préviens qne je n'ai pas d'argent; si tu as confiance en moi, je te paierai au retour de l'expédition. Gagnery eut confiance et livra rapidement tout ce que Bonaparte lui demandait; il y en avait pour une dizaine de mille francs. Bonaparte revint et paya Gagnery, mais il n'oublia pas la preuve de confiance et de foi en lui qu'il en avait reçue, et quand, plus tard, il parvint au pouvoir, il lui fit vendre son établissement et l'attacha à sa personne avec le titre de sellier de l'Empereur. C'est en cette qualité qu'il suivit partout Napoléon et qu'il fit toutes les campagnes de l'Empire. Puis vinrent les revers, et le 28 avril 1814, Napoléon s'embarquait à Fréjus pour l'île d'Elbe. Là, au moment de monter sur le navire qui devait le conduire à l'exil, il fit ses adieux aux fidèles qui l'avaient suivi et leur distribua des souvenirs. Gagnery était là, il n'avait rien reçu : - - Et moi, Sire, dit-il, vous ne me donnez rien ! Que veux-tu que je te donne, mon pauvre Gagnery, répondit l'Empereur, je n'ai plus rien. Tiens, veux-tu mon pot de chambre, c'est tout ce qui me reste; et en disant ces mots, il lui jeta le précieux vase que Gagnery attrapa au vol. C'était un joli récipient à usage de voiture, de forme oblongue, muni d'une anse en anneau à la partie inférieure et décoré d'un filet d'or, avec l'N surmonté de la couronne impériale également en or. Gagnery avait largement de quoi vivre, et il vint se retirer à Essonnes, sur les bords de la rivière de ce nom, dans une propriété appelée la Nacelle, toute voisine de l'île habitée autrefois par Bernardin de-Saint-Pierre. C'est dans cette retraite champêtre que le père Gagnery (on l'appelait ainsi dans le pays) vécut de longues années encore, conservant pieusement le souvenir de son Empereur et contemplant avec respect la chère relique qu'il en avait reçue à Fréjus. Le précieux vase était placé sous verre, sur un meuble élevé où je l'ai vu bien longtemps,
| 59 |
On buvait sec chez le père Gagnery et, quand il recevait de vieux amis, des intimes, anciens soldats comme lui, la plus grande marque d'estime et d'affection qu'il pût leur donner était de les faire boire dans le pot de chambre de l'Empereur ! Mais je me hâte de dire que cela n'avait lieu qu'aux grands jours, alors qu'on se racontait, avec l'émotion du souvenir, les hauts faits de la grande époque. Le père Gagnery est mort depuis longtemps déjà. Qu'est devenu le fameux. vase impérial? je l'ignore, mais si j'avais le temps de me livrer à une enquête, je retrouverais peut-être la trace de cette précieuse relique, car je sais que, lors de la vente qui fut faite après le décès de M. Gagnery, elle fut adjugée, au prix de vingt francs, à quelque amateur de curiosité qui, comme tout le monde dans le pays, en connaissait l'histoire et l'origine. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée, puis l'on se dirige vers la gare, car l'heure du train est proche; et avant de se séparer, les excursionnistes se font leurs adieux, en se donnant rendez-vous à l'année suivante, et en constatant avec satisfaction que l'intéressant programme de la journée, très chargé cependant, a été rempli dans les conditions les plus heureuses; chacun d'ailleurs pouvant s'en féliciter, car le bon vouloir des touristes est venu en aide au dévouement des organisateurs. G. G.
| 60 |
L'ASSEMBLÉE PROVINCIALE DE L'ILE DE FRANCE LES DÉPARTEMENTS DE SAINT-GERMAIN ET DE CORBEIL 1787-1790
(1). La déplorable situation financière de la France vers la fin du règne de Louis XVI est connue : c'était plus que du malaise, c'était une véritable détresse ; après avoir envisagé, étudié tous les moyens d'y remédier, le gouvernement en était réduit à employer celui qui paraissait extrême: l'aveu du déficit à la nation. Dans ce but, fut convoquée l'Assemblée des notables pour le mois de février 1787, et en même temps préparée la série de projets que le ministère comptait lui soumettre au nom du roi pour sauver le pays de la ruine. Le seul qui nous occupe ici est le projet de création, pour les provinces qui, n'étant pas « pays d'États », n'administraient pas elles-mêmes leurs finances, d'assemblées provinciales destinées à les assimiler à ces pays d'États. Le système avait été déjà préconisé par Turgot et Necker; c'est leur successeur, Loménie de Brienne, qui le fit prévaloir devant l'Assemblée des notables. Non sans peine, car, tout en admettant unanimement le principe, cette assemblée s'opposait à la plupart des détails de l'organisation. L'édit fut cependant promulgué dès le mois de juin 1787: il y avait urgence. Dans son remarquable ouvrage : l'Ancien régime et la Révolution, A. de Tocqueville a établi le premier, et d'une façon lumineuse, que de cet édit date réellement la Révolution, «< une grande ―― (1) Cette étude de notre confrère, M. Bournon, a paru d'abord dans la Correspondance historique et archéologique (année 1899, pages 258-268 et 298-306). Comme elle présente un intérêt réel pour Corbeil et sa région, nous la reproduisons avec l'agrément des directeurs de cette publication.
| 61 |
révolution administrative », ― alors que la révolution politique n'a commencé qu'au mois de mai 1789, - ou même, si l'on veut, à la journée du 14 juillet. Il faut y insister, et répéter qu'en effet l'édit de juin 1787 révolutionna l'organisation administrative de la France, telle qu'elle fonctionnait depuis la création des intendants, puisqu'à l'autorité toute-puissante de ces agents elle juxtaposa celle de députés représentant les trois ordres de citoyens qui composaient la Nation. Par cet édit, d'abord, furent créées les municipalités, au dernier degré de l'échelle administrative. Jusqu'alors les paroisses s'administraient à peu près suivant leur fantaisie, ou du moins d'après celle du ou des seigneurs possédant le terroir, et du curé. Dans certains cas, particulièrement graves, les habitants s'assemblaient chez le notaire le plus proche et y signaient une délibération ayant un caractère officiel, mais rien n'était réglé. Il fut décidé que, désormais, chaque paroisse aurait une assemblée municipale composée: de droit, du seigneur et du curé, et, par élection, de trois, six ou neuf membres, d'après le chiffre de la population comptée par feux. De plus, un syndic, également élu, devait assurer l'exécution des délibérations. Au-dessus des municipalités, dans la hiérarchie de l'administration, furent placées les assemblées de département: chaque département étant composé d'un certain nombre d'arrondissements, et chaque arrondissement d'un certain nombre de municipalités. Les assemblées de départements, au terme de l'édit, sont composées de membres, les uns députés par les paroisses, les autres pris dans le sein de l'assemblée provinciale. Ces assemblées, qui auront une réunion chaque année au mois d'octobre, seront, le reste du temps, représentées par une commission ou bureau intermédiaire permanent chargé de veiller à l'expédition des affaires courantes. L'assemblée provinciale, enfin, représente les intérêts de la Généralité ou province tout entière. Elle est composée de membres nommés par le roi, de façon que le Tiers-État en compte autant que le clergé et la noblesse réunis, puis de membres élus par ces trois éléments réunis et qui peuvent être choisis dans les assemblées de départements. L'assemblée provinciale devra aussi avoir une session chaque année, mais elle se perpétuera par une commission intermédiaire prise dans son sein et veillant en permanence au bon ordre administratif, notamment au fonctionnement régulier des
| 62 |
assemblées municipales. A cet égard, la circulaire suivante adressée le 14 juillet 1788 à « MM. des Commissions intermédiaires » énonce une partie de ces attributions de contrôle : «< Toutes les assemblées municipales doivent être pourvues d'un registre de … délibérations. « Ce registre sera renouvelé chaque année. « L'assemblée municipale doit se tenir de droit tous les dimanches après la messe paroissiale, sans qu'aucun soit dans le cas d'être spécialement convoqué. « Si le syndic a reçu, dans le cours de la semaine, les ordres du bureau intermédiaire du département ou de M. l'intendant, il doit les communiquer à l'assemblée municipale qui s'occupera sur-le-champ de les exécuter. « Si le syndic n'a reçu aucun ordre et que l'assemblée municipale n'ait aucun aucun objet dont elle ait à s'occuper, l'assemblée n'en aura pas moins lieu après la messe paroissiale et il sera inscrit sur le registre des délibérations que, tel jour, l'assemblée s'est réunie et s'est séparée, n'ayant reçu aucun ordre de l'exécution duquel elle eût à s'occuper et n'ayant aucun objet à traiter. « Si l'objet de travail porté à une des assemblées tenues le dimanche, après la messe paroissiale, exigeoit quelque assemblée extraordinaire avant le dimanche suivant, comme lorsqu'il sera question de la confection d'un rolle, alors on conviendra du jour et heure où l'on se réunira, et il ne sera besoin d'aucune convo. cation particulière pour que ladite assemblée ait lieu, attendu qu'il en sera fait mention sur le registre. « Vous aurez soin, messieurs, d'envoyer copie de ma lettre à tous les bureaux intermédiaires du département et de leur recommander d'en envoyer sur-le-champ des exemplaires à tous les syndics à qui le bureau intermédiaire prescrira d'en faire accuser la réception par une lettre signée de tous les membres de l'Assemblée municipale et notamment du curé ainsi que du seigneur, s'il est sur les lieux, ou de son représentant (1). « J'ai l'honneur, etc. ». ASSEMBLÉE PROVINCIALE DE L'Ile-de-France. Le nouveau régime administratif dont la France venait d'être dotée n'a encore été exposé que dans ses grandes lignes : par Tocqueville, d'abord, puis par M. Léonce de Lavergne (2) et enfin par M. de Luçay (3). Jusqu'ici, il ne paraît pas qu'une province ait été (1) Arch. nat., H. 1600. (2) Les assemblées provinciales sous Louis XVI; Paris 1864, in-8°. (3) Les assemblées provinciales sous Louis XVI et les divisions administratives de 1789; Paris 1871, in-8°; et du même auteur: La décentralisation; étude bour servir à son histoire en France; Paris 1895, in-8°.
| 63 |
l'objet de recherches spéciales ayant pour objet de montrer le rôle des assemblées provinciales pendant leur éphémère existence. Les archives départementales en fourniraient cependant tous les éléments. Pour l'Ile-de-France et plus spécialement pour la région voisine de Paris, on n'a plus, hélas! à espérer la même bonne fortune. De patientes investigations, où la moisson n'est pas en rapport avec le temps qu'elle a coûté, m'ont permis cependant d'en recueillir quelques vestiges. La Généralité de Paris, ou province de l'Ile-de-France, se composait, on le sait, de vingt-deux élections. L'un des principaux actes de l'Assemblée provinciale fut de les répartir en départements. Elle en créa douze seulement, par la réunion de plusieurs élections. En voici la nomenclature : 3 Senlis. ― ÉLECTIONS Compiègne. - Pontoise. 3 Dreux. Mantes. Montfort. 3 Rozay. – - Provins. Coulommiers. - DÉPARTEMENTS. I I • I ÉLECTIONS. 2 Melun. Étampes. 2 Montereau. Nemours — • 2 Sens. Nogent-sur-Seine. - 2 Joigny. - Saint-Florentin 2 Tonnerre Vézelay. • • 1 Paris (Saint-Germain et Corbeil) I Meaux I Beauvais . 22 DÉPARTEMENTS. I I I I I · 2 I I 12 Ce tableau montre synoptiquement que les deux dernières élections seulement constituèrent un département, et, qu'en revanche, l'Election de Paris en forma deux. C'est le 18 août 1787 que cette répartition fut décidée. L'assemblée siégeait, à Melun, depuis le 11 août précédent. Elle tint plusieurs séances durant le mois. Le Roi avait désigné comme président le duc du Châtelet et nommé 24 membres. Six pour le clergé : M. Pierre Chauvier, général des Mathurins; 7
| 64 |
M. Maurice-Elisabeth de la Vergne de Tressant, abbé de Morigny; M. Charles-Alexandre de Damas d'Antigny, abbé d'Hérivaux; M. Louis-Claude l'Hermitte de Chambertrand, doyen de la métropole et grand vicaire de Sens, abbé des Roches; M. Charles de Tilly-Blaris et M. Jean-Baptiste-Marie de la Bintinaye, tous deux chanoines de l'Église de Paris. Six parmi la noblesse : M. le duc du Châtelet, président; M. le duc de Montmorency, seigneur de (les noms de seigneuries sont en blanc); M. François-Félix, comte de Crillon, seigneur de Crillon, cidevant Boufflers; M. Anne-Louis Regnier, marquis de Guerchy, seigneur de Nangis; M. Elie-Charles Taleyrand-Périgord, prince de Chalais, seigneur du Coudray; M. Louis-Marie, vicomte de Noailles, pour la terre de Vert-lePetit. Douze parmi le Tiers-État: M. Jean-François Antoine, chevalier de Saint-Louis, conseiller du Roi, maire de Saint-Germain; M. Michel-Armand Sallo des Varennes, conseiller du Roi, lieutenant particulier des bailliage et présidial, maire de Sens; M. Jacques de Monthiers, chevalier, conseiller-président, lieutenant-général du bailliage et maire de Pontoise; M. Guillaume Portier, officier vétéran de la maison du Roi, conseiller du Roi, maire de Dreux; M. Gabriel Basile, conseiller du Roi, maire de Joigny; M. Louis-Placide-Félicité Regardin de Champrond, conseiller du Roi, maire de Montereau; M. Eustache-Louis Borel, chevalier, conseiller d'État, conseillerauditeur en la Chambre des Comptes de Paris, président, lieutenant-général honoraire des bailliage et présidial de Beauvais, propriétaire dans l'élection de Beauvais ; M. Marie-Louis-François Marquelet de la Noue, chevalier, conseiller d'État, président, lieutenant-général honoraire du bailliage et siège présidial de Meaux, propriétaire dans l'élection de Meaux;
| 65 |
M. Augustin-Henri Henin, écuyer, procureur du Roi du bailliage et inspecteur général du domaine de Versailles; M. Joseph-Alexandre Sarazin de Maraise, écuyer, propriétaire dans l'élection de Melun; M. Edme Jobert, ancien consul de Paris et propriétaire de terres dans l'élection de Tonnerre et celle de Saint-Florentin ; M. Louis Dailly, propriétaire de terres dans l'élection de Montfort-l'Amaury. Ces séances furent purement officielles et assez stériles. A la première, l'Assemblée reçut, avec un cérémonial réglé à l'avance, le Commissaire du Roi qui n'était autre que l'intendant, Bertier, lequel fit entendre un discours très vide, auquel le Président répondit aussi par des généralités. Puis, lecture fut donnée du réglement du 8 juillet 1787, établi en vertu de l'édit portant création des assemblées provinciales. Un nouveau discours, très vague encore, fut prononcé par le Président pour indiquer à l'Assemblée le caractère de ses futurs travaux, à la suite duquel elle décida « de borner, pour cette fois seulement, les fonctions des procureurs-syndics et des autres membres de la Commission intermédiaire à la première année; après quoi il sera procédé à une nouvelle élection dans laquelle ils pourront concourir ». Puis, des bureaux furent constitués pour se répartir le travail. Les autres séances eurent lieu les 12, 14, 16, 17 août suivants. Elles n'eurent guère plus d'importance. On y reçut les corps constitués de la ville de Melun; on y discuta certains points du réglement, et notamment le rôle du syndic, rôle « plus pénible qu'honorable ». Le Bureau fut d'avis qu'il ne faudrait pas exclure le curé des assemblées paroissiales, et que le seigneur continuerait à les présider, ou, à son défaut, un membre de l'assemblée du département. Le 14, l'Assemblée compléta le nombre des administrateurs. portés par le réglement, en nommant : Dans l'ordre du clergé : M. l'abbé Mannay; M. l'abbé de Commeyras ; M. l'abbé Duhautier ; M. l'abbé de la Rochefoucauld;
| 66 |
M. l'abbé de Mauroy ; M. l'abbé Guyot-Dussière. Parmi la noblesse: M. Molé, ancien premier président; M. Tallon, conseiller au Parlement; M. le comte de la Mirmory; M. le comte de Cély; M. le marquis de Paroy; M. le comte de Tressesson; M. le marquis de Châtenay. M. Dumont; Parmi le Tiers-État : M. Cretté de Palluel; M. Bucquet; M. de Crouy; M. Colinet de Rougebourse; M. Raquiniard; M. Garnot d'Aubepierre; M. Picard, maire de la ville d'Étampes; M. Collin; M. Meignien; M. Ragon-Desplaçons; M. Parent, avocat au Conseil. Le 17, fut édicté un réglement devant servir d'instruction pour sa Commission intermédiaire. En voici les principales dispositions : l'Assemblée siégera à Paris, dans l'emplacement actuel des Bureaux de l'Intendance; au moins une fois par semaine, elle se fera rendre compte par les ingénieurs des chemins et des ouvrages publics qui seront à sa charge. Elle établira une correspondance avec les Commissions intermédiaires de département, et tiendra registre, tous les quinze jours, de leurs opérations. Le samedi 18, les membres de la Commission intermédiaire furent nommés: MM. l'abbé de Tilly-Blaru et le comte de Béthizy, pour le clergé et la noblesse; MM. de la Noue et Hennin, pour le Tiers-État. En outre, MM. l'abbé de la Bintinaye et le vicomte de Noailles furent nommés membres honoraires pour les deux premiers ordres.
| 67 |
Enfin, l'Asemblée élut les membres devant administrer les douze départements entre lesquels était désormais divisée la province et dont nous venons de donner la liste. C'est par là qu'elle termina sa session (1). Elle en tint une autre également à Melun, et beaucoup plus longue, du 17 novembre au 28 décembre 1787. Parmi les membres qui se trouvèrent réunis lors de l'ouverture de cette session, nous n'avons ici à relever que les noms des représentants des deux départements de Saint-Germain et de Corbeil. Les voici : Clergé. - M. l'abbé de la Bintinaye, chanoine de l'église de Paris, représentant le département de Corbeil. M. l'abbé Mannay, prieur de Conflans Sainte-Honorine, département de Saint-Germain. Noblesse. M. le prince de Chalais, seigneur du Coudray, département de Corbeil. M. le vicomte de Noailles, seigneur de Vert-le-Petit, département de Saint-Germain. - Tiers-Etat. M. Hennin, propriétaire à Versailles, représentant le département de Corbeil (2). M. Antoine, maire de Saint-Germain, département de SaintGermain. M. Dumont, propriétaire à Montmartre, département de Corbeil (3). M. Cretté de Palluel, propriétaire à Dugny, département de Saint-Germain. L'Assemblée siégea ensuite les 18, 19, 20, 27 et 29 novembre; les 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20 décembre. On voit quelle importance elle attachait à son œuvre, à sa mission. Pendant ces dix-huit journées de travaux, elle entendit et discuta un grand (1) La relation complète s'en trouve dans un cahier manuscrit conservé aux Archives Nationales (K. 692a) et signé, autographe, pour copie conforme: « Le duc du Châtelet; Lefebvre, secrétaire-greffier. » Elle a été imprimée en un in-4º de 64 pages, Paris, impr. royale, 1787. (2) Est-ce là une erreur du Procès-verbal officiel, car Versailles faisait partie de l'arrondissement de Saint-Germain, ou l'Assemblée a-t-elle voulu que les départements fussent représentés également, en dépit de la résidence des représentants ? (3) Même observation. Nous prouvons plus loin que Montmartre relevait du département de Saint-Germain et de l'arrondissement de Saint-Denis. La situation géographique exigeait qu'il en fût ainsi.
| 68 |
nombre de rapports ou de mémoires sur des questions de milice, d'agriculture, de travaux publics, de finances, d'organisation municipale, mais ce ne furent guère que des généralités. Presque jamais on ne traita les questions locales. Nous extrayons cependant d'un Mémoire de M. d'Ailly, lu à la séance du 19 novembre, et consacré à l'emploi des fonds présumés libres pour 1788, le passage suivant relatif à Vincennes : Pour ce que payent annuellement les habitants de Montreuil, Noisy, Fontenay, Nogent, Rosny, Basse-cour de Vincennes et de la Pissotte, afin d'être déchargés du guet et garde au château de Vincennes ci. • 5.583 1. Pour l'entretien des aqueducs qui conduisent l'eau au château de Vincennes et la fourniture des bois et chandelles de la Compagnie des bas-officiers invalides employés à la garde du château. 4.400 1. Ensemble • 9.983 1. Les dépenses ne doivent plus avoir lieu à compter du mois d'octobre dernier, d'après les ordres donnés par le Roi, pour la vente ou la démolition de ce château, et ces impositions deviennent sans objet. Nous vous proposerions d'en employer le montant en moins imposé s'il pouvait mériter quelque attention et opérer quelque soulagement pour les contribuables, mais l'opération serait trop minutieuse et son effet absolument insensible; aussi pensons-nous que vous en ferez usage pour quelque objet d'utilité publique, qui obtiendra sûrement l'approbation de sa Majesté et le suffrage de son Conseil. Il est tout à fait curieux d'apprendre officiellement qu'en 1787 la vente ou la démolition du château de Vincennes était décidée par le Roi. On ne peut que se féliciter, au regard de l'histoire et de l'archéologie, que cet étrange et barbare projet n'ait pas été exécuté. D'autre part, le 27 novembre, l'Assemblée repoussa une proposition présentée par M. l'abbé de Montagu, président de l'Assemblée du département de Saint-Germain, demandant que le Bureau intermédiaire de ce département fût établi à Paris, à l'exemple de ce qui a été décidé, tant pour la tenue de l'Assemblée de Corbeil que pour l'emplacement du Bureau intermédiaire de ce département ». Tels sont les deux seuls faits que nous ayons eus à retenir, pour ce qui concerne la banlieue parisienne, du Procès-verbal des deux sessions de Melun en 1787 (1). Il n'y eut plus de réunion, (1) Procès-verbal des séances de l'assemblée provinciale de l'Isle-de-France, tenues en novembre et décembre 1787, précédé de l'édit de création, des divers réglements faits par
| 69 |
ni en 1788 ni en 1789, et l'année 1790 vit inaugurer le régime des directoires de départements et de districts. L'Assemblée provinciale ne vécut donc, en réalité, qu'un an. Son zèle avait été grand, et c'est la faute des événements si son œuvre fut à peu près stérile. Il n'en est pas moins vrai que de l'institution de 1787 est sorti le principe de la représentation départementale encore aujourd'hui en vigueur dans ses trois degrés: conseil général, conseils d'arrondissement, conseils municipaux. On a vu que l'Assemblée provinciale avait divisé la Généralité en douze départements, dont deux pour l'Election de Paris: le département de Saint-Germain, et le département de Corbeil. Les historiens de ces deux villes ont également ignoré le fait : ils pourront désormais, en le consignant dans leurs annales, l'ajouter légitimement au chapitre des gloires locales. Dans cet ordre d'idées, les compétitions entre villes ont toujours été très ardentes: Sceaux, Bourg-la-Reine, Choisy-le-Roi se sont âprement disputé le privilège d'être chef-lieu de district, puis d'arrondissement; les. communes d'Auteuil, de Batignolles, de Belleville, de Vaugirard postulèrent maintes fois la faveur d'avoir le cheflieu de canton; celles d'Ivry et d'Aubervilliers ne l'ont obtenue qu'après cent ans de réclamations. A dire le vrai, l'importance attribuée à un chef-lieu de département n'était pas, en 1787, ce qu'elle est devenue depuis. La chose était nouvelle, indécise encore, le mot ne l'était pas moins. Il avait deux significations: celle de territoire et celle de répartition, que le hasard a rapprochées dans le texte imprimé d'un arrêt du Conseil d'Etat, du 8 août 1788, relatif à la répartition de la taille (1). Il y est prescrit de dresser les projets de répartition « entre les départemens formant la division de la province », et ensuite mission est donnée aux bureaux intermédiaires de procéder au département (le mot est ainsi en italiques) des sommes constituant l'impôt. Nous en venons maintenant à l'exposé des quelques renseignesa Majesté, du procès-verbal de l'Assemblée préliminaire, etc. A Sens, chez la veuve Tarbé et fils; à Paris, chez Née de la Rochelle et chez Gattey. 1788, in-4°; 2 ff. de titre et LXXXIV-452 pp. plus 7 ff. non chiff. pour la table. Le 1er décembre 1787, « les députés composant la Commission intermédiaire de l'Isle de France » avaient écrit à Necker pour l'informer qu'ils allaient rédiger « le précis des délibérations prises par l'Assemblée provinciale de l'Isle de France tenue au mois de novem bre» (Arch. nat., H. 1602). (1) Archives nat., H. 1601.
| 70 |
ments que nous avons retrouvés sur les deux départements de Saint-Germain et de Corbeil, dans lesquels le département actuel de la Seine allait être, peu après, tout entier compris, Paris ayant d'ores et déjà une administration spéciale. DÉPARTEMENT DE SAINT-GERMAIN. - Ce que l'on nommait, il y a cent ans, le « Château neur » de Saint-Germain était un corps de bâtiment assez considérable, ajouté par Henri IV à ceux qui dataient de François Ier; ils surplombaient à pic la vallée de la Seine. Cette construction a aujourd'hui disparu, sauf le pavillon d'angle de la terrasse. Elle fut mise par le Roi à la disposition de l'Assemblée du département, qui s'y réunit pour la première fois le 28 octobre 1787 (1). Les tableaux qui terminent le Procès-verbal de l'Assemblée provinciale donnent ainsi qu'il suit la composition de l'Assemblée : Ier DÉPARTEMENT Saint-Germain. Président M. l'abbé de Montagu. CLERGÉ M. l'abbé Lucas. NOBLESSE M. le chevalier de Menilglaise. M. le curé du Pecq. M. le prieur de Marly. M. le curé de Saint-Brice. M. le curé de Courbevoye. M. le marquis de Lévi. M. le vicomte de Boisse. M. le comte de Belsunce. M. le chevalier de Forget. M. le vicomte de Caraman. MEMBRES DU TIERS-ÉTAT. M. Antoine. M. de Boislandry. M. Petit. M. Charlemagne. M. Chevalier. M. Arnoud. M. Moreau. M. Chanorier. M. de Margency. M. du Vivier. M. Berchett. M. Goupy. BUREAU INTERMÉDIAIRE. M. l'abbé de Montagu, président. M. Choffier, prieur et curé du Pecq. M. Antoine, chevalier de Saint-Louis. (1) Les indications qui vont être données dans ce chapitre proviennent toutes, sauf mention différente, d'une liasse des Archives de Seine-et-Oise, cotée C, 327.
| 71 |
M. Boislandry, de Versailles. M. Petit, de Saint-Germain. SYNDICS: M. Melon, prieur et curé de Saint-Germain. M. le Tuillier, procureur du Roi à Saint-Germain. GREFFIER: M. Duval. Cependant, plus de quinze jours avant cette tenue, la Commission intermédiaire du département siégeait déjà. Elle s'était réunie pour la première fois le 13 octobre, et était ainsi composée: Clergé : M. l'abbé Lucas, chanoine de l'Église de Paris; M. Melon, prieur de Saint-Germain. Noblesse M. le chevalier de Menilglaise; M. le marquis de Lévi; M. le vicomte de Caraman fils. Tiers-État: MM. Antoine, maire de Saint-Germain; Petit, maître de la poste à Saint-Germain; Boislandry, négociant à Versailles; Charlemagne, de Drancy. Son rôle était de préparer les questions administratives à soumettre à l'Assemblée générale. Elle s'en occupa avec zèle. Conformément à une décision de l'Assemblée provinciale, le département devait être divisé en six arrondissements. Ils furent constitués de la façon suivante: Saint-Germain. - Saint-Denis. Versailles. Gonesse. - Enghien (1). Argenteuil. - - ― Ayant pris cette décision, la Commission désigna aussitôt ceux de ses membres qui représenteraient les intérêts de chaque arrondissement: un seul nom est à relever pour la banlieue parisienne: celui de M. Charlemagne, de Drancy, arrondissement de SaintDenis. Au cours des séances suivantes, qui furent tenues jusqu'au 25 octobre, on arrêta le budget des dépenses qu'exigerait la nouvelle forme d'administration: Deux procureurs syndics, à 1200 livres chacun. 2.400 liv. Quatre membres de la Commission intermédiaire, à 800 livres chacun Un greffier. 3.200 · 2.400 120 Un concierge La garde des invalides, pendant la durée de la grande assemblée • (1) C'est le nom que portait alors Montmorency, 60 8.180 liv.
| 72 |
De plus, 5.600 livres furent prévues pour dépenses diverses, telles que frais de mobilier, de bureau, de correspondance, et de lumière; indemnité de logement pour les membres étrangers pendant la durée de la grande assemblée (1200 livres, de ce chef). Au total, 13.780 livres de dépenses annuelles. Donc, «la grande assemblée » tint sa première séance le 28 octobre. Seules, les questions de cérémonial furent traitées, il ne paraît même pas qu'on ait songé à y ratifier les travaux préliminaires de la Commission intermédiaire. De fréquentes séances eurent lieu ensuite, du 19 janvier au 1er mars 1788, mais uniquement consacrées à des discussions d'ordre général, sur l'agriculture, l'industrie, le paupérisme. De nouveau, l'Assemblée du département siégea au Château neuf, du 14 au 24 octobre 1788. Elle eut, cette fois, à régler des affaires locales, dont bien peu concernaient le futur département de la Seine. Dans son procès-verbal de 100 pages, petit in-fol., nous ne trouvons, en effet, que l'adjudication, au prix de 2,200 livres, à Joseph Saigne, entrepreneur de travaux, de la réfection de la traverse de Montreuil, et le vote d'un crédit de 318 livres, d'une part, pour la mise en état de la fontaine publique de Vincennes, et de 2,580 livres, d'autre part, pour la réparation du chemin de Rosny à Villemomble (séance du 21 octobre). Les membres de l'Assemblée se répartirent en trois bureaux (nous dirions aujourd'hui commissions): 1° bureau des impositions; 2º bureau du bien public, réglements, comptabilité, etc., comprenant aussi la distribution des grains d'hyver, travaux de charité et autres secours accordés aux paroisses grêlées; 3º bureau des travaux publics. » Elle fixa de la façon suivante le traitement des greffiers de municipalité (nos secrétaires de mairie d'aujourd'hui): Pour les paroisses de 50 feux et au delà • 30 liv. 80 100 200 300 · I 20 150 Un de ses principaux soucis fut aussi de simplifier l'échange des correspondances entre elle et les municipalités, « sans avoir recours au régime dispendieux des postes ». A cet effet, un premier tableau
| 73 |
fut dressé du nombre des municipalités dépendant de chaque arrondissement. Le voici : Saint-Germain Versailles Argenteuil • Enghien. Saint-Denis. Gonesse Soit. 40 municipalités. 38 35 34 35 37 219 Puis, ces municipalités furent réparties en chefs-lieux de dépôts et dépendances qui, sauf quelques exceptions, correspondaient aux arrondissements administratifs. Nous ne citerons ici que les municipalités appartenant au département de la Seine : 1er dépôt Saint-Germain, Courbevoie, Nanterre (quoique dépendant toutes deux de l'arrondissement d'Argenteuil). 2º dépôt : Versailles (chef-lieu), Clamart. Dépendance, Chevreuse : Néant. 3º dépôt: Argenteuil (chef-lieu), Asnières, Colombes, Gennevilliers. Dépendance, Franconville : Néant. 4º dépôt: Enghien. Néant. 5º dépôt : Saint-Denis (chef-lieu), Aubervilliers, Clichy-la-Garenne, Epinay-Saint-Denis, La Chapelle-Saint-Denis, La Courneuve, La Villette, L'Ile Saint-Denis, Montmartre, Stains, Saint-Denis, SaintOuen, Villetaneuse (bien que dépendant de l'arrondissement d'Enghien), Villiers-la-Garenne [Neuilly]. Ire dépendance: Drancy. Belleville, Bobigny, Bondy, Drancy, Le Bourget, Le Pré-Saint-Gervais, Pantin. 2º dépendance: Montreuil. Bagnolet, Charonne, Fontenay-sousBois, Montreuil-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, Noisy-le-Sec, Romainville, Rosny-sous-Vincennes, Villemomble, Vincennes. 3º dépendance: Luzarches: Néant. 6e dépôt Gonesse, Dugny. C'est évidemment par un oubli des scribes que la municipalité de Pierrefitte ne figure pas dans ce tableau; il est certain qu'elle dépendait de l'arrondissement de Saint-Denis. On arrive ainsi à un total de 38 municipalités, dont 33 font aujourd'hui partie de l'arrondissement de Saint-Denis et 5 de celui
| 74 |
de Sceaux: Clamart, Montreuil, Fontenay-sous-Bois, Nogent-surMarne et Vincennes. Enfin, les instructions suivantes furent rédigées: MOYENS DE CORRESPONDANCE 1º Le dépôt de Saint-Germain se pourvoyera d'un ou de deux commission naires qui se rendront une fois par semaine avec les paquets adressés aux différentes mnnicipalités dans les dépôts suivants: Argenteuil, Enghien, SaintDenis, Gonesse, Versailles. 2º Chacune des personnes chez qui le dépôt sera établi se chargera de faire parvenir immédiatement le paquet au dépôt des dépendances. 3º Chaque municipalité sera prévenue d'envoyer à un jour fixe par semaine au dépôt principal ou à celui de sa dépendance les paquets qu'elle aurait à faire parvenir au département, et, dans le cas même où elle n'aurait aucun paquet à y faire passer, elle sera tenue à y envoyer un exprès pour se charger au retour des paquets qui pourraient être adressés à ces mêmes municipalités. 4º Il sera annuellement alloué au commissionnaire du département une somme de 250 à 300 livres. 5º Les municipalités éviteront, autant qu'il sera possible, toute dépense inutile de correspondance; mais dans le cas de frais extraordinaires dont elles justifieront, il leur sera tenu compte (Séance du 22 octobre 1788). Ce fut là, ou à peu près, le dernier acte administratif de l'Assemblée du département de Saint-Germain. Sa Commission intermédiaire continua de fonctionner, avec une régularité toujours décroissante, jusqu'au milieu de l'année 1790, mais il ne fut pas tenu de réunion générale en 1789. DÉPARTEMENT DE CORBEIL Moins riche encore est le fonds des documents attestant l'existence, il y a cent dix ans, d'un département de Corbeil. Voici d'abord, d'après le Procès-verbal de l'Assemblée générale, la liste des membres qui, en 1787, composaient l'Assemblée départementale : CLERGÉ II DÉPARTEMENT Corbeil Président M. le bailli de Crussol. M. l'abbé de Saint-Farre. M. l'abbé de Bouville. M. l'abbé du Malaret. M. l'abbé Seguin de Montrosier, NOBLESSE M. le marquis du Luc. M. le cte de Clermont-Tonnerre. M. le marquis de Champigny. M. le marquis de Bullion.
| 75 |
115 M. l'abbé Paillard. M. l'abbé de l'Épinay. M. Petit de la Motte. M. Leduc. M. Vattier. M. Hedelin. M. Suzanne. M. Lebrun. M. de Brou. MEMBRES DU TIERS-ÉTAT M. Lamoureux. M. Petit. M. Mauduisson de Valmont. M. Maupassant. M. Le Caron de Beauménil. M. Dumont. BUREAU INTERMÉDIAIRE M. le bailli de Crussol, président. M. l'abbé de Saint-Farre. M. le comte de Clermont-Tonnerre. M. Leduc, à Paris. M. Lebrun, à Paris. SYNDICS M. d'Ormesson de Noizeau. M. Ginoux. GREFFIER: M. Aubert. ― Il ne paraît pas, du moins les pièces manquent pour l'établir, que cette Assemblée ait fait preuve de plus d'activité que celle de Saint-Germain. On sait, par le Procès-verbal de l'Assemblée provinciale, qu'elle se réunit à Paris en 1787, et, par une brochure (conservée aux Archives de Corbeil) qui donne la liste de ses membres, qu'elle eut, de même, une session à Paris en 1788. Son siège était rue Boucherat, nº 12 (aujourd'hui partie de la rue de Turenne), c'est-à-dire très près de l'Intendance de Paris, sous l'égide de laquelle elle semble avoir voulu se placer. C'est là aussi que le Bureau intermédiaire du département exerça son ministère administratif. Il avait du papier à en-tête (1); il fit imprimer en 1788 une Instruction pour les municipalités: sur la composition des municipalités et la tenue de leurs Assemblées (2) : c'est là tout ce que l'on connaît de son œuvre. Comme celui de Saint-Germain, le département de Corbeil était divisé en six arrondissements: Corbeil, Montlhéry, Longjumeau, Bourg-la-Reine, Lagny et Brie-Comte-Robert. Un précieux dossier (1) Il en existe un spécimen dans la liasse C, 23 des archives de Seine-et-Oise. (2) « De l'imprimerie de la veuve Delaguette, rue de la Vieille-Draperie, près le Palais » ; 8 pp. pet. in fol. (Archives de la Seine, dép. C¹)·
| 76 |
des archives de la ville de Corbeil (1) permet de reconnaître comment y furent réparties les municipalités qui allaient, peu après, appartenir au département de Paris : c'est l'état statistique, par arrondissement, sur formules imprimées et sous forme de tableaux, des ressources et des charges financières de chaque municipalité en 1789: Arrondissement de Corbeil: 36 paroisses. Aucune n'est passée dans le département de la Seine. Arrondissement de Montlhéry: 35 paroisses. Même observation. Arrondissement de Longjumeau: 36 paroisses, dont Antony. Châtenay. Fresnes-lès-Rungis. Chevilly et L'Hay. Plessis-Raoul (aujourd'hui le Plessis-Piquet). ― - ― - - Le Arrondissement de Bourg-la-Reine 34 paroisses, dont Arcueil. - Auteuil. Bagneux. - Boulogne. - Champigny. Charenton. –Charenton Saint-Maurice (aujourd'hui Saint-Maurice). Châtillon. Choisy-le-Roi. · Créteil. - ― - ― ― Fontenay-lès-Bagneux. — Gentilly. Issy. Ivry. La Branche du pont de Saint-Maur (aujourd'hui Joinville-le-Pont). La Varenne-Saint-Maur. Le Bourg-la-Reine. Maisons-près-Charenton. - Montrouge. Orly. Passy. Puteaux. Sceaux-Penthièvre. Suresnes. Saint-Maur. Vitry. — - Thiais. Vanves. ― Vaugirard. - Villejuif. Arrondissement de Lagny: 46 paroisses, dont Bry-sur-Marne. Arrondissement de Brie-Comte-Robert 40 paroisses, dont Bonneuil-sur-Marne. Le département de Corbeil comptait donc 227 paroisses. Dans ce nombre, 38 dépendent maintenant du département de la Seine. Il y a lieu de remarquer que Chevilly et L'Hay (arrondissement de Longjumeau), forment, depuis 1793, deux communes distinctes, et qu'en revanche, La Varenne-Saint-Maur et Saint-Maur, indiquées comme paroisses distinctes de l'arrondissement de Bourg-la-Reine, ne constituent maintenant qu'une seule commune; qu'enfin, sur les 34 paroisses qui composaient l'arrondissement de Bourg-laReine, 30 sont passées au département de la Seine, et 4 seulement à celui de Seine-et-Oise : Garches, Rueil, Saint-Cloud et Villeneuvele-Roi. (1) Nous en devons la connaissance à notre regretté confrère Robert Goubaux, qui avait été chargé d'inventorier ce dépôt.
| 77 |
DÉCHÉANCE DU RÉGIME ADMINISTRATIF DE 1787. La suppression des Généralités, la division de la France en départements uniformes, de dix-huit lieues carrées, la substitution de Directoires de départements et de districts aux assemblées de provinces et de départements, toutes ces mesures ordonnées par l'Assemblée Nationale à la fin de décembre 1789 et au commencement de 1790, avaient fatalement pour corollaire la disparition de l'institution imaginée par les ministres de Louis XVI. La Commission intermédiaire de la province d'Ile-de-France conserva cependant, quelque temps encore, ses fonctions et ses archives dans le local de l'Intendance, où elle siégeait. Le Directoire du Département « de la Seine et de l'Oise » ayant tenu sa première assemblée le 9 juillet 1790, c'est à lui, à Versailles, qu'elle fit l'envoi de ses papiers. Il y a dans le premier registre des délibérations de cette Assemblée de fréquentes mentions de ces envois (1). L'ancien département de Saint-Germain en fit autant; en voici une preuve : « Après la réception d'une voiture de papiers venant de Saint-Germain, de l'envoi de M. Vaillant, l'un des délégués du Directoire pour le recouvrement des papiers de l'ancienne administration, et la remise d'une décharge au cavalier de la maréchaussée qui avait escorté ladite voiture, la séance a été levée » (Séance du Directoire, du 7 août 1790) (2). De plus, la Commission intermédiaire de la province, voulant liquider correctement sa gestion financière, en fit imprimer un Compte rendu à Messieurs les administrateurs du département, le 1er septembre 1790 (Paris, imp. royale, 1791, in-4º, 34 PP.). Enfin, au mois de mars 1791, comme certaines municipalités, ignorantes encore de la nouvelle organisation administrative, s'adressaient toujours à elle, la Commission leur envoya la circulaire suivante, également imprimée (3): Paris, le mars 1791. Nous avons l'honneur de vous prévenir, Messieurs, que nos fonctions administratives ont absolument cessé, et que vous devez dorénavant vous adresser au (1) Archives de Seine-et-Oise L. 14, fol. 1 à 40, passim. (2) Ibid. fol. 45 v (3) Bibl. Nat. LK15 32.
| 78 |
Directoire du district de….. pour toutes les affaires qui pourront intéresser l'administration de votre paroisse. La nouvelle organisation du département de Paris vous donne, messieurs, des Administrateurs qui méritent toute votre confiance, et qui s'empresseront, sans doute, de seconder votre zèle et vos bonnes intentions. Cette opinion diminue nos regrets de n'avoir pu faire tout le bien que nous aurions désiré, et nous donne l'espoir que, plus heureux que nous, ils auront des occasions et plus de moyens de vous être utiles. Nous avons l'honneur d'être, Messieurs, vos très humbles et très obéissans serviteurs. LES DÉPUTÉS Composant la Commission intermédiaire de l'Isle-deFrance. MM. composant la municipalité de……….. Ici, la courtoisie du ton ne réussit pas à cacher la mauvaise humeur, l'ironie même. Faut-il en être surpris? Que d'événements depuis quatre ans, depuis cette première réunion à Melun de l'Assemblée provinciale, composée par le Roi! Que d'hommes nouveaux au pouvoir! Ceux qui en descendaient pouvaient-ils ne pas en montrer quelque amertume? De ce court billet, d'allure simplement administrative, une impression se dégage, nette, solennelle : c'est le faire-part du décès de l'ancien régime à la nouvelle France. FERNAND BOURNON.
| 79 |
HISTOIRE D'UN VILLAGE SOISY-SOUS-ETIOLLES (Seine-et-Oise)
INTRODUCTION
L'histoire de certaines localités est parfois très facile à faire ; les documents précis et variés ont été conservés avec un soin jaloux; ils ont échappé à l'injure du temps ainsi qu'aux révolutions de tout genre. Le narrateur alors n'a que l'embarras du choix pour mettre sous les yeux des contemporains les récits des temps passés, les hauts faits des grands personnages, les traditions variées des coutumes du pays. Mais souvent aussi les origines demeurent mystérieuses, les vieux parchemins ont été égarés, les ruines se sont amoncelées au temps des guerres qui ont fait tout disparaître par le fer et par le feu. Il ne reste à l'historien que des notes imparfaites ou tronquées, des listes inachevées qui lui fournissent des éléments insuffisants et ingrats. C'est ce qui semble se produire pour le village de Soisy-sousEtiolles; c'est probablement la raison pour laquelle, malgré sa renommée, il n'a pas eu son histoire. L'Abbé Lebeuf, dans son ouvrage sur le diocèse de Paris (1), lui a cependant consacré quelques pages. Il y a plusieurs années, un amateur passionné de l'art et des souvenirs d'autrefois, M. Jolly (2), avait entrepris de compléter (1) Histoire du diocèse de Paris: T. XIII, p. 107 et suiv. (2) M. A. Jolly a été maire de Soisy-sous-Etiolles de 1849 au 18 déc. 1853. Il est mort le 2 avril 1869, à l'âge de 72 ans et n'a survécu que d'un an à son père Louis-CharlesAlexandre, originaire de Viguory (Haute-Marne), médaillé de Sainte-Hélène, mort à 96 ans. Son manuscrit est en la possession de son petit-fils, M. G. Allain, actuellement maire de Soisy-sous-Etiolles. 8
| 80 |
cette notice trop courte ; mais son travail est resté manuscrit. Les détails de surérogation dont il l'avait surchargé en rendaient d'ailleurs l'impression bien difficile sinon impossible. On y trouve toutefois des notes précieuses qui peuvent être d'une grande utilité et d'un profit véritable. A mon arrivée dans la paroisse, j'eus le désir de connaître son histoire, j'interrogeai les vieillards; je consultai les archives communales, les vieux registres paroissiaux (1), je pris des notes. Malgré les lacunes nombreuses et les imperfections de toute sorte, je rédigeai cette monographie, et je voudrais espérer que ce travail ne sera pas sans intérêt; ne servirait-il qu'à aider de plus heureux à faire une œuvre meilleure, que je me déclarerais satisfait. Les habitants de Soisy y trouveront des souvenirs d'autrefois, ils apprendront avec plaisir ce qui se passait du temps de leurs aïeux, ce qu'était leur village aux époques reculées, quelle était sa réputation et ils tiendront à honneur de s'en montrer toujours dignes. CHAPITRE PREMIER GÉNÉRALITÉS. Près de la ville de Corbeil, assis sur un gracieux coteau, adossé à la forêt de Sénart, séparé de la Seine (2) par de superbes avenues, se trouve le village de Soisy-sous-Etiolles, appelé jusqu'au XVIIIe siècle, Soisy-sur-Seine. Son origine ne paraît pas être très ancienne; la première notion que l'on en trouve remonte toutefois au Xe siècle. C'est à l'époque où Alran, fils de Bouchard Ier, comte de Corbeil, voulut rentrer dans les biens que son père avait légués à l'abbaye de St-Maur des Fossés (3). L'abbé Lebeuf dit bien que le nom de Soisy, en latin Soisiacum, doit venir du nom d'un général romain, Sosius, mais il n'apporte pas de preuve bien sérieuse à son assertion. (1) La collection remonte à 1596 et se continue sans interruption jusqu'à la Révolution. (2) Son aspect est au couchant. Les cartes géographiques marquent un port au bas de Soisy et la Grange-de-Soisy à l'opposite, le village entre deux. (Lebeuf, Hist. du diocèse de Paris, t. XIII, p. 108). (3) Id. p. 109.
| 81 |
Ce nom, d'ailleurs, est commun à plusieurs localités : Soisy-surEcole, près de Milly, où les chanoines de St-Spire avaient des propriétés ; Soisy-sous-Montmorency, tout à côté de la ville qui porte ce nom. Souvent les anciens appelaient ce village Choisy, ce qui pouvait amener quelque confusion avec Choisy-le-Roy qui n'en est pas éloigné, ou bien Choisy-aux-Bœufs près de Versailles. Cette appellation est d'ailleurs ancienne, car on lit dans le dénombrement de la Prévôté de Paris, rédigé vers 1350: « Madame de Couldray tient un fief séant au port de Choisy-sur-Saine (1) ». Les documents précis, relatifs à son histoire, sont d'autant plus difficiles à trouver, que la nomination à la cure en était dévolue, depuis le XIIe siècle, à une collégiale du diocèse de Senlis, St-Frambourg (2). Cette donation ne viendrait-elle pas de quelque famille de Chambly, ou de Pont-Ste-Maxence, ayant habité cette région ? Les archives de la ville de Beauvais (3) possèdent un titre sur parchemin, daté de 1257, contenant une autorisation temporaire et révocable, accordée à Nicolas de Soisy, écuyer et à Agnès de Pont, sa femme, par l'Abbé de St-Symphorien et par le premier curé de Pont-Ste-Maxence, de faire célébrer l'office divin dans la chapelle de leur château de Pont-Ste-Maxence. On trouve bien encore Jacqueline de Soisy, mariée en 1309 à Guy le Bouteillier de Senlis, seigneur d'Ermenonville et de Draveil. A qui avait succédé Gilles Malet dans la seigneurie de Soisy ? De qui tenait-il le titre de chastelain de Pont-Ste-Maxence? Seraitce par sa femme Nicole de Chambly? Autant de questions, dont les réponses nous aideraient à pénétrer ce mystère. Quoique nous puissions relever dans les anciens documents, voire ceux du XIe siècle (4), les noms de plusieurs personnages se faisant (1) Arch. nat. P. 127. Chambre des comptes, aveux et dénombrement. (2) C'est ce qui a donné naissance, sans doute, à la rue des Frambourgeois, que l'on a écrit par inadvertance Francs-Bourgeois. Il y avait à Ivry une chapelle du titre de S. Frambourg, abbé du Maine au VIe siècle, qui serait mort le 15 août. On y conservait le souvenir d'une grotte, où le saint se reposait, ainsi que d'une citerne dont l'eau avait la vertu de guérir (Lebeuf, XII, p. 188). (3) Beauvais, série H, 1707. Il y est aussi fait mention d'une donation semblable faite en 1407, par Gilles Malet, à l'église de Pont. (4) Lebeuf, XIII, p. 110 et suiv,
| 82 |
appeler de Soisy, Gilles Malet se trouve être le premier Seigneur dont l'histoire nous donne quelques détails. Il possédait déjà cette terre en 1385 et le fief qui établissait ses droits était dénommé le Jardin, dépendant en partie du Seigneur de Périgny (1), et pour le reste, du Seigneur de Mons (2). Soisy resta dans sa famille jusqu'en 1480, époque à laquelle Louise Malet, femme de Gilles d'Agincourt, vendit cette Seigneurie à Olivier le Daim. A la mort de ce dernier, cette propriété ¡dut passer au Chapitre de Notre-Dame de Paris; nous trouvons en effet un Évêque, puis un Abbé, portant le titre de Seigneur de Soisy. A cette époque, plusieurs maisons furent possédées par des ecclésiastiques. Dans le cours du XVIIe siècle, avec l'illustre famille de Bailleul, qui y demeura jusqu'en 1737, vinrent se fixer dans ce pays des conseillers au Parlement de Paris. Sous l'Empire, plusieurs généraux et maréchaux choisirent, pour se reposer de leurs fatigues et jouir de l'éclat de leurs lauriers, les ombrages des avenues séculaires de Soisy. De nos jours, les propriétés les plus importantes sont habitées par d'excellentes familles de magistrats, d'avoués, d'industriels. Par suite du morcellement du parc du château, en 1876, le pays s'est étendu; de larges avenues, de belles rues ont été ouvertes. Une partie importante du village salue avec bonheur les rayons du soleil que les terrasses et les cimes des arbres interceptaient autrefois, au grand regret des anciens. La mairie et l'école des garçons, installées depuis la révolution dans une partie des biens de la Cure, furent transportées alors au centre du village dans de belles constructions. Monsieur A. de Vandeul, dont la générosité est si connue, était alors maire de Soisy; par ses soins et sous sa direction, l'Église fut agrandie, restaurée et entourée d'un joli jardin. Les Religieuses de la Providence de Portieux, après cinquante années de dévouement consacrées à la direction des classes communales, eurent la joie de voir revenir à l'asile et dans les écoles libres leurs élèves, à l'exception d'un tout petit nombre. Le bureau des postes et télégraphes rend de grands services aux (1) Commune du canton de Boissy-S-Léger. (2) Dépendance d'Athis-Mons, près d'Ablon.
| 83 |
habitants du pays; on vient depuis peu d'y adjoindre une cabine téléphonique publique. Soisy-sous-Etiolles, autrefois seigneurie, devint sous Olivier le Daim une châtellenie avec droit de haute, moyenne et basse justice; il dépendait de l'Ile-de-France et touchait à la Brie. Depuis la révolution française, il fait partie du département de Seine-etOise; il a Corbeil pour chef-lieu de canton et d'arrondissement. Pour les affaires ecclésiastiques, il était soumis autrefois à l'Archevêque de Paris; depuis le Concordat de 1801, il dépend de l'évêché de Versailles. Le dernier recensement (1) porte le chiffre de la population à 1537 habitants. CHAPITRE II L'ÉGLISE, JUSQU'AU CONCORDAT DE 1801. La Sainte Vierge est patronne (2) de l'église de cette paroisse. « C'est un bâtiment assez moderne, la nef principalement, laquelle « a été rebâtie dans ce siècle-ci, avec une chapelle à droite du « chœur, au-dessus de laquelle on a pratiqué un dôme. Le vaisseau « est petit et proportionné au village. Quelques-uns de MM. de « Bailleul, présidents à mortier et seigneurs du lieu y ont été inhu- « més » (3). « Les deux travées du chœur de l'Église datent de la moitié du « XIII. siècle, le surplus a été reconstruit à une époque avancée du « XVII siècle. Le tout ne forme qu'un édifice de la plus modeste « apparence » (4). « La cuve baptismale est entourée d'une superbe balustrade (5) « en bois, toute sculptée de fleurs de lys et de dauphins, semblable « à celles qui environnaient les lits de parade dans les résidences «< royales » (6). (1) En 1896. (2) La fête patronale se célèbre le jour de l'Assomption. (3) Abbé Lebeuf, Histoire du diocèse de Paris, t. XIII, p. 108. (4) Inscriptions de la France, IV vol. p. 206. (5) Id. p. 210. (6) Elle sert depuis 1878 de balustrade à la tribune.
| 84 |
« A l'extérieur, au pourtour de l'entablement, des têtes de chi- « mères, alternent avec des têtes grotesques sculptées, au nombre « de six, sur le devant; sur le côté (1) de l'Église, qui est séparée du « château par une ruelle, il y a aussi sous l'entablement des têtes « semblables » (2)… « Il n'existe plus aux fenêtres qu'un seul vitrail peint, encore « n'est-ce qu'un fragment. Il représente l'Abbé Rousseau, vêtu d'un « rochet à la forme romaine, offrant à la Sainte Vierge le dessin « d'une Église. Il est à genoux, soutenu par St François de Paule, « son patron. On y lit cette inscription: « Messire François Rousseau, chanoine de St-Spire, curé de Sois.. « [depuis] l'année 1596, a donné cette vitre l'année 1643, et décédé «« le… ». La date semble n'avoir jamais été inscrite; l'Abbé Rousseau est mort à Soisy; il a été inhumé dans l'Église le 15 octobre 1653 comme il appert des registres de la paroisse (3). «< Il existe encore plusieurs tombes dans le choeur de l'Église, « mais elles sont bien effacées (4). On remarque celle de Mre Louis « Dubois, aumônier du roi, inhumé en 1662 et celle de Mre Joa- « chim Ménessier, ancien curé de Soisy, décédé le 16 Juillet «< 1727 ». L'Abbé Lebeuf (5) avait lu sur une tombe de marbre : Cy gist Claude Belot, Abbé d'Evron, chanoine de Paris, seigneur de Soisysur-Seine, mort le 24 décembre 1619; ce qui se rapporte exactement avec les registres paroissiaux. Le même historien avait de plus remarqué dans l'Église une plaque de cuivre, perdue depuis, mais dont il a heureusement relevé l'inscription qu'il cite ainsi : « Le prieur de l'Hermitage de Sénart est tenu de célébrer chaque « semaine deux messes en l'Église de céans, à l'autel de St Michel… et « la veille de St Michel, les Vêpres, et le jour la Messe, pour l'âme (1) Celui qui regarde le nord. (2) Hist. ms. de Soisy par M. Jolly, p. 320 et suiv. Ces têtes ont été placées lors des derniers travaux, à côté du portail, au nouveau bas-côté (Note de l'auteur). (3) Il a donc été 57 ans curé de cette paroisse. (4) Inscriptions de la France, IV, p. 211: «<3 dalles en pierre bleue étaient placées au pied des degrés du maître-autel; l'une complètement oblitérée, celle du milieu, portant l'épitaphe en français de Claude Belot, seigneur de Soisy, aumônier du Roy, abbé de Notre-Dame d'Evron (diocèse de Laval) et de Fontenelle (diocèse de Luçon), chanoine de Notre-Dame de Paris (Disparue ainsi que les autres) ». (5) Id., 108.
| 85 |
« de Gilles Malet, chevalier, maître-d'Hôtel du roi, seigneur de « Villepescle et Soisy et Dame Nicole de Chambly sa femme. 1411 ». Ces souvenirs des temps passés n'ont pas laissé d'autre trace; plus heureux a été le sort de la tombe de M. le président de Bailleul, dont il sera question plus loin. Mais ce qui est plus extraordinaire, presque providentiel, c'est la conservation des pierres représentant le Seigneur de Soisy et sa famille au XIVe siècle. Véritables trésors historiques et archéologiques, elles échappèrent longtemps à la sagacité des chercheurs et des savants; la description en sera lue avec intérêt. La première, la plus importante, nous montre Gilles Malet et sa femme; elle fut retrouvée en juin 1853, dans l'Église même, quand on voulut en refaire le dallage (1). Elle mesure 1m95 de longueur et om65 de hauteur. En procédant à l'enlèvement des dalles du chœur, on rencontra, publie le narrateur, une dalle remarquable par ses proportions. A peine avait-elle été retournée qu'on remarqua comme un bas-relief sculpté avec des vestiges de bleu d'azur et de rouge. Malheureusement elle était percée de deux trous énormes, faits probablement pour recevoir les pieds d'un banc, par des ouvriers ignorant la valeur de ce souvenir. Bientôt, après l'avoir un peu nettoyée, on put lire cette inscription, en lettres gothiques, en tête et sur le côté droit de la bordure: Monseignieur Giles Malet, chevalier, Seignieur de Villepescle, Conseiller et Maistre dostel du roy. Chastellain de pont Sainte Maxence. Visconte de Corbeil et Seignieur de Soisy. Madame Nicole de Chambly sa feme. « Au centre du tableau, on voit le Christ en croix ; il porte le nimbe crucifère. « Deux anges, agenouillés sur des nuages, reçoivent dans des coupes le sang pré- «< cieux, qui s'échappe de ses mains; ses pieds sont croisés et fixés par un même «< clou. L'image du soleil et de la lune est tracée au-dessus du croisillon de « l'arbre du salut. A la droite du rédempteur, se trouve Marie, sa mère; à la « gauche St Jean, son fidèle disciple. Derrière la Ste Vierge, Malet, agenouillé, « est soutenu par St Gilles, son patron. Son armure est timbrée de ses armes ; il « porte l'épée et le poignard en gaîne. « Du côté opposé, Nicole, sa femme, dans la même attitude, a, derrière elle, « St Nicolas, son patron. La chasuble et la crosse de l'Évêque de Myre sont «< d'une forme remarquable. La Sainte Vierge et les Saints que nous venons de (1) Magasin pittoresque, XXIX année, p. 171, avec gravure, et Revue archéologique, XIII année, p. 503.
| 86 |
« nommer sont décorés du nimbe. Le costume militaire de Malet, son épée, ses « éperons, sa ceinture; l'ajustement de Nicole, dont la tête est ceinte d'un dia- « dème, sont deux curieux exemples de costumes du XVe siècle. Derrière les « patrons des nobles personnages, deux anges portent l'écu de leurs armes; elles « sont d'or à trois fasces de gueules, au franc canton. De même pour la dame. « Les fasces sont timbrées d'hermines et d'une coquille, en tête de la première, « pour le mari ; et pour Nicole, de coquilles trois et deux .. L'armet ou casque « grillé, manque en chef de l'écu de Malet; déjà, à cette époque, certains gen- « tilshommes étaient dispensés d'aller à la guerre et d'y conduire leurs vassaux. « Le sol du tableau semble être un champ consacré à la sépulture; il est jon- «< ché de fleurs et d'ossements humains. Aussi, est-on singulièrement surpris de « trouver le fond du tableau, couvert d'une mosaïque, divisée par compartiments « symétriques, dont les ornements variés sont alternativement répétés. Les cou- « leurs bleu et rouge ont été employées dans cette décoration, aussi bien que « pour les vêtements des divers personnages. Saint Gilles porte une robe de « bure; la couleur brune a été répandue dessus ». Cette pierre, relevée et restaurée, fut alors placée à l'entrée de l'église, près des fonts baptismaux; en 1878, elle fut transportée, par les soins de M. de Vandeul, dans le bas-côté qu'il venait de faire construire. Les nouveaux fonts du baptême furent également déplacés, lors de ces derniers travaux. En 1894, à cet important souvenir est venu s'en adjoindre un autre, non moins précieux : c'est une pierre représentant les enfants de Gilles Malet, d'un travail identique à la première et de la même époque. Elle fut trouvée dans la propriété de Madame Gillotin, à Soisy, où elle servait de marche d'escalier, pour descendre au potager. Cette portion de terrain dépendait autrefois du fief de Gilles Malet appelé alors le Jardin, et plus tard, Gerville (1). Le Bulletin des travaux historiques, Archéologie, 1884, nº 2, en donne la description suivante : « C'est une pierre plate, portant gravée en creux par des traits d'une faible « profondeur, l'effigie de deux personnages agenouillés, l'un de profil, l'autre de « trois quarts, dont les noms sont inscrits sur la partie inférieure. On remarque « tout d'abord que le monument est incomplet. Un fragment notable manque à » droite, un personnage tout entier a disparu. En effet, l'inscription, bien qu'incomplète, elle aussi, annonce au moins trois figures. D'après la disposition de « celles qui subsistent, on peut conjecturer que la troisième, agenouillée comme <«<les deux autres et ayant la même attitude, se présentait de profil, tournée vers (< (1) Voir Bulletin de la Société, 1895, p. 40: Une page de l'histoire de Soisy-sous-Etiolles, par M. l'abbé Colas,
| 87 |
«< la gauche, faisant face à ses deux compagnons. Les deux priants sont encore «< dans la fleur de l'âge ; celui de gauche a quinze à dix-huit ans à peine; l'autre «< paraît un peu plus vieux. Tous deux portent le même costume: tête nue, les «< cheveux coupés droit sur le front, les bras et les jambes protégés par l'armure « en fer battu. La poitrine, défendue par une cotte de mailles qui ne paraît qu'au « cou et vers le haut des cuisses, est presque entièrement recouverte d'un pour- « point très collant avec de longues manches s'évasant au coude. Ce vêtement de « dessus est décoré des armoiries reproduites sur l'écu, qui surmonte la tête de chaque personnage. Le champ du fond est orné de compartiments carrés, gar- « nis de rosaces et d'ornements géométriques, terminés par des feuilles d'une « forme bien particulière. Le tout est gravé dans la pierre par le même procédé « que les figures. Une seule des trois inscriptions encore visibles est entière. Une « partie de celle de droite, nous l'avons déjà observé, a été enlevée par la fracture « de la dalle ; quant à celle de gauche, le frottement en a effacé quelques lettres ; « mais il est facile d'en reconstituer le texte. L'inscription centrale se lit : ” MESS' JEH MALET CHLR CHAMBLENC DU ROY Messire Jehan Malet, chevalier, chambellenc du roy. « Cette légende nous permet de rétablir l'inscription de gauche de la manière « suivante: Charles Malet, escuier. On ne distingue plus, il est vrai, que les «< lettres Arles … LET… IER, mais sur le nom et le prénom, pas de doute. « Les lettres … IER forment aussi bien la terminaison du mot chevalier, … que «< celle du mot escuier; or nous voyons par la seconde colonne que le graveur « abrège chevalier en chlr, tandis que dans la troisième, escuier est écrit en « toutes lettres, comme dans la première. Cette qualité d'ailleurs s'accorde avec «< l'âge du personnage, visiblement plus jeune que son voisin. … « La troisième colonne donne en quatre lignes les lettres suivantes: PHELIPP «< ESCUIER… DE BALE … PANNETIE … Le nom de famille fait défaut; « la lacune est grave. Mais y a-t-il trop de témérité à supposer qu'il s'agit d'un «< frère, d'un beau-frère ou d'un proche parent des précédents? La lecture suivante « paraît donc assez plausible: PHILIPPE [MALET] ESCUIER [SEIGNEUR] « DE BALE[NCOURT] ou DE BALE[NVILLIERS] PANETIER [DU ROY] ». Cette intéressante description est accompagnée de diverses appréciations ou notes qu'il n'est pas utile de rappeler ici. Il sera bon de faire remarquer toutefois la supposition qu'il existerait une troisième dalle sur laquelle auraient été représentées les filles ou brus du seigneur de Soisy, et qui aurait fait pendant à la pierre des fils de Gilles Malet. Le monument complet aurait ainsi présenté l'aspect d'une sorte de triptyque fixe, dont le troisième volet n'a pas encore été retrouvé. J'ajouterai que le vœu de l'auteur (1) de voir (1) M. Jules Guiffrey, Directeur de la manufacture des Gobelins,
| 88 |
cette pierre placée dans l'église, à côté de celle qui représente Gilles Malet, est actuellement accompli (1). Les lacunes de noms dont il est parlé n'ont pu, malgré toutes les recherches, être comblées. La terre de Soisy passa des descendants de Gilles Malet à Olivier le Daim en 1480. Gilles Malet était mort en 1410; Nicole de Chambly, sa veuve, mourut peu de temps après, et Jean et Charles Malet leurs fils ne leur survécurent pas longtemps. Dans cet espace de 70 ans, on ne voit apparaître aucune trace de nom se rapprochant de celui de Philippe. Le travail de ces pierres est très remarquable; le dessin des têtes en particulier annonce un artiste habile. On pourrait en dire autant d'un vitrail (2), que possédait l'abbaye de Bonport, près de Pont de l'Arche. Il représentait Gilles Malet et sa femme agenouillés, revêtus de costumes blasonnés. Le vitrail et la pierre de Soisy sont certainement de la même époque; il semblerait même que l'un a dû servir de modèle à l'autre. Un monument, plus moderne, il est vrai, mérite cependant une attention particulière. Il rappelle la famille de Bailleul, qui posséda la seigneurie et le château de Soisy, de 1625 environ à 1737. Il fut élevé à la mémoire de Nicolas de Bailleul, dont la mort survint en 1652, par sa veuve Elisabeth Malier, qui fit édifier, pour le recevoir, une chapelle du côté de l'Épître (3). On y construisit en même temps un caveau, où furent inhumés les restes de plusieurs membres de la famille. A l'orient s'élevait un autel, surmonté d'un rétable de valeur, entre les colonnes duquel fut placé un tableau représentant la mort du Christ (4). Parmi les personnages qui y figurent on remarque Marie-Madeleine, dont les traits et l'attitude excitent l'attention. Cela me porte à croire que le peintre, comme on le faisait souvent à cette époque, a voulu reproduire les traits de Madame de Bailleul. Au fond se trouvait le mausolée, surmonté d'une statue en marbre blanc, représentant le défunt, à genoux et priant. Un livre était posé (1) Grâce à un don généreux de M. Grimprel, un nouvel habitant de Soisy. (2) Il a été reproduit par le Magasin pittoresque, t. XXIX, p. 236. (3) Ce terrain fut pris sur l'emplacement du cimetière, pour ne rien diminuer des dépendances du château, qui entouraient le reste de l'Église. Il en sera fait de même pour le clocher, en 1730. (4) Au rétablissement du culte, en 1795, ce rétable et le tableau furent placés dans le sanctuaire, devant le maître-autel,
| 89 |
en face de lui, sur la tête d'un ange, faisant l'office de console. Au dire de M. Jolly (1), c'était un beau travail, que l'on pourrait attribuer au ciseau des Anguier. Cette console et la tête de l'ange, qui demeurèrent longtemps dans le chantier d'un entrepreneur de maçonnerie, furent vendus, malheureusement, à sa mort. La grande table de marbre se dresse avec son cadre blanc, portant, dans le haut, une tête d'ange, au bas, une tête de mort finement sculptée, ornée d'une couronne de laurier. Toute la partie circulaire de l'entablement qui surmonte le tout, est également en marbre. L'inscription, rédigée dans un latin très pur, est un éloge simple et complet, qu'il est bon de rapporter ici : D. O. M. ET ÆTERNÆ MEMORIÆ NICOLAI DE Bailleul. QUI, EX ILLUSTRI ET PERANTIQUA APUD CALETES BALLIOLORUM GENTE ORIUNDUS, OMNES TOGE GRADUS DECURRIT, RARO AD POSTEROS VIRTUTIS EXEMPLO. DEPOSITO SUB HENRICO MAGNO, VELUTI TYROCINIO, ABDICATISQUE MILITARIBUS STUDIIS, SENATOR FACTUS, deinde libelLORUM suplicum Magister, et post diversas LegatIONES, PRÆTURAM ADeptus, Urbi DENIQUE, REIQUE URBICÆ TERTIUM PRÆPOSITUS, TANTUS UBIQUE VIR FUIT, UT OMNIBUS ADMIRATIONEM SUI RELINQUERet. Sed ESSET QUE REGINE CANCELLARIUS (2). CUM PRÆSES IN SENATU SEDERET, IPSO DIGNUS FASTIGIO A REGE NON SEMEL PRONUNCIATUS, } UT EST VIRTUTIS COMES INVIDIA, MALEVOLORUM HOMINUM ARTIBUS REUS INNOCENS RELEGATUR, MAGNO BONORUM OMNIUM DOLORE. POSTMODUM TAMEN REVOCATUS ET IN SACrum Palatinorum ordinem, REGIIS AUSPICIIS RES ADMINISTRANTIUM ALLECTUS, ÆRARIO PRÆFICITUR. QUO IN MUNERE PUBLICÆ PECUNIÆ PARCUS, SUÆ LARGUS, AVARITIÆ MACULAM, QUAM PAUCI VITANT, FACILÈ EFFUGIT. NEQUE VERÒ HÆC INTER PUBLICI NOSOCOMII CURATIONEM, ANTE ANNOS V ET XX. (1) Histoire manuscr., p. 322. (2) Cette ligne a été ajoutée en très petits caractères.
| 90 |
DELATAM INTERMISIT, PROPENSIORE SEMPER IN PAUPERES ANIMO, PERPETUA ET CONSTANTI in Deum pietate. POSTREMO CUM, DIVISO IN FACTIONES REGNO, CUNCTA BELLO ATROCI Deflagrare, SenATUMQUE IPSUM, CUI PRÆERAT, IN PARTES DISTRACTUM CERNERET, TANDEM MOERORE, CURIS, LABORIBUSQUE CONFECTUS, REGI ET PATRIE, QUAM DUDUM DEVOVERAT, VITAM IMPENDIT XIII KAL. SEPTEMBR. ANNO R. H. M. DC. LII. AETAT. VI ET LX. ELISABETHA MALIER AMANTISSIMO CONJUGI HOC MONUMENTUM MOERENS POSUIT, EXIGUO QUAMVIS SOLATIO INGENTIS SUI LUCTUS. VIATOR, PIIS MANIBUS BENE PRecare. La traduction suivante en a été transcrite, dans le but d'être utile à quelques-uns. A Dieu, très-bon, très-grand et à l'éternelle mémoire de Nicolas de Bailleul, qui, sorti de l'illustre et très ancienne maison des Bailleul, au pays de Caux, parcourut tous les degrés de la magistrature, exemple de vertú bien rare, qu'il légua à la postérité. Ayant fait, sous Henri le Grand, ses premières armes, il abandonna bientôt la vie militaire et devint conseiller au parlement, puis maître des requêtes; ensuite, après diverses ambassades, il fut nommé lieutenant civil et enfin, par trois fois, prévôt de la ville; il excella si parfaitement partout, qu'il provoqua l'admiration universelle. Comme il siégeait en qualité de président à mortier et qu'il était chevalier de la reine, il fut déclaré par le Roi, à plusieurs reprises, digne du faîte des honneurs. Mais comme l'envie poursuit toujours la vertu, par suite des intrigues des mécontents, il fut disgracié comme un coupable, malgré son innocence, à la grande peine de tous les gens de bien. Bientôt enfin, revenu en faveur, et ayant été introduit dans l'ordre auguste des surintendants des finances, sous les auspices du roy il fut mis à la tête du Trésor public. Dans cet emploi, économe des deniers publics, prodigue de ses biens, il évita facilement la tache de cupidité, que fort peu parviennent à éviter. Il ne s'écarta pas, à la vérité, de ces qualités, à travers l'administration de l'hôpital public, qu'il dirigea l'espace de plus de 25 ans, redoublant toujours de dévouement à l'égard des pauvres, et témoignant d'un amour perpétuel et persévérant envers Dieu. Enfin, lorsque le royaume étant partagé en factions, il voyait tout périr dans une guerre horrible, le Parlement lui-même, dont il avait été le président, étant
| 91 |
divisé par les partis, il fut, à la fin, accablé par le chagrin, les soucis, les travaux, et il sacrifia à son Roi et à sa patrie la vie qu'il leur avait vouée depuis longtemps, le 13 des Calendes de Septembre (1), l'an de notre salut 1652, à l'âge de 66 ans, Elisabeth Malier, sa veuve inconsolable, a élevé ce monument à son époux bien-aimé. Passant, prie pour l'âme de cet homme de bien. Nicolas de Bailleul, jusqu'en 1614, était appelé le Bailleul (en 1615, sa mère est encore nommée le Bailleul). On lui donne en plus sur son portrait, placé au musée de Versailles, sous le n° 4099, le titre de chevalier, marquis de Château-Gontier, titre créé en sa faveur en 1647 (2). Ces quelques vestiges fournissent peu de détails sur l'origine de l'Église, et l'on peut se demander si elle a toujours occupé l'emplacement où nous la voyons aujourd'hui. Est-ce dans cette Église que fut fondée en 1270, par Jean de Soisy, Adam, trésorier de l'Église de Nevers et Robert, chevalier, pour le repos de l'âme de leur père et d'Isabeau, leur, mère, une chapelle dont le titulaire devait célébrer 5 messes par semaine (3)? Il est bien difficile de l'affirmer. Enclavée dans le domaine seigneurial, resserrée par les dépendances du château, elle ne remonte peut-être pas non plus au-delà du XVIe siècle, à moins qu'elle n'ait été reconstruite ou restaurée au même temps. Les registres paroissiaux (4) relatent des travaux d'amélioration, exécutés en 1697. C'est l'abbé Joachim Ménessier, alors curé de la paroisse, qui nous les fait connaître par cette note: « Le premier jour d'aoust de cette présente année, a esté placé « la grille de fer avec la menuiserie, qui reigne autour du cœur, « et le même cœur a esté alongé de 5 pied, et dans le mesme tant, « toute l'église a esté reblanchie et le tout par les bienfaits de Mon- (1) Il mourut à Paris le 20 août et fut inhumé dans l'Église de Soisy le 23 du même mois. (2) Inscriptions de la France, T. IV, p. 216. Les registres paroissiaux mentionnent le titre de chevalier en 1644 et celui de marquis de Château-Gontier en 1647. (3) Lebeuf, Hist. du dioc. de Paris, t. XIII, p. 111. (4) Les registres paroissiaux remontent au 16 oct. 1596 et se continuent sans interruption, jusqu'à nos jours. Ceux de 1596 à 1792 forment, à la mairie, le premier fonds de l'état-civil. Ils sont rédigés d'une façon très soignée et remarquablement intéressante.
| 92 |
seigneur de Bailleul, seigneur de ce lieu (1), par notre solicita- « tion pour la gloire de Dieu et lornement de son temple ». Plus tard c'était l'ameublement de l'Église qui attirait son attention; aussi il écrit en 1724 : « les confessionnaux (2) ont esté faits « et placés, l'un la semaine de la passion, et l'autre la semaine de “devant la Pentecôte. Les fonts baptismaux ont été faits et pla- « cés la première semaine de juillet de la même année ». La magnifique balustrade en bois sculptée de fleurs de lis et de dauphins, dont il est fait mention dans les Inscriptions de la France (3), n'avait pas encore été donnée à l'Église, puisque l'abbé Ménessier n'en parle pas. L'Archevêque de Paris, à la suite de la Confirmation donnée à Soisy en 1784, inscrit dans son Mandement, parmi les travaux urgents à faire dans l'Église, l'installation d'une grille, pour entourer les fonts baptismaux (4). Quand M. de Guilhermy la remarqua, elle était de date récente dans l'Église; depuis 1878, elle sert d'appui à la tribune. Le clocher, qui menaçait ruine, se trouvait probablement au milieu de l'Église ; c'est ainsi qu'il paraît représenté dans la gravure de Flamen (5). Le dernier descendant des de Bailleul, seigneur du lieu, résolut d'en élever un autre, sur l'emplacement où il se trouve encore de nos jours; M. l'Abbé Dandien était alors curé de Soisy; c'est lui qui rédigea (6) les notes intéressantes qui suivent : « Le 19 octobre 1727, la première assemblée s'est tenue pour « représenter requête à l'intendant de Monseigneur, au sujet du « rétablissement du clocher et on a fait la visite des réparations. « La démolition commença le 8 mars suivant ». Pendant qu'on était occupé à ces travaux, survint un accident qui aurait pu avoir des suites fâcheuses. Le clocher s'écroula. « C'était le 29, pendant le « Victimae paschali laudes, des Vêpres, à 3 h. de l'après-midi; en « dedans de l'Église, personne ne fut blessé ». La nef actuelle fut reconstruite ou agrandie à la même époque. (1) Louis de Bailleul. (2) Il y avait à cette époque un curé et un vicaire. (3) T. IV, p. 210. (4) Voyez ci-dessus, p. 83. (5) M. Jolly, Hist. mss. p. 29, dit : « Le clocher était alors sur le milieu de la nef », les cloches ont été cassées, l'une d'elles avait été bénite le 15 juillet 1725. (6) Archives communales, registres paroissiaux, année 1727.
| 93 |
Nous lisons en effet dans les mêmes registres: L'an 1730, le 8 mai, « le sieur Leroy, entrepreneur maistre masson, a commencé à <«< démolir la nef de l'Église et le 11 commencé à creuser les fonda- «tions et à les bâtir. Les fondations de la nef du côté de M. de Bail- « leul ont près de 6 pieds de profondeur, elles ont près de 3 pieds « et demie d'épaisseur de pierres de molière liées avec un mortier « composé d'un tiers de chaulx, un tiers de sable rouge, et un tiers « de sable des démolitions. Du côté de la rue elles ont six pieds « un pouce de profondeur; vers le milieu, onze pieds, à cause « d'un caveau rempli de terres rapportées qu'on y a trouvé et « qu'on a rebâti et rempli comme le reste des fondations; le tout «< fait sur un bon fond. « Les anciennes fondations étaient très mal bâties avec un mortier « composé de terre pure, n'ayant que deux pieds de profondeur et « trois d'épaisseur. « Le 20 du présent mois, continue le narrateur, on a posé la pre- « mière pierre de taille à l'encognure du côté de M. de Bailleul et on « a fouillé les fondations de la partie du clocher hors œuvre à onze « pieds 3 pouces de profondeur. Ce qui fut suivi, quelques jours après, d'une autre solennité ainsi rapportée dans la même relation: « Le 25º jour de mai, la première pierre de l'angle de la nef et « du cloché a esté posée par haut et puissant Seigneur messire « Nicolas Louis de Bailleul, chevallier seigneur marquis et gou- « verneur pour le roy de la ville de Chasteau-Gontier, marquis de « Tillay (1), seigneur de Soisy-sur-Seine, d'Estiolles, Gravois et « autres lieux, conseiller du roy en tous ses conseils et ancien pré- «sident à mortier en la Cour du Parlement de Paris, ayant cons- «titué à cet effet messire Louis Dandien, prestre curé dudit «< Soisy, de le faire pour Luy, n'estant pour lors en son chasteau de « Soisy, en présence de Messieurs les curés, cy-dessous signés et «< autres: « Vuilbaut curé d'Ormoy, J. G. Thévenot curé d'Etiolles, « L. Morne, ancien curé de Moissy, Caron curé de Lieusaint, « Lemaire, Goupy etc, et construit par Jean-Baptiste Le Roy en- «trepreneur des bâtiments du roy et J. Vautier maître charpen- «< tier ». Le clocher ainsi construit ne subit que peu de changements; avant de les faire connaître, il convient de rapporter un événement (1) Village situé près de Gonesse (S.-et-Oise).
| 94 |
des plus tristes qui se produisit dans l'Église elle-même : une tentative d'assassinat contre la personne du curé, pendant le saint sacrifice de la messe, l'année suivante. L'Abbé Lebeuf (1) parle d'un arrêt du Parlement du 15 juin 1731 au sujet d'un garçon jardinier du château, qui, le jour de la Trinité, avait tiré un coup de fusil sur le curé de la Paroisse, revêtu de ses habits sacerdotaux. Il ajoute qu'il eut le poing coupé et fut brûlé vif en place de Grève. L'arrêt lui-même nous fournira des détails plus précis ; le voici tel qu'il est inscrit aux registres du Parlement : « Veü par la Cour, le procès criminel fait par le Prévôt de Paris ou son lieu- « tenant criminel au Châtelet, à la requête du substitut du Procureur général du « Roy demandeur et accusateur contre Claude Aubert, garçon jardinier, défendeur «<et accusé, prisonnier ès-prisons de la Conciergerie du Palais à Paris, appellant « de la sentence renduë sur ledit procès le 12 juin 1731, par laquelle il auroit été « déclaré duëment atteint et convaincu d'avoir, de dessein prémédité, tiré un coup <de fusil sur le Curé de Soisy sous Etiolle, qui étoit lors revêtu de ses habits « sacerdotaux, faisant ses fonctions curiales dans l'Église dudit lieu, le dimanche « de la Trinité, duquel coup il a été blessé. Pour réparation, ledit Claude Aubert « auroit été condamné d'être conduit par l'exécuteur de la haute-justice, dans un « tombereau, rue Neuve Notre-Dame, au devant de la principale porte de l'Église « de Paris, ayant écriteaux devant et derrière portant ces mots: Assassin sacrilège « de dessein prémédité, étant à genoux, nuë tête, nuds pieds et en chemise, la corde «< au col, tenant entre ses mains une torche ardente de cire jaune du poids de « deux livres, dire et déclarer à haute et intelligible voix que, méchamment et « comme mal avisé, il a commis l'assassinat sacrilège de dessein prémédité, men- <«<tionné au procès, dont il se repent, en demande pardon à Dieu, au Roy et à « Justice, et audit lieu avoir le poingt droit coupé, ce fait, conduit en la place de <«< Grève pour y être brûlé vif, et ses cendres ensuite jettées au vent, ses biens « acquis et confisquez au Roy, ou à qui il appartiendra; sur iceux préalablement « pris la somme de deux cens livres d'amende envers le Roy, au cas que confis- «cation n'ait pas lieu au profit de Sa Majesté. «< Ouy et interrogé en la Cour ledit Claude Aubert sur sa cause d'appel et cas « à luy imposez, tout considéré : « Ladite Cour dit qu'il a été bien jugé par le dit Lieutenant criminel du Châ- « telet mal et sans grief appellé par le dit Claude Aubert et l'amendera ; et « néanmoins, au lieu des écriteaux mentionnez en la dite sentence, sera le dit « Aubert conduit avec écriteaux devant et derrière portant ces mots : Assassin de « dessein prémédité en l'église de Soisy sur Seine en la personne de son curé. Et (1) Hist. du diocèse de Paris, XIII, p. 114. t
| 95 |
« pour faire mettre le présent arrêt à exécution, renvoye ledit Aubert prisonnier « par devant ledit Lieutenant criminel du Chatelet.' « Fait en Parlement le quinze juin mil sept cent trente et un. « Signé : de Lamoignon, Pinterel. « Arreste que le sieur Aubert sera secrettement étranglé après qu'il aura esté « étendu sur le bûcher et avant que le feu y soit mis. < Signé : de Lamoignon, Pinterel. Les registres paroissiaux parlent de la réconciliation de l'Église, et du crime, qu'ils relatent en ces termes : « Le 22º de mai, de l'an < 1731, a été réconciliée leglize de Notre Dame de Soisy-sur-Seine «< par nous, prêtre, docteur de Sorbonne, curé d'Estiolles, sous- « signé à ce délégué par Mgr Vintimille du Luc, archevêque de « Paris, comme il paroît par l'acte de délégation en datte du vingt- « et-un dudit mois, signé : Parquet, vicaire général, et par ordre .« de Mgr Martin, secrétaire, laquelle avoit été souillé et prophané « par l'assassin commis contre la personne de messire Louis Dan- « dien, prêtre, curé de ladite paroisse, lorsqu'il commençoit l'office « divin le 20º mai, jour de la Trinité. « En présence de Messire Jean François Gascart, prêtre curé du Coudray, au diocèse de Paris, de messire Guy François Guelto, prêtre curé d'Ormoy, duché de Villeroy, et de messire Jean Baptiste Roblastre, prestre, prieur de la Sainte Trinité du Hamel, …. Thévenot curé destyolles (1). Le curé de Soisy, blessé légèrement, put reprendre peu de temps après l'exercice de son ministère, qu'il continua dans cette paroisse jusqu'en l'année 1755. Les choses importantes, signalées ensuite, se rapportent au baptême des cloches, cérémonie qui fut assez fréquemment renouvelée. La première mention qui en est faite remonte à l'année 1641, au mois de juillet (2) « les deux cloches de l'Église Notre Dame « de Soisy ont été fondues, la grosse et la petite. La grosse, ont esté « parain: Henri Dupuys, fils de Henry Dupuys, paroissien de « Soisy, et Anne le Maistre, fille de Jehan le Maistre, concierge du « chasteau dudit Soisy, mareine, lesquelles n'ont rien donné à « l'Église. « La petite cloche, tenue par Henry Doucet et Charlotte Dupuys, (1) Archives départementales: registre de Soisy-sur-Seine. (2) Archives de la Mairie de Soisy, registres paroissiaux. 9
| 96 |
«< lequel Doucet a donné à l'Église 24 livres et ladite Dupuys 16 liv. « Les recettes se sont élevées à 490 livres 13 sols, 6 deniers pour « l'une et à 487 livres 14 sols 6 deniers pour l'autre ». Quelques années auparavant, le clocher possédait 3 cloches, comme le prouve l'extrait du testament de Jehan Privé, daté du 14 avril 1611: « le dict testateur veult et entend que le marguillier « soit tenu à faire sonner la grosse cloche 3 fois et la faire tinter « un quart d'heure durant auparavant le salut, et durant la pro- « cession faire sonner les trois cloches à branle… » Nouveau baptême en 1719, il est ainsi relaté: « Le 21 jour de septembre, fête de St Mathieu, après les vêpres, « a esté bénite une cloche de cette paroisse par nous Joachim Men- « nessier (1), curé, accompagné des révérends Pères Maurice Paci- « fique et Pierre Goby, récolez de Corbeil (2), et a esté nommée « Marie Magdeleine, par Messire René Mesnet, conseiller du roy, « ancien contrôleur général des restes de la Chambre des comptes « et du conseil, et dame Marie Magdeleine de Secqueville, son « épouse; fondue par les soings et frais de Monseigneur de Bailleul, « seigneur de cette paroisse ». « Six ans plus tard, la grosse cloche était refondue. « « L'an 1725 le 15º jour de juillet a esté faite la bénédiction de la grosse cloche de cette paroisse et a esté nommée Nicole Louise « Marthe Clémence par Monseigneur de Bailleul et Madame de « Courchamp, dont les noms et qualités sont sur la ditte cloche ». A la suite de l'écroulement du clocher en 1728, les cloches eurent sans doute à souffrir, car en 1774, on s'occupa de les refondre. On lit dans le livre des comptes (3) L'an 1774, le 19e jour de juin, IVe dimanche après la Pentecôte, eut lieu à l'Église une réunion, où se sont présentés les sieurs Joseph et Nicolas Antoine (4), père et fils, fondeurs de cloches, lesquels, après nous avoir présenté des lettres, qui constatent leur connaissance et science dans le genre de la fonte… nous offrent leurs services pour la fonte de nos cloches dont on ne tire aucun usage, depuis nombre d'années qu'elles sont (1) Curé de Soisy de 1696 à 1727. (2) Le couvent des Récollets, fondé en 1635 près la porte St-Nicolas à Corbeil, fut transféré en 1641 à la rue des Grandes-Bordes où il demeura jusqu'à 1790 (Les Récollets à Corbeil. Orléans 1888, in-8°). (3) Archives paroissiales: comptes de la Fabrique de Soisy. (4) Ils étaient d'Orville (Vosges).
| 97 |
cassées, en nous prévenant que les préparatifs qu'ils ont faits pour les cloches de paroisses environnantes, diminueraient de beaucoup les dépenses nécessaires dans d'autres circonstances. Après en avoir délibéré, il fut observé que la fabrique ne peut donner qu'une somme modique, au plus 120 livres provenant de la vente du premier banc bourgeois. Tous les membres s'étant cotisés complétèrent la somme de 422 livres, réclamée par les fondeurs, qui s'engagèrent à descendre les cloches et à les remonter. Et pour le cas où elles excéderaient le poids qu'elles ont en ce moment, il est convenu qu'on leur paiera 1 livre 4 sols, la livre du métal fourni. Cette convention est signée par Mellet, curé ; Dorget, vicaire et 35 habitants (1). Le baptême des nouvelles cloches fut célébré le 7 juillet suivant ; elles furent nommées: la ire, Eléonore; la 2°, Sophie; la 3e, Césarine; et la 4º, Marie-Louise, par très haut et très puissant Seigneur LouisMarie-Gabriel-César, baron de Choiseul, capitaine de gendarmerie, brigadier des armées du roi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la cour de France auprès du roi de Sardaigne, et très haute et très puissante dame Marie-Sophie-Eléonore de Choiseul, veuve du très haut et très puissant Seigneur, Jean-CharlesJoseph d'Andigné, comte de Vésins, lieutenant pour le roi du Saumurois, dame de cette paroisse. Elles demeurèrent ainsi jusqu'à la tourmente révolutionnaire; les trois premières furent enlevées (2); la dernière seule échappa et reprit ensuite sa mission jusqu'en 1895. Avant de clore le paragraphe relatif au clocher, notons qu'en l'année 1878, il fut restauré et remis à neuf; deux cadrans furent placés au-dessous des moulures supérieures, l'un du côté du levant, l'autre du côté du couchant, remplaçant l'ancien cadran de l'horloge qui se trouvait, jusqu'à cette époque, à la hauteur du premier étage, côté du midi. La Révolution avançait à grands pas; la fête de la Fédération fut (1) La quittance du travail est ainsi formulée : « Nous… soussignés reconnaissons avoir reçu 432 livres pour la fonte de 4 cloches, plus 40 livres 16 sols pour la fonte des fontaines ou Palliers, plus 12 livres 12 sols pour fourniture de métal, formant au total la somme de 485 livres 8 s. que nous reconnaissons avoir reçu desdits sieurs Curé et Marguillers et dont nous les quittons. Soisy-sur-Seine, le 9 juillet 1774 ». (2) Elles furent portées à Paris, et elles restèrent longtemps dans le Jardin des Plantes (Jolly, hist. mss. de Soisy-s-E., p. 329).
| 98 |
célébrée avec enthousiasme. Le procès-verbal, tel qu'il a été relevé dans les registres municipaux, en sera le meilleur témoignage (1). « Quatorze juillet jour de la fédération ille a Etez cellebrez une messe sollen- « nelle et ou tout le cord de la municipallitez a assistez et le cord de la gard «nassionalle. Daprest la messe se sond et on etez prossessionnellement dans la « venue du Balcond (2) asistez du clergé. Dans la dict a venue était dressez une « otelle ou monsieur le maire a pausez les min et a prononcez le serment aux « nom de tout les offisier municipau Destre fidelle à la nation à la loi au roy et « de maintenire de tout sest pouvoir la fidellitez à La Constitution; Et tout le <«< citoien on repondu Je le Jurre ». Les habitants de Soisy n'étaient pas les derniers à donner des gages de leur patriotisme ardent, car le même registre relate à la date du 10 novembre (3) qu'« ille a etez fait et chantez un service « Entre notre Eglize en memoire de nos frerre darme qui on perie sous les murs de nencie pour combatre pour la patrie ». Peu de temps après (4), eut lieu la prestation de serment par M. le curé, René Antoine Mellet, prêtre gradué en l'Université de Paris et par M. le vicaire Claude Guerre, prêtre, du diocèse de Bourges. Voici le procès-verbal qui en fut rédigé : « L'an 1791 le 30 janvier Lassemblée convoqué le dimanche dauparavant se « sont réunis à leglise à lissue de la seconde messe, à laquelle le nombre des <«« assistans est toujours plus considérable, Messieurs les Curé, vicaire, le Maire, <«< municipaux, notables et principaux habitans accompagnés de la garde natio- « nale. Lassemblée tenant, M. le Maire a fait part à M. les susdits Curé et vicaire « du décret du 27 novembre dernier, accepté par le Roy le deux du courant, reçu « avant hier par la municipalité, suivant lequel decret lassemblée nationale «< demande à Messieurs les Curés, vicaires et Ecclésiastiques fonctionnaires publics «<le serment de veiller avec soins sur leurs fidels du diocèse ou de la paroisse « qui leur est confiée, d'être fidels à la nation, à la loi et au Roy et de maintenir « de tout leur pouvoir la constitution décrétée par lassemblée nationale et « acceptée par le Roy. La lecture faite, Messieurs les curé et vicaire de cette pa- « roisse sont montés dans la chaire et ont prêté le serment suivant la formule « tracée dans le décret ». Le même registre nous apprend qu'il fut : « Chanté et célébré un service pour le repaux de lamme de Réquétit Mirabeau, <«<lesquelles la municipalité assisté de la garde nationnalle six son transporté en (1) Archives municipales, registre 1787-1792. 1. 45 verso, année 1790. (2) Avenue Chevalier. (3) Arch. munic., reg. 1787-1792, f. 54. (4) Id. f. 58.
| 99 |
« ordre et on assisté à tout le service qui a été célébré le dit jour et an que six « desut… et signé de noms et de tous les six toyens qui y etait présent ». L'anniversaire de la Fête de la Fédération fut célébré avec solennité; une messe fut chantée sous l'avenue du Balcon. Le 9 octobre, suivant, il fut chanté un Te Deum et le psaume Exaudiat, à l'Église, où s'était rendue la municipalité, après avoir parcouru les places et carrefours, où le procureur syndic avait donné lecture de la constitution du 14 septembre. Une autre réunion, qui eut lieu le 6 novembre, est intéressante; elle est ainsi relatée : « Nous, Mairre, officiers municipaux et procureur de la Commune et notable, « composant le Conseille Etant assemblée an la Chambre de la Commune assistée « de M. Pomard marguillier contable et M. Bastié marguillier an charge à layfait « de délibéré sur la representation de la majeur party des habitans de notre « Paroise qui nous ont exposé quil aitay de la plus grande utillitée pour la Paroisse « de supprimée la messe quit se dit a onze heur et demy fette et dimanche, «< quelle soit remise a partire du jour de la Toussaint aux Saint jour de Pacque « quelle soit dite incontinent à huit heur du matin et depuis Pacque jusque la « Toussaint à sept heur du matin an raison de ce que la grande messe qui se dissait dans tout le courant de lanée à neuf heur du matin et dans les fettes <«< qui se trouvais dans le courant de lanée quit arrivais un mardy out un ven- «< dredy, ont aitait obligé pour laysance des personne quit voyages par le coche « daux, de la dirre a huit heur du matin lhiver comme leté an raison de la « messe de honze heur et demy, privay la plus grande party des citoyens « dassisté à la grande messe Paroissialle les trois quar de lané. Daprès cet exposé <«< quit nous a été présenté que nous avons considérée quil aytait sage et prudent «daprès avoir conferay et examinée lexposé, nous avons deliberait et accorday a «<lexposé six dessut à layfait d'acorday le désir aux vœux generalle et que do- <«< rénavant quille sera dit la basse messe depuis la Toussaint jusquà Pacque à «< 8 heur et de Pacque à la Toussaint à 7 heur et la grande messe paroissiale «< toute lané à dix heur… ». Ces bonnes dispositions à l'égard de la religion et du clergé ne devaient pas se maintenir longtemps. C'est ainsi qu'à l'assemblée communale du 12 janvier 1792 M. l'Abbé Mellet, curé, ne fut élu président que par 9 voix, et par le bénéfice de l'âge, tandis qu'en l'année 1787, il avait réuni toutes les voix des 64 votants. A noter également une perquisition faite, chez M. de la Rue (1), l'un des propriétaires, accusé de cacher dans sa maison des prê- (1) C'était le 13 avril 1792, à 10 h. du matin.
| 100 |
tres non assermentés. On visita tous « les appartemens, chambres, « cabinets, grenier, cave, écurie, remises, cours, toutes les armoires « ouvertes; on fouilla tous les endroits du parc, notamment le « souterrain et la glacière et il fut reconnu qu'il avait été accusé à « tort » (1). Une nouvelle forme de serment ayant été décrétée par la loi du 14 août, on réunit la municipalité et le clergé à l'Église on y remarquait M. l'Abbé Mellet et M. l'Abbé Guerre; le nom de ce dernier ne paraît plus ensuite sur le registre des délibérations de l'assemblée municipale. Il n'y a plus rien d'intéressant à relever jusqu'à l'époque de la fermeture de l'Église et de l'interdiction du culte catholique, qui coïncidèrent avec la création et l'organisation d'une Société populaire ; dont les procès-verbaux ne sont mentionnés dans aucun des inventaires de la Mairie. Le dernier baptême eut lieu le 28 octobre 1793 (7 Brumaire an II); peut-être que l'Église fut fermée ensuite, ce qui n'eut lieu à Corbeil que le 12 novembre 1793. Les registres paroissiaux n'étaient plus tenus depuis le 3 novembre 1792; le premier acte de l'état civil fut rédigé à la mairie le 5; c'était à l'occasion d'un mariage. M. le Curé remit entre les mains du Maire (2), le 12 décembre 1793, trois paquets de registres de l'Église, contenant 87 cahiers, dont le 1er remontait à l'an 1596; il y joignit 173 livres, reliquat des deniers de la Fabrique. Que se passa-t-il, à partir du mois de novembre 1793, pendant l'année 1794 et les premiers mois de 1795 ? Les archives municipales ne nous offrent aucun renseignement. Le Curé demeura probablement au milieu de ses paroissiens, car il ne mourut que le 25 décembre 1799. M. François Faure, dit Frère Nil, de l'hermitage de Sénart, est bien mentionné au 5 octobre 1792, comme habitant de Soisy ; mais était-il prêtre ? La présence de M. l'Abbé Dorget est bien constatée au 21 avril 1795, dans un procès-verbal, dont voici les termes (3): « Aujourd'hui, (1) C'est actuellement la propriété de M. de Vandeul, (2) Arch. munic., reg. 1787-92, p. 84. (3) Archives municipales. Registre des délibérations du conseil général de la Communę de Soisy-sous-Etiolles, f. 3,
| 101 |
2 floréal de l'an III de la République française, une et indivisible, s'est présenté le citoyen Simon Dorget, et nous a déclaré que depuis quelque temps, il venait en cette commune où il a été élevé (1) et nous a exibé un certificat de mise en liberté du comité de sûreté générale de la convention nationale, du 4 ventôse (23 février) de la présente année, expédié sur l'original, déposé au sécrétariat du district de Versailles, et qu'il réside habituellement en la commune de Lisses, district de Corbeil ». Déjà, au 27 mars 1795, le rocher qui avait été élevé à la place de` la croix de Gerville démolie, pour recevoir le buste de Marat (2), avait été vendu et adjugé au citoyen Corvasier, pour la somme de IIO livres. Le Saint jour de Pâques, le 5 avril de la même année, l'oratoire de Madame Bellet (3), ouvert à l'exercice du culte catholique, avait servi pour administrer le Sacrement de Baptême: l'enfant s'appelait Anne Geneviève Normand, née le 20 mai 1794. Le prêtre était M. l'Abbé Dorget; peut-être était-il autorisé de M. l'Abbé Mellet, qui ne paraît plus à aucune cérémonie, dans aucune circonstance. C'est M. l'Abbé Dorget qui administre les sacrements dans le dit Oratoire jusqu'à l'ouverture de l'Église, qui eut lieu le 28 juin 1795. Dès le 29 prairial (17 juin) s'étaient présentés à la Mairie (4) les citoyens Vibert, Louis Normand, Jacquet, Malégat, Genuys, Decharge, Morant et Soubiroux, pour faire réclamation, en exécution de la Loi du XI du présent, de l'Église destinée originairement à l'exercice du Culte Catholique et ont déposé leur réclamation signée Le Maire s'appelait Philippon ; il était entrepreneur de charpente. Il fut donné droit à la demande de ces vaillants chrétiens, car le 9 messidor (27 juin), le citoyen Simon Dorget comparut à la Mairie, déclarant qu'il se propose d'exercer le ministère du culte. connu sous la dénomination de catholique dans l'étendue de cette commune et a requis qu'il lui soit donné acte de sa soumission aux (1) Son père, Claude Dorget, tenait depuis 1744 un cabaret à Soisy. (2) La commune s'appelait Soisy-Marat, à cette époque. On a retrouvé dans la Seine, il y a quelques années, le cachet en bronze de la commune de Soisy, portant cette dénomination de Soisy-Marat. (3) Maison Bruslon. (4) Registre des délibérations du Conseil général de Soisy-sous-Etiolles, f. 8.
| 102 |
lois de la République, de laquelle déclaration il lui a été décerné acte, conformément à la Loi du 11 prairial an III. Aussi, dès le lendemain, fut célébrée, au milieu d'un concours considérable de paroissiens, la réconciliation de l'Église. M. l'Abbé Dorget nous a laissé le récit suivant de cette fête (1): « Le Ve Dimanche après la Pentecôte, veille de la fête des Apôtres « S. Pierre et S. Paul, j'ay réconcilié et bénit, avec les cérémonies « et prières prescrites par le rituel de Paris, l'Église de Soisy, l'au- « tel, le tabernacle, ciboire, linges et ornements, et ay célébré « solennellement la grand'Messe précédée du Veni Creator, accom- « pagnée de l'exposition et bénédiction du St Sacrement; et l'après- « midi, chanté les Vêpres et Complies, suivies d'un salut solennel, « terminé par le Te Deum, en actions de grâces du rétablissement « de l'exercice de la Religion et du Culte Catholique, interrompus « en cette Église, depuis environ vingt mois » (2). L'Abbé Simon Dorget était né à Etiolles, le 24 août 1742. Deux ans après il vint à Soisy, où il fit sa re communion en 1757. Diacre en 1768, il est inscrit, en 1770, comme prêtre habitué à St-Barthélemy, en la cité, à Paris. Nommé le 2 mai 1774, vicaire à Soisy-sousÉtiolles, il demeura dans ce poste jusqu'au 24 février 1777. Nous le trouvons en 1784, comme vicaire, à Moissy-l'Évêque (3); en 1788 avec le même titre à St-Germain le vieux-Corbeil; en 1790, il était curé de Lisses. A partir de 1795, il exerce le ministère à Soisy, où il fut nommé en qualité de curé, lors du Concordat de 1801, par Monseigneur l'Évêque de Versailles. Le 17 messidor au III (5 juillet 1795) Charles Joseph Polchet, récollet du couvent de Corbeil, fermé en 1790, vint se retirer à Soisy, où il finit ses jours, le 28 janvier 1796, âgé d'environ 82 ans. Son nom de religion était Alexandre. L'Abbé Dorget fut appelé à la Mairie le 11 Brumaire an IV (2 nov. 1795), pour faire la déclaration suivante : « Je reconnais que l'uni- « versité (sic) des citoyens français est le Souverain et je promets « soumission et obéissance aux lois de la République »>. Une nouvelle déclaration lui fut demandée le 13 germinal an IV, (1) Registres paroissiaux, année 1795. (2) Des cérémonies semblables avaient eu lieu le 5 juin à Corbeil et à Ris-Orangis, commune qui s'était appelée Brutus, pendant la période révolutionnaire. (3) Seine-et-Marne.
| 103 |
(2 avril 1796) en exécution de l'art. 18 de la loi du 7 vendémiaire : c'était pour renouveler son intention d'exercer le ministère du culte catholique dans l'Église, ainsi que dans l'oratoire de la citoyenne Bellet. Ensuite, au 2 vendémiaire an VI, (23 septembre 1797), il fut obligé, pour se conformer à la loi du 19 fructidor, « de faire le « serment de haine à la royauté et à la monarchie, d'attachement « et de fidélité à la République et à la Constitution de l'an III ». Bientôt les catholiques allaient retrouver un peu de calme et de liberté, avec la promulgation du Concordat conclu entre Bonaparte, premier Consul, et le Souverain Pontife, Pie VII. Mais avant de clore ce chapitre, il est intéressant de noter la vente de la Société populaire ainsi que la fête de la souveraineté du peuple en 1798 et celle du 14 juillet de la même année, qui sont ainsi racontées: Le 8 brumaire an IV (30 octobre 1795) s'est présenté le citoyen Laforge, trésorier de la ci-devant Société populaire, lequel a exposé les comptes de la dite Société toutes dettes acquittées, il s'est trouvé un excédent de 77 livres, IS SOUS. Ensuite il a été procédé à l'adjudication de la lampe dite Quinquets, laquelle a été adjugée au citoyen Vibert pour 200 livres ; d'un petit tableau sous verre, ayant une gravure, adjugée au citoyen Lemasle, pour 25 livres ; d'un bonet de fer blanc, représentant celui de la liberté, adjugé au citoyen Tessier pour 29 livres ; puis de la barrière, fermant l'entrée de l'autel de la Patrie, laquelle a été adjugée au citoyen Charton pour 277 livres (1). La fête de la souveraineté du peuple fut célébrée le 30 ventôse an VI (20 mars 1798); le récit en a été consigné en ces termes : « Nous avons dressé un hotel sous l'arbre de la liberté, dans la place du quin- «< conge. Nous avons garny cette hotel de verdure et surmonté de la liberté. Le « commancement de la marche de la fétes a commancé à la maison commune: « quatorze vielliard ayent à la main une baguette Blanche, accompagné de quatre « Jeune Jean nommé par les vielliard qui on porté les inscription sur chacune « mansionné dans la loy; six autres Jeune Jean portant les Riflame, entouré de <«< la garde national; 20 Jeune Jean chantant, accompagne de musique et viollons, « chantant des chansons à nalogue à la fétes et patriotiques. Etant arrivé à Lhotel, (1) Registre, f. 21. Pour expliquer ces grosses sommes, il est bon de rappeler que tout se payait alors en assignats et que ceux-ci perdaient à cette époque plus de 90 % sur le numéraire-métal.
| 104 |
«< il a été fait lecture de la loy du 13 ventôse, dela proclamation du directoire « Exécutif, qui a été entendu de toute la commune et à plodit de grands cris de « Vive la République, la Liberté, l'Egalité et la conservation de la fête de la « Souveraineté du peuple… Aux retoure, avec la même marche et chanchon pa- <«<triotique, qui a duré de puis dix heures du matin jusque à 3 heur après midy. « Nous avons fini la fête par des dance ». « Et avoir tiré des boites » (1). Désormais tout sentiment religieux était exclu des fêtes; les doctrines de Jean-Jacques Rousseau commençaient à produire leurs fruits. Il sera facile de le constater dans le récit de la fête du 14 juillet 1798; quelle différence depuis 1790 ! « L'an VI, de la République Française, le 26 messidore (14 juillet 1798) Nous « avons dressé une authel de la Patrie dans la place publique, orné de la liberté « et de branche de chêne et de thiolle à XI heures du matin. Nous avons partie « de la maison commune pour aller à l'autel de la patrie, accompagné d'un petit « nombre de la garde National, deux assesseurs : dominic Gervais Mercier, « Robert Philippon, du citoyen Prudent, et le citoyen Manceaux, instituteur, du «< citoyen Robert Vibert, adjudant, etc., les 4 chanteurs, et un nombre de jeune « garçon… Etant arrivé à l'autel, l'ong a chanté des himes. Un discours prononcé «< par l'agent, à na logue à la fêtes; Recontinué par des hymes, Nous sommes « retourné à la maison commune… « Et finit par des danse » (2). Deux ans plus tard, l'enthousiasme diminue, les ressources d'ailleurs font défaut et il est décidé que : «< Vu que nous navons aucun fons à notre disposition, pour donner à cette fête tout le développement qu'elle mérite. Art. 1er. Demain, 25 messidor, tous les travaux cesseront, excepté ceux de nécessité indispensable. Art. 2. Le Maire (3) et l'adjoint se rendront à Corbeil, accompagnés des assesseurs et de la garde nationale ». L'abbé E. COLAS (A suivre) curé de Soisy-sous-Etiolles. (1) Registre, f. 35. (2) Registre, f. 40. (3) Le maire était M. Vibert, qui avait succédé à M. François Gaujard. Ce dernier lui remit 4 registres de délibérations, depuis 1787, jusqu'à l'an VIII, fin prairial et en plus 29 registres (paroissiaux) depuis 1596, y compris ceux de l'an VIII.
| 105 |
UN BAPTÊME EN L'ÉGLISE DE S. BASILE D'ÉTAMPES (1762)
Les registres paroissiaux d'Étampes, au XVIIIe siècle, sont fort intéressants; l'on y puise une quantité de renseignements précis que l'on ne trouverait nulle autre part. L'ensemble des actes de ce que l'on appelle aujourd'hui l'état-civil, donne à chaque paroisse sa physionomie particulière : à Notre-Dame, ce sont les marchands qui dominent: parmi eux, on remarque des noms de professions inusités de nos jours les paindépiciers, les potiers d'étain, les habilleurs de filasses (1), etc.; à St-Gilles, ce sont les postes, les messageries royales, les hôtelleries et les auberges; à St-Pierre, les laboureurs; à St-Martin, les laboureurs aussi, mais encore les mégissiers et les chamoiseurs. Partout des moulins, c'est la principale industrie. Les Couvents: Mathurins, Cordeliers, Capucins, Barnabites, la Congrégation de Notre-Dame (2), l'Hôtel-Dieu, le chapitre de Notre-Dame, avaient des registres particuliers pour les sépultures faites dans leur église, ou dans leur cimetière. Ceux de la paroisse de St-Basile sont assurément les plus curieux. Là, habitaient l'élite de la population, noblesse et bourgeoisie, et la plupart des hauts fonctionnaires de l'époque, dont on suit l'existence pas à pas, pour ainsi dire, par leurs actes de baptêmes, de mariages et de sépultures, avec le grand attrait d'une authenticité absolue. (1) 1718, mariage, à Notre-Dame, de Christophe Longchamp, « homme qui passe sa vie à habiller les filasses » (sic). (2) Avec les actes concernant les religieuses décédées au Couvent de St-Charles d'Orléans, où elles avaient été exilées par ordre du Roi, pour opposition à la Bulle Unigenitus.
| 106 |
C'est dans ces documents que nous avons trouvé la première cérémonie de la Rosière qui eut lieu en 1789, et non en 1790, comme on l'avait cru jusqu'ici (1). Nous y avons relevé les alliances des Desmorets, exécuteurs des hautes œuvres du Bailliage, avec les bourreaux de Paris, de Rouen et de Troyes; l'existence d'un ermite dans la maladrerie de St-Lazare; l'ancien usage de laisser pendant une nuit sous les châsses des Corps-Saints, le corps de gens victimes d'accidents sur la voie publique, et bien d'autres faits à peine connus, ou ignorés, entre autres le baptême de M. le vicomte Charles de Viart, seigneur de Boischambault, dans la paroisse d'Abbéville, Officier au régt de Conty-Infie avant la Révolution, ensuite maire de Morigny-Champigny. Nous copions intégralement cet acte de baptême : « Dimanche, 4 avril 1762, baptisé Charles, né ledit jour (2), fils de messire Charles Nicolas Viart, chevalier, seigneur de Boischambault, Mézières, Colon et autres lieux, ancien capitaine second factionnaire (3) au régiment de Périgord-infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de St Louis, pensionnaire du Roy et lieutenant de messieurs les maréchaux de France (4), et de dame Marie Madeleine Baudry, demeurant à Étampes, ses père et mère; le parrain, le régiment de Périgord icy présent sous les armes, leurs drapeaux (5), musique et tambours ; lequel, sur une délibération du corps, a choisy messire Gérosme de Saint-Hilaire, chevalier, seigneur dudit lieu, chevalier de l'ordre royal et militaire de St Louis, lieutenant-colonel commandant le régiment; la marraine, dame Geneviève Duris, douairière de feu messire Houmain de Courbeville, chevalier, seigneur de Gironville et autres lieux, grande tante de l'enfant, et sœur de M. Duris, en son vivant chevalier, seigneur (1) Bulletin de la Société historique de Corbeil-Étampes : 1900, 1re livr., p. 38. (2) Le jour de la naissance a été ajouté après coup, d'après une note qui precède l'acte, signée « Vénard », en conséquence de la sentence du bailliage « rendue le 17 juillet 1769 ». (3) Le régiment d'infanterie était formé de 2 bataillons à 4 compagnies de fusiliers, dites du 1er 2° 3° et 4° factionnaires, et d'une compagnie dc grenadiers, ou de chasseurs. Le régiment de Périgord avait été créé en 1684; c'est aujourd'hui le 8rº de ligne. (4) Le lieutenant des maréchaux de France au bailliage était, en même temps, juge du point d'honneur. M. de Viart porte aussi ce dernier titre dans plusieurs actes. Il avait succédé à son oncle François Duris. (5) Chaque régiment avait deux drapeaux; l'un blanc, l'autre de couleur.
| 107 |
¡er de Guinette, per capitaine audit régiment de Périgord, chevalier de l'ordre royal et militaire de St Louis. Le père présent ». Ont signé : « Ge Duris de Courbeville; St Hilaire; Sabrit; Maudet; capitaine Menadier ; Viart père; Rivet, curé ». En marge, on lit les deux mentions suivantes: « Nota: que par un cas singulier, Madame Viart est accouchée quelques heures auparavant le départ dudit régiment, faisant route de Valogne, en Normandie, à Toulon, en Provence. « Lors de l'immersion de l'eau sur la tête de l'enfant, les drapeaux l'ont couvert, et elle a été annoncée par le bruit du canon du Roy ». Les signatures « Sabrit, Maudet, Menadier », sont celles d'officiers du régiment qui, en plus de M. de Viart et de M. Etienne Duris, avait eu dans ses cadres M. Germain de Crestault, autre. habitant d'Étampes. Les registres de S. Martin rappellent aussi le passage de cette troupe par l'inhumation, le 5 avril, du « corps d'un soldat du régiment de Périgord, trouvé mort la veille au chantier des Roziers ». Le père du nouveau baptisé, né en 1713, avait eu pour parrain et marraine, le 29 Mai, Nicolas Gabriel Viart de Villette, son oncle, et dame Marie Duris, sa tante, épouse du sieur de Ronssereau, avocat au Parlement. Il était fils de Guillaume Charles de Viart d'Orval, seigneur de Boischambault, dit le chevalier d'Orval en 1720, mort à l'âge de 79 ans à Étampes et inhumé en l'église de St Basile, le 17 janvier 1753, en face la chapelle Ste Marguerite, lieu de sépulture de sa famille, près de sa femme, Marie-Madeleine Duris, morte en 1737, à 52 ans, et enterrée le 19 mai de la même année. Jacques Duris, conseiller secrétaire du Roi, Maison et Couronne de France et de ses Finances, seigneur de Viefvy, Romainville, Noir-Epinay, etc., avait eu de Marie Durand (1), d'après les registres paroissiaux, deux fils et cinq filles. 1° Étienne Duris, seigneur de Guinette, dont nous avons déjà parlé. 2º François Duris, mort en 1754, seigneur de Châtignonville, (1) La pierre qui couvrait autrefois, dans l'église de St-Basile, la tombe de Jacques Duris et de sa femme, est aujourd'hui au musée d'Étampes.
| 108 |
Viefvy, Romainville, etc., Juge du point d'honneur, lieutenant des maréchaux de France; 30 Marie, femme de Mathieu de Ronssereau, citée plus haut; 4° Elisabeth-Françoise, qui épousa, en 1702, Gérard Edeline, plus tard prévôt d'Etampes, lieutenant général du bailliage; 5º Anne, femme, en 1705, de Claude Glasson, capitaine, 1er exempt des cent-suisses de la garde ordinaire du Roi; 6 Marie-Madeleine, la mère du nouveau baptisé, née vers 1685; 7° Geneviève, sa marraine, née en 1700, décédée en 1767; elle avait épousé, le 26 octobre 1733, dans l'église St-Basile, messire Louis-Alphonse Houmain, seigneur de Courbeville, Gironville, etc., mort en 1748, à 46 ans. C'est le 8 février 1757 qu'eut lieu le mariage de Charles-Nicolas de Viart avec Marie-Madeleine Baudry, fille de Pierre Thomas Baudry, conseiller du Roi, lieutenant en l'Election, et de Marie Parizot, en présence d'Adrien Constant Esprit Renault de Barres, chevalier, seigneur comte de Barres, baron de Laz, seigneur de Villeneuve-sur-Auvers, grand et petit Jours et autres lieux, capitaine gouverneur, grand bailli de Ville, château et duché d'Etampes, ancien capitaine commandant le 1er escadron de Dragons Wallons de feue S. M. Impériale, et sa femme, Claude Charlotte Viart d'Orval, sœur germaine de l'époux; Henry Auguste Viart des Francs, chevalier, ancien capitaine au régiment royal artillerie, chevalier de l'Ordre royal et militaire de S. Louis, oncle paternel à la mode de Bretagne, Michel Louis Bouraine, conseiller du Roi, receveur des tailles de la ville et élection, et Marie Henriette Baudry, son épouse, sœur germaine de la mariée; Charles Alexis Baron, marchand bourgeois, cousin germain (étant fils de Nicolas Baron, lieutenant en l'élection, et de Marie-Madeleine Parizot). Les registres paroissiaux nous donnent les noms de trois enfants nés de ce mariage : 1º Charles, dont le baptême fait l'objet de cette notice. 2º Magdeleine, née le 8 février 1764, qui eut pour parrain et marraine, Henry Auguste Viart, chevalier, seigneur de NoirEpinay en partie, capitaine au régiment d'Aunis, chevalier de St-Louis, son oncle, et Anne Charlotte de S. Pol, dame de Châtignonville, douairière de feu messire François Duris, écuyer, seigneur de Viefvy, Romainville, etc., grande tante paternelle.
| 109 |
Magdeleine de Viart épousa M. Joseph de Romanet, général de brigade, maire d'Etampes de 1808 à 1815. 3º Charlotte, dont nous n'avons pas vu l'acte de baptême, plus tard madame de Lort. Elle est citée en 1771 en qualité de marraine, le parrain étant son frère Charles. Tous deux, et leur tante, Madame de Barres, furent les donataires de la Rosière en 1789. Charles Nicolas de Viart est mort dans son château de Brunehaut, près Morigny, le 6 octobre 1786. A l'inhumation dans le cimetière de cette paroisse, assistaient : Messire Michel Louis Bouraine, écuyer, secrétaire du Roi, receveur particulier des finances, beau-frère; César Joachim Poilloue de St-Périer, chevalier, neveu (1); [le chevalier] de Valory, chevalier de S. Louis, aussi neveu à cause de Madame son épouse (2); Messire Jacques Julien François Picart, écuyer, seigneur de Noir-Epinay, ancien lieutenant général au Bailliage royal d'Etampes (3); messire Louis Picart de Noir-Epinay, chevalier, président lieutenant-général au Bailliage d'Etampes, etc, etc. Marie Madeleine Baudry, son épouse, était morte en 1773, et avait été inhumée, le 5 juin, dans la chapelle Sainte-Marguerite de l'église Saint-Basile, à l'âge de 41 ans. Charles de Viart, le filleul du régiment de Périgord, avait épousé Louise Georgette Angot des Rotours; il décéda, comme son père, à Brunehaut, le 30 décembre 1839. Il laissa le « Jardiniste moderne » (Paris, 1819) et une « Chanson nouvelle dédiée aux jeunes Ecoliers d'Étampes » (Paris 1825) (4) que M. Bigot de Fouchères a reproduite dans son ouvrage. Son fils, Amédée de Viart, né à Brunehaut, le 23 août 1809, mort à Paris le 18 juillet 1868, fut député du collège électoral d'Etampes, de 1842 à 1846. Son buste est au musée de cette ville, ainsi que ceux de sa femme, née Marie Agathe Gigaut de Crisenoy, et de son père. On y voit aussi les portraits au pastel de Mmes de Romanet et de Lort. Ch. FORTEAU. 15 Novembre 1900. (1) Par sa femme, Marie Geneviève de Bouraine, fille de Louis Michel et Marie Henriette Baudry, veuve de Charles François de Foyal. (2) Charlotte de Poilloue de S. Mars. (3) Epoux de Louise Marguerite de Bouraine. (4) Léon Marquis, « Les Rues d'Etampes ».
| 110 |
UN ÉPISODE DE LA TERREUR LE CITOYEN ARMAND CLARTAN, MAIRE D'ÉTAMPES, AU TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE (11 Juillet 1794)
Sous le régime de la Terreur, la ville d'Étampes avait pour maire le citoyen Armand Clertan, dit Clartan, âgé de 68 ans, né à Berney près Genève, qui, bien qu'étranger au pays qu'il habitait seulement depuis vingt ans, s'était rendu très populaire et avait su se faire estimer de ses concitoyens, état de choses qui contribua beaucoup à lui faire accepter le lourd fardeau de chef de la municipalité, surtout à une époque des plus troublées, où il y avait péril à ceindre l'écharpe municipale. Patriote ardent et sincère, sage, pondéré et intègre, son administration obtint les éloges de tous les Étampois, à l'exception des membres de la Société des Jacobins, dont plusieurs, poussés par la haine et la jalousie, le dénoncèrent comme complice des Hébertistes (1). Malgré son âge avancé et sans aucune preuve sérieuse de culpabilité, il fut impitoyablement incarcéré pendant plusieurs mois et traduit ensuite au Tribunal révolutionnaire, qui l'acquitta, grâce aux démarches faites par l'universalité des habitants d'Étampes, qui le savaient innocent. Or, comme le citoyen Clartan est le seul officier municipal étampois, que nous sachions, qui faillit porter sa tête sur l'échafaud, nous avons cru devoir, à l'aide de documents qui se trouvent aux (1) Quelques-uns de ces Jacobins ont profité des événements pour s'enrichir, en acquérant à vil prix châteaux et fermes provenant des biens nationaux, qu'ils payèrent en assignats.
| 111 |
Archives nationales, faire revivre en quelques pages cette figure révolutionnaire, et faire apprécier et connaître en même temps. l'homme probe, si injustement oublié, comme tant d'autres Étampois victimes de leur dévouement à la chose publique (1). Le 24 ventôse an II (14 mars 1794), sur le rapport de Saint-Just, et en vertu du décret de la Convention nationale, les Hébertistes, au nombre de vingt, faisant partie de la faction à la tête de laquelle était l'infâme Hébert, dit le Père Duchesne, qui eut le cynisme d'accuser la reine Marie-Antoinette d'avoir corrompu son fils dans. la tour du Temple, furent arrêtés et renvoyés, le 1er germinal suivant, au Tribunal révolutionnaire, sous l'inculpation de « complicité avec les agents de l'étranger pour affamer Paris, avilir le régime républicain et ramener la contre-révolution ». Le 4 du même mois, ils furent condamnés à mort et exécutés le même jour à trois heures du soir, à l'exception d'un nommé Laboureau, comparse de peu d'importance, qui fut acquitté (2). Trois semaines plus tard, d'autres partisans d'Hébert, tels que Chaumette, procureur de la Commune, l'inventeur du culte de la Raison, l'ex-évêque Gobel et autres, montèrent à leur tour sur l'échafaud. Dans l'instruction de ces deux procès, plusieurs témoins ayant déclaré que les condamnés avaient des complices aux environs de Paris et dans les départements, une nouvelle procédure fut ouverte par le Comité de sûreté générale, à la suite de laquelle trente personnes, y compris le citoyen Clartan, ont été renvoyées au tribunal révolutionnaire, sous l'inculpation d'avoir empêché l'approvisionnement de Paris. Voici les causes qui ont amené l'arrestation du maire d'Étampes. Le 24 vendémiaire an II (15 octobre 1793), le citoyen Armand Clartan, sur la proposition des représentants du peuple Couturier et Crassous en mission à Étampes, fut nommé maire en remplacement du citoyen François Sibillon, qui avait succédé, le 15 mai (1) Après la période révolutionnaire, les archives communales de la ville d'Étampes ont été détruites, en grande partie et pour cause, par les acteurs de cette époque néfaste, ou par leurs descendants, dont plusieurs ont occupé des fonctions municipales. Toutefois, on trouve encore aux Archives nationales (W 412, nº 946), un certain nombre de documents qui permettent de divulguer les faits et gestes de certains personnages devenus plus tard les coryphées de l'Empire et de la royauté. (2) Cet individu était un agent payé par Robespierre. 10
| 112 |
1792, à Jacques Guillaume Simonneau, assassiné par le peuple le 3 mars précédent (1). Les relations intimes de Clartan avec son prédécesseur médiat, dont il avait pris la défense en plusieurs circonstances, furent vues avec défiance par la faction jacobine étampoise, à la tête de laquelle se trouvait un énergumène dangereux, le citoyen Charles Constance, dit Boyard, tapissier, qui avait été officier municipal en 1791 avec Simonneau, dont il était devenu l'ennemi juré (2). Aussi, quelques sectaires haineux, qui ne pardonnaient pas à Clartan l'amitié qu'il avait portée au malheureux maire d'Étampes, victime de son respect de la loi, profitant de la loi des suspects et de la toute-puissance de Robespierre qui voulait anéantir, non seulement les hébertistes, mais tous les patriotes qui lui portaient ombrage, le dénoncèrent comme un adepte du Père Duchesne et poussèrent l'infamie jusqu'à l'accuser d'avoir empêché les denrées d'arriver à Paris. Mais comme son honnêteté, sa probité et son patriotisme étaient inattaquables, tous ses concitoyens prirent sa défense ainsi qu'on le verra plus loin, et furent assez heureux pour le sauver de l'échafaud. Comment le citoyen Clartan, qui était d'origine suisse, vint-il se fixer à Étampes ? Nous l'ignorons. Tout ce que nous savons, c'est qu'il avait été domestique au service de M. Boucher de l'Étang, ancien commissaire des guerres, décédé à Paris en 1772, et qu'ensuite il fut pourvu de l'emploi d'officier garde de la porte du comte d'Artois, frère de Louis XVI. Or, comme il avait épousé une étampoise, Marie-Anne Melun, alliée à la famille Périer, il choisit Étampes pour résidence. Quoi qu'il en soit, malgré ses attaches royalistes, il faut qu'il ait manifesté de bonne heure des opinions libérales et fait preuve de patriotisme pour avoir obtenu la confiance des sociétés populaires qui se sont fondées à Étampes après la réunion des États-Généraux, et mérité plus tard les bonnes grâces du trop fameux Couturier, représentant du peuple, qui procéda lui-même à son installation de maire. (1) Avant la Révolution, Sibillon, originaire de la Lorraine, tenait un pensionnat à Étampes. En 1785, il a fait imprimer à Orléans, chez Rouzeau-Montant, un ouvrage dédié aux magistrats de la ville d'Étampes, intitulé: Principes de traduction, qui n'est pas sans mérite au point de vue pédagogique. (2) Constance, dit Boyard, était un insigne coquin qui tut la terreur d'Étampes pendant les plus mauvais jours de la Révolution. Ses concitoyens le surnommèrent l'Argousin.
| 113 |
Le 17 ventôse an II, c'est-à-dire sept jours avant l'arrestation d'Hébert et de ses complices, le conducteur de la diligence des messageries nationales, le citoyen Desjardins, qui était possesseur d'un fusil à deux coups, dut remettre son arme au corps de garde de la Garde nationale établi au lieu dit la Maison-neuve, près les Capucins, faubourg Évezard. Cet acte, peut-être arbitraire, commis par suite d'une erreur dans l'exécution de la consigne, mais qui ne pouvait être imputé au maire, donna lieu à une plainte contre lui, comme responsable du désarmement dont avait été victime le conducteur de la diligence, ayant pour témoin un voyageur nommé Mallet, chirurgien, demeurant à Paris. Cette plainte contre le maire d'Étampes fut suivie d'une autre plus sérieuse, pour empêchement, par lui apporté, à la libre circulation des subsistances pour l'approvisionnement de Paris, et qui émanait selon toute vraisemblance de Constance Boyard et de ses acolytes. Ces dénonciations produisirent immédiatement leur effet, car quelques jours plus tard, le citoyen Clartan ayant reçu une citation à comparaître le 5 germinal (25 mars 1794) devant le Comité de Sûreté générale et de surveillance de la Convention nationale, se rendit à Paris pour répondre des faits qui lui étaient reprochés. Voici en quoi consistait cet interrogatoire, que nous reproduisons textuellement. D. Pourquoi la Garde nationale a-t-elle désarmé le citoyen Desjardins, conducteur de la diligence de Paris à Bourges, d'un fusil à deux coups? R. J'ai ouy dire qu'un citoyen avait été dépouillé de son fusil, mais j'ignore qui l'a fait. D. Avez-vous défendu à la Garde nationale de laisser passer des comestibles pour Paris? R. Non, au contraire nous avons toujours mis en réquisition pour Paris toutes nos denrées. Tout ce que nous avions défendu, c'était de les laisser sortir d'Étampes pour le reste de la Commune, si ce n'est avec ménagement et eu égard aux grands besoins que nous éprouvions nous-mêmes (1). S'il est survenu des ordres contraires, c'est plutôt le fait du comité de surveillance que le nôtre ; ce que je dis au surplus sans intention d'inculper le comité. (1) Bien que cette phrase soit peu compréhensible, elle est ainsi écrite dans l'interrogatoire.
| 114 |
Cet interrogatoire terminé et signé par Clartan, le Comité séance tenante prit l'arrêté suivant : « Le Comité de sûreté générale arrête que Clartan, maire d'Étampes, sera conduit dans les prisons de la Conciergerie, que le présent arrêté sera envoyé à l'accusateur public du Tribunal révolutionnaire, pour qu'à sa diligence il soit procédé au jugement du prévenu, charge le citoyen Chaumette de l'arrestation de Clartan ». L'arrestation du maire, basée sur des dénonciations mensongères, causa une vive émotion parmi la population et surtout dans les nombreuses sociétés patriotiques qui existaient alors. Pour contrecarrer les mauvais desseins des Jacobins étampois dont l'objectif était de discréditer et de compromettre aux yeux du Comité de sûreté générale les membres de la municipalité qui faisaient cause commune avec le maire, le lendemain 6 germinal, l'administration municipale prit un arrêté relatif à la visite des voitures publiques connues sous le nom de turgotines ou diligences(1), dans lequel, entre autres considérants, il était formellement ordonné de les arrêter si elles contenaient des subsistances de première nécessité. Pour prouver aux délateurs du citoyen Clartan que les habitants d'Étampes savaient à quoi s'en tenir sur leurs agissements aussi odieux que criminels, les commissaires de la municipalité, Périer et Brou, écrivent, le 9 germinal (28 mars), au citoyen accusateur public Fouquier-Tinville pour lui remettre les pièces servant à établir qu'aucun des membres de ladite municipalité, et particulièrement le maire, ne s'est opposé à la libre circulation des comestibles pour la commune de Paris, et s'il y a eu quelques obstacles à cet égard c'est le comité de surveillance de la commune d'Étampes qui en a été la cause… « On recueillera, ajoutent-ils, d'autres pièces par la Société populaire d'Étampes et toutes les autorités constituées de la même commune, justifiant l'innocence du maire et la pureté de son patriotisme ». Leur lettre se termine ainsi : « Nous t'invitons au nom de l'humanité et de l'innocence à faire accélérer cette malheureuse affaire en faveur d'un vieillard de 71 ans (2) et d'un citoyen que les repré- (1) On appelait turgotine une voiture publique ou diligence à huit places, attelée ordinairement de quatre chevaux, dont le ministre Turgot fut le promoteur. (2) C'est une erreur, Clartan n'avait que 68 ans.
| 115 |
sentants du peuple, Couturier et Crassous, en mission à Étampes, ont successivement nommé maire à la sollicitation de ses concitoyens ». Le 11 germinal (30 mars), le Conseil général révolutionnaire d'Étampes prit en séance publique l'arrêté suivant pour être transmis à l'accusateur public. « Le Conseil général arrête que pour détruire les impressions fâcheuses qui ont été faites au Comité de sûreté générale contre le citoyen Clartan, maire, il atteste que ledit citoyen Clartan est un vrai patriote et n'a cherché dans aucun temps à entraver la libre circulation des subsistances de la commune de Paris, et qu'il importe de lui rendre promptement la liberté et le renvoyer dans l'exercice de ses fonctions ». « Pour copie conforme Signé BROU, officier municipal ». Le même jour la Société républicaine des Sans-Culottes, dans sa séance de primidi, lui vote l'adresse suivante : « Le citoyen Clartan, contre le vœu de sa modestie, appelé par la confiance de ses concitoyens aux fonctions consécutives de notable, officier municipal et maire, y a montré constamment pendant trois ans une énergie au-dessus de tout éloge, comme au-dessus de son âge ». « Signé DUVERGER, président. BAUDE, secrétaire ». : Le Comité révolutionnaire de surveillance de la commune auquel incombait la responsabilité d'avoir empêché la libre circulation des denrées pour Paris, pour laquelle le maire n'avait fait aucune opposition, crut devoir aussi adresser à l'accusateur public une supplique écrite avec cette emphase qui caractérise l'époque, dans laquelle il rappelle la conduite de Clartan à la prise de la Bastille. Il fait savoir également qu'au mois « d'Août son cœur « bouillonnant de colère au récit de la trahison de cet infâme hypo- « crite (Louis XVI), il ne put cacher son courroux et dès le même « instant prononcer son supplice, et désire ardemment que la Con- «vention pour le punir de ses forfaits le fasse périr sur l'échafaud « et purge le sol de la liberté d'un pareil monstre ». Cette pièce ridicule est signée des citoyens Hoüaleine, président, Berchère, Dupuis, Martin, Poussin père, Levesqueau.
| 116 |
De son côté, le juge de paix Gillot lui délivre un certificat constatant son innocence. Il en est de même des marchands beurriers, coquetiers, domiciliés à Étampes, qui attestent que jamais la municipalité ne s'est opposée à l'approvisionnement de Paris. En adressant à l'accusateur public toutes ces pièces qui démontrent d'une manière irréfutable l'innocence du maire, le commissaire de la commune y joignit un mémoire en sa faveur ainsi qu'il résulte de la lettre suivante : « Paris, 20 germinal de l'an 11. Au citoyen accusateur public au Tribunal révolutionnaire à Paris. Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort. Citoyen, La commune d'Étampes m'ayant nommé son commissaire à la suite de l'affaire du citoyen Clartan, son maire, m'a chargé de t'adresser sous le nom de ce respectable citoyen un précis des faits qui confirment son innocence d'après les pièces qui t'ont été précédemment remises, et celles qui sont pour le moment entre les mains du citoyen Chauveau de la Garde que je lui ai choisi pour défenseur officieux. Le citoyen Desjardins, conducteur des messageries nationales, l'un de ses deux dénonciateurs, étant de retour depuis environ deux jours et pouvant rester à Paris pendant quatre à cinq, la Commune d'Étampes, la Société populaire et toutes les autorités constituées de ladite commune intimement convaincues de l'innocence du maire, et de la perte que son absence cause à la chose publique, par une erreur peut-être involontaire commise dans la dénonciation faite contre lui par les citoyens Desjardins et Mallet, chirurgien à Paris, rue de la Barillerie, attendent de la justice que tu voudras bien faire mettre en jugement ledit citoyen Clartan, maire, pendant le peu de temps que ledit citoyen Desjardins doit rester à Paris, ou lui faire donner ordre d'y rester jusqu'au moment que tu auras fixé pour le rapport de l'affaire devant le jury. Salut et fraternité. Le commissaire de la commune d'Etampes Signé : PÉRIER ». Dans le mémoire dont il est parlé dans cette lettre, le citoyen Périer fait valoir qu'à l'époque du siège de la Bastille, et quoique
| 117 |
âgé de 64 ans, le citoyen Clartan partit d'Étampes, armé de son fusil, pour aller partager les dangers et la gloire de ses frères. Lors du départ de la première réquisition du district d'Étampes, quelques difficultés étant survenues, fondées sur l'absence d'un volontaire, le citoyen Clartan se présenta au milieu des volontaires s'écriant: Faut-il vous montrer l'exemple, suivez-moi! J'ai 70 ans, c'est moi qui porterai le drapeau à sa destination (1). Quelques jours après l'envoi de ce mémoire, c'est-à-dire le 22 germinal (11 avril), le citoyen Gabriel Deliege, l'un des juges du tribunal révolutionnaire, procéda à l'audition de l'ennemi de Clartan, le citoyen Sulpice-Charles Constance, dit Boyard, âgé de 47 ans, tapissier, demeurant à Étampes, lequel lui a déclaré que le maire d'Étampes était anciennement attaché à l'infâme d'Artois, qu'il s'est toujours rangé du côté de l'aristocratie (2); Que le jour de la mort de Simonneau, Sibillon et Clartan sont venus le trouver à la maison commune pour l'engager à ne point insérer dans le procès-verbal le fait que Simonneau avait crié qu'on fit feu sur le peuple (3), en ajoutant qu'il ne fallait point déshonorer la mémoire d'un homme qui cependant s'était rendu infiniment coupable par ce fait atroce ; qu'il a remarqué que Clartan vivait en grande intimité avec Simonneau, qu'il a toujours regardé comme un faux patriote. Le 8 floréal (27 avril), un nommé Eynaud qui, selon toute vraisemblance, était le compère du terroriste Constance Boyard, écrit de Paris à l'accusateur public de ne pas se presser, de se méfier des députations qui lui seront adressées, le parti aristocratique étant le seul dominant dans la commune d'Étampes. Il a dévoilé, dit-il, au Comité de sûreté générale, tous les coquins du pays. Il annonce à Fouquier-Tinville que Constance Boyard part pour Étampes à l'effet de réunir tous les matériaux nécessaires, qu'il lui enverra et qu'il s'empressera de lui remettre aussitôt réception. Le 23 prairial, le citoyen Eloy, agent national des employés aux subsistances de la commune de Paris, à Étampes, apporte aussi son témoignage en faveur de Clartan, en certifiant qu'il n'a jamais dans aucun temps entravé ou cherché à entraver l'approvisionnement de (1) Clartan n'avait que 68 ans. (2) Constance Boyard fait allusion à l'emploi d'officier garde de la porte du comte d'Artois que Clartan avait occupé autrefois. (3) Ces mots sont soulignés à l'encre rouge.
| 118 |
Paris. Qu'il a cédé la halle aux blés, établie dans la ci-devant église Saint-Gilles, pour servir de supplément de magasin et faciliter l'approvisionnement dont il s'agit. Le 25 du même mois, des habitants d'Étampes, au nombre de plus de cinq cents, voyant que l'accusateur public, contrairement à ses habitudes expéditives, faisait traîner en longueur l'instruction dirigée contre leur maire qu'ils savaient innocent des crimes dont il était accusé, adressent aux citoyens Président, Juges et accusateur public du tribunal révolutionnaire, une pétition dans laquelle ils demandent que le citoyen Clartan, vieillard de 72 ans (sic), soit jugé le plus tôt possible, qu'il n'a pas été interrogé depuis quatrevingt-quatre jours qu'il est arrêté. On remarque parmi les signataires de cette pétition les noms suivants: Lemaire, Fargis, Dergny, Sébastien Gatineau, Gabaille, Malherbe, Guettard, Bataille, Bouchery, capitaine de la 4e compagnie du Nord, Bonnet, Nasson, agent national, Dramard père, Godin fils, Chevallier-Darblay, Moreau, perruquier, Lestour, officier municipal, Meslen, officier municipal, J. Pre Angot, officier municipal, Paillet, notable, Voizot, notable, Banouard, notable, Dupuis, président du comité révolutionnaire de surveillance, Martin, président de la Société populaire d'Étampes, Théodore Rousseau, Sibillon, Périer, membres, etc, etc. Malgré les nombreuses démarches faites en faveur du maire d'Étampes pour accélérer son procès, Fouquier-Tinville, qui avait été circonvenu par le citoyen Eynaud dont nous avons parlé plus haut, ne crut pas devoir prendre en considération les doléances de toute une ville, qui s'étaient manifestées par un grand nombre de pétitions émanées de toutes les sociétés populaires et des pouvoirs constitués. Enfin, après trois mois et dix jours de détention dans les prisons de la Conciergerie et du ci-devant collège du Plessis, le citoyen Clartan, avec ses co-accusés, au nombre de vingt-neuf, comparut, le 23 messidor an II (11 juillet 1794), au tribunal révolutionnaire. Voici dans l'acte d'accusation la partie qui le concerne : Antoine-Quentin Fouquier expose que, par arrêt du comité de sûreté générale de la Convention nationale, par jugement du tribunal central du jury d'accusation du département de Paris et autres arrêtés sous diverses dates,
| 119 |
« Armand Clartan, maire d'Étampes, âgé de 69 ans, né à Berney près Genève, demeurant à Étampes, département de Seine-et-Oise, a été traduit au tribunal révolutionnaire. « Qu'examen fait des pièces adressées à l'accusateur public, il en résulte que Clartan, maire d'Étampes, est prévenu d'avoir coopéré à ce système de famine imaginé par Hébert, Chaumette et autres contre la commune de Paris et d'avoir employé les manoeuvres les plus odieuses pour empêcher l'approvisionnement en s'opposant à l'arrivage des subsistances, ainsi qu'il l'a fait en défendant au Comité de surveillance d'Étampes de laisser passer aucuns comestibles pour Paris. Il paraît que c'était à Étampes un foyer de conspirations pour punir la commune de Paris, en l'affamant, des efforts qu'elle a faits, des sacrifices en tout genre auxquels elle s'est dévouée pour soutenir et affirmer la liberté et l'égalité. « D'après l'exposé ci-dessus, l'accusateur public a dressé la présente accusation contre le prévenu sus-nommé pour s'être déclaré l'ennemi du peuple français, en participant aux trames et complots formés pour affamer Paris en empêchant l'arrivage des subsistances. «En conséquence, l'accusateur public requiert qu'il lui soit donné acte de l'accusation par lui portée, et aussi qu'il soit dit et ordonné qu'à sa diligence et par l'huissier du tribunal porteur de l'ordonnance à intervenir, le prévenu sus-nommé sera pris et écroué sur les registres de la maison d'arrêt où il est détenu. «< Fait au cabinet de l'accusateur public, le 22 messidor an deux. Signé A. Q. FOUQUIER. » On remarquera que l'accusateur public n'a retenu dans l'acte d'accusation que le fait d'avoir cherché à affamer Paris, en empêchant l'arrivage des denrées et que le délit, relevé contre lui pour avoir permis à la garde nationale de service au poste de la Maisonneuve de désarmer le citoyen Desjardins, conducteur de la diligence de Paris à Bourges, a été mis de côté comme ne lui étant pas imputable. Le lendemain 11 juillet, le maire d'Étampes comparut au tribunal révolutionnaire assisté de Me Chauveau de la Garde son défenseur qui, brièvement, combattit l'accusation et démontra victorieusement l'innocence de son client, qui était victime de dénonciations odieuses et mensongères faites par ses ennemis. Après une courte délibération, le Tribunal acquitta Clartan et dix-sept autres accusés comme « n'étant pas convaincus de s'être
| 120 |
rendus coupables des délits à eux imputés, et conséquemment de s'être par là déclarés les ennemis du peuple ». Le lendemain de l'acquittement du citoyen Clartan, l'agent national près le Conseil général d'Étampes fit connaître à l'assemblée que le maire d'Étampes annonce à ses collègues le jugement qui le renvoie à ses fonctions et le désir qu'il a de s'y rendre bientôt. Il fait part également qu'il a répondu et témoigné au citoyen Clartan tout l'intérêt, la satisfaction que cette réponse était faite pour inspirer à tous les membres. Dans une séance extraordinaire du même Conseil, tenue le 28 messidor (16 juillet), le citoyen Filleau, substitut de l'agent national, fit connaître que le citoyen Clartan, maire, acquitté de l'injuste accusation portée contre lui et qui l'avait fait traduire au Tribunal révolutionnaire, est de retour, rendu à sa famille et à ses fonctions. Le citoyen Clartan continua ses fonctions de maire jusqu'au 26 brumaire an IV (17 novembre 1795), époque à laquelle fut nommée une nouvelle municipalité, composée des citoyens Petit, premier officier municipal, Bouquin, Fricaud, Hochereau, Bureau, administrateurs, Nasson, faisant fonctions de commissaire du district. Après une administration de deux années, tourmentée par les événements terribles qui s'étaient succédé, il rentra dans la vie privée, guéri pour toujours des honneurs qu'il n'avait pas sollicités et dont il avait failli être victime. Ainsi que nous l'avons rapporté, le citoyen Clartan était apparenté par sa femme à la famille Périer, dont plusieurs membres ont joué à Étampes un certain rôle pendant la Révolution, notamment Charles-César Périer, curé de Saint-Pierre, prieur du prieuré de Vitry, député d'Étampes aux États-Généraux. Elle mourut à Étampes le 21 prairial an IV (9 juin 1796) (1). (1) Aujourd'huy vingt-deux prairial l'an quatre de la République française une et indivisible, en la maison commune et par devant moy officier public soussigné, Est comparu le citoyen Joseph Clartan, demeurant au Parray (sic), lequel m'a déclaré que le jour d'hier, au domicile du citoyen Armand Clartan, ancien maire de cette commune, était décédée Marie-Anne Melun, âgée de soixante-seize ans, native de cette commune, épouse dudit citoyen Armand Clartan. . D'après laquelle déclaration, moy officier public, me suis transporté audit domicile et après m'être assuré dudit décès, j'ay rédigé le présent acte, en présence dudit citoyen Joseph Clartan, beau-frère de la décédée, déclarant, et du citoyen Jean-Vallery Périer,
| 121 |
Armand Clartan, qui était plus jeune que sa femme, lui survécut 17 ans. Il est mort à Étampes le 14 février 1813, à l'âge de 87 ans, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès reproduit ci-dessous, que nous devons à l'obligeance de notre excellent confrère et compatriote M. Ch. Forteau (1). Ainsi disparut du monde ce témoin du grand drame de la Terreur, qui eut le courage, malgré son âge avancé, d'administrer la ville d'Étampes pendant la période la plus difficile et la plus dangereuse de la Révolution. PAUL PINSON. homme de loy, greffier en chef du jury d'accusation et tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement d'Étampes, y demeurant, rue Darnatal, neveu de la décédée, à cause de Anne-Magdelaine Basset, son épouse, témoins qui ont signé avec moy. - - Signé Petit, officier public — Périer Clartan. (1) Du lundi quinze février mil huit cent treize, heure de midi. Acte de décès de M. Armand Clertan dit Clartan, âgé de quatre-vingt-sept ans, propriétaire, ancien maire de la ville d'Étampes, domicilié en cette ville, rue du Peray, décédé d'hier à deux heures de relevée. Sur la déclaration faite par les sieurs Jean-Vallery Périer, avocat, greffier en chet du Tribunal civil, âgé de 60 ans, et de François Clertan, propriétaire, cultivateur à ChatillonMichaille, arrondissement de Nantua, département de l'Ain, âgé de 33 ans, neveu du décédé, qui ont signé. Lecture faite. Signé Périer père : - Clertan Armand Périer (petit-neveu).
| 122 |
PERIN JULES PÉRIN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE CORBEIL-ÉTAMPES (1834-1900) Un ancien, dont j'ai oublié le nom, écrivait cette sentence, qui peut servir d'épigraphe à la présente notice: Lorsqu'on ignore le passé de son pays, on est un étranger chez soi. La vie tout entière de Jules Périn, sous ses formes multiples, a été consacrée à l'étude de l'histoire, non pas celle de notre grande patrie, la France, mais celle d'une fraction, bien minime il est vrai, depuis l'époque préhistorique jusqu'aux temps qui précédèrent la Révolution de 1789. Très chercheur, très curieux, de ce qui avait trait au passé des contrées où il aimait à séjourner, depuis le lieu de sa naissance, la capitale de l'Artois, qui l'a nommé membre correspondant de son Académie, jusqu'à Ris-Orangis et à Mers-sur-Mer, près du Tréport, où il fonda le Comité d'Études de la vallée de la Bresle, son activité ne connaissait pas de bornes.
| 123 |
Marcheur infatigable, sitôt qu'un vestige de monument, une inscription, une pierre quelconque lui étaient signalés, il partait aux renseignements, visitant les lieux, interrogeant les vieillards, les femmes, les enfants; il était d'une patience et d'une ténacité incroyables dans ses enquêtes. Plusieurs de nos collègues, qui l'ont accompagné dans diverses excursions locales, doivent avoir gardé le souvenir des conférences documentées, où il développait, avec une éloquence abondante, colorée et pleine d'humour, le résultat de ses découvertes. Pas un détail ne lui échappait, et si un doute se produisait dans son esprit, il allait aux sources, fouillait les Bibliothèques, les archives communales, et au besoin, si c'était possible, compulsait les minutes des notaires et des greffiers. Pendant son séjour à Ris-Orangis, qui était le lieu préféré de sa villégiature, il passait de longues heures à la Bibliothèque de Corbeil, scrutant les vieux livres, les estampes anciennes, recherchant les traces laissées par les personnages illustres qui avaient habité les châteaux de l'arrondissement de Corbeil. Il avait réuni un certain nombre de documents précieux et inédits concernant les communes de l'arrondissement, notamment celle de Ris-Orangis dont il se proposait d'écrire une monographie complète. Malheureusement, son trépas prématuré ne lui a pas permis de mettre au jour cette œuvre intéressante. Une de ses dernières préoccupations avait été de découvrir la sépulture où avaient été ensevelis les restes de Duquesne. On sait que le chef des escadres de Louis XIV était protestant, ce qui empêcha le roi de l'élever à la dignité d'amiral. Cependant il le nomma marquis et érigea en marquisat la terre du Bouchet. C'est là qu'il mourut, et fut inhumé. Jules Périn, sur les instances du conseil municipal de Dieppe, ville natale de Duquesne, se rendit à la poudrerie du Bouchet, où le très aimable colonel directeur se mit à sa disposition, mais toutes les recherches furent vaines, et il fallut renoncer définitivement à tout espoir de retrouver la sépulture du grand marin. Je pourrais raconter à l'infini de semblables incidents de la vie de Jules Périn, je me suis borné à citer celui relatif à Duquesne parce qu'il avait trait à une illustre et historique personnalité. Avec notre regretté collègue, l'archéologie devenait un charme, et un plaisir délicat, même pour les moins érudits de ses auditeurs,
| 124 |
amme 1 HI TE fransk te A clicite ie Stinene, zar i calles te nemare in Les mis les tomments 12sete a fontane lame4861 ter intrutes et les arts a grande Exocation de 00, 1 ruda, e le ant neme 1 I t di ottobre row. It a petit Palais. ti se presagiert a four te davent so Riebrang s61187 atcmbreux mittears contact gere Is Tententhe celebre a Paris, en de sca so a 24 Cartonnet, et 11 second a humation fans in caveat de famille, ado mettere de cette commune, en presence de parents, d'amis, et hab tants accoms pour la rendre les derniers devoir. Asres a termeres theres. A Tilet, pariant au nom de la société de la Montagne Sainte-Genemere, font Jules Périn était le fondateur, a retrace dans the emorvante allocution, la vie de labeur et de dévouement 1 1 setence de Jales Périn. Après cet hommage a l'homme public et au savant la rappelé les vertus de l'homme crive. Tous ceux qui ont connu “ont aimé, a-t-il dit en terminant, et est de ceux sur la tombe desquels on pourrait écrire cette devise: PERTRANSIT BENEFACIENDO Il a passé sur la terre, en répandant ses bienfaits. E. DELESSARD.
| 125 |
NÉCROLOGIE
La liste des pertes subies ces temps derniers par notre Société n'est pas longue, mais elle est particulièrement douloureuse. La plus sensible pour nous est celle de M. Jules Périn, dont la mort foudroyante, arrivée le 24 octobre 1900, a causé une profonde émotion à ses nombreux amis. Avocat de talent, archéologue lettré, il rendait de continuels services et savait, avec la plus grande obligeance, mettre son expérience et sa science à la disposition de qui en avait besoin, car il était la bonté même. Non content d'être membre de nombreuses sociétés savantes et de plusieurs commissions importantes, dont celle municipale du Vieux Paris, il avait fondé sa chère Société de la Montagne Sainte-Geneviève pour laquelle il donnait, sans compter, son temps et son bien, et encore une société et un musée à Tréport-Mers, qu'il habitait dans la belle saison. De nombreux journaux de Paris et de province lui ont consacré des articles élogieux que nous avons pieusement recueillis.. Mais si la perte de M. J. Périn est grande pour les œuvres qu'il avait créées, elle n'est pas moins pénible pour la Société de Corbeil-Étampes: ouvrier de la première heure, il l'avait encouragée à ses débuts et ne cessait de lui donner l'appui de ses conseils et de ses travaux. Membre du Conseil d'administration depuis l'origine, il était bien rare qu'il manquât à nos réunions, où nous étions heureux de profiter de son expérience et de ses bons avis; c'est pourquoi nous tous, ses collègues, ressentons vivement la perte de cet homme aimable et bienveillant qui laisse parmi nous un vide qui ne sera pas de sitôt comblé. Un de ses amis de Paris, également membre de la Société de Corbeil-Étampes, lui a consacré une notice affectueuse que l'on
| 124 |
L'ouverture de notre musée de St-Jean à Corbeil lui causa une véritable joie. Notre Société avait désormais un temple pour abriter ses collections. Elle grandissait chaque année et nous pouvions en toute sécurité être assurés de son avenir. Jules Périn, que l'on peut considérer à juste titre comme l'un de ses protagonistes les plus ardents, s'employait activement à la propager; conférences, brochures, articles de journaux etc., rien ne pouvait lasser sa persévérance. Malheureusement, il faut bien le reconnaître, la multiplicité de ses travaux dépassait les forces humaines; il s'est surmené, car à toutes ses fonctions il en joignait d'autres, celles de membre du conseil d'administration de la société des Amis des monuments parisiens, de président de la Société historique de la Montagne SainteGeneviève, de membre de la Commission des antiquités et des arts de Seine-et-Oise, etc. etc. Pendant la grande Exposition de 1900, il organisa des conférences-promenades, et, le jour même où il fut frappé de mort subite, le 24 octobre 1900, il avait, au petit Palais, tenu sous le charme de sa parole imagée, les nombreux auditeurs qui se pressaient autour de lui, ne se doutant guère qu'ils l'entendaient pour la dernière fois. Un premier service funèbre a été célébré à Paris, lieu de son domicile, à l'église Saint-Nicolas du Chardonnet, et un second à Ris-Orangis où a eu lieu l'inhumation dans un caveau de famille, au cimetière de cette commune, en présence de parents, d'amis, et de nombreux habitants accourus pour lui rendre les derniers devoirs. Après les dernières prières, M. Valet, parlant au nom de la société de la Montagne Sainte-Geneviève, dont Jules Périn était le fondateur, a retracé, dans une émouvante allocution, la vie de labeur et de dévouement à la science de Jules Périn. Après cet hommage à l'homme public et au savant, il a rappelé les vertus de l'homme privé. Tous ceux qui l'ont connu l'ont aimé, a-t-il dit en terminant, et il est de ceux sur la tombe desquels on pourrait écrire cette devise: PERTRANSIIT BENEFACIENDO Il a passé sur la terre, en répandant ses bienfaits. E. DELESSARD.
| 125 |
NÉCROLOGIE La liste des pertes subies ces temps derniers par notre Société n'est pas longue, mais elle est particulièrement douloureuse. La plus sensible pour nous est celle de M. Jules Périn, dont la mort foudroyante, arrivée le 24 octobre 1900, a causé une profonde émotion à ses nombreux amis. Avocat de talent, archéologue lettré, il rendait de continuels services et savait, avec la plus grande obligeance, mettre son expérience et sa science à la disposition de qui en avait besoin, car il était la bonté même. Non content d'être membre de nombreuses sociétés savantes et de plusieurs commissions importantes, dont celle municipale du Vieux Paris, il avait fondé sa chère Société de la Montagne Sainte-Geneviève pour laquelle il donnait, sans compter, son temps et son bien, et encore une société et un musée à Tréport-Mers, qu'il habitait dans la belle saison. De nombreux journaux de Paris et de province lui ont consacré des articles élogieux que nous avons pieusement recueillis.. Mais si la perte de M. J. Périn est grande pour les œuvres qu'il avait créées, elle n'est pas moins pénible pour la Société de Corbeil-Étampes: ouvrier de la première heure, il l'avait encouragée à ses débuts et ne cessait de lui donner l'appui de ses conseils et de ses travaux. Membre du Conseil d'administration depuis l'origine, il était bien rare qu'il manquât à nos réunions, où nous étions heureux de profiter de son expérience et de ses bons avis; c'est pourquoi nous tous, ses collègues, ressentons vivement la perte de cet homme aimable et bienveillant qui laisse parmi nous un vide qui ne sera pas de sitôt comblé. Un de ses amis de Paris, également membre de la Société de Corbeil-Étampes, lui a consacré une notice affectueuse que l'on
| 126 |
trouvera ci-contre, ornée d'un portrait de notre regretté collègue, que nous devons à la généreuse initiative de son plus cher ami. A. D. Un autre décès, qui nous touche moins directement, mais qui nous a grandement attristés, est celui de M. Séré-Depoin, le fondateur et le président à vie de la société-sœur de Pontoise et du Vexin français. C'était aussi un dévoué, celui-là, qui consacrait à cette Société qui était son œuvre, son temps, ses deniers, ses travaux. Ancien maire de Pontoise, il a rendu à cette ville de signalés services à l'époque terrible de la guerre allemande, et il y a subi luimême des malheurs qui ont pesé lourdement sur les années qui lui restaient à vivre. Pourra-t-on jamais, à la Société de Pontoise, remplacer ce vaillant et généreux bienfaiteur? Nous ne le savons, mais comme membre de la Société de Pontoise, nous prenons une vive part au chagrin que cause à nos collègues la mort de leur Président bien-aimé, et nous leur souhaitons, sinon de le remplacer, ce qui est difficile, au moins de lui trouver promptement un successeur qui puisse continuer l'œuvre de M. Séré-Depoin, parvenue aujourd'hui à un si haut degré de prospérité. A. D. Pour clore cette liste funèbre nous avons encore à signaler la mort d'un excellent confrère, Monsieur l'abbé Damoiseau, curé de Saint-Germain-lès-Corbeil, décédé le 24 août 1900, victime de son dévoûment. C'est en allant visiter des malades, atteints d'un mal éminemment contagieux (la variole), qu'il contracta le germe de cette cruelle affection qui l'emporta en peu de jours. Nouveau venu dans la paroisse de St-Germain, M. l'abbé Damoiseau n'était pas des nôtres depuis longtemps; mais devant cette mort tout accidentelle d'un homme jeune et robuste, nous saluons avec respect le sublime dévoûment de ce soldat du Christ tombé au champ d'honneur.
| 127 |
BIBLIOGRAPHIE
G. GIRARD. - Versailles illustré. 4° année, nº 45, 20 Décembre 1899 et 20 janvier 1900. Juvisy-s-Orge. Charmante notice, richement illustrée de 18 belles gravures et due à la plume alerte de notre sympathique collègue M. Girard. L'auteur a su retrouver des documents inédits qui éclairent d'un jour tout nouveau l'histoire de ce beau domaine, aujourd'hui morcelé. (Il en a été fait un tirage à part). Paul QUESVERS et Henri STEIN. - Inscriptions de l'ancien diocèse de Sens, publiées d'après les estampages d'Edmond Michel. Paris, 1897-1900. 2 forts vol. in 4º, de plus de 750 pages chacun. T. I et II. Les deux auteurs de ce grand travail ne sont pas des inconnus pour nous, puisqu'ils font partie de notre Société. C'est une pieuse pensée qui les a portés à l'entreprendre ; ils ont voulu en effet satisfaire un des plus chers désirs d'un ami disparu, Edmond Michel, en publiant ce grand ouvrage dont il avait préparé les éléments. Une partie de notre arrondissement appartenait à l'ancien diocèse de Sens, c'est pourquoi Corbeil et beaucoup de noms de notre région sud se retrouvent fréquemment dans les tables de noms qui accompagnent chaque volume. Ces deux volumes sont les premiers, l'ouvrage entier devra en former cinq; dans l'un des trois qui restent à publier, Corbeil et ses environs doivent tenir une plus large place. L'Abbé GLIMPIER. St-Sulpice de Favières, par l'Abbé A. Glimpier, curé de St-Sulpice de Favières. Étampes, 1899. in 16, de 32 pages. Petite monographie à l'usage des visiteurs, où l'auteur a réuni des renseignements qui ne se trouvent pas ailleurs. Paul PINSON. - Noël satyrique du XVIIIe siècle sur les dames de la haute Société Étampoise. Étampes, 1900. in 8º, de 16 pages, tiré à 20 exemplaires. Curieux document tiré, par notre confrère, de son inépuisable collection. 11
| 128 |
Étampes pittoresque, guide du promeneur dans la ville et l'arrondissement, texte par M. Maxime Legrand, avec le concours de MM. Léon Marquis et René Ravault. Étampes, 1900. Seconde partie de cette charmante publication, dans laquelle l'auteur promène les lecteurs dans l'arrondissement d'Étampes, en décrivant, avec sa verve habituelle, les sites et les monuments de cette contrée, le tout artistiquement illustré par l'habile crayon de M. R. Ravault. En cours de publication, sept livraisons ont déjà paru. - - QUENTIN-BAUCHART (Ernest). Les Farcinistes et leur livre. Extrait du Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire, nº 8, 15 août 1900, pp. 369 à 381. Histoire d'une secte religieuse qui procédait quelque peu du Jansénisme et qui prit naissance, vers 1775, dans un village nommé Farcins, dans l'ancien diocèse de Lyon, aujourd'hui département de l'Ain. L'un des chefs de cette secte, Claude Bonjour, vint s'établir à Corbeil vers 1791; il s'y fit cordonnier pour vivre et recruter des adeptes. Vers 1800, la police expulsa les Farcinistes de Paris et de Corbeil. Un curé de campagne en rupture de vœux, qui vivait avec deux femmes illuminées ; un de ses nombreux enfants, nommé Élie, érigé et stylé en bon Dieu; des folles hystériques et quelques ouvriers fanatisés et à moitié fous, tel était l'État-Major du Farcinisme, qui n'existe plus qu'à l'état de légende. On assure cependant qu'il y en a encore une centaine à Paris et peut-être quelque-uns à Farcins. Il nous a paru intéressant de signaler ici cette secte qui a existé quelque temps à Corbeil. A. D. Annuaire du département de Seine-et-Oise pour 1900, Versailles, Cerf. In 12, de 581 pages. Comme les années précédentes, l'annuaire de 1900 ne contient que des renseignements administratifs. Almanach-Annuaire de l'arrondissement de Corbeil et des cantons limitrophes pour l'année 1900. Corbeil, imp. Crété. Almanach récréatif, illustré de quatre gravures hors texte donnant des vues de Corbeil et contenant des notices historiques sur quelques communes de l'arrondissement. Il y a lieu d'espérer que le nombre de ces notices ira en augmentant, car il serait utile que chaque commune eût la sienne. Almanach d'Étampes et annuaire de l'arrondissement pour 1900. Étampes, imp. Humbert-Droz, in 16 à 2 colonnes, 128 pp. avec annonces. - FORTEAU (Ch.). Les registres paroissiaux du canton de Méréville. Pussay. Fontainebleau. imp. Bourges, 1899, in 8° de 33 pp.
| 129 |
Cette monographie de l'importante commune de Pussay est un extrait du travail que s'est imposé notre patient confrère M. Forteau, c'est-à-dire la publication des registres paroissiaux des environs d'Étampes (Tirage à 50 exempl. des Annales de la Société historique du Gâtinais). - De DION (le Cte A.). — Croquis Montfortois. Tours, imp. Deslis, 1900, in 4º de 70 pp. orné de 30 gravures, représentant des sites et des monuments de Montfort-l'Amaury ou de ses environs. Publiés par la Société archéologique de Rambouillet. Comme le dit très simplement, dans sa courte préface, l'éminent Président de la Société archéologique de Rambouillet, il publie ces matériaux, rassemblés par lui, pour les historiens de l'avenir qui seraient tentés d'écrire l'histoire de Montfort-l'Amaury. ― GASSIES (G.). Coup d'œil sur l'Archéologie du moyen âge, d'après les monuments français et, en particulier, d'après ceux du département de Seine-et-Marne et de la région avoisinante, in 8°, de 171 pp. avec gravures dans et hors texte. Meaux, Le Blondel, 1899. Extrait du Bulletin de la Société littéraire et historique de la Brie. Géographie pittoresque et monumentale de la France. L'Ile de France, comprenant dix fascicules in 8°. Paris, E. Flammarion, 1899. BARRON (L.). Les fleuves de France, la Seine. In 8º de 312 pp. avec 175 dessins par A. Chapon. Paris, Laurens, 1899. 11 Réimpression d'un ouvrage paru en 1889. GATIN (L. A.). - Essai historique, un village: Saint-Martin-laGarenne (S.-et-O.), in 8º xvII et 247 pp. avec gravures. Paris, imp. Levé : Société d'édition et de librairie, 1900. POUSSIN (Henri), architecte. — Notice avec plans et dessins sur les nouvelles prisons départementales de Fresnes-les-Rungis, in 4º, de 33 pp. de texte, avec 19 dessins dans le texte, 4 planches doubles hors texte et carte des environs de Fresnes. Paris, Aulanier et Cie, édit. 1900. BROCHET (J.). — Annuaire de l'Enseignement primaire en Seineet-Oise pour 1900, par J. Brochet, secrétaire de l'inspection académique; in 16. Versailles, Cerf. Paris, librairie centrale de Seineet-Oise. COLINET (C.). -Les voies de communication en Seine-et-Marne, par C. Colinet, conducteur principal honoraire des Ponts et Chaussées. 2º série, in18, de 55 pp. Fontainebleau, imp. Bourges, 1900. Extrait du journal l'Abeille de Fontainebleau.
| 130 |
Département de Seine-et-Oise. Conseil général, session ordinaire d'Août 1899. Rapport du Préfet et de la commission départementale. Versailles, Cerf, 1899, in 8º, de 1147 pp. On y trouve, page 543, le rapport de l'Archiviste du département (notre sympathique confrère, M. Emile Coüard), qui contient des extraits concernant le bailliage d'Étampes, et l'énumération des versements faits aux archives départementales par l'administration de l'enregistrement. Il est utile de noter ici que, parmi ces versements, figuraient de volumineux dossiers versés par le receveur de l'enregistrement de Corbeil, au nombre desquels se trouvaient des registres, inventaires et autres papiers qui provenaient de l'ancien Prieuré de Notre-Dame-des-Champs à Essonnes. - MARTIN-SABON. Supplément au Catalogue des photographies archéologiques faites dans les villes, bourgs et villages de l'Ile de France et dans les provinces de Picardie, Normandie, Bretagne, Touraine, etc., d'après les monuments, églises, châteaux, etc., par F. Martin-Sabon, ingénieur des arts et manufactures. Janvier, 1899, Petit in-8°, à 2 colonnes, 44 pp. Paris, Giraudon, éditeur. Le Catalogue proprement dit avait paru en 1896. Compte-rendu des opérations du Comice agricole de Seine-etOise en 1899. Versailles, Cerf, in-8º, de 187 pp. - A. Dufour. — Supplément au Catalogue méthodique de la bibliothèque communale de la ville de Corbeil, par A. Dufour, Bibliothécaire-Archiviste de la ville. Paris, 1900, in-8° de vi et 210 pp. Le Catalogue méthodique de la bibliothèque de Corbeil a paru en 1889. FORTEAU (Ch.). - Méréville pendant la Révolution (1788-1804). Extraits des registres municipaux, recueillis et annotés par Ch. Forteau. Étampes, 1899, in-12 de Iv et 108 pp. D AUBERT (Charles). Les brigands de Montlhéry; pièce tragicomique en un acte. Paris, Mouriot, édit., 1900, in-8° de 12 pp. à deux colonnes. Commission des antiquités et des arts du département de Seineet-Oise (Commission de l'inventaire des richesses d'art). Tome XXme. Versailles, imp. Cerf, 1900, in-8° de 121 pp. COUDERC (C.).— Œuvres inédites de Pierre de Blarru et documents sur sa famille, par Camille Couderc, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. Besançon, imp. Jacquin, 1900, in-8°, 29 pp. Extrait du Bibliographe moderne, nº 2, de 1900. Généalogie de la famille des fondateurs du Collège de Boissy
| 131 |
et de la lignée de Châlo-Saint-Mard. Paris, Champion, 1899, in folio. A. BESNARD. - La lignée de Châlo-Saint-Mard. Vannes, imp. Lafolye, in-4° de 33 pp. Extrait de la Revue des questions héraldiques, archéologiques et historiques. Le Centenaire de la machine à papier continu, son invention par Nicolas-Louis Robert, en 1799, à la papeterie d'Essonnes de M. Didot-Saint-Léger. Biographie de l'inventeur par J. Bréville. Historique des divers perfectionnements apportés à la machine Robert, par Didot-Saint-Léger (1800-1818). Imprimerie Firmin-Didot et Cie au Mesnil (Eure). Paris, librairie Didot, 1900. In-8° de 80 pp. et 2 planches. - Depuis peu de temps, on a fait sortir de l'injuste oubli, où elle était tombée, la mémoire de ce pauvre inventeur qui dota son pays, sans profit pour lui-même, d'une des plus importantes inventions des temps modernes. Plusieurs ouvrages récents se sont occupés de Louis Robert et de sa machine à papier continu (1, celui-ci est un nouvel hommage rendu à sa mémoire et à son génie par une des plus vieilles maisons de la papeterie et de l'imprimerie. Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français. Année 1899 (juillet): l'Abbaye de Notre-Dame, et les Budé, seigneurs d'Yerres, par Jacques Pannier, pasteur de l'église réformée de Corbeil, 2 pp. in-8°. Même Bulletin (Septembre). Les séjours et la sépulture d'Abraham du Quesne au Bouchet (2), 1682-1688, par le Pasteur J. Pannier, 7 pp. in-8°. Même Bulletin (Décembre). Troisième centenaire de l'autorisation du culte public à Ablon. Inauguration du temple de VilleneuveSt-Georges, par le Past. J. Pannier, une page avec gravure. Versailles illustré. Décembre 1900. Oberkampf, par A. Dutilleux, gravures. Notice écrite par notre érudit confrère à l'occasion de l'inauguration du monument élevé, à Jouy, à la mémoire d'Oberkampf. Description de Paris, par Arnold Van Buchel. Extrait du T. XXVI des mémoires de la Société de l'histoire de Paris, pp. 59 à 196. (1) Voir dans le Bulletin de notre Société, la bibliographie des années précédentes. (2) Commune de Vert-le-Petit, canton d'Arpajon, arrondt de Corbeil.
| 132 |
Cette description est extraite et traduite d'un manuscrit latin appartenant à la bibliothèque d'Utrecht et prêté par cette ville à la Bibliothèque Nationale de Paris. L'auteur, Van Buchel, a séjourné à Paris de 1585 à 1587. C'était un érudit doublé d'un archéologue, aussi cette relation de son voyage en France est-elle fort intéressante. Mais ce qui lui donne une grande valeur pour nous, c'est qu'il est venu visiter Corbeil au mois de janvier 1586 et qu'il en donne une description, qui occupe les pages 157 à 159 des mémoires de la Société de l'Histoire de Paris. Dans le manuscrit original, deux dessins représentent, l'un, les ruines du vieux château qui servait de tête de pont du côté des faubourgs, l'autre, la forteresse bâtie par Louis VJ, et dont l'emplacement est occupé aujourd'hui par les grands moulins de Corbeil. Prévenu à temps, nous avons pu aller à la bibliothèque Nationale prendre des photographies de ces deux dessins. Cette description est un peu sommaire, mais elle est la plus ancienne connue et, à ce point de vue, elle a un grand intérêt pour nous. A. D. Louis XV à Petit-Bourg, en 1735, chez le duc d'Antin, texte et note. Bulletin de la Sté de l'Histoire de Paris, 1900, 1re livr., p. 47. Rapport sur les Archives du département de Seine-et-Oise, 18971899, présenté au Conseil général par M. Coüard, archiviste du département. Extrait du bulletin de la Sté de l'histoire de Paris, 1900, 2º livr., p. 91 et suiv. Une partie de ce rapport intéresse notre région. Alphonse de Courcel, sénateur. Notice biographique avec portrait. s. 1. n. d. (Paris 1900), pet. in 16 carré, 32 pp. Edition de propagande, publiée à l'occasion du renouvellement partiel du Sénat. La ville de Versailles, son histoire, ses monuments, ses rues, par Auguste Jehan. - Versailles, L. Bernard, 1900. Ce petit volume, sans prétention, sera, pour les habitants de Versailles et les étrangers qui visitent cette ville, un guide sûr et précis; quoique sommaire, il contient une foule d'indications nouvelles et inédites et est illustré par trois artistes versaillais fort appréciés. Musée de sculpture comparée (moulages). Palais du Trocadéro. Catalogue raisonné, publié sous les auspices de la Commission des monuments historiques, par Louis Courajod et P. Frantz-Marcou. XIVe et XVe siècles. Paris, imp. nat., 1892. No 643. - Haymon, premier Comte de Corbeil (Xe siècle). Statue funéraire surmontant son tombeau dans l'église Saint-Spire de Corbeil. Suit une description de cette statue que les auteurs attribuent au 1er tiers du
| 133 |
XIVe siècle; ils la font suivre de l'article de Millin sur le tombeau et la statue du Comte Haymon; une belle gravure de la statue accompagne cet article. Il y a lieu de faire remarquer ici que le Musée du Trocadéro renferme encore les moulages des deux statues, dites Clovis et Clotilde, qui proviennent de l'Eglise Notre-Dame de Corbeil, dont, avec six autres de même style et de même époque, elles ornaient le portail. Mais ces statues, aujourd'hui à St-Denis, sont du XIe siècle, c'est pourquoi les auteurs de ce catalogue ne s'en sont point occupés. Catalogue de la Bibliothèque de la Commission des monuments historiques, dressé par A. Perrault-Dabot, archiviste de la Commission. Paris, imp. nat., 1895, in-8°. N° 1708. Monographie de l'église Saint-Spire de Corbeil, d'après un manuscrit attribué au baron de Guilhermy, s. d., in-4°. lithographie. No 1541. - - Livret-Catalogue des objets d'art et de curiosité du musée d'Etampes, précédé du réglement. Etampes, 1875, in-16. No 2193ª. Pèlerinage à Notre-Dame de bonne garde, ou notice sur l'église de Longpont, et l'antique Confrérie rétablie en ce lieu par ordonnance de Mgr l'évêque de Versailles et enrichie des indulgences de l'église. Paris, 1852, in-12. Archives de la Commission des monuments historiques. Catalogue des relevés, dessins et aquarelles, dressé par A. PerraultDabot, archiviste de la Commission. Paris, imp. nat., 1899. in-8°. texte encadré. – Page 321. Athis-Mons, Eglise (clocher). Elévation de la façade nord, coupe, plan, détail de l'étage supérieur et autres détails, par Selmersheim, 1866. N° d'inventaire: 6956. Page 323. Chennevières, Église. Etat actuel, plan et coupe longitudinale, à omoi par mètre, coupe transversale et face principale, par Garrez,,1852. Inventaire: 2760. - Pages 324-325. Etampes, église Notre-Dame. 1º Plan général. 2º Élévation de la façade méridionale. 3° Porte méridionale, plan, coupe et élévation. 4º Elévation de l'Abside. -5° Coupe longitudinale. 6º Coupe transversale, détails (chapiteau). 7° Coupe longitudinale, détails (statues, rosaces), par Laisné, 1851. Inventaire: 3827 à 3833. Nos 8 à 13. Plan général de la ville, coupe et détails de restauration du clocher (calques) par Lucien Magne, 1815 (?) (1). — - (1) Cette date nous paraît erronée, nous la copions telle qu'elle est, en faisant des réserves.
| 134 |
Invent. 5409 à 5414. N° 14, Église Notre-Dame, détails de la base de la flèche, plan, coupe, élévation, par Selmersheim, 1866, Invent. 6953. No 15, Plan, coupe transversale de l'église, coupe et élévation du clocher. Détails, par Selmersheim, 1874. Invent. 7243. - Etampes. Église Saint-Martin. Reconstruction du comble de la tour, élévation du comble. Charpente du comble, plan et élévation. Plan de la tour et du portail. Auteur et date inconnus. Inventaire: 2907 à 2909. Etampes. Eglise Saint-Basile. Plan à omoi par mètre. Face principale, coupe transversale, porche, face latérale droite, par Petitgrand. s. d. Inventaire: 9024 et 9025. Page 325.- La Ferté-Alais. Plan, élévation de la face principale, par Garrez; 1846. Invent. 2899. Id. Vue perspective, façade principale, coupe longitudinale, coupe sur le clocher; plan, pile de la nef, corniche du clocher, détail de la tourelle de l'escalier, par A. Ballu, 1875. Invent. 7402. Id. Charpentes: plan, coupe, élévation, état actuel. Charpentes: projet de réfection. Charpentes: projet de réfection (duplicata) par de Baudot, 1884. Inventaire: 9651 à 9653. Page 327. Juvisy. Pont des Belles-Fontaines. Plan et coupe longitudinale à om005 par mètre; détail d'un des groupes du pont et de son piédestal à omo4 par mètre; vues perspectives (côtés d'amont et d'aval), coupe transversale à omo05 par mètre, par H. Poussin, 1885. Inventaire : 9363. Page 331.- Montlhéry. Château. Plan général du château à omo05 par mètre, plans et élévation des tours et du mur d'enceinte. Plans et coupe de la tour principale à omo2 par mètre, par H. Labrouste, 1843. Inventaire: 2863 et 2864. Page 332. Morigny. Eglise. Vue perspective (Sépia), plans général et particulier, par Garrez, 1846. Inventaire : 2882 et 2883. Page 337. Viry-Châtillon. Grotte de Piédefer d'Aigues. Plan et coupe à omo05 par mètre, par Petitgrand. s. d. Invent. 11036. Les monuments historiques de France, par E. du Sommerard. Paris, imp. nat., 1876, in-4°. On trouve dans cet ouvrage la liste des monuments historiques de toute la France. Nous croyons faire œuvre utile en indiquant ici ceux des arrondissements de Corbeil et d'Étampes que nous avons relevés parmi tous ceux de Seine-et-Oise.
| 135 |
Athis-Mons. Eglise (clocher), Corbeil. Eglise Saint-Spire. Etampes. Eglise Notre-Dame, Eglise Saint-Basile. Tour Guinette. La Ferté-Alais. Eglise. La Queue-en-Brie. Tour de l'ancien Château (1). Longpont. Restes de l'Eglise de l'ancienne Abbaye. Montlhéry. Restes de l'ancien Château. Morigny. Restes de l'ancienne Abbaye. Les Archives de la Commission des monuments historiques, par Perrault-Dabot. Paris, 1900. in-8°. gravures.. Nous n'avons à signaler dans ce volume qu'une très jolie gravure du pont des Belles-Fontaines à Juvisy-sur-Orge, d'après le dessin de M. H. Poussin, qui fait partie des Archives de la Commission. JOURNAUX ET REVUES L'Echo Arpajonnais, journal des vallées de l'Orge, de l'Essonnes, de l'Yvette et de la Bièvre. Le No du 5 janvier 1899 contient un article important de M. Paul Allorge, sur l'ancienne porte de Paris à Montlhéry. C'est un cri d'alarme, que pousse notre confrère, sur la démolition de cette porte, projetée par le Conseil municipal de Montlhéry. L'Echo de Villeneuve-St-Georges, revue de la paroisse et des familles. Mensuel. rre année. No í, janvier 1900. Lyon, imp. Paquet. in-16 à 2 col. 8 pp. Les Echos du clocher de Verrières-le-Buisson Ire année. No 1, janvier 1900. Lyon, imp. Paquet. in-16 à 2 col. 8 pp. Association amicale des instituteurs et institutrices publics de Seineet-Oise. Bulletin mensuel. Ire année, Nº 1, Juin 1900. in-8° 18 pp. publié à Paris et à Versailles. Le journal de Brunoy, organe des intérêts communaux de VilleneuveSt-Georges, Montgeron, Crosne, Yerres, Mandres, Villecresnes, Périgny, Boussy, Varennes, Santeny, Quincy, Epinay et Brunoy. Hebdomadaire. Comme toutes les communes citées ci-dessus appartiennent à l'arrondissement de Corbeil, il en résulte que les notices historiques qui y sont insérées de temps à autre sont intéressantes pour nos environs, surtout celles qui sont dues à la (1) Cette tour n'existe plus.
| 136 |
plume savante de notre confrère, M. Ch. Mottheau, l'historique du pont de Boussy, par exemple, qui occupe plusieurs Nos à partir du 11 février 1900. Le Petit écho du Commerce et de l'Industrie, littéraire, judiciaire, annonces et avis divers, intermédiaire des propriétaires et locataires. Bulletin spécial à l'arrondissement de Corbeil, paraissant le 15 de chaque mois. Ire année, No 3, 18 février 1900. 8 pp. in 8°. Nº L'Abeille de Seine-et-Oise, arrondissements de Corbeil et d'Etampes, bi-hebdomadaire. 9 et 13 juillet 1899. le Pont de Ris, par J. Périn. 18 octobre 1899. Notices historiques sur Grigny, Ablon et Villeneuve-SaintGeorges. 1599-1899, par le Pasteur J. Pannier. 5 février 1900. Article sur l'ouverture du temple protestant de VilleneuveSaint-Georges. 3 juin 1900. Compte-rendu très détaillé de la cérémonie d'inauguration du monument de Victor Duruy, à Villeneuve-Saint-Georges, le 27 mai 1900. Le Petit Journal. 5 février 1900, un temple à Villeneuve-SaintGeorges. L'indépendant de Seine-et-Oise, organe républicain de CorbeilEssonnes et de l'Arrondissement, hebdomadaire. 18 mars 1900. Article sur Mauzaisse, Bourgoin, de la Barre et les quais de Corbeil. L'Intermédiaire des chercheurs et curieux. N° 813. 20 octobre 1898, p. 555. Curieux article où l'on rapporte, d'après le Mercure de Janvier 1737, l'ouverture d'un tombeau, qui eut lieu en 1706, dans l'église de Bretigny-s.-Orge, à la suite de laquelle on mit au jour les restes parfaitement conservés d'une femme qui avait été inhumée en cette église en 1587. 30 octobre 1900, p. 767. Notice nécrologique sur notre regretté confrère M. Jules Périn. 15 Décembre 1900, page 1012. Un incendie violent à Corbeil en 1775, d'après une lettre du poète Colardeau, du 26 octobre 1775, adressée à son oncle, curé de Pithiviers. La Loi, journal judiciaire. Article nécrologique important sur M. Jules Périn, dans le N° du 30 octobre 1900. Le Messager Eudois. Nº du 11 Novembre 1900. Panégyrique, avec portrait, de M. Jules Périn, qui était propriétaire à Mers et était très connu au Tréport et à la ville d'Eu. Corbeil-Journal, organe républicain. Hebdomadaire. Journal fondé à Corbeil à la fin de 1900.
| 137 |
Nº 2, 26 octobre 1900. Découverte de vases gallo-romains dans une sablière entre Brévannes et Valenton. Le progrès de Rambouillet et de Dourdan. Dans le No du 6 octobre 1900 de ce journal, notre sympathique collègue, M. Lorin, de Rambouillet, a donné une notice biographique, avec portrait, de M. G. de Linière, ancien Sous-Préfet de Corbeil et ancien Président d'honneur de notre société, à laquelle il n'a pas cessé de témoigner le plus vif intérêt. Dans cette notice, l'auteur suit pas à pas M. de Linière depuis son entrée dans la carrière jusqu'à sa nomination à la Sous-Préfecture de Rambouillet, en passant par les différents postes qu'il a occupés à la satisfaction générale. Nous connaissions cet aimable fonctionnaire que nous avons toujours su apprécier, mais M. Lorin, poursuivant son étude biographique, nous le présente aujourd'hui sous un jour tout nouveau pour nous, c'est-à-dire comme érudit et archéologue. Il nous apprend en effet que M. de Linière débuta dans les lettres par un savant travail sur l'Acropole d'Athènes, où il montra que l'art chrétien n'était que le prolongement de l'art merveilleux des Grecs. : Le génie grec attirait M. de Linière; il le prouva en consacrant un second ouvrage à Démosthènes et à l'art oratoire à Athènes. Le succès de ces travaux en amena d'autres; M. de Linière publia successivement des études sur divers sujets historiques la guerre des Albigeois et les guerres de religion jusqu'à la Ligue, la Bibliothèque d'Alexandrie et sa destruction en 640, et il met en ce moment la dernière main à un travail important sur le Cardinal Mazarin, qu'il a documenté de correspondances inédites, puisées aux ministères de la guerre et des affaires étrangères. Nons savions que notre ancien Président d'honneur était un administrateur aussi bienveillant qu'habile, mais c'est une véritable révélation pour nous d'apprendre qu'il est en même temps écrivain de talent et historien, et, comme nous n'oublions pas le rôle important qu'il a joué dans la formation de notre Société, dont il a été le véritable fondateur, c'est un devoir de reconnaissance pour nous, et pour notre part nous l'accomplissons avec plaisir, de nous associer de tout cœur aux éloges mérités que vient de lui décerner notre collègue et ami, M. Lorin. A. D. Le Courrier de Versailles et de S.-et-O. Hebdomadaire. Deux articles sont consacrés à Oberkampf dans les Nos du 27 octobre 1900 et 3 novembre suivant ; ils ont été écrits à l'occasion de l'inauguration, qui eut lieu le 28 octobre 1900, du monument élevé à Jouy-en-Josas à la mémoire de ce grand industriel; le premier de ces articles est à la fois biographique et historique, le second rend compte de la cérémonie d'inauguration. L'Echo de Versailles et de Seine-et-Oise. Hebdomadaire. Article sur Oberkampf dans le No du 21 octobre 1900, à propos de l'inauguration du monument d'Oberkampf qui doit avoir lieu le 28 octobre suivant,
| 138 |
CHRONIQUE
Le dimanche, 27 mai 1900, Villeneuve-St-Georges était en fête : on inaugurait solennellement ce jour-là le monument élevé par souscription, dans cette commune, à la mémoire de Victor Duruy, l'éminent historien, le grand ministre de l'instruction publique, qui a vécu de longues années à Villeneuve-St-Georges, où il est mort et où il repose dans le cimetière de la commune. Cette cérémonie était présidée par M. Leygues, ministre de l'instruction publique, accompagné de M. le Préfet de Seine-et-Oise et d'une délégation de l'Institut. Tous les hauts fonctionnaires du département, les députés, les sénateurs, les pompiers et une foule de sociétés diverses, venues de tous les points de Seine-et-Oise, s'étaient joints au cortège officiel. De nombreux discours ont été prononcés, par M. Gréard, vice-recteur de l'Académie de Paris, M. Leygues, ministre de l'instruction publique, M. Roucher, maire de VilleneuveSt-Georges, M. Gaston Boissier, de l'Académie française, MM. G. Picot et Wallon de l'Institut, MM. Gabriel Monod, Combes, Cazalet, etc. etc. Un temps magnifique a favorisé cette belle cérémonie, qui s'est terminée fort tard et dont tous les détails ont été rapportés dans le No du 3 juin 1900 de l'Abeille de Seine-et-Oise, et dans les No suivants pour les discours, cités in extenso. A. D. Le 28 Octobre 1900, on a inauguré en grande pompe le monument élevé, à l'aide d'une souscription publique, à Jouy-en-Josas, en l'honneur et à la mémoire du grand industriel que fut Oberkampf. Bien que cette cérémonie eût lieu à Jouy-en-Josas, en dehors de notre arrondissement, les villes de Corbeil-Essonnes ne pouvaient
| 139 |
s'en désintéresser, car Oberkampf a laissé de durables souvenirs chez nous par la création de la filature et de la tixeranderie de Chantemerle, et encore de cette usine, sœur de celle de Jouy, connue dans notre pays sous le nom de l'Indienne, et qui n'existe plus depuis un petit nombre d'années. C'est dans cette usine
C. P. OBERKAMPF qu'Oberkampf installa son frère et son neveu Samuel Widmer, et où ce dernier inventa les machines à graver les dessins, qui devaient augmenter dans une large mesure la production des usines de Jouy et d'Essonnes. Oberkampf est donc des nôtres par son séjour à Essonnes, par les établissements industriels qu'il y a créés, par le mariage de sa fille et par sa descendance restée en grande partie dans notre pays.
| 140 |
Il se maria deux fois; de son premier mariage il eut deux fils qui moururent jeunes et une fille, Julie Oberkampf, qui épousa M. Louis Feray, grand industriel et propriétaire de Chantemerle, mort en 1836. De cette union naquirent quatre enfants: Amélie Feray, épouse de M. de Champlouis, Baron et Pair de France; Julie Feray, épouse de M. de Salvandy, ministre de l'instruction publique sous Louis-Philippe; Henry Feray, général de division, qui devint le gendre du Maréchal Bugeaud; et enfin Ernest Feray, le Sénateur, qui continua à Essonnes l'œuvre de son grand-père Oberkampf. Corbeil et Essonnes ont d'ailleurs manifesté leur reconnaissance envers cette famille en donnant à quelques-unes de leurs voies publiques les noms de tous ses membres. C'est ainsi que nous avons, rien qu'à Corbeil, la rue Oberkampf, la rue Feray, la rue Widmer, la rue de Champlouis et la place de Salvandy. Plusieurs discours ont été prononcés à cette fête d'inauguration : celui de M. Haussmann, député de la circonscription, était remarquable autant dans la forme que par le fonds; aucun des orateurs n'a eu garde d'oublier l'épisode de Napoléon Ier détachant sa propre croix d'officier de la Légion d'honneur pour la placer sur la poitrine d'Oberkampf, lors d'une visite qu'il faisait à Jouy. Cette scène a été reproduite par un joli dessin d'Isabey, qui se trouve maintenant au musée de Versailles, et a été depuis popularisé par la gravure. On en voit une reproduction dans un des salons de la Mairie de Corbeil. Nous avons emprunté quelques détails de cette notice à une biographie d'Oberkampf due à la plume de M. de Salvandy, son petitfils par alliance; nul n'était mieux désigné pour l'écrire. Cette biographie est ornée du portrait d'Oberkampf, reproduction du beau tableau de Gérard que nous avons vu si longtemps dans le grand salon de Chantemerle, et que nous reproduisons pour accompagner cet article. A. D. L'année 1900 a vu se terminer les travaux qui avaient été entrepris pour sauver d'une ruine imminente le curieux clocher de l'église d'Athis-Mons. Cet intéressant monument historique, restauré dans son style primitif et rendu à sa beauté première, pourra maintenant défier longtemps encore les injures du temps, sinon celles des hommes, qui souvent, hélas! sont plus meurtrières.
| 141 |
Cet heureux résultat est dû au dévoûment éclairé du maire d'Athis-Mons, qui a pris l'initiative de cette belle restauration et a su trouver les ressources nécessaires pour l'accomplir. Dans sa séance du 6 juin 1900, la société des Antiquaires de France a élu M. A. Dufour, de Corbeil, membre associé correspondant national de la société des Antiquaires de France (Journal des débats, 9 juin 1900). ERRATUM Nous avons reçu la lettre suivante de M. Le Paire de Lagny: Dans le Bulletin de notre Société, 1re livr. de 1899, page 39 (Les Vicomtes de Corbeil), M. Depoin dit: « Nous ignorons si c'est lui, Simon II, ou son oncle Simon I, dont le tombeau « monumental de marbre… « Une aquarelle de Gaignières nous a conservé la vue de ce monument, «< note 130, série Pe 5, nº 3970 du Catalogue publié ». Il y a là une erreur : le N° 3970 indique bien la série Pe 5, folio 9, avec l'indication: Simon de Corbeil, mais l'aquarelle indiquée ne représente pas le tombeau d'un des deux Simon, mais celui du comte Haymon. En examinant l'aquarelle, j'ai reconnu de suite le tombeau du comte Haymon, de plus j'ai pu lire dans l'inscription en lettres dorées : Le bon Comte Hémon, jadis Comte de Corbeil. J'ai fait rectifier le Catalogue et le folio 9 de la série Pe 5 qui, au lieu du nom de Simon, porte aujourd'hui celui de Hémon. Dans les dessins de Gaignières, je ne trouve aucun tombeau du Comte Simon. LE PAIRE. Dans le même Bulletin, pages 164-165, M. Depoin dit encore: M. de Rilly, qui prépare un travail historique sur Oysonville, nous a signalé quatre documents tirés des Archives d'Eure-et-Loir… M. de Rilly rectifie ainsi la fin de cette phrase : … quatre documents tirés des archives du Château d'Oysonville. Même Bulletin, page 172 (Chronique). Bruyères-le-Châtel, châsse de SaintVivien. Cette châsse n'est point à Bruyères-le-Châtel, mais à Bruyères-sur-Oise, près de Beaumont. Le document qui nous a fourni ce renseignement disait Bruyères tout court, c'est ce qui nous a induit en erreur. Notre Confrère, M. le chanoine Marsaux, a décrit ce curieux reliquaire dans le T. XI des Mémoires de la Société de Pontoise. Il est toujours bon de rectifier une erreur; on nous en signale une qui nous avait échappé. C'est à la page 84 du Bulletin de 1898, la note 2, tout au bas de la page, dit ceci : Guillaume IV de Meaux Boisboudran, 72e grand Prieur de France, est mort le 2 octobre 1739. C'est le 2 octobre 1639 qu'il faut lire.
| 142 |
TABLE DE LA 6 ANNÉE
Statuts et réglement de la Société . Liste des membres Conseil d'administration, bureau, comités Sociétés correspondantes • Page V XI XVIII XX Compte rendu des séances. Un condamné à mort au XVIIe siècle, par M. A. Dufour. Mandres et ses anciens fiefs, par M. Ch. MOTTHEAU. Description de l'Hôtel-Dieu de la ville d'Étampes en 1785, par M. Paul PINSON. • Le premier couronnement de la Rosière à Étampes en 1789, par M. Ch. FORTEAU • XXI I • 16 • 30 38 Jean de Montaigu, seigneur de Marcoussis: Une erreur judiciaire au moyen âge, Réhabilitation du condamné, par M. E. DELESSARD Bibliothèque de la Société. • Compte-rendu des séances. Assemblée générale du 5 juillet 1900 L'Assemblée provinciale de l'Ile-de-France, par M. Fernand BOURNON • Histoire d'un village: Soisy-sous-Étiolles, par M. l'abbé 42 45 117 47 60 E. COLAS 79 Un Baptême en l'église Saint-Basile d'Étampes, par M. Ch. FORTEAU. 105 • Un épisode de la Terreur. Le citoyen Armand Clartan, maire d'Etampes, au tribunal révolutionnaire, par M. Paul PINSON . Jules Périn, membre du Conseil d'administration de la Société de Corbeil-Étampes, par M. E. DELESSARD Nécrologie. Bibliographie. Chronique. Erratum. · GRAVURES: IIO 122 125 127 138 141 Tombeau de Jacques Bourgoin dans l'église Saint-Spire de Corbeil · Porte de l'ancien Cloître Saint-Spire, à Corbeil (cul-delampe). Plans des fiefs de Mandres. Médaillon de M. Jules Périn. Portrait d'Oberkampf . . I 15 • pp. 16, 24, 26, 28 122 139