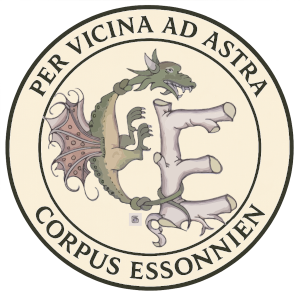Ceci est une ancienne révision du document !
SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D'ÉTAMPES ET DU HUREPOIX
Bulletin n°16 (1910)
PAGE EN CONSTRUCTION
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHEOLOGIQUE 1102) DE CORBEIL D'ÉTAMPES ET DU HUREPOIX 15e Année MIKA YO 1 re LIVRAISON HURE POL — - 1909 ETAMPER PARIS AT ALPHONSE PICARD ET FILS, ÉDITEURS. LIBRAIRES DES ARCHIVES NATIONALES ET DE LA SOCIÉTÉ DE L'ÉCOLE DES CHARTES Rue Bonaparte, 82 MCMIX
SOMMAIRE DU 1er BULLETIN DE 1909 Statuts et règlement de la Société Liste des membres. • Conseil d'administration, bureau, comité de publication. Sociétés correspondantes Compte-rendu des séances. Assemblée générale du 7 juin 1909. Recherches sur l'Atelier monétaire de Corbeil (1643-1657), par M. Emile CREUZET.. La Grande Boucherie de Philippe-Auguste et l'Hôtel Saint-Yon, à Étampes, par M. L.-Eug. LEFÈVRE. La Paroisse de Saint-Pierre d'Etampes (suite et fin), par M. Ch. Forteau. Les Sœurs Augustines à Corbeil (1643-1792), par M. A. Dufour. ― . GRAVURES • · Plan de la Halle d'Etampes et de ses environs en 1825. Pl. I. Grand Hôtel Saint-Yon et dépendances. Pl. II-III-IV. Pignon, lucarne, tourelle. V XI XXII XXIII I 6 16 32 47 59 32 43 44 Les demandes de rectifications ou modifications des noms ou adresses de la liste des membres, ainsi que de tous renseignements se rapportant à la Société ou au Bulletin, doivent être adressées à M. DUFOUR, Secrétaire général, rue du 14 Juillet, 21, à Corbeil. Pour ce qui regarde les cotisations et la comptabilité, on devra s'adresser à M. PoPor père, Allées de Saint-Jean, à Corbeil. Le Conseil d'administration laisse aux auteurs l'entière responsabilité des opinions qu'ils pourront émettre dans leurs écrits. чело
BULLETIN 100 HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DONAL p DE CORBEIL D'ÉTAMPES ET DU HUREPOIX Famous Paved mor Mist-ops DE LA SOCIÉTÉ 15e Année Rullaly diese Viln W batononl honest cislinEur the CORNEIL 2 LIVRAISON - CHUMEPOR Bomb 1909 PARIS ALPHONSE PICARD ET FILS, ÉDITEURS LIBRAIRES DES ARCHIVES NATIONALES ET DE LA SOCIÉTÉ DE L'ÉCOLE DES CHARTES Rue Bonaparte, 82 ETAMPES MCMIX
SOMMAIRE DU 2e BULLETIN DE 1909 Promenade archéologique du 5 juillet 1909, à Etampes. La Chevalerie Etampoise, par M. J. DEPOIN.. L'ancien château d'Etiolles, en 1700, par M. A. Dufour. L'artillerie de Corbeil au xvie siècle (1534), par M. A. D. Les Sœurs Augustines à Corbeil (1643-1792), par M. A. DUFOUR. Origine et explication d'une tapisserie au xvIe siècle, par M. T. PINARD. Notice historique sur l'église et le cimetière St-Nicolas, de Corbeil, par M. Emile CREUZET. Bibliographie. Chronique 5 septembre 1909. Journal officiel du 12 janvier 1910. Une découverte. L'inondation de la Seine, à Corbeil, en janvier 1910. Nécrologie.. · · - - GRAVURE Ancien parement d'autel à l'Abbaye de St-Victor de Paris. 532000 65 73 94 98 104 106 108 129 136 141 106 Les demandes de rectifications ou modifications des noms ou adresses de la liste des membres, ainsi que de tous renseignements se rapportant à la Société ou au Bulletin, doivent être adressées à M. DUFOUR, Secrétaire général, rue du 14 Juillet, 21, à Corbeil. Pour ce qui regarde les cotisations et la comptabilité, on devra s'adresser à M. POPOT père, Allées de Saint-Jean, à Corbeil. Le Conseil d'administration laisse aux auteurs l'entière responsabilité des opinions qu'ils pourront émettre dans leurs écrits. to BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL D'ÉTAMPES ET DU HUREPOIX 16e Année CORNEIL 1 re LIVRAISON EURE FO veller $ — - 1910 STAMPES PARIS ALPHONSE PICARD ET FILS, ÉDITEURS LIBRAIRES DES ARCHIVES NATIONALES ET DE LA SOCIÉTÉ DE L'ÉCOLE DES CHARTES Rue Bonaparte, 82 MCMX SOMMAIRE DU 1er BULLETIN DE 1910 Statuts et règlement de la Société Liste des membres. . Conseil d'administration, bureau, comité de publication. Sociétés correspon dantes Le Dr Paul Boucher, par M. A. D. . Compte-rendu des séances. • · · Un manuscrit de l'abbé Guiot, par M. A. D. Les cantons du district de Corbeil, département de Seine-et-Oise, 1790 (Sera continué). La poudrerie d'Essonnes et l'explosion du 27 octobre 1788, par M. A. D. Les portes de Corbeil, par M. A. DUFOUR. GRAVURE · Le Docteur Paul Boucher (1841-1909). V XI XXII XXIII I 4 8 II 57 61 Les demandes de rectifications ou modifications des noms ou adresses de la liste des membres, ainsi que de tous renseignements se rapportant à la Société ou au Bulletin, doivent être adressées à M. DUFOUR, Secrétaire général, rue du 14 Juillet, 21, à Corbeil. Pour ce qui regarde les cotisations et la comptabilité, on devra s'adresser à M. PoPor père, Allées de Saint-Jean, à Corbeil. Le Conseil d'administration laisse aux auteurs l'entière responsabilité des opinions qu'ils pourront émettre dans leurs écrits. BULLETIN 2 DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL D'ÉTAMPES ET DU HUREPOIX 16e Année 1910 2 LIVRAISON TET YO PARIS ALPHONSE PICARD ET FILS, ÉDITEURS LIBRAIRES DES ARCHIVES NATIONALES ET DE LA SOCIÉTÉ DE L'ÉCOLE DES CHARTES Rue Bonaparte, 82 — STAMPE MCMX SOMMAIRE DU 2º BULLETIN DE 1910 Assemblée générale du 25 juillet 1910. Un manuscrit de l'abbé Guiot. Les cantons du district de Corbeil, département de Seine-et-Oise, 1790, par M. A. D.. Un épisode de la légation du Cardinal Chigi en France (1664), par M. Claude COCHIN. Hachette en amphibole trouvée au Mesnil-Voisin (Bouray), par M. Maxime LEGRAnd. - Bibliographie. Chronique annuelle (Association des Dames Françaises (Croix-Rouge). Une vue de Corbeil. Vigneux. Inauguration d'un monument au grand marin du Quesne) Nécrologie (MM. Soupault. Clément. Mathurin. Legros. Nourry. - Privé. J. Leroy) Les rues de Corbeil en 1821. · ―― • - < GRAVURES • Hachette en amphibole. Ex-libris de l'Abbé Guiot, avec portrait (à intercaler en regard de la page 11, 1re livraison). 65 77 133 138 143 150 153 156 140 Les demandes de rectifications ou modifications des noms ou adresses de la liste des membres, ainsi que de tous renseignements se rapportant à la Société ou au Bulletin, doivent être adressées à M. DUFOUR, Secrétaire général, rue du 14 Juillet, 21, à Corbeil. Pour ce qui regarde les cotisations et la comptabilité, on devra s'adresser à M. POPOT père, Allées de Saint-Jean, à Corbeil. Le Conseil d'administration laisse aux auteurs l'entière responsabilité des opinions qu'ils pourront émettre dans leurs écrits. чело BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE ANNÉE 1909. - Ire LIV. - DE CORBEIL, D'ÉTAMPES ET DU HUREPOIX A. MONTDIDIER. —- IMPRIMERIE BELLIN BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL D'ÉTAMPES ET DU HUREPOIX 15e Année CONFEIL печень ― 1909 ETAMPER PARIS ALPHONSE PICARD ET FILS, ÉDITEURS LIBRAIRES DES ARCHIVES NATIONALES ET DE LA SOCIÉTÉ DE L'ÉCOLE DES CHARTES Rue Bonaparte, 82 MCMIX |V| SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D'ÉTAMPES ET DU HUREPOIX STATUTS Approuvés par arrêté préfectoral en date du 19 février 1895 S458S6 V.15-16 ARTICLE I. Une Société est fondée à Corbeil sous le titre de Société Historique et Archéologique de Corbeil, d'Étampes et du Hurepoix. Elle a pour but les études, les recherches et les publications concernant l'histoire et l'archéologie de notre contrée et des régions circonvoisines, ainsi que la description et la conservation des monuments anciens situés dans ces mêmes régions. Elle a son siège à Corbeil et tiendra ses séances soit à la SousPréfecture, soit à la Mairie, avec l'autorisation préalable du SousPréfet ou du Maire. - ―――――――― ART. II. La Société s'interdit toutes discussions ou publications politiques ou religieuses. ART. III. La Société se compose de tous les fondateurs et, en nombre illimité, des personnes qui, adhérant aux Statuts, sont admises par le Conseil sur la présentation de deux membres. Le Conseil peut aussi désigner des membres correspondants qui seront nommés par l'Assemblée générale. 053 |VI| Les mineurs ne seront admis dans la Société que sur le consentement soit de leurs parents, soit de leur tuteur. ART. IV. Le titre de fondateur est acquis: 1° aux signataires des présents statuts, 2° à tout membre qui fait don à la Société d'une somme de cent francs au moins. ―――― ART. V. Chaque sociétaire paie une cotisation annuelle de dix francs; cependant cette cotisation est réduite à cinq francs pour les personnes appartenant au clergé et à l'enseignement. ART. VI. Tout membre adhérent qui aura effectué un versement de cent francs au moins sera exonéré du paiement des cotisations annuelles. ――― ―――― ART. VII. La Société est administrée par un Conseil composé de vingt et un membres, élus pour trois ans en Assemblée générale. Ce Conseil se renouvelle chaque année par tiers. Les membres sortants sont rééligibles. ―― ART. VIII. Le Conseil, sur la proposition du Comité de publication, statue sur l'impression des travaux et la composition des bulletins; il soumet aux auteurs les modifications qu'il juge nécessaires et détermine l'ordre des insertions. - ART. IX. Aucune dépense ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une délibération du Conseil. Le trésorier ne doit effectuer aucun paiement sans le visa du Président ou d'un Vice-Président. ART. X. La Société se réunit tous les ans, au mois de mai, en Assemblée générale, soit à Corbeil, soit dans toute autre ville désignée par le Conseil. Cette assemblée nomme les membres du Conseil. Elle entend les rapports qui lui sont présentés par le Conseil et qui sont relatifs à l'état des travaux et à la situation financière de la Société. - Elle délibère sur toutes les propositions qui lui sont soumises par le Conseil. ART. XI. La Société pourra organiser des excursions archéologiques, faire exécuter des fouilles, établir une bibliothèque, un musée, acquérir, recueillir ou recevoir, à titre de dons manuels, tous les objets et documents qui l'intéressent. Toutes ces questions seront décidées par le Conseil. ― ART. XII. Les membres correspondants reçoivent les publications de la Société et sont affranchis de toute cotisation. ―――― 1 |VII| ART. XIII. En cas de dissolution de la Société, les membres titulaires, réunis en une Assemblée générale spécialement convoquée à cet effet, seront appelés à statuer sur la liquidation de l'actif social et sur la destination des collections appartenant à la Société. ART. XIV. – Les présents Statuts pourront être modifiés par l'Assemblée générale, sur une proposition écrite et signée de dix membres au moins, mais aucune modification ne deviendra exécutoire qu'après avoir été autorisée par l'autorité compétente, en exécution de l'article 291 du Code pénal. ART. XV et dernier. Un règlement intérieur, adopté par l'Assemblée générale, arrête les conditions de détail propres à assurer l'exécution des présents Statuts et le bon fonctionnement de la Société. ――― Vu par le Vice-Président : P. BOUCHER. Vu et soumis à l'approbation de Monsieur le Préfet de Seine-et-Oise. Le Sous-Préfet de Corbeil, G. DE LINIÈRE. Le Préfet de Seine-et-Oise, Chevalier de la Légion d'honneur, autorise la « Société Historique et Archéologique de Corbeil, d'Étampes et du Hurepoix » à se constituer légalement, en vertu de l'article 291 du Code pénal et conformément aux présents Statuts. Fait à Versailles, le 19 février 1895. Pour le Préfet, Le Secrétaire-général délégué, DUFOIX. |VIII| RÈGLEMENT SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE LA CORBEIL, D'ÉTAMPES ET DU HUREPOIX Arrêté par l'Assemblée générale du 4 Décembre 1894 ―――― DE ARTICLE I. Messieurs les Sous-Préfets de Corbeil et d'Etampes sont Présidents d'honneur de la Société. ART. II. Le Conseil, conformément à l'article VII des statuts, désigne, chaque année parmi ses membres, un Président, deux ou plusieurs vice-Présidents, un Secrétaire général, un Secrétaire rédacteur et un Trésorier. - ART. III. Le Président ouvre et dirige les séances, maintient l'ordre dans les discussions, fait exécuter les statuts et les décisions de la Société, la convoque pour les séances ordinaires et extraordinaires et ordonnance les dépenses. En cas d'absence des Président et vice-Présidents, le Conseil est présidé par le plus âgé des membres présents. ART. IV. Le Secrétaire général est chargé, sous la direction du Conseil, de la composition et de la rédaction du bulletin ; il veille à l'impression et à la correction de toutes les publications de la Société ; il se met en rapport avec les auteurs et leur soumet, s'il y a lieu, les observations approuvées par le Conseil, sur le rap. port du Comité de publication. Il fait annuellement à l'assemblée générale un rapport sur les travaux de la société ; enfin il remplit les fonctions d'archiviste. |IX| ART. V. Le Secrétaire rédacteur rédige les procès-verbaux des séances et est chargé de tout ce qui se rapporte à la correspondance. ――― ART. VI. Le Trésorier est chargé du recouvrement des cotisations annuelles; il paie les dépenses ordonnancées et donne, chaque année, à la séance générale, un état de la situation financière de la Société. - ART. VII. Le Conseil se réunit tous les trois mois; cependant le Président peut le convoquer chaque fois que les intérêts de la Société l'exigent. ART. VIII. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des suffrages; pour qu'elles soient valables, sept membres au moins doivent être présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. ―― - ART. IX. Le Conseil statue sur les demandes d'admission et désigne la catégorie à laquelle doit appartenir chaque candidat admis, afin de déterminer le montant de sa cotisation, conformément à l'article V des statuts. ww Les délibérations du Conseil ont lieu au scrutin secret, et les noms des candidats refusés ne sont pas inscrits au procès-verbal. ART. X. - Les décisions du Conseil ordonnant une dépense sont transmises sans retard au Trésorier par un extrait du procès-verbal, signé du Secrétaire rédacteur. ART. XI. Les fonds disponibles de la Société seront déposés à la caisse d'épargne de Corbeil ou dans toute autre caisse désignée par le Conseil. ART. XII. L'ouverture de l'année sociale est fixée au 1er janvier. Tout candidat admis doit sa cotisation à partir du 1er janvier de l'année de son admission. ART. XIII. La Société publiera un bulletin périodique et, si ses ressources le lui permettent, elle pourra également publier des mémoires et des documents. – ART. XIV. Un Comité de publication, composé d'un vicePrésident et du Secrétaire général, membres de droit, et de cinq membres choisis par le Conseil et renouvelables chaque année, proposera la publication, sous les auspices de la Société, des mémoires et documents dont il aura apprécié la valeur réelle. - |X| ART. XV. Les Sociétaires ont droit à toutes les publications de la Société à partir de l'année de leur admission. ART. XVI. Tous les Sociétaires peuvent assister aux séances du Conseil, mais ils ne peuvent prendre part aux votes. Le Président peut leur donner la parole quand ils ont à faire des communications qui rentrent dans l'ordre des travaux de la Société. Cependant le Conseil peut se former en Comité secret sur la demande de deux de ses membres. — ART. XVII. Les auteurs pourront faire exécuter, à leurs frais, des tirages à part des travaux publiés par la Société. Tout tirage à part devra porter la mention du volume dont il aura été extrait. Aucun tirage à part ne pourra être mis en circulation avant la publication par la Société du travail dont il est l'objet. ART. XVIII. Les demandes de modifications aux statuts devront être adressées au Président quinze jours au moins avant l'assemblée générale; il en sera fait mention sur les lettres de convocation. — - ART. XIX et dernier. Le présent règlement pourra être modifié par le Conseil, sur la proposition et à la majorité de sept membres au moins. - Afin d'assurer l'envoi exact de nos publications, Messieurs les Sociétaires sont instamment pries d'indiquer à M. le Secrétaire général, leurs changements de domicile, de titres, ou toutes autres rectifications. |00000029| LISTE DES MEMBRES Les noms précédés d'un astérisque (*) sont ceux des MEMBRES FONDATEURS qui ont racheté leur cotisation. MM. ALLAIN, Maire de Soisy-sous-Étiolles, 12, rue Godot de Mauroi, à Paris (IXe). ALLEZ, au château de Belesbat, par Boutigny (S.-et-O.) et à Paris, rue de Berri, 5 bis (VIII). ALLORGE, Professeur de dessin à Montlhéry (S.-et-O.). AMIOт, avocat à la Cour, 207, Boulevard St-Germain, Paris (VII®). AMODRU, député, 66, avenue des Champs-Elysées, Paris (VIII). ARGELIES, Député de Seine-et-Oise, à Juvisy (S.-et-O.). AUBLET-DELAUNAY (Mme), 173, Boulevard Péreire, à Paris (XVIIe). *AUBRY-VITET, Archiviste-Paléographe, 69, rue de Varenne, à Paris (VII). ASHER, à Berlin (Allemagne). AUSCHER, ingénieur expert, 24, rue La Fayette, à Versailles. BABIN, Maire d'Arpajon, à Arpajon (S.-et-O.). BARREAU (Eugène), Juge au tribunal de commerce de Corbeil, à Ris-Orangis (S.-et-O.). BARTHÉLEMY (Louis), ingénieur, 5, avenue de Villiers, à Paris (XVII). BARTHÉLEMY (Mine vve), rue Feray, à Corbeil. BARTISSOL, Maire de Fleury-Mérogis, par Saint-Michel-surOrge, et 17, avenue du bois de Boulogne à Paris (XVI®). BASSERIE (Mile), 49, rue St-Vincent, au Mans (Sarthe). BAUDELOT, avocat, 2, rue de Miromesnil, Paris (VIII). BEGLET (Armand), rue du Cirque, 3, à Paris, et à Villefranchesur-Mer, Alpes-Maritimes, à l'usine à gaz. *BERANGER (Charles), 4, rue de Marignan, Paris (VIII). *BERNON (le Baron de), à Palaiseau, et à Paris, 3, rue des Saints-Pères (VI). |00000030| XII BIBLIOTHÈQUE (la) COMMUNALE DE CORBEIL, représentée par M. DUFOUR, bibliothécaire. * MM. BIZEMONT (le Comte de), 8, rue Girardet, à Nancy (M.-et-M.). BLONDEAU, Architecte à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne). BOBIN, pharmacien à Étampes. BOËTE, Instituteur, à Villecresnes (S.-et-O.). BONNEFILLE, ancien Sénateur de Seine-et-Oise, à Massy (S.-et-O.). BONNEFOY, à Paris, rue de la Paix (IIe). BONNIN, (l'Abbé), Curé d'Ablon (S.-et-O.). +*BOSELLI (Paul), 130, rue Royale, à Lille (Nord), et 32, cours la Reine, Paris (VIIIe). BOUCHER (Dr Paul), Médecin en chef de l'Hôpital de Corbeil. BOUGIN (Louis), à Paris, 3, place Jussieu (Ve). BOUILLOUX-LAFONT, banquier à Etampes. BOUJU-TANDOU (J. Albert), 45, avenue Marceau, à Paris (XVI). BOULANGER, 19, quai Bourbon, Paris (IV). BOULÉ (Alphonse), Juge de paix honoraire, à Lignières (Cher). *BOURDIN (Lucien), ingénieur chimiste, à Corbeil. BRICARD, propriétaire, à Corbeil. BRINON, vice-président de la chambre de commerce de Corbeil-Étampes, à Pussay (S.-et-O.). BROSSELIN, propriétaire à Étiolles, par Corbeil et à Paris, 89, boulevard Malesherbes (VIII). BRUNOY (la Commune de) (S.-et-O.). BUNEL, agent d'assurances, 8, rue de la Cordonnerie, Etampes. CALLIET, banquier, ancien Maire de Corbeil. CANOVILLE, Maire de Mennecy (S.-et-O.). CARNOT (François), 8, avenue Montespan, à Paris (XVIe). CAUVIGNY (l'Abbé), curé de Ballancourt (S.-et-O.). *CAUVILLE (Paul de), ancien Sénateur, à Port-Toutevoye par Gouvieux (Oise) et à Paris, 7, Boulevard Beauséjour (XVI®). CAYRON (l'Abbé), Curé de Lardy (S.-et-O.). CHAMBON, ancien avoué à Corbeil, 2, rue Villaret de Joyeuse, à Paris (VIII). *CHATONEY (Eugène), 6, rue Meissonier, à Paris (XVII). CHERON, à Lardy (S.-et-O.). CHEUVREUX, à Étiolles par Corbeil, et à Paris, 4, rue de Téhéran (VIII®). |00000031| XIII MM. CHEVALIER (Léon), Conseiller-Maître honoraire à la Cour des Comptes, à Soisy-sous-Étiolles, et à Paris, 216, rue de Rivoli (Ier). CIBIEL (Alfred), Député de l'Aveyron, au château de Tigery, et 53, rue Saint-Dominique, à Paris (VII). CLAVIER (MI), professeur à Corbeil. CLAVIER (Paul), Architecte, 21, rue de la Cordonnerie, Etampes. CLAYE, notaire à La Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne). CLEMENT, Architecte de l'arrondissement, à Etampes. CLÉMENT (l'Abbé, Curé de Thoiry (S.-et-O). COCHIN (Henry), Député du Nord, au château de Mousseau par Evry-petit-Bourg, et à Paris, 5, avenue Montaigne (VIII). COLLARDEAU DU HEAUME (Philéas), 6, rue Halévy, à Paris (IX“). COLLÈGE (le) GEOFFROY-SAINT-HILAIRE, à Etampes. COLLOMP, 31, rue Marbeuf, Paris (VIII). + COPPÉE (François), membre de l'Académie française, 12, rue Oudinot, à Paris (VII). COTHEREAU, Président du tribunal civil, à Corbeil. COURAUD (l'Abbé), curé de Garches (S.-et-O.). *COURCEL (le Baron Alphonse de), sénateur, au château d'AthisMons (S.-et-O.), et à Paris, 10, boulevard Montparnasse (XV). + COURCEL (Georges de), à Vigneux, et à Paris, 178, boulevard Hausmann (VIII). * COURCEL (Robert de), secrétaire d'Ambassade, à Vigneux (S.-et-O). *COURCEL (Valentin de), à Athis-Mons (S.-et-O.), et à Paris, 20, rue de Vaugirard (VI). CREUZET, principal clerc d'avoué, à Corbeil. * CROS (Louis), Conseiller général de Seine-et-Oise, à Corbeil. DAMERON, Architecte, rue Chantereine, à Corbeil. DANCONGNÉE, 4, rue du Général Foy, Paris (VIIIe). DANGER, ancien géomètre, 18, rue Brunard, à Etampes. DANZAS (Mile), 49, rue Ampère, à Paris (XVIIe). + DARBLAY (Aymé), au château de Saint-Germain, par Corbeil. DARBLAY (Robert), au château de Saint-Germain, par Corbeil. DARNET (Jérôme), Greffier en chef du tribunal de Corbeil. |00000032| XIV DECAUVILLE (Mme), à la Ferme du Bois-Briard, commune de Courcouronne, par Ris-Orangis (S.-et-O). MM. DELABRECQUE, avoué à Corbeil. DELESSARD (Mme Edouard), à Ris-Orangis, et à Paris, 10, rue de l'Université (VIIe). DELESSARD (Ernest), Ingénieur civil, à Lardy (S.-et-O.). * DEPOIN (Joseph), Secrétaire général de la Société historique de Pontoise, 50, rue Basse, à Pontoise, et à Paris, 150, boulevard St-Germain (VIe). DESRUES (l'Abbé), Curé Doyen de l'Isle-Adam (S.-et-O.). DESTARAC (l'Abbé), Curé de Méry-sur-Oise (S.-et-O.). DORMANN, imprimeur, à Etampes. DOUCET (Jacques), 19, rue Spontini, Paris (XVI®). Drouin (G.), 4, place des Saussaies, Paris (VIIIe). DUBOIS (Robert), 7, rue d'Enghien, à Paris (Xe), et à Brunoy, 16, rue de Réveillon (S.-et-O.). DUCASTEL, Architecte à Juvisy (S.-et-O.). DUFAURE (Amédée), ancien député, au Château de Gillevoisin par Chamarande, et 116 bis, avenue des Champs-Élysées, à Paris (VIIIe). DUFOUR (M. A.), Conservateur de la Bibliothèque et des Archives de la ville de Corbeil, rue du 14 Juillet, 21, à Corbeil. DURANDET (l'Abbé), Curé du Ris-Orangis (S.-et-O.). DUREY COMTE (Dr), à Corbeil. * DUVAL (Rubens), Professeur au Collège de France, à Morsang-sur-Seine par Corbeil, et à Paris, 66 avenue de la Grande Armée (XVII). DUVAL (Mlle), institutrice à Palaiseau (S.-et-O.). ETAMPES (M. le Conservateur du musée d'). FERAY (Georges), 21 avenue de l'Alma, à Paris (VIII®). FLAMMARION (Camille), Directeur de l'Observatoire de Juvisy, à Juvisy, et à Paris, 16, rue Cassini (XIV). FLIZOT, libraire, à Étampes. FORTEAU (C.-M.), Trésorier de la Caisse d'Épargne, à Étampes. FOUCHER (l'Abbé), Curé-archiprêtre de Corbeil. FOUDRIER (l'Abbé), Curé d'Arpajon (S.-et-O.). |00000033| XV MM. GANAY (le Marquis de), au Château de Courances, par Milly (S.-et-O.), et à Paris, 9, avenue de l'Alma (VIIIe). GANDRILLE (Mme), à St-Germain-lès-Corbeil, par Corbeil. GARNIER. Maire de Corbeil, quai de la Pêcherie, à Corbeil. GATINOT, inspecteur primaire honoraire, à Montgeron (S.-et-O.). GAUDIN, entrepreneur de travaux, à Corbeil. GENET (l'Abbé), Curé de Méréville (S.-et-O.). + GENTY (l'Abbé), Vicaire général de Versailles, 23, rue SaintHonoré, à Versailles. GERARD (Octave), avoué à Corbeil. GEOFFROY, inspecteur à la Cie P. L. M., à Corbeil. Mgr GIBIER, Evêque de Versailles, à l'Evêché de Grandchamp, à Versailles. MM. GILBERT (André), secrétaire d'ambassade, 17, avenue de Breteuil, Paris (VIIe). GIRARD (Mme), 61, rue Parisis, à Dreux (Eure-et-Loir). GIRONDEAU, professeur au Collège d'Etampes. GLIMPIER (l'Abbé), Curé de St-Sulpice de Favières, par Boissysous-St-Yon (S.-et-O.). GRAILLOT, chef d'institution, à Montlhéry (S.-et-O.). GRAND (Emile), avoué à Corbeil. GRAND (Mlle M.), à Corbeil. GRANDS MOULINS de Corbeil (M. le Directeur des). GRONNIER, principal du Collège Geoffroy-St-Hilaire, à Etampes. GUÉBIN (Mme), 28, rue d'Assas, Paris (VIe). GUILBERT (Denys), Avocat, au Château du Colombier, par StChéron, et à Paris, 116, rue de Rennes (VI). GUILLARD, banquier, à Corbeil. GUYOT (Gustave), propre, à Massy (S.-et-O.), et à Paris, 63 bis, rue du Rocher (VIII®). GUYOT (Joseph), au Château de Dourdan, à Dourdan, (S.-et-O.), et à Paris, 30, rue de Condé (VIº). HABER (André), avoué, à Corbeil. HARO (Henri), Peintre-Expert, 20, rue Bonaparte, à Paris (VIe). † HAURÉAU (Barthélemy), Membre de l'Institut. HAUFT (Maurice), 10, avenue de Villiers, à Paris (XVIIe) et à Boissy-sous-Saint-Yon (S.-et-O.). |00000034| XVI MM. HERVIER (Marcel), à Essonnes (S.-et-O.). HINQUE (Edmond), à Yerres (S.-et-O.), et à Paris, 94, boulevard Haussmann (VIIIe). HUMBERT, notaire à Brunoy (S.-et-O.). Houssoy (le Comte du), au château de Frémigny, par Bouray, (S.-et-O.), et 5, rue Beaujon, à Paris (VIII). HUET (Edmond), 12, rue St-Jacques, à Étampes. HUTTEAU (Léonce), 3, rue Saint-Jacques à Etampes. * JACQUEMOT (l'Abbé), Curé-Doyen d'Argenteuil (S.-et-O.). JALLEY (l'Abbé), Curé de Grigny, par Ris-Orangis (S.-et-O.). JEANCOURT-GALIGNANI, Maire d'Etiolles, par Corbeil, et à Paris, 82, rue du faubourg St-Honoré (VIII). JARRY (Henri), Membre du Conseil départemental d'hygiène, à Corbeil. JOANNE (Edmond), Hôtel de Nesmond, 55 et 57, quai de la Tournelle, à Paris (Ve). JOZON (Maurice), Notaire à Corbeil. LA BAUME-PLUVINEL (Mlle de), au Château de Marcoussis, et à Paris, 9, rue de la Baume (VIII®). LACOMBE (Paul), Trésorier de la Société de l'histoire de Paris, 5, rue de Moscou, à Paris (VIIIe). LADMIRAL (le D'), à Étiolles, par Corbeil. LAROCHE (Mme Jules), rue Saint-Spire, à Corbeil. LASNIER (E.), Receveur des Finances, en non activité, 28, rue de Champlouis, à Corbeil. LAUDERAUT (l'Abbé), Curé de St-Martin, à Étampes. LAURISTON (de), propriétaire au Coudray-Montceaux, par le Plessis-Chenet (S.-et-O.). LAVALLÉE (Pierre), au Château de Segrez, par Boissy-sous-StYon, et à Paris, 10, rue de Vézelay (VIIIe). LEBRET, ancien Garde des Sceaux, avocat à la Cour, 11, rue Michelet, Paris (VIº). LECACHEUR (Mme), rue Saint-Spire à Corbeil. LE COLLÈGE Geoffroy-Saint-Hilaire, à Etampes. LEGRAND (Maxime), Avocat, 98, rue Saint-Jacques, à Étampes. |00000035| XVII MM. LEGROS, notaire, maire de Boissy-St-Léger (S.-et-O.). LE GAL (l'Abbé), curé de Brunoy (S.-et-O.). LEHIDEUX (Roger), à la Brégallière, à Brunoy, et à Paris, 3, rue Drouot (IXe). LEPROUST (l'Abbé), Curé de St-Gilles, à Étampes. LELONG, notaire à Corbeil. LEMAIRE (A.), à Corbeil. LEMAY (l'Abbé), Curé de l'Etang-la-Ville (S.-et-O.). LE MICHEL, prop. à Saintry, par Corbeil. LESCUYER, notaire, à Etampes. LE PAIRE (Jacques-Amédée), à Lagny (S.-et-M.). LEROY (Jules), juge au tribunal de commerce de Corbeil. LOISEL (Albert), rue du 14 Juillet, 21 bis, à Corbeil. LORIN, Avoué, Secrétaire-général de la Société historique de Rambouillet, à Rambouillet. MAILLE ST-PRIX, au Château de la Grange, par Évry-PetitBourg, et à Paris, 11, Square de Messine (VIII). MALLET, père, banquier, à Corbeil. MALLET fils (Louis), banquier, à Corbeil. MALLET (Auguste), à la Roche, commune de Villebon, par Palaiseau (S.-et-O.). MARCHEIX, Conservateur de la Bibliothèque de l'École des Beaux-Arts, 47, rue de Vaugirard, à Paris (VI). MAREUSE (Edgar), Secrétaire du Comité des Inscriptions parisiennes, 81, boulevard Haussmann, à Paris (VIII). MARION (Mme), 39, rue Saint Jacques, à Étampes. MARQUIS (Mme Léon), 3, rue du Flacon, à Etampes. MARTELLIÈRE, ancien magistrat, à Pithiviers (Loiret). MARTELLIÈRE fils, architecte à Paris, 33, rue Claude-Bernard (Ve). MARTIN, entrepreneur de travaux, à Corbeil. MASSON, Directeur des Ateliers de Chantemerle, à Essonnes (S.-et-O.). MASSUCHETTI (l'Abbé), Curé de Viry-Châtillon (S.-et-O.). MATHURIN (l'Abbé), curé de Linas, par Montlhéry (S.-et-O.). + * MAUBAN (Georges), à Soisy-sous-Etiolles, et à Paris, 5 bis, rue de Solférino (VII). MAUDUIT, géomètre, rue St-Antoine, à Etampes. MÉLINGE (l'Abbé), curé de Morigny, par Étampes (S.-et-O.). ANNÉE 1909. - - Ire LIV. B. |00000036| XVIII MM. MONTGERMONT (le comte G. de), 62, rue Pierre Charron, à Paris (VIII), et au château de Montgermont, par Ponthierry (S.-et-M.). MORAND (Raoul), attaché au musée de l'Armée, Hôtel des Invalides, à Paris, et villa Charmante, 4, rue du Pressoir, à Brunoy (S.-et-O.). MOREL D'ARLEUX (Mme), rue du Renard, Paris (IV®). MOTTHEAU, 49, rue des Vallées, à Brunoy (S.-et-O.). NOURRY, instituteur honoraire, à Mandres (S.-et-O.). OUDIOU (Mme), 12, avenue Darblay, à Corbeil. PAILLARD (Julien), architecte, 13, rue Lacuée, à Paris (XII). PAILLARD, huissier, à Brie-Comte-Robert (S.-et-M.). PAISANT, Président honoraire du Tribunal de Versailles, 47, rue Neuve à Versailles. PALLAIN, gouverneur de la Banque de France, Hôtel de la Banque, à Paris (Ier). PAPIN, Agent des Assurances générales, à Corbeil. PARA (Le Docteur), à la Ferté-Alais (S.-et-O.). PASQUET (Alfred-Marc), Architecte de l'arrondissement, à Corbeil. PASTRÉ (Aymé), au Château de Beauvoir, par Evry-Petit-Bourg, et à Paris, 14, rue François Ier (VIIIe). PAULIN (Mile), Institutrice à Ferrières-en-Brie (Seine-et-Marne). PELLERIN, à Saintry, par Corbeil. PERIN (Louis), à Ris-Orangis, et à Paris, 8, rue des Écoles (Ve). PÉRIN (Félix), à Morsang-sur-Orge, par Savigny-sur-Orge (S.-et-O.). PETIT (Mme Félix), propriétaire, rue St-Spire, à Corbeil. PETIT (Georges), agent d'assurances, à Corbeil. * PIERREDON, 150, avenue des Champs-Élysées, Paris (VIII). PILLAS (Albert), ancien trésorier-payeur-général, 20, rue de Mouchy, Versailles. PINARD (André), au château de Champcueil, par Mennecy, et à Paris, 54, quai Debilly (XVIº). PINTEAUX, 52, rue de Turbigo, Paris (III). PLANCOUARD (Léon), correspondant du Ministère de l'Instruc- |00000037| XIX tion publique, à Berck-plage (Pas-de-Calais), et à Arthies, par Magny-en-Vexin (S.-et-O.). MM. POPOT père, caissier central honoraire de la Caisse d'épargne de l'arrondissement de Corbeil, à Corbeil. PORLIER, Quai Bourgoin, à Corbeil. POULTIER, Avocat à la Cour d'Appel de Paris, 28, rue de Suresnes (VIII). PUYO, conservateur des Hypothèques, à Corbeil. PRESTAT, 40, rue des Écoles, à Paris (Vº). PRIVÉ (Julien), au Pin (Seine-et-Marne). RABOURDIN (Charles), Maire de Paray, 43, rue de Rennes, à Paris (VI). RADOT (Émile), ancien président du tribunal de Commerce de Corbeil, à Essonnes (S.-et-O.) RAVAUT (Paul), 114, avenue des Champs-Elysées, Paris (VIII). RESVE, chef d'institution à Montlhéry (S.-et-O.). RICHEMOND, Boulevard Malesherbes, 88, à Paris (VIII). RICHERAND (le Baron), Maire de Villecresnes, et à Paris, 13, rue Paul-Louis Courrier (VIIe). RILLY (le Comte de), au château d'Oyzonville, par Sainville (Eure-et-Loir). RISCH, instituteur à Saulx-les-Chartreux, par Longjumeau (S.-et-O.). ROBIN fils, marbrier, à Corbeil. ROUSSEL, Docteur de l'Université de Paris, 71, rue de Grenelle, Paris (VII). ROUSSELIN (l'Abbé), Curé du Mesnil-Aubry (S.-et-O.). ROUSSEAUX, ancien avoué à Corbeil. ROYER, Pharmacien, 143, rue de Paris, à Pantin (Seine). ROYER, banquier, à Étampes. SABROU (Charles), rue St-Spire, à Corbeil. SAINTIN (Alfred), Maire de Montlhéry (S.-et-O.). *SAY (Mme), à Paris, 79, avenue Malakoff (XVIº). SERGENT, notaire honoraire à Milly (S.-et-O.). SIMON (Paul), Architecte, à Villeneuve-St-Georges (S.-et-O.). SIMON (l'Abbé), Curé de Livry (S.-et-O.). SOUPAULT, 59, avenue de Neuilly, à Neuilly (Seine). |00000038| XX MM. STECHERT, à New-York (États-Unis). TANON (M. L.), Président de Chambre à la Cour de Cassation, 46, rue Jacob, à Paris (VIº), et au château du Clos Bernard, à Soisy-sous-Étiolles (S-et-O.). TAVERNIER, architecte, 19, rue Soufflot, à Paris (Vº). TETON (Gabriel), instituteur à Épinay-sous-Senart, par Brunoy (S.-et-O.). THIBAUT, propriétaire à Saintry, par Corbeil. THIRROUIN (Achille), à Lisses, par Essonnes (S.-et-O.). THOMAS, architecte de la ville, à Corbeil. THOMAS (Henri), 25, rue St-Jacques, à Etampes. TOURNEUX (Maurice), à Morsang-sur-Orge, clos de la Guérinière, et à Paris, 34, quai de Béthune (IV). TREUILLE (Raoul), 156, rue de Rivoli, à Paris (Ier). TREILHARD le Comte), au château de Marolles-en-Hurepoix, et 10, avenue de Messine, à Paris (VIII). VALLET (l'Abbé), Curé de Ste-Escobille, par Authon-la-Plaine (S.-et-O.). VAUFRELAND (le Baron de), Maire de Morsang-sur-Seine, au château des Roches, commune de Morsang-sur-Seine, et à Paris, 38, avenue Gabriel (VIII). VAVASSEUR (l'Abbé), Vicaire-général du diocèse de Versailles, 6, rue du Sud, à Versailles. VERDAGE (Emile), négociant, à Corbeil. VERLEY (Gaston, Architecte, à Corbeil. VIAN (Paul), notaire honoraire, 9, rue Boissy-d'Anglas, à Paris (VIII). VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (la Commune de) (S.-et-O.). VOLLANT (Louis), ingénieur civil, 7, rue de Villersexel, Paris (VII). WARIN, Directeur des Papeteries d'Essonnes, à Essonnes (S.-et-O). WALTER (Henri), au Mesnil-Longpont, par Montlhéry, et 217, rue Saint-Honoré, à Paris (Ier). |00000039| XXI MEMBRES HONORAIRES CORRESPONDANTS MM. COÜARD (Emile), Archiviste de Seine-et-Oise, à Versailles, Hôtel de la Préfecture. DUTILLEUX (A.), Chef de division honoraire à la Préfecture de Seine-et-Oise, à Versailles, 19, avenue de Picardie. LEFÈVRE (Eugène), Archéologue, à Etampes. PHARISIER, Rédacteur en chef de l'Abeille de Seine-et-Oise, à Corbeil. STEIN (Henri), Archiviste aux Archives nationales, 38, rue Gay-Lussac, à Paris (Vº). |00000040| XXII LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION MM. BONNIN (l'Abbé), d'Ablon. BOUCHER (le Dr P.), de Corbeil. BRICARD, propriétaire à Corbeil. COURCEL (V. de), d'Athis-Mons. DEPOIN (Joseph), de Pontoise. DUFOUR (M. A.), de Corbeil. DUTILLEUX (A.), de Versailles. JARRY (H.), de Corbeil. LASNIER (E.), de Corbeil. LEGRAND (Maxime), d'Étampes. BUREAU DE LA SOCIÉTÉ Présidents d'honneur: M. le Sous-Préfet de Corbeil. M. le Sous-Préfet d'Étampes Président : M. le Baron de COURCEL, membre de l'Institut. M. le Dr P. BOUCHER, Médecin en chef de l'hôpital de Corbeil. M. V. de COURCEL, d'Athis-Mons. M. M. LEGRAND, d'Etampes. M. DUFOUR, Conservateur de la bibliothèque et des archives de la ville de Corbeil. Vice-Présidents: Secrétaire-Général : MM. LELONG (M.), notaire à Corbeil. MAREUSE (Edgar), de Paris. MARTELLIÈRE, de Pithiviers. MOTTHEAU, de Brunoy. PASQUET (A. Marc), de Corbeil. POPOT père, de Corbeil. ROUSSEAUX, de Corbeil. TOURNEUX (Maurice), à Paris. VOLLANT, à Paris. - Trésorier: M. POPOT père, caissier central honoraire de la Caisse d'Épargne de Corbeil. Secrétaire-Rédacteur: M. M. LELONG, notaire à Corbeil. COMITÉ DE PUBLICATION MM. le Dr P. BOUCHER, Vice-Président, membre de droit. A. DUFOUR, Secrétaire général, membre de droit. V. de COURCEL, d'Athis-Mons. Max. LEGRAND, d'Étampes. |00000041| XXIII SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France. Société historique et archéologique de Pontoise et du Vexin. Société archéologique de Rambouillet. Société historique et archéologique du Gâtinais. Société archéologique de Sens, à Sens (Yonne). Société des sciences morales, des lettres et des arts de Seineet-Oise, à Versailles. Commission des antiquités et des arts de Seine-et-Oise, à Versailles. La Bibliothèque de l'Académie Royale des belles-lettres, d'histoire et des antiquités à Stockholm (Suède). Société des Amis des monuments parisiens, 98, rue de Miromesnil, à Paris (VIII). Societé française d'archéologie, 13, rue de Phalsbourg, Paris (XVIIe). Société archéologique d'Eure-et-Loir, à Chartres (Eure-et-Loir). Société historique et archéologique de Brie-Comte - Robert (Seine-et-Marne). Société des Bollandistes, 22, Boulevard St-Michel, à Bruxelles (Belgique). Bulletin historique du diocèse de Lyon, place Fourvière, Lyon (Rhône). Société Dunoise, à Châteaudun. Société archéologique de Château-Thierry. Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois, à Vendôme (Loir-et-Cher). La Bibliothèque de la Ville de Paris, à l'Hôtel Saint-Fargeau, 29, rue de Sévigné, à Paris. La Société archéologique et historique de Clermont (Oise). La Société des Sciences historiques et naturelles de Semur (Côte-d'Or). La Société d'archéologie, sciences, lettres et arts du département de Seine-et-Marne, à Melun (Seine-et-Marne). |00000042| |00000043| SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, D'ÉTAMPES ET DU HUREPOIX COMPTE-RENDU DES SÉANCES SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Tenue à l'Hôtel-de-Ville de Corbeil (Salle de la Bibliothèque) le 17 mai 1909. Présidence de M. le Dr BoUCHER, Vice-Président. Etaient présents: MM. le Dr Boucher, Bricard, Dufour, Jarry, Lasnier, Lelong, Marc-Pasquet, Popot et Vollant. Des excuses sont présentées au nom de MM. l'Abbé Bonnin, d'Ablon; Valentin de Courcel, d'Athis-Mons; Joseph Depoin et Edgar Mareuse, de Paris. Le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance précédente; il est adopté sans observations. Le Conseil enregistre la démission de M. Chavignier, greffier du Tribunal de commerce de Corbeil, et celle de M. Dupuy-Dutemps, ancien percepteur de Corbeil, actuellement à Elbeuf. M. le Président dit que la Société a été encore très éprouvée par de trop nombreux décès, et il déplore la perte des collègues disparus dont les noms suivent : M. François Coppée, membre de l'Académie française et Président de notre Société historique. - 1909. — I. ~I |00000044| M. Mauban (Georges), de Soisy-sous-Etiolles, membre fondateur de notre Société. M. Oudiou, Architecte de la ville de Corbeil. M. Félix Petit, de Corbeil. M. Paul Darblay, de Saint-Germain-lès-Corbeil. M. V. Delorme, de Saint-Germain-lès-Corbeil. M. Guébin, avoué à Corbeil. M. l'Abbé Isbecque, Curé-Archiprêtre de Notre-Dame d'Etampes. M. le Comte de Dion, de Montfort-l'Amaury. M. Fernand Bournon, Archiviste-Paléographe, de Paris. Le Secrétaire-général donne ensuite lecture d'une liste de membres nouveaux dont le Conseil est appelé à prononcer l'admission et dont voici les noms : M. Pinteau Emile, à Paris, 52, rue de Turbigo, présenté par MM. Dameron et Bonnefoy. Le Collège St-Hilaire, d'Etampes, présenté par MM. Girondeau et Lefèvre. M. Puyo, Conservateur des hypothèques à Corbeil, présenté par MM. Creuzet et Dufour. M. l'Abbé Foucher, Curé-Archiprêtre de Corbeil, présenté par MM. Boucher et Dufour. M. Chavignier, greffier du tribunal de Commerce de Corbeil, présenté par MM. Boucher et Dufour'. Madame Vve Oudiou, à Corbeil, présentée par MM. Dufour et Thomas. M. Bobin, pharmacien à Étampes, présenté par MM. Lefèvre et Forteau. M. le Comte de Bizemont, 8 rue Girardet à Nancy, inscrit comme membre fondateur, présenté par MM. Lefèvre et Legrand. M. Hinque, de Yerres, présenté par MM. Dubois et Mottheau. M. l'Abbé Mélinge, Curé de Morigny, présenté par MM. Lefèvre et Legrand. M. Huet (Edmond) à Étampes, présenté par MM. Legrand et Forteau. M. l'Abbé le Gal, Curé de Brunoy, présenté par MM. Mottheau et Dubois. 1. M. Chavignier, admis en 1908, a donné sa démission en janvier 1909. |00000045| 3 - M. Dancongnée (Léon), Avocat à Paris, présenté par MM. Vian et Dufour. M. Risch, Instituteur à Saulx-les-Chartreux, présenté par MM. Creuzet et Dufour. M. Pillas, trésorier-payeur général honoraire, 20 rue de Mouchy, à Versailles, présenté par MM. Lefèvre et Dufour M. Paillard, de Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), présenté par MM. Blondeau et Dufour. Madame Vve Gandrille, de Saint-Germain-lès-Corbeil, présentée par MM. Boucher et Dufour. Madame Vve Delessard, de Ris-Orangis (et Paris), présentée par MM. E. Delessard et Dufour. M. Delabrecque, avoué à Corbeil, présenté par MM. Rousseaux et Gérard. Madame Vve Guébin, à Paris, 28 rue d'Assas, présentée par MM. Dufour et Jozon. M. Drouin (G.), à Paris, 4 place des Saussaies, et au Château de Feyrolles-en-Brie (S.-et-M.), présenté par MM. Vian et Dancongnée. Les Grands Moulins de Corbeil, présentés par MM. Garnier et Lefèvre. A la suite de cette communication, M. le Président propose au Conseil la nomination des 22 membres nouveaux ci-dessus nommés; à l'unanimité leur admission est prononcée. L'ordre du jour appelle ensuite la nomination du Président de la Société, en remplacement de M. François Coppée, récemment décédé. A ce sujet, Mr le Secrétaire général donne lecture d'une lettre de M. le Bon de Courcel, membre de l'Institut et sénateur de Seine-et-Oise, qui, pressenti au sujet de son acceptation de la Présidence de notre société, termine sa réponse dans les termes suivants : « J'ai donc senti faillir ma résolution et, si vous ne trouvez pas de meilleur « nom que le mien pour succéder aux noms glorieux tous deux, quoique diffé- « remment, d'Hauréau et de Coppée, je me livre à vous pour cette Présidence ». A la suite de cette lecture, le Conseil remercie M. le secrétaire pour la démarche, couronnée de succès qu'il a faite auprès de M. le Bon de Courcel, et manifeste sa satisfaction en nommant, à l'unanimité, M. le Bon de Courcel, Président de la Société histo- |00000046| 4 rique et archéologique de Corbeil, d'Etampes et du Hurepoix, et il charge son secrétaire général d'informer M. de Courcel de cette décision. Au sujet de la Bibliothèque de la Société, qui s'augmente sans cesse et qui devient trop encombrante pour lui, M. Dufour dit qu'il a écrit à M. le Maire de la ville pour lui demander l'autorisation de déposer dans un des meubles du salon du Maire, à l'hôtel de ville, un certain nombre de volumes, tous reliés, faisant partie de la bibliothèque de la société. M. le Maire a répondu à M. Dufour dans les termes suivants : « Je vous confirme l'autorisation que je vous ai donnée de déposer dans les bibliothèques du salon du Maire, à l'Hôtel de ville, les volumes appartenant à (( « votre société, dont vous pourrez disposer pour cet emploi. Je m'en rapporte «< à vous pour que ces volumes soient reliés et ne puissent déparer les meubles « dans lesquels ils se trouveront. « Il est bien entendu qu'il ne s'agit que d'un simple dépôt au nom de votre «< société, et que les volumes en question resteront à votre disposition pour être <«< retirés quand bon vous semblera. La question de la clef de la Bibliothèque <«< paraît présenter une difficulté. Il me semblerait naturel qu'il y eût une double <«< clef, dont l'une resterait en votre possession, et l'autre serait déposée au secré- «tariat de la mairie. Veuillez croire que j'ai été trop heureux d'avoir pu vous « être agréable et que, relativement, j'ai fait bien peu à votre égard, comparative- <«<ment aux services que vous avez rendus et que vous rendez encore chaque « jour à la ville ». En conséquence, ajoute M. le Secrétaire général, je me suis empressé de profiter de cette autorisation; une centaine de volumes sont déjà déposés à la mairie, dans la bibliothèque choisie à cet effet. Au point de vue de nos publications, M. Dufour rappelle que le T. VIII des mémoires de la Société, Histoire de Brunoy, a paru, et il annonce que le 2me bulletin de 1908 est sous presse et paraîtra prochainement. L'ordre du jour appelle ensuite la fixation de la date de l'assemblée générale de 1909. M. le Président propose le lundi 7 juin 1909, à 3 h. 1/2 à l'Hôtel de ville de Corbeil. Cette proposition est acceptée par le Conseil, qui fixe ainsi l'assemblée générale au 7 juin 1909. Le Secrétaire général annonce ensuite que le Guide au musée St-Jean qu'il avait été chargé de préparer, est terminé et imprimé. |00000047| - – 5 - Il en a déposé un certain nombre d'exemplaires entre les mains du gardien du musée, qui sera chargé de les vendre au prix fixé à 50 centimes par exemplaire. Puis il annonce au Conseil que les neuf statues envoyées par le Ministère sont maintenant mises en place. L'on se rappelle, dit-il, que l'administration du Trocadéro (qui avait fait l'envoi de ces statues), consultée sur la question de leur mise en place, avait demandé 500 francs pour faire ce travail. Effrayé par ce gros chiffre, ajoute M. Dufour, je me suis mis en rapport avec un jeune maçon très habile, qui m'a fourni personnel et matériel, et l'opération a très bien réussi. Nos statues sont en place, elles y font bon effet, et j'ai dépensé en tout 50 et quelques francs qui, d'ailleurs, ont été payés par la ville. M. le trésorier donne ensuite quelques renseignements sur la situation financière de la Société pour l'exercice 1909. Le compte-rendu détaillé de cet exercice sera fourni par lui à l'assemblée générale, mais dès à présent, il peut dire qu'il existait, au 31 Décembre 1908, un solde disponible de 3699 fr. 43 c. Le Secrétaire général donne ensuite lecture d'une lettre de M. Joseph Guyot, le propriétaire du curieux château de Dourdan, qui a pris l'initiative de réparer un oubli de la postérité, en érigeant au grand poète comique que fut Regnard, à l'occasion du bi-centenaire de sa mort, un monument dans la ville de Dourdan, où il vécut, travailla et mourut, puis fut inhumé dans l'église de cette ville. Le Conseil approuve l'envoi qui a été fait par le trésorier, au nom de la Société, d'une somme de 20 fr. pour sa souscription au monument de Regnard. Enfin le Conseil prie M. le Secrétaire général d'adresser une lettre de remercîments à Madame Millet, pour le don qu'elle a fait au musée Saint-Jean d'un tableau au pastel, fleurs et fruits. Et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 5 h. 1/2. |00000048| - 6· ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Tenue le 7 Juin 1909, à l'Hôtel de ville de Corbeil, sous la présidence de M. le Dr BOUCHER, Vice-Président. La séance est ouverte à 3 n. 1/2. Etaient présents: MM. Boucher, Dufour, Creuzet, Lasnier, Jarry, Jozon, Lelong, Marc-Pasquet, de Corbeil; Humbert, de Brunoy ; Delessard, de Lardy; Périn, de Morsang-sur-Orge; Julien Privé, du Pin; et Vollant, de Paris. Sont excusés par lettre ou verbalement : MM. l'Abbé Cauvigny, de Ballencourt; Joseph Depoin, de Paris ; L. E. Lefèvre, d'Etampes; Bricard, de Corbeil; Comte de Bizemont, de Nancy; Baron A. de Courcel, E. Mareuse et V. de Courcel, de Paris; Popot père, L. Cros et E. Grand, de Corbeil ; et le Président de la Société Archéologique d'Eure-et-Loir, à Chartres. M. le Président donne ensuite la parole à M. le Secrétairegénéral pour la lecture de son rapport annuel sur la situation et les travaux de la Société pendant l'exercice 1908. Celui-ci s'exprime en ces termes : Messieurs et chers Collègues, Conformément à nos statuts, je viens en 1909, comme je l'ai fait les années précédentes, vous rendre compte de la marche de notre société et de ses travaux pendant l'année qui s'est terminée le 31 décembre 1908. Notre société a encore été très éprouvée pendant cette même année 1908, et j'accomplis le triste devoir de vous lire la liste funèbre des collègues que la mort nous a enlevés pendant cette période. En 1906, nous avons perdu six de nos membres, sept nous avaient été enlevés en 1907 et aujourd'hui nous comptons neuf décès pour l'année 1908 ; et cette série funèbre n'est pas close, hélas, car nous aurons à rendre compte, pour l'exercice 1909, de la mort récente de M. le Comte de Dion, de Montfort-l'Amaury, de MM. Bournon, Trochu et J. de Courcel, de Paris et Delaunay de Saintry. Voici la liste des collègues que la mort nous a enlevés en 1908 et dont nous saluons la mémoire. M. l'abbé Muret, curé de Brunoy, M. G. Mauban, de Soisy, |00000049| 7 - M. Oudiou, de Corbeil, M. Petit (Félix), de Corbeil. M. Darblay (Paul), de Saint-Germain, M. Victor Delorme, de Saint-Germain, M. E. Guébin, de Corbeil, M. l'abbé Isbecque, d'Étampes, M. François Coppée, de Paris. M. l'abbé Muret était, depuis de longues années, curé de Brunoy ; il n'y a laissé des regrets, car il était adoré de ses paroissiens. que Nous avons tous connu M. Oudiou, l'architecte de la ville, qui a longtemps habité Corbeil, où il était apprécié à cause de sa bonté et de ses qualités aimables, qui lui avaient valu beaucoup d'amis. M. Petit Félix, un compatriote, car il était né tout près de nous, au PlessisChenet, a laissé chez nous beaucoup de regrets, car il était très aimé pour sa bonté et sa serviabilité. M. Darblay Paul, le grand industriel de Corbeil et d'Essonnes, était universellement connu et estimé ; son éloge est dans toutes les bouches, je n'ai donc point à le faire, mais je salue en lui le bienfaiteur de notre pays, et le membre fondateur de notre société. M. Guébin, qui nous a été enlevé si prématurément, avait, par un long séjour, acquis le droit de cité chez nous; bon et serviable, il n'avait que des amis qui, tous, ont été péniblement affectés par sa mort, si douloureuse pour les siens, et si triste pour tous ceux qui l'ont connu. M. Victor Delorme, ancien fermier, était revenu habiter à Saint-Germain la maison de ses parents. Il aimait notre pays qui était le sien, c'est pourquoi il avait demandé à entrer dans notre société, où il n'est pas resté assez longtemps pour s'y faire connaître. La mort de M. l'abbé Isbecque a été un deuil pour la ville d'Etampes où il était très aimé. Avant d'aller à Etampes, il avait été pendant de longues années le curé de la Ferté-Alais; les habitants de ce pays, qui le regrettaient toujours, se sont unis à ceux d'Etampes pour déplorer la perte de cet homme de bien. M. Georges Mauban était membre fondateur de notre société. Il habitait Paris, l'hiver, et pendant la belle saison, la jolie commune de Soisy-sous-Etiolles, où sa famille, une des plus anciennes de cette commune, jouissait de l'estime et de la sympathie générale. Très aimé, M. Mauban n'a laissé que des regrets. Quant à notre regretté Président, François Coppée, membre de l'Académie Française, il est trop universellement connu et admiré pour que j'ose entreprendre de faire son éloge; d'ailleurs notre Président, M. le Dr Boucher, dans la séance de notre assemblée générale du 25 mai 1908, a éloquemment exprimé les regrets causés à la société par la perte de son illustre Président. Aux vides causés par les neuf décès que je viens d'indiquer, il faut encore ajouter les démissions suivantes : |00000050| M. Legris, ancien Procureur à Corbeil, nommé à Paris. M. Dupuis-Dutemps, ancien percepteur à Corbeil, nommé en la même qualité à Elbeuf (Seine-Inférieure). Décès et démissions ont donc produit onze vides dans nos rangs, et comme compensation de ces pertes, j'ai le plaisir de vous annoncer l'entrée dans la Société de 22 membres nouveaux qui ont été admis par le Conseil dans sa séance du 17 mai 1909 et dont voici les noms : MM. Pinteau Emile, de Paris, présenté par MM. Dameron et Bonnefoy. Le Collège Saint-Hilaire, d'Etampes, présenté par MM. Girondeau et Lefèvre. MM. Puyo, Conservateur des Hypothèques à Corbeil, présenté par MM. Dufour et Creuzet. M. l'Abbé Foucher, Curé-Archiprêtre de Corbeil, présenté par MM. Boucher et Dufour. Madame Oudiou, de Corbeil, présentée par MM. Thomas et Dufour. M. Bobin, pharmacien à Etampes, présenté par MM. Lefèvre et Forteau. M. le Comte de Bizemont, à Nancy, présenté par Mme Marquis et M. Dufour. (M. de Bizemont est inscrit comme membre fondateur). M. Hinque, de Yerres, présenté par MM. Mottheau et Dubois. M. Chavignier, Greffier du tribunal de Commerce de Corbeil, présenté par MM. Dufour et Boucher. M. l'Abbé Mélinge, Curé de Morigny, présenté par MM. Lefèvre et Legrand. M. Huet (Edmond), à Etampes, présenté par MM. Legrand et Forteau. M. l'Abbé Le Gal, Curé de Brunoy, présenté par MM. Mottheau et Dubois. M. Dencongnée, à Paris, présenté par MM. Vian et Dufour. M. Risch, instituteur à Saulx-les-Chartreux, présenté par MM. Dufour et Creuzet. M. Pillas, trésorier-payeur-général honoraire, à Versailles, présenté par MM. Lefèvre et Dufour. M. Paillard, à Brie-Comte-Robert, présenté par MM. Blondeau et Dufour. Madame Vve Gandrille, de St-Germain-lès-Corbeil, présentée par MM. Boucher et Dufour. Madame Vve Delessard, de Ris-Orangis et Paris, présentée par MM. E. Delessard et Dufour. M. Delabrecque, avoué à Corbeil, présenté par MM. Rousseaux et Gérard. Madame Vve Guébin, à Paris, présentée par MM. Dufour et Jozon. M. Drouin (G.) à Paris, présenté par MM. Vian et Dancongnée. Les Grands Moulins de Corbeil, présentés par MM. Lefèvre et Garnier. Les onze vides qui se sont produits dans notre société sont donc compensés, et largement au delà, par la rentrée des 22 membres nouveaux dont je viens de vous lire les noms, ce qui me permet de constater la vitalité et l'accroissement continu de notre société. |00000051| 9 Permettez-moi de vous en donner la preuve par la statistique des trois dernières années en 1906 nous avons inscrit 31 membres nouveaux, 18 en 1907 et 22 en 1908, ce qui nous donne, pour ces trois années, un total de 71 nouveaux collègues; c'est un résultat très satisfaisant et qui est dû, j'aime à le croire, aux travaux que nous avons publiés et aussi à la bonne tenue de nos publications. En 1909, la Société est entrée dans la quinzième année de son existence et c'est avec une réelle satisfaction que je constate que, pendant cette période. déjà longue, elle n'a pas cessé de se développer et de s'accroître, crescit eundo, comme disaient les anciens. Je dois vous parler maintenant de nos travaux de 1908, et ce n'est pas sans crainte que j'aborde ce sujet, parce qu'il m'amène forcément à vous faire l'aveu, assez pénible, que nous sommes cette année très en retard dans nos publications. Un seul de nos deux bulletins de 1908 a paru; le second est sous presse et en grande partie imprimé, il paraîtra certainement en juin 1909. Ce retard est dû à des causes diverses, entre autres à l'impression du Tome VIII de nos mémoires, qui vous a été distribué dernièrement (Histoire de Brunoy, T. I) et dont la mise au jour a retardé le 2me bulletin de 1908. Ce retard sera bientôt réparé et nous mettrons aussitôt sur le chantier le 1er bulletin de 1909 qui a souffert, lui aussi, de l'arrêt forcé de son devancier. Ce 1er bulletin de 1908 était assez fourni puisqu'il comptait tout près de cent pages. Après les pièces liminaires, il donnait la suite de l'histoire de la paroisse St-Pierre d'Etampes, dont les deux premières parties ont été publiées en 1907. C'est un grand travail qui fait honneur à son auteur, M. Forteau, d'Etampes, et qui offre un intérêt sérieux pour les habitants de cette ville, dont beaucoup de familles trouvent, dans les documents cités, des renseignements curieux sur leurs ancêtres plus ou moins éloignés. Après M. Forteau, vient M. Creuzet qui continue, dans ce même bulletin, la suite de ses intéressantes recherches sur les enseignes et les vieilles hôtelleries de notre ville de Corbeil. M. Creuzet s'est donné la spécialité d'explorer les fonds si curieux et si peu connus des minutes notariales de notre pays, et il y a fait d'abondantes trouvailles qui lui ont permis de restituer en quelque sorte l'histoire et la situation des rues et des maisons de Corbeil depuis le moyen âge jusqu'à nos jours. C'est un grand travail, commencé dans notre bulletin en 1907, et que M. Creuzet continuera dans les bulletins qui suivront. Nous ne saurions trop remercier l'auteur pour son utile contribution à nos travaux, car celle-ci, absolument inédite, a été appréciée comme elle mérite de l'être. Ce rer bulletin de 1908 se termine par la publication d'un document italien, trouvé dans les Archives du Vatican à Rome, par notre jeune et érudit Collègue, M. Claude Cochin, archiviste-paléographe, membre de l'école française de Rome. M. C. Cochin nous a donné, avec le texte italien de l'original, lä traduction française de ce document qui se rapporte à une entrevue, qui eut lieu les 17 et 18 octobre 1647 à Essonnes, où se trouvait un relai de poste, entre Mgr Bagni, nonce |00000052| - ―― 10 du pape à Paris, et la reine mère d'abord, puis, le lendemain, avec Louis XIV et le Cardinal Mazarin. Nous remercions notre jeune Collègue pour cette intéressante communication et nous espérons que M. Cl. Cochin, au cours de ses studieuses recherches, saura encore découvrir des documents intéressant l'histoire de notre contrée et dont il voudra bien nous faire profiter. Quant au 2e bulletin de 1908 non encore terminé, je puis déjà vous dire qu'il comprendra le compte rendu de l'assemblée générale du 25 mai 1908, suivi par le récit de l'excursion archéologique à Ponthierry, Montgermont, Pringy et l'Abbaye du Lys; puis la suite de l'histoire de St-Pierre d'Etampes, par M. Forteau, et un nouveau chapitre des Enseignes et hôtelleries de Corbeil, dû à M. Creuzet. D'autres notices sont sous presse et j'aurai l'occasion de vous en reparler; mais dès à présent il est certain que ce bulletin se terminera, comme chaque année, par la bibliographie annuelle, la chronique et la nécrologie. Pour la série de nos mémoires, vous avez reçu le T. VIII; c'est la monographie de Brunoy, due à notre collègue, M. Mottheau. L'auteur, enfant du pays, y a consigné ses souvenirs et le fruit de ses longues et patientes recherches dans les différents fonds d'archives de Paris et de Seine-et-Oise; nous devons l'en remercier comme il le mérite, en attendant la publication du second volume dont le ms. terminé est entre mes mains et sera illustré, comme le premier, d'assez nombreuses gravures. Dans un rapport précédent, en vous parlant de notre musée Saint-Jean, je vous avais annoncé l'arrivée de neuf statues que j'avais enfin obtenues et que je me préparais alors à mettre en place. Cela est fait maintenant et je dois vous donner le détail de ces beaux moulages qui nous viennent des ateliers du Trocadéro. Il y a d'abord le Christ bénissant, XIIIe siècle, reproduction de l'admirable statue qui décore le grand portail de la Cathédrale d'Amiens, puis la Vierge dorée, x11° siècle, qui se trouve au portail latéral de la même Cathédrale; deux des admirables statues qui ornent le portail occidental de la Cathédrale de Chartres, XIIe siècle; deux autres statues ornant un pied-droit de la même cathédrale, XIIe siècle; deux statues d'apôtres, provenant de la Cathédrale de Bordeaux, XIIIe siècle; et une statue d'Evêque, xive siècle, provenant de la même cathédrale. Ces neuf statues étaient plus ou moins en morceaux qu'il fallait réunir et mettre en place, ce n'était pas une petite affaire pour des gens tout à fait inexpérimentés en ce genre de besogne; je me résolus alors à aller au Trocadéro, à l'atelier des moulages où je trouvai un personnage très compétent, c'était le Directeur de l'atelier, qui se mit à ma disposition pour mettre mes statues en place, mais il me demanda 500 fr. pour faire ce travail!! C'était raide, aussi je reculai, n'osant pas charger la société, ou la ville, d'une si grosse dépense. Il fallait pourtant se tirer de ce mauvais pas, et pour ce faire, je me mis en rapport avec un jeune maçon, très habile, que je connaissais bien. Il se chargea de la besogne et amena un collègue; je lui fournis tout le matériel qu'il me demanda, le gardien du musée |00000053| - ――― II fut aussi mis à sa disposition, et en deux jours de travail tout fut heureusement terminé, sans le moindre accroc. J'ai dépensé environ 55 fr. et suis très heureux de ce résultat. Nos statues sont en place et font bel effet dans le musée, je vous engage fort å les aller voir, car elles méritent une visite et vous êtes mieux qualifiés que tous autres, chers Collègues, pour les apprécier. Pardonnez-moi de vous avoir retenus si longtemps, mais j'étais si fier de la réussite de l'érection de mes belles statues, que je tenais à vous en conter l'histoire; vous voudrez bien m'excuser en donnant à ce rapport votre cordiale approbation qui sera pour moi unc marque de confiance et m'encouragera à continuer la tâche laborieuse que vous m'avez confiée il y a bientôt 15 ans. A la suite de cette lecture, M. le trésorier donne connaissance, dans les termes suivants, de la situation financière de la Société pendant l'année 1908. COMPTE-RENDU DE L'EXERCICE 1908 • ET SITUATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ AU 31 DÉCEMBRE 1908 Recettes Solde de l'Exercice 1907. Cotisations de l'année 1908 Subvention de Mme A. Darblay pour le Musée Subvention du Conseil général Prix de vente de bulletins de la Société. Rachat de sa cotisation par M. le Comte de Bizemont, fondateur. Intérêts des fonds placés à la banque Mallet et à la Caisse d'épargne. Total des recettes de l'année. • 2.045 100 100 90 100 A. D. 116 84 2.551 84 Ensemble. 3.965 44 2.551 84 6.517 28 |00000054| - - I. CONCERNANT LE MUSÉE SAINT-JEAN • Dépenses I. 1. Traitement du gardien et entretien du jardin (¹). 2. Travaux de fumisterie 3. Chauffage et achat d'ustensiles de chauffage 4. Frais de rentrée des caisses de statues et achat d'antiquités. • II. CONCERNANT LA SOCIÉTÉ 5. Frais d'impression du bulletin, de ses annexes et clichés (2) 6. Frais de tirage de 50 exemplaires supplémentaires de la promenade en Seine-et-Oise et de 15 exemplaires des gravures de l'Eglise St Germain. 7. Participation à la conférence d'Etampes. 8. Souscription au monument du poète Regnard. 9. Excédent de dépenses de l'excursion à Ponthierry et à l'Abbaye-du-Lys 10. Frais de recouvrement des cotisations. 11. Reliure de volumes appartenant à la Société. • 12. Frais d'administration, de poste et déboursés divers 591 55 50 16 15 13 1.450 228 100 20 8650 6255 45 90 154 20 Total des dépenses. • 1. Filliau, gardien; élagage, fourniture de sable et journées de jardinier. 2. Bellin, imprimeur; Raymond, clicheur. 670 70 2.147 15 2.817 85 |00000055| – 13 Récapitulation Recettes Dépenses Solde disponible au 31 décembre 1908. Représenté par : En compte courant chez MM. Mallet. A la Caisse d'épargne Espèces en caisse Egalité. • • Répartition des fonds 3.085 95 52388 89 60 3.699 43 Fonds libres. Somme réservée, provenant du rachat de leurs cotisations par 25 membres fondateurs • Certifié exact, Le Trésorier, POPOT. • 6.517 28 2.817 85 3.699 43 1.199 43 2.500 M. le Président invite ensuite l'assemblée à donner son approbation au compte rendu du secrétaire général, ainsi qu'au rapport financier du trésorier. A l'unanimité et sans observations, l'assemblée approuve ces deux rapports; elle donne au trésorier décharge pleine et entière, puis elle vote de chaleureux remerciements aux deux auteurs pour leur dévouement et leur zèle envers la société, ainsi que pour leurs intéressantes communications. M. le Président demande à l'assemblée de confirmer la nomination, faite le 17 mai 1909 par le Conseil d'administration, de M. le Baron A. de Courcel, membre de l'Institut et sénateur de Seine-et, Oise, comme Président de la Société, en remplacement de M. François Coppée, membre de l'Académie française, décédé. Cette nomination, accueillie avec faveur, est confirmée à l'unanimité des membres présents. |00000056| 14 L'ordre du jour appelle ensuite les élections qui doivent se faire, conformément aux statuts, chaque année à l'assemblée générale. En conséquence, M. le Président donne lecture de l'article VII des statuts qui est ainsi conçu : La société est administrée par un conseil, composé de vingt et un membres, élus pour trois ans, en assemblée générale. Le Conseil se renouvelle chaque année par tiers. Les membres sortants sont rééligibles. Le tiers du Conseil sortant en 1909 se compose des six membres suivants MM. Boucher, Bricard, Dufour, Jarry, Martellière père et Mottheau. M. Guébin, récemment décédé, était le septième membre sortant, il y aura lieu de procéder à son remplacement. M. le Président invite donc l'assemblée à procéder à la nomination de sept membres du Conseil, et il désigne à ses suffrages les six membres sortants qui sont rééligibles. A l'unanimité, sont renommés membres du Conseil, pour trois ans, MM. Boucher, Bricard, Dufour, Jarry, Martellière père et Mottheau. Quant au septième membre à nommer, M. le Président propose, en remplacement de M. Guébin, décédé, M. Rousseaux, avoué honoraire, qui, pressenti à ce sujet, a accepté. Il en est ainsi et Me Rousseaux, avoué honoraire, est proclamé membre du Conseil, en remplacement de M. Guébin, décédé. M. le Président rappelle ensuite que, pour obéir aux articles II et XIV du règlement, l'assemblée générale doit nommer chaque année les membres du bureau. Se rendant à cette invitation, l'assemblée renouvelle, par acclamation, pour une année, les pouvoirs du bureau tout entier; elle maintient de même en exercice, pour la même période, les membres du Comité de publication. L'ordre du jour appelle ensuite l'assemblée à désigner le lieu et la date de l'excursion archéologique annuelle, pour la présente année 1909. Plusieurs buts d'excursion sont successivement proposés et, après discussion, l'assemblée décide, à l'unanimité, que l'excursion de 1909 aura lieu, cette année, à Etampes le 5 juillet prochain. M. le Président rappelle à ce sujet que la première des excursions archéologiques de la société a eu lieu dans cette même ville |00000057| - – 15 d'Etampes en 1896, avec le plus grand succès, et il ne doute pas qu'après 15 ans, l'excursion en 1909 ne jouisse de la même faveur. Pour terminer, M. le Président donne la parole à M. Dufour qui donne lecture d'une curieuse notice sur la bibliothèque de Corbeil et son catalogue en vers latins (1). Avant de lever la séance, M. le Président informe l'assistance que le musée St Jean a été exceptionnellement ouvert aujourd'hui à l'occasion de l'assemblée générale. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 5 heures. (1) Cette notice sera insérée dans un prochain bulletin. |00000058| RECHERCHES SUR L'ATELIER MONÉTAIRE DE CORBEIL (1) (1643-1657) Dans un article des plus intéressants, paru dans les annales de la Société du Gâtinais, en 1884, et reproduit, non sans quelques additions et variantes, dans le premier bulletin de 1906 (2), de la Société historique de Corbeil-Etampes, notre érudit secrétaire général a établi, d'une manière irréfutable, l'existence d'un atelier monétaire à Corbeil. Sans vouloir trop prouver, écrit-il en terminant, j'estime que l'on peut affirmer avec certitude que tous les liards, et seulement les liards marqués de la lettre monétaire A, datés de 1654 à 1658, sont sortis des ateliers de la monnaie de Corbeil. A l'appui de son assertion, l'honorable M. Dufour a cité et donné le texte de quatre documents, émanant de la Cour des monnaies; le plus important est, incontestablement, l'ordonnance de Louis XIV du 28 novembre 1654, concernant l'établissement, en cette ville, d'un atelier monétaire pour la fabrication spéciale des liards. Cependant, malgré l'évidence de cette fabrication, nous dit cet estimable auteur, « il est surprenant que notre ville n'ait gardé « aucune trace, aucun souvenir de cet Hôtel royal des monnaies, « établi dans ses murs. Rien dans les Archives de la ville, ni ail- «< leurs, ne le rappelle; nous n'avons pas même la rue de la Mon- « naie, qui, dans beaucoup de villes de France, prouve, en per- « pétuant le souvenir, qu'il y a eu là un atelier monétaire. Où était « situé celui de Corbeil? On l'ignore, et toutes les recherches faites « pour le découvrir ont été sans résultat. Le hasard nous aidera «< peut-être un jour à percer ce mystère ». Le hasard nous a servi, ou plutôt des recherches patientes et 1. Cette notice a été lue dans la séance du 25 mai 1908. 2. Page 69 à 74. |00000059| - 17 - méthodiques dans les minutiers notariaux, nous ont permis de découvrir des actes, qui nous fournissent des renseignements précieux sur l'atelier monétaire de Corbeil. A la suite de quelles circonstances le transfert à Corbeil d'un atelier dépendant de la monnaie de Paris, eut-il lieu ? Antérieurement à 1654, ne fabriquait-on pas déjà de la monnaie à Corbeil? L'ordonnance royale de 1654 n'intervint-elle pas seulement pour rendre plus active cette fabrication, en autorisant l'emploi d'un plus grand nombre de presses? A quel endroit se trouvait cet atelier? Quelle importance avait-il? Combien d'ouvriers y employait-on ? Quels salaires recevaient-ils ? Autant de questions que nous allons aborder et essayer de résoudre, en faisant emploi des documents inédits dont nous venons d'indiquer la source. A nouveau, nous remercierons ici messieurs les notaires de la bienveillance qu'ils nous accordent en nous permettant l'examen de leurs anciens minutiers, si riches en documents concernant la vie publique et privée aux siècles passés. Si nous nous en rapportons à certaine opinion, assez accréditée, les troubles de la Fronde auraient seuls occasionné le transfert à Corbeil de tout ou partie de l'atelier monétaire de Paris, de 1654 à 1658. Cette fabrication, a écrit M. Dufour, n'aurait-elle pas été ordonnée, au contraire, uniquement pour soulager momentanément l'atelier de Paris « surchargé de besogne par les nombreuses et « fréquentes modifications apportées aux monnaies sous le règne « de Louis XIV ? » Il est certain que dès le commencement de février 1653, le roi était rentré à Paris; le cardinal de Retz, assagi, s'était réconcilié avec la cour; Mazarin était revenu, presque en triomphateur ; la Fronde était donc virtuellement terminée. Cependant la province était loin d'avoir recouvré la tranquillité; des bandes de gens armés tenaient encore la campagne, qu'ils ravageaient. Nombreux sont les faits de vol et de pillage que les paysans de l'Ile de France eurent à souffrir, dans les mois, les an1909. - I. 2 |00000060| ――――― ― 18. (( nées même, qui suivirent immédiatement la rentrée de Louis XIV dans la capitale. A l'appui de ce que nous avançons, nous nous contenterons de relater ici les termes d'un procès verbal, dressé le 28 mai 1653, constatant le meurtre de Louis Carré, me du coche de Sens à Paris, et le vol et pillage de son bateau par des soldats du régiment de Picardie, et ce, à moins d'une lieue de Corbeil, malgré toutes les précautions prises. Aujourdhuy, par devant le notaire royal à Corbeil (¹), soubz signé, est comparu Laurence Guibert, veufve de Louis Carré, me du coche de Sens. Laquelle a requis acte de ce que le jour d'hier matin, ledict deffunct, son mari, et elle remontant le coche dudict Sens, de Paris audict Sens, et estans au dessus dud. Corbeil, environ demye lieue, led. coche a esté surpris, pillé et vollé par quantité de soldatz du régiment de Picardye, qui ont tiré quantité de coups de fuzilz et tué ledict Carré, mary de lad. Guibert, d'un coup dont il est mort, aud. Corbeil, dès ceste nuict, sur les trois heures du matin. Ledict deffunct et elle ayant passé ledict Corbeil, sur l'assurance que les bateaulx ordinaires et coches ont tousjours passé librement pendant tous les troubles, et, principallement quand il n'y avoict que les troupes du Roy, et qu'il n'y avoict point de troupes estrangères; et, davantage, qu'elle avoict envoyé deux hommes exprès pour descouvrir s'il y avoict point des gens de guerre sur les passages et pour descouvrir, afin de n'estre point surpris, et avoir le temps de se garrer, et se mectre en sureté, et de l'aultre costé de la rivière. 1. M Clozeau, notaire. Néantmoings, le malheur est arrivé que lesdictz gens de guerre, gens de pied du Régiment de Picardye, ont sy furieusement attaqué led. coche à coups de mousquetz et fuzilz, et avec trois bachotz qu'ilz avoient, qu'ilz sont entré audict coche, ainsy tué ledict me de coche, pillé et vollé quantité de hardes, rompu et brizé des coffres, armoires, oster les chappeaulx, manteaulx, juste au corps et aultres habitz et linges, or et argent en quantité, dont ilz se sont chargez, tant qu'ilz en pouvoient porter, tellement que, cheminant avec des surcharges, ilz en laissoient cheoir par les chemins; et oultre, telle quantité d'aultres hardes, et tellement vollé, pillé et ravagé, que ce qu'ilz ne pouvoient emporter ilz le jestoient dans la Rivière. Et pour davantage approuver le dire de la dicte veufve, elle a faict comparoir le nommé Pierre Jouye, cocher de carrosse à Paris, y demeurant aux marais du Temple; Pierre Masart, mareschal, demeurant rue Montorgueil, et Guillaume Fleury, commis aux aydes, qui estoient audict coche, qui ont certifié le dire de ladicte veufve véritable. Et fait aussy comparoir Jehan Gillet et Sébastien Penautier, vallets dudict coche, |00000061| 19 ― qui ont aussy attesté, juré et affirmé, que le matin ledict deffunct, me du coche, les a envoyez sur le chemin du Coudray et aultres advenues, pour descouvrir et en advertir; qu'ils y ont esté, n'ont rien veu ; de là ont esté au Plessis (¹) et ès environs, et n'ont rien trouvé; que s'est destaché led. Penautier pour donner advis au coche qu'il n'y avoict rien à craindre, et ledict Gillet demeura pour pousser oultre et estre tousjours à la descouverte. Mais approchant, ledict Penautier, dud. coche il veit une trouppe de soldatz qui devalloient d'un bois où ilz estoient cachez, et que lesdictz atestans n'avoient poinct veuz, et n'estoient sortis que lorsque ledict coche estoit monté l'eaue jusqu'au lieu où ils estoient ainsy cachez lesdictz soldats, lesquelz ont ainsy surpris et vollé led. coche et blessé led. m de coche d'un coup de fuzyl ou mousquet, dont il est ainsy mort, et ainsy qu'il est dict cy-dessus. Dont acte, et ont la plus part déclaré ne sçavoir escripre, ny signer, les aultres se sont retirez, ladicte veuve et tesmoings a signé avec ledict notaire, et tesmoings pour ce présent acte; Hugues Aubry, boulanger, et Lois Trehet, clerc, le mercredy xxviii may 1653. Signé : AUBRY TREHET Laurence GUIBERT CLOZEAU, notaire. Ce procès-verbal démontre suffisamment le peu de sûreté qui régnait alors dans nos campagnes; les troubles continuaient et Mazarin eut à lutter pour rétablir, dans les provinces, la tranquillité qui régnait à Paris. Mais ces troubles furent-ils la cause initiale du transfert partiel, à Corbeil, de l'atelier monétaire de Paris? Nullement. Si l'on se reporte aux termes de l'ordonnance de novembre 1654, on est persuadé que, bien avant cette date, Corbeil était doté d'un atelier monétaire. N'y lit-on pas, en effet, que par lettres patentes, des mois de juin et septembre de l'année 1649, avril et juillet 1654, il avait été ordonné, une fabrication en cuivre neuf des espèces de liards, et la « conversion en icelle des deniers étrangers qui ont été introduictz «< en ce royaume, à nostre très grand préjudice et de nos subjects, « et mesme des doubles de France, réduicts en deniers. dès l'année « 1645, et ce, pendant le temps et avec le nombre des presses y < mentionnées ». 1. Le Plessis-Chenet. Or, c'est sur les remontrances de Isaac BLANDIN, commis pour l'exécution de ces lettres patentes « qu'il est nécessaire de placer « 12 presses au moins en nostre ville de Corbeil, affin de disperser |00000062| - - 20 « les liards qui y seront fabriqués ès villes et provinces circonvoi- « sines pour le soulagement du menu commerce, et que la cour « n'ayant pourveu ledict Corbeil que d'un commissaire, qui ne pou- <roit seul vacquer suffisamment, avoir l'oeil et ordonner sur tout « ce qui seroit de la dicte fabrication dans un établissement de «< cette qualité », — c'est sur ces remontrances, disons-nous, qu'intervint l'ordonnance royale du 28 novembre 1654, autorisant « à « faire toutes choses nécessaires à l'establissement et à la fabrique « des liardz et despendance en la ville de Corbeil, avec le nombre « de douze presses, pour donner aux habitans de Paris et environs, «<et aux provinces susdictes, le secours qu'ils en attendent et qui « leur est nécessaire pour le menu commerce ». Cette ordonnance ne créa donc pas l'atelier monétaire de Corbeil, mais en autorisa seulement l'agrandissement, en vue d'une fabrication plus importante. D'ailleurs, notre assertion est corroborée et confirmée par de nombreux actes, émanant des ouvriers de la monnaie, eux-mêmes. Ces actes, en la forme authentique, prouvent indiscutablement l'existence d'un atelier monétaire à Corbeil, dès le commencement de 1643, à la fin du règne de Louis XIII. En effet, le 19 janvier 1643, suivant contrats passés devant Me Clozeau, notaire à Corbeil, Daniel Cochin, compagnon fondeur, demeurant à Troyes, en Champagne, et François Mauger, aussi compagnon fondeur de la ville de Paris, du consentement de Pierre Mauger son père, me fondeur de la monnaie, reconnaissent s'être loués pendant deux ans à la communauté des maîtres fondeurs de la monnaie qui se fabrique en la ville de Corbeil. Un autre contrat va nous indiquer la nature de cette fabrication. Par obligation du 1er avril 1643, Jean Incelin, fondeur, demeurant à Corbeil et travaillant à la monnaie des doubles qui se fabriquent en la ville de Corbeil, et sa femme, s'étaient reconnus débiteurs de 88 livres envers Bernard Carenda, me fondeur de la monnaie. Pour se libérer, Incelin, par acte reçu par Me Clozeau le même jour, 1er avril, promet à Carenda de travailler à la fonte trois mois durant, à commencer du « lendemain des festes de Pâques, et de « fournir des outilz à luy appartenant, qui sont à présent à la fon- « derie, qui se consistent en une paire de soufflets, 4 moules garnis, « une caisse de bois de sapin, et une platine de fourneau ». |00000063| - 21 – Bien entendu, à l'expiration des trois mois Jean Incelin pouvait, si bon lui semblait, entretenir le marché passé précédemment entre lui, Carenda, Pierre Oudin et Pierre Mauger, pour la fabrication de la monnaie à Corbeil. Enfin, suivant traité intervenu devant Me Clozeau, notaire, le 24 avril 1643, Bernard Carenda, Pierre Oudin, Jean Incelin et Pierre Mauger, tous quatre ouvriers, travaillant à la monnoie, à Corbeil, décident et accordent, en exécution des conventions qui les lient: « Qu'ils jetteront au sort pour savoir celluy d'entre eux qui aura le livre com- «< mun, lequel portera ledit livre à la monnoye pour y estre enregistré les esto- «phes (') et argent qui leur seront baillez et délivrez, et des livraisons et des- « charges. « Lequel livre il sera tenu de communiquer aux aultres, lesquels en prendront «< chacun coppie, sy bon leur semble, ce qu'ilz promettent de garder et observer <«< inviolablement, à peine, contre celluy qui aura le dit livre, d'une pistolle, va- « lant 10 livres, dont il sera tenu en paier perte, et tenu en payer lad. pistolle, «‹ à chacun des 3 aultres pour chacune faulte qu'il fera, et d'être ledit livre osté « de ses mains, aussy sy bon leur semble. « Et sy a esté communiqué, celluy qui aura led. livre, à chacune fois qu'il re- <«< cepvra argent ou cuivre, il en fera le payement et livraison esgallement à chacun des trois aultres. Et celluy qui aura premier faict son ouvrage en pourra « prendre à celluy auquel il en restera le plus, et néantmoins par un ordre, en « sorte que chacun d'entre eux ayt pour s'employer ». Nous pouvons donc affirmer, avec certitude, qu'il y eut un atelier monétaire à Corbeil, dès 1643; par suite, la Fronde n'a pu influer sur sa création. Enfin, nous savons qu'à l'origine on fabriquait des doubles à l'atelier de Corbeil. Malgré les termes employés dans le traité d'avril 1643, nous ne pensons pas qu'aucune pièce d'argent ait été frappée à Corbeil. Le liard, petite monnaie de cuivre, valait 3 deniers, et faisait la 4 partie d'un sol. Les liards fabriqués à Corbeil ne valaient que 2 deniers, d'où leur nom de doubles. Il n'est donc pas téméraire d'affirmer que la création de l'atelier monétaire de Corbeil, faite pour soulager l'atelier de Paris, a été rendue nécessaire, précisément pour accélérer cette transformation de monnaie et aussi pour convertir en liards des deniers étrangers I. Matières. |00000064| 22 - introduits en France, en grande quantité, pendant la guerre de Trente ans (¹). L'invasion des monnaies étrangères en France ayant augmenté par suite des troubles de la Fronde, les commerçants qui en éprouvaient préjudice, s'en plaignirent. C'est alors que parut l'ordonnance royale de 1654, qui décidait la refonte de toutes ces mauvaises monnaies; Isaac Blandin, qui avait traité pour la fabrication des liards, en profita pour agrandir l'atelier monétaire de Corbeil. Yeut-il interruption de fabrication à l'atelier monétaire de Corbeil, entre 1643 et 1654? Aucun document ne nous autorise à le supposer. Les liards fabriqués à Corbeil sont communs; toutefois il y a parmi eux des pièces d'un type tout spécial qui ont été frappées en 1654 et 1655. Ce liard, recherché par les collectionneurs, est assez rare et se paie 10 à 12 francs. Il est connu sous le nom de pièce de plaisir, ou liard de Corbeil. Nous signalerons qu'en 1643, le gouverneur de la monnaie du Roi était Jean Varin; il demeurait à Soisy-sous-Etiolles. Henri de Guenegaud, secrétaire d'Etat aux Finances, qui contresigna l'ordonnance royale de 1654, y résidait également. Où était situe l'atelier monétaire de Corbeil? Par acte reçu pardevant Me Clozeau, notaire à Corbeil, le 21 mars 1643, Honoré de Molin, se qualifiant de me orfèvre, demeurant à Paris, île du Palais, fit cession et transport à Bernard Carenda, maître fondeur à Paris, rue de la Pelleterie, paroisse S'-Jacques de la Boucherie, du bail à loyer que lui avait consenti Léon Fontaine, procureur et notaire royal à Corbeil, de la maison du Barillet, sise à Corbeil, et dépendances, pour les 2 ans qui restaient à courir du bail. Le loyer annuel s'élevait à 90 livres. La maison du Barillet contenait deux corps de logis avec cour 1. Déjà, en septembre 1599, un arrêt du Conseil d'Etat avait interdit le cours des douzains, des liards, et autres monnaies de billon, qui n'étaient pas au coin et aux armes du Roi et qui ne portaient pas son nom en légende. |00000065| 23 ― au milieu. Elle se trouvait rue et près la porte Saint-Nicolas et l'hôtel de ville. Elle tenait par devant à la place du Jeu de l'arquebuse et d'un côté à la Rue du Port Saint Laurent. Son estimation fut de 3000 livres en 1653. Sans nul doute, l'atelier monétaire de Corbeil se trouvait dans cet immeuble important, loué et habité par le chef de la fonte de la monnaie de Corbeil, et où restait également Pierre Mauger, l'un des mes fondeurs (1). Peut-être même avait il été établi dans les pièces servant précédemment d'étude au notaire Fontaine. Autrement, on ne concevrait pas que Carenda ait consenti à payer un loyer si peu en rapport avec son salaire. A cette époque, une maison bourgeoise se louait à Corbeil de 40 à 50 livres seulement. 1. Acte Clozeau du 30 mai 1643. 2. Acte Clozeau. Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, le fonctionnement de l'atelier monétaire de Corbeil était assuré, en 1643, par six ouvriers, soit quatre maîtres fondeurs et deux compagnons : 1° Léon Carenda; 2º Pierre Oudin; 3° Jean Incelin; 4° Pierre Mauger, me fondeurs associés, sous la direction de Carenda. Les compagnons étaient Daniel Cochin, venu de Troyes en Champagne, et François Mauger, venu de Paris, qui était frère de Pierre Mauger. Seuls, Carenda et François Mauger étaient illettrés. Plus nombreux étaient les ouvriers qui travaillaient à la monnaie, de 1654 à 1657; plusieurs nous sont connus. Le 5 septembre 1655 (2), Nicolas Tabouré, ouvrier ordinaire du Roi en la monnoie de Paris, demeurant ordinairement à Paris, rue de la Calande, et Marguerite Poliat, sa femme, « estant de présent en la ville de Corbeil emploiez en la monnoie des liards », constituent 46 livres 10 sols tournois de rente annuelle, au profit de Antoine de Valemart, marchand, demeurant à Rouen, sur une maison et lieu sise à Paris, rue de l'Arbre Sec; Cette vente avait été faite par les époux Tabouré pour s'acquitter de 850 livres qu'ils devaient à Valemart pour une lettre de change. |00000066| 24 - Le 3 novembre 1655 (1), Jean Georges, vigneron à Evry-sur-Seine, donne à bail pour un an à Nicolas Godelle, portier de la monnoie des liards à Corbeil, la 1/2 de la maison et dépendances, appelée l'Enfer, sise au faubourg de Corbeil, près l'église St-Jacques, et ce, moyennant un loyer de 18 livres (2). Le 25 du même mois (3) de novembre, Michel Daumont, archer des gardes de son altesse royale, fondé de procuration de Pierre de Chartres l'aîné, demeurant à Orléans, « estant de présent travaillant à la monnoie des liards de Corbeil », donne à bail pour 6 ans, à Nicolas Hemery, cordonnier, demeurant au faubourg de Corbeil, une maison et lieu, sis au faubourg St-Léonard, moyennant un loyer annuel de 48 livres. Pierre de Chartres était d'une vieille famille Corbeilloise. (( Le 25 juillet 1655, Me Charles Aubry, notaire à Corbeil, reçoit le contrat en vue du futur mariage de Robert Jamet, fondeur en cuivre, servant à la fabrique des liards, à Corbeil, avec Nicolle Guibert (4). En 1656, Jean Arragon, Corbeillois, était commis garde pour faire la délivrance des liards monnayés à l'atelier de Corbeil; Jacques de Longpré était aussi commis cette même année. Le 2 Juillet 1657 (5), Germain Vaillant, demeurant à Paris, en l'abbaye de Livry, étant alors à Corbeil, à la monnoye des liards, loue pour six ans, du 11 novembre 1657, à Edme Gibert, laboureur et voiturier, la maison, cour, jardin et dépendances sis à Corbeil, appelée l'Enfer, près le Tremblay, moyennant 45 livres par an. Le 5 juillet 1657(6), intervient un marché entre Jean Foisy, l'un des entrepreneurs du blanchissement des liards en la fabrique de Corbeil, Antoine Gontier et Toussaint Hulliot (7), fondeurs de cuivre à Corbeil, aux termes duquel : Foisy a promis livrer auxd. Gontier et Hulliot, jusques à la quantité de deux 1. Minute de M Clozeau, notaire à Corbeil. 2. Cette maison sise au faubourg St-Jacques, appartenait en 1674, à M. Martin de Foisse, greffier du bailliage de Villeroy. C'est d'elle, selon toute probabilité, que la rue d'Enfer tire son nom (Arch. de S.-et-O., E. 6904). 5. Minute Clozeau. 6. Minute Clozeau. 3. Minute de Me Clozeau, notaire à Corbeil. 4. Arch. de Seine-et-Oise, E. 6896. 7. Toussaint Hulliot était fils de Toussaint Hulliot, notaire royal à Coulommiers. Il contracta mariage à Corbeil, le 31 mai 1657, avec Louise Delisle. |00000067| - 25 — « milliers pesants de poussière de cuivre, et les dits Gontier et Hulliot, de fondre « lad. poussière, et livrer aud. Foisy la moitié pesant de cuivre en lingots, de ce <«< qu'il leur fournira de poussière, sans aulcuns deniers bailler, l'un à l'autre ; et « à condition expresse que le cuivre qui sera livré par Gontier et Hulliot pro- « viendra desd. poussières, et sera loyal ». L'association entre Gontier et Hulliot prit fin le 15 octobre 1657, à la suite de différends qu'ils avaient ensemble, « à cause de plusieurs prétentions qu'ils se demandoyent l'un l'autre, procédant tant de leur association que pour autres causes » et à raison desquelles une instance avait été engagée devant la prévôté de Corbeil. Nous trouvons enfin comme intéressés à la fabrication des liards de Corbeil, Lefebvre et Deodaty, bourgeois de Paris, qui avaient, sans doute, sous-traité de Isaac Blandin, chargé par le roi de la fabrication des liards dans tout le royaume. Par acte du 18 février 1657 (¹), le sieur Deodaty, écuyer, sieur de Villiers, et Nicolas et Jacques Lefebvre, intéressés en la fabrique des liards de Corbeil, se portent caution envers Roger de Ramponnet, écuyer, sieur de la Choppinière, major de la ville de Corbeil, demeurant à la Choppinière, paroisse de Villabé, et Elise Choppin, sa femme, de honorable homme Pierre François Marchand, me menuisier à Paris, pour l'exécution des clauses d'un bail qui lui avait été consenti des moulins de Ronfleur, Fort et de la Choppinière, situés sur la rivière d'Etampes, et bras d'eau de la Choppinière, paroisses de Villabé et d'Essonne. Le salaire d'un maître fondeur à l'atelier monétaire de Corbeil était, en 1643, de trente sols tournois par jour de travail, à commencer la journée depuis 4 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. Le salaire journalier d'un compagnon fondeur était de 20 sols. Enfin, un apprenti gagnait 12 sols, pour travailler de 5 h. du matin à 9 h. du soir. On le voit, ces ouvriers étaient de rudes travailleurs. Et, malgré ces longues journées, ils faisaient encore des heures supplémentaires. Ces temps sont éloignés. Le payement avait lieu, chaque semaine, le dimanche. 1. Minute Clozeau. |00000068| 26 - - Ces salaires, qui seraient si insuffisants de nos jours, pour faire face aux besoins de la vie, étaient, il y a deux siècles et demi, presque un maximum. Un artisan gagnait en moyenne 12 à 15 sols par jour; un ouvrier agricole seulement 10 à 12 sols. Ces salaires étaient en rapport avec la situation économique de l'époque; ils correspondaient au peu de cherté des vivres. Il faut considérer qu'alors, une livre de pain coûtait i sol, une pinte de vin (o'93), 2 à 3 sols, un poulet 8 sols, une douzaine d'œufs de i sol à i sol 6 deniers; un mouton 3 livres 10 sols, un porc gras I 5 à 8 livres, une vache laitière 25 livres. Le mois de nourrice d'un enfant se payait 5 livres. Enfin on pouvait se loger convenablement pour 20 à 25 livres par an. Tous ces chiffres ont été relevés par nous sur des inventaires. Les contrats de travail, intervenus entre la communauté des maîtres fondeurs de la monnaie de Corbeil et leurs ouvriers, sont des plus intéressants à connaître (¹). En outre du prix des salaires et des heures de travail que nous avons indiqués plus haut, ces marchés nous apprennent que les ouvriers ne devaient pas se divertir alors qu'ils se trouvaient à leur « besongne » et que, au cas où ils travailleraient l'heure passée, ils seraient payés raisonnablement de ce qu'ils auraient fait en supplément. L'ouvrier ne pouvait, pendant la durée de son contrat, « se retirer ny divertir, ny employer ailleurs, à peine de dommages intérêts », fixés à 30 livres pour les compagnons fondeurs, et à 20 livres pour les apprentis. De leur côté, les maîtres fondeurs étaient tenus d'employer leurs ouvriers, le temps convenu, « faulte de ce, de les payer, comme si ils travailloient ». On peut assurer que, à cette époque, qu'on croirait si lointaine, de tels contrats étaient exécutés réciproquement, et avec honneur. A quelle époque la fabrication de la monnaie cessa-t-elle à Corbeil? Nous estimons qu'elle se termina au plus tard vers la fin de l'année 1657. 1. Nous donnons le texte de deux de ces contrats, aux pièces justificatives. |00000069| - 27 ― Un acte du 26 janvier 1658 (¹), constate, en effet, le paiement, à cette date, par François Perrault, monnayeur en la monnaie de Paris, de la somme de 69 livres, 6 sols, 6 deniers, à Charles Aubry, notaire à Corbeil, en l'acquit de Jean Regnault, marchand à Paris, pour prix de loyer de logements occupés par lui, Perrault, et « autres monnayeurs » jusqu'au dernier décembre 1657, dans une maison sise au faubourg et carrefour Saint Léonard. Il est présumable que ce départ coïncidait avec la fin de la fabrication à Corbeil. De plus, nous n'avons trouvé ici aucun autre acte postérieur concernant les ouvriers de la monnaie. De nombreuses fraudes se commettaient journellement sur les voitures et les bateaux transportant les liards des provinces à Paris. Ce fut, sans doute, aussi l'une des causes de l'installation d'un atelier monétaire à Corbeil. Malgré les précautions multiples, prises pour éviter ces fraudes, on n'y parvenait pas toujours. Nous en donnerons pour preuve le curieux procès verbal portant la date du 1er août 1656 (2). La garde de jour et de nuit qu'il fallait faire pour empêcher le vol de bateaux chargés de liards, allant de Montargis à Paris, n'était pas ordinaire; ce fait montre encore le peu de sûreté des routes, aussi bien par la voie de terre que par la voie d'eau, trois ans après la Fronde. Sans doute, nous aurions pu découvrir encore d'autres documents concernant l'atelier monétaire de Corbeil, notamment aux Archives nationales, série Z, et dans les pièces du greffe de la prévôté de Corbeil, déposées aux archives départementales, mais ceux que nous avons trouvés à Corbeil même, et que nous venons d'analyser, nous ont paru suffisamment clairs et probants pour élucider les questions posées. L'intérêt présenté par ces documents nous faisait un devoir de les faire connaître. 1. Minute de Nicolas Regnault, le jeune, notaire à Corbeil. 2. Minute Clozeau, notaire à Corbeil. Voir pièce annexe nº 3. Emile CREUZET. |00000070| PIÈCES JUSTIFICATIVES I Marché fait par un compagnon, fondeur de monnaie, pour travailler à la fonte de la monnaie à Corbeil (acte devant Me Clozeau, notaire à Corbeil du 19 janvier 1643). Fut présent Daniel COCHIN, compagnon fondeur, demeurant à Troyes, en Champagne, estant de présent en ceste ville de Corbeil. Lequel recongnoist qu'il s'est alloué à la communaulté des maistres fondeurs de la monnoye qui se fabrique en la d. ville de Corbeil, ce acceptant par Bernard Carenda, Pierre Oudin, Jehan Hincelin, et Pierre Mauger, me fondeurs de la d. monnoye, à ce présens. C'est asçavoir que ledict Cochin a promis et sera tenu de servir et travailler pour ladicte communaulté de fondeurs, à la fonderie de la monnoye de Corbeil, deux ans durant, à commencer du jour et date des présentes, moyennant vingt sols tournois par jour de travail, en se rendant, par ledict Cochin, à la besongne, à cinq heures du matin, jusques à neuf heures du soir, et sans se divertir de la d. besongne, et au cas que sy il travailloit l'heure passée, luy payeront raisonnablement ce qu'il aura travaillé ; et le tout à la charge d'estre par le dit compagnon payé des dictes heures; qui se sont, à ce faire, obligez, par chacun dimanche, de ce qui se trouvera luy estre deub pour la septmaine précédente, et sans que le d. Daniel Cochin se puisse retirer ny divertir, ni employer ailleurs, à peyne de trente livres de dommages et interestz; Aussy seront tenus lesd. fondeurs de l'employer à peyne, faulte de ce, d'estre payé par led. entrepreneur comme sy il travaiiloit; et le tout aussy à condition que sy si lesd. fondeurs estoient congédiez, audit cas le présent traité demeurera nul et résolu. Car ainsy promettant, obligeant respectivement, lesd. fondeurs solidairement entre eulx, ung d'eux seul pour le tout. Faict et passé en l'estude du notaire royal à Corbeil, soubz signé, le lundy dixneufviesme jour de Janvier mil six cens quarante trois, après midy; présens Hugues Aubry, boulanger, et Pierre Prieur, clerc, demeurant audit Corbeil, tesmoings, et ont tous signé, sinon le dict Caranda, qui a desclaré, sur ce interpellé, ne scavoir escrire ny signer. Pierre Oudin, Incellin, Prieur, Clozeau, not. Signé Pierre Mauger, Cochin, Aubry, |00000071| ― – 29 II Autre marché fait par un compagnon fondeur, du 19 janvier 1643 (Clozeau, notaire). Fut présent François Mauger, compagnon fondeur de la ville de Paris, de présent, demeurant en ceste ville de Corbeil. Lequel, en présence, assisté et du consentement de Pierre Mauger, son frère, à ce présent, me fondeur de la monnoye : Recongnoist qu'il s'est alloué aux me fondeurs de la monnoye qui se fabrique en ceste ville de Corbeil, ce acceptant par Bernard Carenda, Pierre Oudin et Jean Inselin, me de lad. fonte, pour eux et leurs consors, et à ce présens. Pour, par led. François Mauger, servir au travail de lad. fonte de lad. monnoye, pendant le temps de deux ans, commençant aujourdhuy, où il sera tenu de s'employer par chacun jour ouvrable, depuis l'heure de cinq heures du matin, jusques à neuf heures du soir, sans se divertir ny retirer dud. service, à peine de luy estre déduict le temps qu'il aura manqué, et s'il se retire de vingt livres de dommages et interestz. Ceste convention faicte auxd. charges, et moyennant douze solz tournois par chacun jour de travail pendant la première année, que lesdictz m” ont promis et seront tenus luy payer par chacun dimanche de la septmaine; et à condition que sy il travaille daventage après l'heure passée, qu'il en sera payé raisonnablement; et seront tenuz lesd. mes de luy fournir employ, à peine de le payer comme sy il avoit travaillé; et sy a esté accordé que sy lesd. me estoient congédiez, et n'estoient plus employez, que le présent traicté demeurera nul; et pour le regard du loyer de la seconde année, led. compagnon en sera payé selon raison, et suivant le travail qu'il fera. Car ainsy promettant, obligeant respectivement lesd. fondeurs sollidairement, ung d'eux seul pour le tout, sans division; et ledict Pierre Mauger, avecq son frère, et eux deux sollidairement à l'entretien du contenu des présentes. Faict et passé en l'estude du notaire royal, à Corbeil, soubs signé, le lundy dix neufviesme jour de Janvier mil six cens quarante trois, après midy, en présence de Pierre Prieur, clerc, demeurant aud. Corbeil, tesmoing, et ont tous signé, sinon led. Carenda, qui a desclaré, sur ce interpellé, comme aussy led. entrepreneur ne scavoir, ni l'ung ni l'aultre, escrire ne signer. Signé Pierre Mauger, Pierre Oudin, Incellin, P. Prieur, Clozeau, not. |00000072| 30 - III Procès-verbal de difficultés, au sujet de trente sacs de liards, saisis au port de Corbeil. 1er août 1656 (Clozeau, notaire). Aujourd'huy, en présence du notaire royal à Corbeil, soubz signé, et des tesmoings cy après nommez, Jehan Chartier, marchand bourgeois de la ville de Lyon, ou nom et comme procureur fondé de procuration spécialle, de noble homme Edme Sollu, bourgeois de Paris, y demeurant, rue St-Advoye, paroisse de StMédéric, comme procureur de Me Ysaac Blandin, qui a traicté avec sa Majesté, pour la fabricquation des liardz, dans le roiaume, fondé de procuration passée pardevant Jehan Larie, et Sadot, notaires au Chastellet de Paris, le premier jour d'aoust mil six cens cinquante quatre, pour toutes sortes d'affaires et concernant ledict traité, oultre pouvoir de substituer un ou plusieurs procureurs à l'effect entier ou partie d'icelle, ainsy que de ladicte procuration en estoict apparu ausdicts notaires, rendu audict sieur Sollu, attendu qu'il y en a minutte, vers ledict Sadot, notaire.. Lequel sieur Chartier audict nom, a sommé et interpellé Jacques de Longpré, demeurant audict Corbeil, et à ce présent, comme commis des sieurs Le Febvres et Deodaty, bourgeois de Paris, et dépositaire de la quantité d'une balle de liardz, estans en ses mains, qu'il a pris dans un basteau, estant au port de Corbeil, sur la rivière de Seine, par la conduicte de Daniel Vailleau, voiturier par eau, demeurant à Montargis, comme ladicte balle de liardz, appartenant audict sieur Sollu; Lequel sieur de Longpré a faict responce qu'il a charge exprès et par escript du sieur Deodaty, intéressé à la fabricquation des liardz de Corbeil, de faire saisyr et arrester tous les liardz, génerallement de ce royaume, qui passeront et seront conduictz dans le département de Paris, pour ladicte fabricquation, mesme aussy, charge de porter pareille commission et pouvoir en plusieurs lieulx pour empescher les fraudes qui se commettent journellement par la voiture des liardz des aultres provinces en la ville de Paris; Que pour ce, il a esté exprès en la ville de Montargis, où il a baillé un pouvoir par escript, signé dudict sieur Deodaty, à un habitant de ladicte ville, qui ayant veu la descharge desdicts liardz dans ledict bateau, s'est acheminé exprès et de cheval en ceste ville, où il est arrivé mardy dernier, pour l'advertyr du passage dudict bateau. Quoy sachant ledict Longpré, a pris huissiers et assistances, un marignier et un bateau, qui ont esté de jour et de nuict pour prendre garde au passage dudict basteau, que luy respondant a esté jusques à St-Mamin, lieu ou d'ordinaire on |00000073| 31 — descharge dans d'aultres basteaux des marchandises que l'on conduict de Montargis à Paris; quoy faisant on n'a pas perdu la cognoissance dudict basteau, et ainsy qu'il a faict de grands frais. Pourquoy a faict reffus de rendre la balle de liardz contenant trente petitz sacs de chacun dix livres, jusques à ce que le mémoire desdictz frais soict arresté par qui il appartiendra, joingt que lesdictz voituriers n'avoient aulcun passeport desdictz sieurs Lefebvres et Deodaty, leur ayant faict sommation et interpellation par escript de le déclarer. Sur quoy ils ont faict responce qu'ils n'en avoient aulcun. Lequel sieur Chartier, audict nom, a protesté de tous ses despens, dommages et intérests, et du séjour du basteau, et mesme pour le recouvrement de ladicte balle de liardz allencontre dudict de Longpré, auquel la lettre de voicture adressante audict sieur Sollu, luy a esté exhibée par le dict Valleau, et proteste aussy contre tous aultres qu'il appartiendra. Lequel de Longpré a respondu que le dict Valleau, luy a montré une simple lettre missive, escripte de Montargis, signée de Monmelier, adressante audict sieur Sollu, marchand, demeurant à Paris, rue Ste-Avoye; qu'il n'a aulcune cognoissance dudict sieur Sollu, partant il a deub faire arrester ledict basteau. Dont acte ausdites parties pour leur servir ce que de raison. Faict le mardy matin, premier jour d'aoust mil six cens cinquante six, présens M. Spire Barré, praticien, et Claude Hay, clerc, demeurant à Corbeil, tesmoings, et ont signé : Signé: Chartier, Barré, de Longpré, Hay, Clozeau, notaire. |00000074| LA GRANDE BOUCHERIE DE PHILIPPE-AUGUSTE ET L'HOTEL SAINT-YON A ETAMPES Les maisons du Moyen Age existent encore fort nombreuses à Etampes si nous ne les distinguons pas, c'est parce qu'elles furent défigurées au cours des siècles et ont ainsi perdu, au moins superficiellement, leur caractère spécial. Souvent on les devine de très vieux logis ou d'antiques échoppes, sans qu'on puisse déterminer, même à cent années près, le temps de leur fondation. Quelquesunes, dédaigneuses des maquillages, usent encore des grâces d'un art suranné pour avouer leur naissance vers le xve ou vers le xvi siècle. Pour d'autres, c'est un déshabillage fortuit, un décrépissage indiscret qui révèle à nos yeux amusés ou ravis des structures désuètes et l'âge vénérable d'une petite demeure cinq ou six fois centenaire de quels masques plats et insignifiants n'ont pas été affublées nos plus vieilles habitations particulières ! : Nous connaissons ainsi les vestiges d'une construction érigée au xire siècle, le plus vraisemblablement dans la seconde moitié (¹). A vrai dire, il ne s'agit pas d'un ancien logis ou manoir, et les détails caractéristiques de son origine n'abondent pas, au moins dans l'état actuel de la maison; car il suffirait probablement de décrépir les murs extérieurs pour dégager de nouvelles particularités 1. Déjà signalée par M. Max. LEGRAND, Etampes pittoresque, 2° édit., t. I, p. 180. |00000075| ERIE T nombreuses a qu'elles furent moins superf vine de très e déterminer, n. Quelquesgrâces d'un vers le xv décrépissage es structures You six fois n'ont pas éte ction érigée de moitié r, et les démoins dans ment de de particularités p. 180. J, p. 2 |00000076| N No |00000077| - 33 certaines et retrouver enfin des formes romanes ou du style gothique primitif. J'ai cru devoir attirer l'attention sur cette construction non seulement parce qu'elle est un exemple jusqu'à présent unique à Etampes, mais encore parce que son origine est entourée de circonstances historiques qui la signalent spécialement et augmentent beaucoup son intérêt. La construction dont je veux parler appartient à la ligne de maisons serrées entre la rue de la Tannerie et la rivière canalisée qui traverse la ville depuis le x1° siècle (¹). Elle est cachée par un autre petit bâtiment en façade sur la rue. Mais celui-ci est bien connu de tout le monde, à cause des marques flagrantes que sa façade sur la rue a conservées du temps jadis. Ce pittoresque logis porte le numéro 15 de la rue de la Tannerie (2), et s'appela longtemps « le Petit Hôtel Saint-Yon », parce qu'il a été une dépendance de l'Hôtel Saint-Yon proprement dit, autre vieille demeure plus imposante et plus ornée, à laquelle il est du reste contigu (3). Le corps de bâtiment en façade sur la rue ne date peut-être pas du xiie siècle; en tout cas, rien dans son aspect ne rappelle l'époque romane ou les débuts des temps gothiques, et il aurait alors subi plusieurs remaniements importants vers les xve et xvie siècles: on se rappelle sa porte en bois sculpté, aux panneaux plissés en parcheminure, et que surmonte une niche gothique vide. Séparée de ce petit bâtiment par une étroite cour, et connue seulement des familiers, est la construction un peu plus vaste qui m'a entraîné à écrire cette étude. Par bonheur, s'il y a eu là des altérations certaines et graves, au xvie siècle, si l'on en croit la boiserie élégante d'une fenêtre de style Renaissance, elles ont laissé subsister des fragments importants de l'édifice originel permettant de se faire une idée des dispositions architecturales dans les parties basses. - 1. L. Eug. LEFÈVRE, Etampes et ses monuments aux x1º et XII° siècles, mémoire pour servir à l'étude archéologique des plus anciens monuments étampois, extrait des Annales de la Société archéol. du Gátinais, Paris, A. Picard, 1907, p. 32. 2. Autrefois rue de la Coutellerie, et dénommée aussi familièrement rue de la Salle, probablement à cause de la Salle des Plaids, réservée à cet usage jusqu'en 1518, et non pas à cause d'une auberge, comme je l'ai lu quelque part. 3. Les deux propriétés ont été réunies au moins pendant plusieurs siècles, entre 1607 et 1820. 1909. - I. 3 |00000078| - 34- - Ainsi nous découvrons, engagées dans le mur de la façade orientale qui regarde la vallée, une colonne avec chapiteau et base dont le caractère appartient franchement au style du xir° siècle : et il n'est pas certain qu'il n'en existe pas d'autres invisibles dans le mur dont le pied baigne dans l'eau : en tout cas, il se trouve une autre colonne avec son chapiteau qu'une ouverture dans le mur a laissés presque entièrement dégagés. Je ne me crois pas en droit d'en faire état comme de la première, parce que son chapiteau n'est pas placé au même niveau que l'autre : il est possible qu'on l'ait simplement baissé pour le faire passer sous une pièce de bois, en l'espèce un linteau qu'il fallait soutenir. Du reste, on trouve encore d'autres débris de fûts de colonnes que l'on a rassemblés pour supporter les poutres du plancher en divers endroits. Ce sont les seules traces d'art roman qu'on a laissées à notre curiosité dans la maison, mais elles suffisent, je pense, à indiquer que le rez-de-chaussée de la façade était ouvert avec de grandes arcades (¹). Je reconnais d'ailleurs bien vite que cette disposition n'a rien de très extraordinaire. Mais il se trouve que la maison, comme toutes ses voisines placées dans le même rang, est, ainsi que je l'ai dit, baignée par une rivière canalisée (2). Les colonnes enfermées dans le mur de la façade orientale sont donc sur le bord de l'eau, et le sol du rez-de-chaussée (3) n'était qu'à plusieurs centimètres au-dessus du niveau de l'eau de la rivière, comme celui d'un lavoir ordinaire. Le bâtiment forme un rectangle ayant environ 13 mètres de long, sur 8 mètres 50 de large. 1. A l'intérieur de la maison, dans l'axe de la première colonne citée, on découvre encore engagée dans une cloison, la partie basse du fût d'une autre colonne, distante de moins de quatre mètres, et dont la base a tout l'air d'être enterrée. Cela laisse donc encore supposer que le rez-de-chaussée tout entier était une grande pièce dont le plafond reposait sur une ligne de colonnes. Toutefois il faut se méfier du déplacement des colonnes ; et je m'empresse de dire que, malgré l'invraisemblable supposition de colonnes apportées là et engagées dans les murs sans avoir servi à cette même place, je fais à cet égard toutes les restrictions nécessaires. 2. La rivière a de 4 mètres à 4 mètres so de largeur. 3. Il s'agit en réalité de la partie la plus inférieure de la maison, à l'origine; mais son sol, dans l'état actuel des choses, est au-dessous du niveau de la rue, et pourrait être considéré comme un sous-sol : j'ajoute qu'il y a néanmoins des caves véritables, construites avec voûtes vers le xv ou le xvr siècle, et dont le niveau est sensiblement inférieur à celui de la surface de la rivière elle-même. |00000079| 35 – En résumé, il est supposable que la maison fut construite pour abriter une industrie ayant besoin d'un accès facile à la rivière, et même qu'il s'agit d'un abattoir, d'une peausserie ou d'une mégisserie. En effet, les étaux de boucherie étaient établis de l'autre côté de la rue, bien avant 1186. Philippe-Auguste avait fait construire en cet endroit sa Grande-Boucherie sur l'emplacement des anciens étaux (¹). En outre, les bouchers et charcutiers étaient obligés par des règlements de tuer les animaux « sur les rivières et non en leurs maisons », comme stipulent les vieux textes (2). C'est pourquoi notre bâtiment à arcades, placé entre les étaux et la rivière, doit avoir été une dépendance de la boucherie, avec la grande maison voisine dont le nom d'Hôtel Saint-Yon paraît être encore un garant qu'elle fut la propriété des bouchers. En effet, la famille de Saint-Yon se trouvait, au XIIe siècle, à la tête de tout le commerce de boucherie qui pouvait se faire dans Paris. Formant une communauté régie dans ce but par un règlement spécial (3), les Saint-Yon étaient les uniques détenteurs des étaux, et, à l'imitation d'un système établi à Rome dans l'Antiquité, ils possédaient, comme une charge d'Etat ou un fief transmissible, la surintendance, la juridiction, la police, la surveillance sanitaire même, sur tout ce qui concernait le voyage, la vente et le débit des bestiaux dans la grande ville (4). Il en était ainsi dès le milieu du xiie siècle, 1. FLEUREAU, ouv. cité, p. 75. 2. Coustumes des bailliage et prévosté d'Estampes, anciens ressorts et enclaves d'iceluy Bailliage rédigées et arrestées, au moys de Septembre 1556, par ordonnance du Roy. Paris, 1557, in-8°. Voici le texte de deux articles intéressants qui montrent en outre un réel souci de l'hygiène Art. 185. N'est loisible à personne faisant sa demourance en la ville d'Estampes tenir bestes à laines, porcz, oyes, et canes, sur peine de confiscation desdites bestes, oyes et canes, et d'amende arbitraire. - Art. 186. - Peuvent néanmoins les bouchers pour la fourniture de ladite ville, tenir en icelle les dites bestes à laine pour huit jours seulement, et sont tenuz iceux bouchers tuer leurs bestes sur la rivière et non en leurs maisons. Il faut noter que, durant le Moyen Age, on tirait l'eau des puits pour l'alimentation. On craignait moins d'utiliser les rivières comme de grands égoûts naturels. Sur les tueries et escorcheries, voir C. ENLART, Manuel d'archéologie française, t. II, p. 257; et DE CAUMONT, Abécédaire, Arch. civ. et mil., 1869, p. 230-235. 3. Ce réglement a été publié tout au long par le R. P. Jacques DU BREUL, Le Théâtre des Antiquités de Paris, Paris, 1612, in-4º, p. 787. 4. Au fur et à mesure que les murs de Paris étaient reculés, la communauté des SaintYon rencontrait dans les nouvelles annexes d'autres privilégiés avec lesquels elle passait alors des contrats. Elle traitait même quelquefois avec des privilégiés placés en dehors des murs. Le cas s'est présenté pour les Templiers en 1182. L'abbaye de Saint-Germain des |00000080| → 36 - et, en 1182, Philippe-Auguste confirma seulement les privilèges et les coutumes de la Communauté (¹). Enfin, en 1189, celle-ci paraît avoir réorganisé ses étaux qui, au nombre de vingt-trois, étaient situés en face du Châtelet, auprès de la Seine, et connus sous le nom de la Grande-Boucherie. D'un autre côté, c'est en 1186 que Philippe-Auguste réforma le commerce de la boucherie à Etampes. On serait donc tenté de croire que le roi étendit alors jusqu'ici le privilège de la Communauté de Saint-Yon. On s'imagine volontiers ces puissants hommes d'affaires réorganisant et reconstruisant pour le compte du Souverain, tout en lui payant chaque année une redevance plus forte que celle perçue par lui jusqu'alors. Mais, s'il n'y a aucun doute sur l'établissement des Saint-Yon à Etampes, tant s'en faut que nous soyons éclairés sur l'époque de l'événement et sur le rôle exact joué par leur Communauté dans cette ville. Au contraire, non seulement les textes les plus anciens ne font pas mention des Saint-Yon, comme bouchers d'Etampes, mais ils les écartent plutôt, tout au moins durant les xie et xiiie siècles. Voici ce que nous distinguons de plus clair. Avant 1186, il existait une boucherie dans chaque quartier de la ville, à Saint-Martin, à Saint-Gilles, à Saint-Pierre, et à Notre-Dame au lieu que nous avons indiqué. Cette dernière boucherie, qui était la plus importante, et appartenait à Hugues Nascard (2), était probablement divisée en plusieurs étaux avec chacun un tenancier différent. Donc, vers 1186, Philippe-Auguste se substitua (3) à Hugues Nascard en - l'indemnisant certes (4), mais dans le but de supprimer un interméPrés possédait également des étaux indépendants en vertu de très anciens droits, et parce qu'elle était établie hors l'enceinte. 1. Un système semblable existait pour la boulangerie, qui était sous la dépendance du grand panetier; et d'autres branches d'industrie ou de commerce, fripiers, gantiers, pelletiers, cordonniers, selliers, bourreliers, etc., avaient un grand chef en la personne du chambellan royal. 2. D'après notre érudit collègue, M. Joseph Depoin, ce nom est devenu Nacquard. 3. Il est remarquable combien souvent Philippe-Auguste a employé ce procédé à Etampes. Quand il casse la Commune ou quand il supprime l'abbé de Notre-Dame, c'est pour augmenter les ressources royales et tirer de toutes choses un maximum de rendement. Nous trouvons dans l'acte de la boucherie une nouvelle application du système. Voir notre Etampes et ses monuments aux xx et x11° siècles, pp. 21-24 et 62-74. 4. Avec 100 sols paris. de rente perpétuelle à prendre sur le revenu de la nouvelle boucherie. A noter que le diplôme délivré en 1187 était postérieur aux changements et aux travaux exécutés par Philippe-Auguste. Cette même rente fut transférée en 1246 |00000081| 37 — diaire coûteux, et de profiter seul des augmentations de rente qu'il avait en vue. Tout ceci se trouve confirmé par des actes postérieurs (¹). Enfin dans l'acte de 1187, comme dans un autre de 1274, l'autorité complète du suzerain propriétaire est affirmée sans restriction (2). La conséquence de tout cela, c'est qu'il ne faut pas hésiter à prendre à la lettre les termes précis du diplôme de 1187: PhilippeAuguste a fait démolir pour son propre compte les anciens étaux, et il a fait reconstruire les nouveaux pour en tirer directement du profit. De sorte que les halles détruites soit en 1763, soit vers 1835, étaient un édifice royal (3). De même, selon toute évidence, le petit manoir qui m'a entraîné à faire la présente étude et qui fut primitivement, à n'en pas douter, une dépendance de la Grande-Boucherie, doit être un reste des bâtiments érigés vers 1186 par Philippe-Auguste. C'est donc un édifice royal, à moins cependant qu'il ait été construit par Hugues Nascard ou l'un des prédécesseurs de celui-ci ; il est extrêmement difficile de se faire une opinion précise à ce sujet. En tout cas, nous nous trouvons en présence d'une construction élevée pour servir à une industrie dérivant de la boucherie: tuerie, peausserie ou mégisserie ; et en considérant la sculpture classique de ses chapiteaux et la belle proportion de ses colonnes, elle nous par un nommé Guyard de Papillon à l'abbaye royale de Villiers près de La Ferté-Alais (FLEUREAU, ouv. cité, p. 134). 1. En 1246, saint Louis autorise que la rente sur les étaux consentie à Hugues Nascard en 1187 passe à l'abbaye de Villiers sans qu'il soit question d'aucun concessionnaire général, Saint-Yon ou autre. En 1274, la reine Marguerite, devenue dame suzeraine d'Etampes, délivre un acte accordant directement des baux aux tenanciers des divers étaux de la nouvelle boucherie, moyennant 72 livres paris. de rente, lesquels apparemment se payaient encore aux xvir siècle (FLEUREAU, ibid., p. 137). Les tenanciers d'alors s'appellent Guillaume de La Ferté, Paul Breton, Guillaume de Marie, Pierre Rouault, Jean Mallard, Jean Catault et Jean Colard; ils possédaient également des privilèges de famille (FLEUREAU, ouv. cité, p. 136-137). La Communauté de Saint-Yon s'est peu å peu associé plusieurs familles qui naturellement devaient être riches et n'ont rien de commun avec les petits bourgeois ci-dessus : ces familles portaient les noms de Thiberts, Ladehors et d'Auvergne. - · - «l 2. «…quoniam propter stalla Hugonis Nascardi, quæ destructa fuerunt et eversa, quando stalla nostra Stampis fieri fecimus… » ; .in stallis nostris carnificium Stampensium… »; …quod nos carnificibus Stamparum, qui consueverunt boucheriam Stampensem, quæ dicitur ad novos stallos… » (FLEUREAU, ouv, cité, p. 134 et 136). - « 3. L. Eug. LEFEVRE, ouv. cité, p. 75, note 3. |00000082| 38 offre une nouvelle preuve du soin et de l'intelligence pratique avec lesquels nos ancêtres du Moyen Age installaient leurs locaux destinés au travail industriel ou commercial. Sur le bâtiment de la Grande-Boucherie construit par PhilippeAuguste et dont les derniers vestiges ont disparu vers 1840, nous savons fort peu de chose. Aucun dessin, si mauvais soit-il, n'est là pour nous en donner l'image même imprécise (1). Nous savons seulement par Fleureau que le bâtiment avait un étage: au-dessus des étaux se trouvait une grande salle où, depuis un temps indéterminé, mais vraisemblablement depuis la fondation, se tenaient les plaids», c'est-à-dire les plaidoiries, les tribunaux civils. La justice, qui, dans Etampes, était réservée en principe au roi, en sa qualité de suzerain, et qui le fut véritablement en fait pendant fort longtemps, - était rendue dans le Palais royal; seules les très petites causes abandonnées à un fonctionnaire étaient jugées ailleurs. Mais quand les rois cessèrent de rendre la justice eux-mêmes (2), il semble que le palais n'en resta pas moins réservé pour eux seuls. C'est pourquoi une salle spéciale était nécessaire, et, comme nous venons de le dire, à Etampes cette salle se trouvait au-dessus des étaux de boucherie, et en somme dans une propriété royale (3). — Avant le xvi siècle, quand les habitants ne possédaient pas encore un hôtel de ville, les grands actes de la vie communale se passaient dans cette salle avec l'apparat et la solennité aimés du Moyen Age. Là se faisait l'élection des échevins (4). La salle de la - 1. Il est notable combien Etampes a été peu favorisé dans cet ordre d'idées. L'art du dessin n'y fut sans doute jamais florissant. C'est seulement vers le milieu du xix® siècle qu'un simple amateur, mais dessinateur consciencieux, Lenoir, a commencé à relever plusieurs monuments intéressants. Ses documents sont précieux. 2. Ils se faisaient quelquefois remplacer par la reine ou par le prince héritier désigné ; mais alors le principe était sauvegardé. On a parlé d'une Salle de Justice construite spécialement dans ce but, à la fin du xr siècle dans l'enceinte du château de Caen, pour l'usage des Ducs de Normandie (VERDIER et CATTOIS, Architecture civile et domestique au Moyen Age, Paris, 1855, t. II, p. 152). 3. Au Moyen Age, les salles convenables pour une telle cérémonie manquaient fréquemment. Aussi l'habitude se prit de tenir les plaids dans les églises. L'autorité ecclésiastique en était mécontente, et les conciles répètent sans se lasser leurs interdictions à ce sujet, interdictions qui ne paraissent pas avoir eu souvent grand effet. - 4. « La manière de procéder en cette election étoit, que les Echevins obtenoient du Lieutenant Général la permission de faire assembler les habitants. Ceux-ci assemblez, en la présence du même Lieutenant Général et du Procureur du Roy, en l'audience où l'on tenait les plaids… Le Procureur du Roy requeroit que l'on fit la nomination des nouveaux Echevins. La nomination faite par les habitans, le Lieutenant Général prenoit le serment |00000083| 39 Halle car le bâtiment s'est aussi appelé ainsi pendant longtemps, a cessé d'être salle d'audience quand les rois eurent renoncé à itiliser pour leurs séjours le palais royal devenu trop petit et mal commode. C'est la reine Claude qui consacra cet abandon, en 1518, en permettant aux habitants d'user de sa « maison du séjour » (¹) pour les séances de justice. Ensuite le sort de la salle des plaids devint aventureux. Pendant la Révolution, le bâtiment fut vendu comme bien national (2): ceci prouve bien son origine royale. Au XIXe siècle on y faisait des ventes publiques; des troupes de passage ou des amateurs locaux y donnaient des représentations théâtrales (3). Une troupe de comédiens, celle de la famille Cizos, originaire de Chartres, résidait habituellement une partie de l'hiver à Etampes en octobre 1824, pendant un de ces séjours, une fille naquit, la petite Marie Cizos, qui sous le nom de Rose Chéri devint célèbre autant pour son talent que pour sa vertu. Une plaque de rue perpétue le souvenir de la Grande-Boucherie de Philippe-Auguste et de la salle des plaids, mais seulement en rappelant leur passé dramatique. Une rue qui borde la place vide est en effet désignée sous le nom de Rue de l'Ancienne-Comédie. J'ajoute que la place actuelle représente plus que la superficie de la halle détruite. En même temps que la vieille construction royale, on démolit aussi une maison également historique qui appartenait au chapitre de la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans (4), et qui d'ailleurs était dite « de Sainte-Croix ». C'est elle qui est dé- - - - ――――――― de ceux qui avoient été nommez par la plus grande partie, de bien et deuëment gouverner, et administrer les deniers communs de la ville et après avoir ainsi pris le serment, il prononçoit un acte de la teneur duquel il paroit qu'il leur donnoit toute l'autorité qu'ils avoient » (D. B. FLEUREAU, Les Antiquitez d'Estampes, Paris 1683, p. 212). I. FLEUREAU, ouv. cité, p. 27. ― 2. Léon MARQUIS, Les Rues d'Etampes, p. 176. - Pourtant Marquis ajoute que le bátiment était la propriété de la Communauté des bouchers. En outre, il émet la supposition que la Boucherie de Philippe-Auguste aurait été démolie en 1763. Mais ceci est inexact, car le bâtiment, que nous pouvons supposer avoir été reconstruit, a continué d'être désigné « la salle d'audience ». (Voir MARQUIS, p. 404, note G). 3. Sur le plan cadastral de 1825, le bâtiment est désigné « Théâtre ». Quand il fut démoli, les troupes d'amateurs allèrent s'installer dans une maison de la route de Paris, dite Salle de la Girafe. 4. Dans cette maison, le représentant du Chapitre d'Orléans exerçait à Etampes sa justice haute, moyenne et basse sur ses justiciables d'Etampes ou des environs (FLEUREAU, ouv. cité, p. 37). |00000084| ――――― 40 signée en 1226, dans l'acte de limitation des paroisses Notre-Dame et Saint-Basile (¹). Nous avons l'acte de délibération du directoire, en date du 31 octobre 1791, ordonnant sa vente comme faisant partie de la seigneurie du Menil-Girault (2). De cet hôtel Sainte-Croix, je considère comme en ayant fait partie la maison portant nº 14, qui existe actuellement à l'angle de la rue de la Tannerie et de la Place de l'Ancienne-Comédie, sur la façade de laquelle est sculptée en pierre une croix à deux branches égales. Cette maison, qui est très ancienne, possède une cave voûtée à deux étages. Pour en revenir aux de Saint-Yon, il est évident que s'ils ne furent pas les concessionnaires de la boucherie étampoise aux XIIe et xe siècles, ils ont pu le devenir par la suite; le fait est très douteux, mais en tout cas, et c'est tout ce que nous prétendons aujourd'hui, ils ont bel et bien possédé à Etampes la grande demeure qui porte leur nom et dont l'ornementation soignée révèle le passé à travers le Moyen Age et la Renaissance. Je crois donc intéressant d'ajouter quelques mots de plus et sur eux et sur leur logis. Comme on le conçoit tout de suite, cette vieille famille de barons tirait son nom du fief de Saint-Yon, près de Châtres, aujourd'hui Arpajon, qui est à quinze kilomètres environ d'Etampes ou de Corbeil. ――――――― D'après l'abbé Lebeuf (3), le plus ancien seigneur du' fief serait Hugo miles de Sancto Ionio, cité au cartulaire de Notre-Dame-desChamps. Aymon de Saint-Yon est nommé au cartulaire de Longpont dans un acte passé entre 1086 et 1135. Puis, sous Louis VI existait Païen, Paganus de Sancto Ionio, dont le vrai nom était Rogerius et qui servit de médiateur entre son prieuré de Saint-Yon et l'abbaye de Morigni. 1. FLEUREAU, ouv. cité, p. 404. Ce très intéressant acte signé par Gautier Cornu, archevêque de Sens, confirme une partie de ce que nous avons dit ci-dessus. On y trouve cette phrase: « … A domo sancla Crucis Aurelianensis quæ est juxta domum Regis… » La maison du Roi citée ici ne saurait être son habitation, son palais du séjour, qui eût été plus respectueusement désigné, mais une propriété du roi, mise en opposition avec la propriété du Chapitre d'Orléans. Il s'agit, à mon avis, de la Boucherie et de ses dépendances. Le même acte cite en même temps une propriété appartenant au Chapitre de l'église Sainte-Croix d'Etampes, qui au temps de Fleureau, était « renfermée dans le corps de la boucherie » (p. 405). Tout auprès (juxta) se trouvait également la propriété, le domus de l'abbaye de Saint-Denis, mais nous ne savons pas où exactement. Enfin l'auberge du Coq-en-pâte ne doit pas avoir changé de place depuis longtemps. 2. Archives départementales. En partie publié par L. MARQUIS, ouv. citė, p. 403. L'hôtel est estimé à 120 liv. de revenu et à 2113 liv. de capital. 3. Hist. de la ville et du diocèse de Paris, t. IV, p. 94, 163 et 164. - |00000085| - 41 A partir de 1133, une série de transactions interviennent entre eux et plusieurs autres contractants : 1° le roi de France; 2º les religieux de Saint-Martin des Champs, alors détenteurs du prieuré de Montmartre; 3° les religieuses qui succédèrent à ceux-ci dans le même lieu passé au titre d'abbaye. C'est dans ces derniers actes que les de Saint-Yon se révèlent les Grands-bouchers de Paris, car il s'agissait pour eux d'acquérir de vieux bâtiments mitoyens pour donner de l'extension aux étaux du Châtelet. En 1153, Philippe de Saint-Yon vendit aux religieuses de Montmartre tout ce qu'il avait de terres ou autres héritages à Torfou (¹), en même temps qu'il remettait au roi le fief qu'il possédait en ce lieu (2). Les Saint-Yon acquirent peu à peu une grande puissance à laquelle leur richesse ne fut sans doute pas étrangère. A la fin du XIIIe siècle, une de leurs filles, Agnès, épousa Robert II de Courtenay, Sr de Tanlay, de Ravières et de Saint-Winemer, qui était issu du roi Louis VI; de même, une arrière-petite-fille de ce couple, Jeanne de Tanlay, dame de Poissy épousa Jean de Chamigny, Sr de SaintYon (3). Les Saint-Yon se sentaient puissants et avaient de gros intérêts à défendre; aussi n'est-il pas surprenant qu'ils aient joué parfois un rôle politique. Au commencement du xve siècle, pendant les guerres des Armagnacs et des Bourguignons, ils se mirent à la tête des bouchers ou Ecorcheurs, du parti du Duc de Bourgogne contre le Duc d'Orléans et les Armagnacs, et furent un grave sujet de troubles. Les revers de la lutte leur firent perdre momentanément leurs privilèges. Néanmoins, au cours du siècle, Garnier de Saint-Yon fut échevin de Paris et garde de la Bibliothèque du Louvre (4). Enfin ils furent pendant plusieurs siècles si étroitement mêlés aux grands événements de la vie parisienne que les documents les concernant sont innombrables aux Archives nationales. La Communauté perdit 1. Cant. de la Ferté-Alais, arrt d'Etampes. 2. J'emprunte ces renseignements qui me paraissent très vraisemblables au P. DU BREUL, ouv. citè, p. 784 et suiv. Au sujet de Torfou et du roi de France, voir L.-Eug. LEFEVRE, Etampes et ses Monuments au X11° siècle, p. 55, 76 et 85. 3. Le P. ANSELME, Hist. de la Maison royale de France, p. 445-446. - 4. La guerre des Armagnacs eut une vive répercussion à Etampes, en 1411, sans que d'ailleurs le nom de Saint-Yon soit en vue dans les récits, du moins à ma connaissance. La ville se rendit sans lutte aux alliés Bourguignons et Parisiens; mais le château-fort résista pendant quelques jours, et en somme, le pillage ne put être complètement évité. |00000086| - 42 son droit de juridiction en 1673, mais elle ne fut complètement et définitivement abolie qu'à l'époque de la Révolution. Jusqu'à présent, le souvenir des Saint-Yon ne s'est perpétué à Etampes que par leur hôtel. Le mystère le plus singulier plane sur leur arrivée et leur établissement dans la ville. Cependant un renseignement encore inédit que j'ai eu la chance de trouver (¹), va mettre les chercheurs de bonne volonté sur une nouvelle piste. Tout d'abord, les Saint-Yon apparaissent dans les environs d'Etampes. Ils furent propriétaires à Torfou. En 1261, on cite Jehanne, dame de Saint-Yon et de Méréville (2); en 1293, Isabelle de Saint-Yon vend à Hugues de Bouville tous les droits qu'elle possède sur la seigneurie de Milly (3). Enfin il semble que la famille ait commencé à quitter son ancienne seigneurie patrimoniale de SaintYon, sous Charles VII, quand apparaît un certain de Behene (4). Enfin, voici le fait important: nous savons par un arrêt du Parlement de Paris, en date du 6 octobre 1629, que Denis de Saint Yon était alors lieutenant du bailliage d'Etampes, et que Hierosme de Saint-Yon avait, plus ou moins longtemps avant la même date, occupé le poste de maître des eaux et forêts du bailliage (5). Le chroniqueur étampois Pierre Plisson, qui a établi une liste des lieutenants généraux et particuliers (6) avant le xvIIIe siècle, ne cite aucun 1. Je dois cette chance aux fiches bibliographiques de M. Paul Pinson, dont la publication est en cours (Voir Arrêts). 2. MAX. LEGRAND, ouv. cité, p. 181. Voir aussi Rec. de Gaignières, B. N., Est., P 11ª, fo 127. 3. Renseignement communiqué par M. PAUL PINSON. 4. LEBEUF, ouv. citė, p. 164. 5. Nous n'avons pas pu jusqu'à présent voir cet acte ou sa copie, car il y a de nombreuses lacunes dans les collections publiques, et M. Pinson lui-même n'a trouvé que le titre de l'arrêt. Il s'ensuit que nous iguorons si Denis de Saint-Yon fut lieutenant-général ou lieutenant particulier. En outre, nous avons retrouvé des lettres patentes du 18 décembre 1630, dans lesquelles Hiérosme de Saint-Yon est qualifié lieutenant des eaux et forêts (Arch. nat., ZIR 567, fº 318). Il avait donc alors monté en grade. Il était peut-être le fils d'Antoine de Saint-Yon qui fut lieutenant-général des eaux et forêts au commencement du xvir siècle (Arrêts de la Cour du 6 juillet 1601, du 15 mars 1603, du 17 mars 1604). Il faut probablement identifier Anthoine avec le Sr de Sainctyon qui, en 1610, conseiller du roi, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, publia un important ouvrage : Les édicts et ordonnances des roys, coustumes des provinces, réglemens, arrests, etc… des eaux et forests, Paris. Nous avons trouvé dans cet ouvrage les trois derniers titres cités ci-dessus ; il contient en outre des renseignements précis sur les règlements et coutumes d'Etampes, concernant les eaux et forêts, sur la nomination des maîtres et des sergents dangereux, etc. Un maitre Claude de Sainctyon fut procureur du roi en la Chambre du Trésor, en 1549 (Arch. nat., Z¹▲ 527, arrêt du 24 Novembre). 6. L. MARQUIS, les Rues. - - |00000087| Pl. I. Grand-Hotel-Saint-Yon et dépendances. Façade du côté de la rivière |00000088| 13 . |00000089| - - 43 - Saint-Yon; son énumération est d'ailleurs visiblement incomplète à l'époque en question, et cette lacune explique en partie comment les historiens suivants sont restés ignorants du fait (¹). Jusqu'à présent, nous ne possédons aucun document prouvant que l'hôtel qui porte leur nom fut construit ou restauré par des Saint-Yon. Et même l'écusson gravé dans le marbre, qui veut attester au moins la propriété, est moderne. Du moins, on savait formellement par les titres qui sont encore en la possession du propriétaire actuel de l'Hôtel St-Yon (2), quelle fut jadis l'importance de cette demeure, aujourd'hui divisée entre quatre propriétaires. Elle comprenait les maisons portant les numéros 15, 17, 19, et tout ou partie de la maison portant le numéro 13. Les aliénations successives ont commencé après 1607 pour être complètes en 1820. L'hôtel proprement dit est passé successivement entre les mains de Jacques Alleaume fils de Ferry Alleaume), puis de Hémard de Danjouan qui le légua à son fils l'abbé Pierre (1675). En 1764, Robert Darblay, mégissier, en prend possession. En 1665, les Chartreux d'Orléans perçoivent une rente sur la location. L'immeuble n° 19 a désormais perdu son ancien caractère; on vient de lui enlever son dernier signe distinctif, une grande porte charretière à arc plein cintre. Là devaient avoir été reléguées les écuries et les remises (3). L'immeuble n° 13 comprend au moins une tourelle d'escalier et une partie du bâtiment sur la rivière qui appartenaient jadis au n° 15, le Petit-Hôtel-Saint-Yon dont nous avons parlé au début (4). Le corps en façade sur la rue en a peut-être été détaché également. Ainsi au xvie siècle, et très probablement depuis fort longtemps, les bâtiments de la propriété alors détenue par les de Saint-Yon au bord de la rivière canalisée et presque sans discontinuité, s'étendaient sur une longueur de 60 mètres environ. “ 1. PLISSON cite comme lieutenants généraux Claude Cassegrain en 1568 et Jacques Petau en 1626. Puis comme lieutenants particuliers: Pierre Le Maire en 1553 et Nicolas Cousté en 1634. 2. M. Auguste Dujoncquoy, adjoint au maire d'Etampes. 3. Un mémoire faisant partie des titres de propriété signale que la ruelle bordant le jardin et dite du Pont-Doré », portait autrefois le nom de « Ruelle au Comte », parce qu'elle aboutissait à la rue du même nom. L'acte de 1226 mentionne un « vicus Comitis » qui doit sans doute se trouver en ces parages. 4. D'après le plan cadastral, le nº 15 fait hache sortante sur le n° 13; et le n° 13 entre de même dans la maison voisine, nº 11. |00000090| — 44 - Quant à l'hôtel actuel (n° 17, en A sur le plan) c'est une grande construction qui tourne autour d'une cour. Il a deux étages surmontés de toits très en pente qui font de vastes combles avec charpentes en châtaignier et lucarnes très ornées du côté de la rue. Il est probable que l'hôtel a été bâti en deux fois (¹), mais peutêtre avec un court intervalle entre les deux constructions. Peut-être encore, à cette occasion, a-t-on démoli entièrement les édifices antérieurs, ou s'est-on contenté de les rajeunir. Le corps de bâtiment le plus ancien me paraît être celui qui touche au nº 19. Les meneaux de ses fenêtres ont été enlevés par un marchand de laines au milieu du siècle dernier. Depuis, une restauration opérée en 1873 par M. Dujoncquoy, a remis les choses à peu près en état. L'autre corps de bâtiment, mitoyen avec le n° 15, est peut-être une annexe très ancienne, mais, en tout cas, il a une décoration très caractérisée de la fin du xve siècle ou du commencement du xvie. Il s'étend en travers, d'un côté s'avançant vers la rue, de l'autre enjambant la rivière. L'aile nord-ouest possède une ornementation particulièrement soignée, parce qu'elle était du côté de la rue. Son grand pignon, qui donne sur la cour, a son rampant garni de crochets ayant toute l'exubérance de leur époque (Pl. II). Il est gardé à droite et à gauche par deux chiens héraldiques. Celui de gauche est ancien (2); l'autre ne l'est pas. Les sculptures bien conservées qui ornent les montants et l'archivolte de la lucarne de la façade (Pl. III) sont remarquables par leur style; elles représentent des feuillages qui s'échappent d'un vase et grimpent enchevêtrés à des amours. La lucarne rectangulaire est coupée par une croisée, c'est-à-dire par un meneau et une traverse horizontale. Elle est surmontée d'un fronton triangulaire refait et plus ou moins inventé par l'architecte restaurateur (3), ainsi que les deux clochetons qui l'accostent. Il y a sur la cour deux autres lucarnes semblables et restaurées dans les mêmes proportions, mais dont les montants et l'archivolte sont simplement moulurés. L'hôtel est flanqué de deux tourelles d'escalier, dont une possède quatre étages, le dernier étant occupé par une pièce qui accapare. toute la cage au-dessus de l'escalier (4). 1. A l'intérieur, on trouve deux grands murs accouplés.. 2. Il fut retrouvé intact dans un grenier. 3. M. Roguet, en 1873. 4. Les tourelles d'escalier datant du Moyen Age sont extrêmement communes à Etampes. Le palais royal en possédait une très élevée dont la partie supérieure devait être |00000091| de T 16 # 1 Pl. II. Grand-Hôtel-Saint-Yon. Pignon sur la cour |00000092| |00000093| Pl. III. Grand-Hotel-Saint-Yon. Lucarne sur la façade principale (restaurée) - |00000094| |00000095| Pl. IV. Grand-Hotel-Saint-Yon. Tourelle d'escalier |00000096| |00000097| – - 45 Chaque tourelle avait sa porte d'entrée ouverte sur la cour. La plus richement sculptée de ces portes donnait accès dans la tourelle sud elle a été malheureusement mutilée; sa structure est changée, et même elle est engagée dans de nouvelles constructions qui n'en laissent plus voir qu'un fragment. La porte de la seconde tourelle est parfaitement conservée, et c'est un bon exemple parmi les plus simples des portes ornées qui furent érigées à Etampes à la fin de la période gothique (¹). Les fenêtres de la même tourelle ont aussi un joli caractère dans leur simplicité (Pl. IV). Du côté de la rue seulement, toutes les ouvertures de fenêtres des appartements sont quadrangulaires; toutes sont divisées en quatre compartiments par une croisée (2). Les bases des montants et des meneaux sont moulurées de la même façon que la porte de la tourelle. Sur la façade du jardin, les fenêtres sont banales à l'exception d'une très bien conservée, mais qui, étant plus étroite, ne possède pas de croisée. J'ajoute que les faîtières et les girouettes sont modernes. A l'intérieur, les chambres sont très vastes, mais sans ornementation aucune, à l'exception d'une pièce du premier étage, dans le pavillon sur la rue. Celle-ci possède un plafond à poutrelles avec de nombreuses incrustations. Cette jolie décoration a malheureusement subi dernièrement un désastre : un commencement d'incendie a chauffé à l'excès la matière sans doute résineuse qui bouchait les trous d'incrustation, et ceux-ci se sont presque tous vidés. Les quatre plus grandes chambres du bâtiment principal, superposées deux à deux, possèdent une garde-robe ménagée dans l'épaisseur du mur du côté de la rivière, mais non pas, comme on pourrait le croire, avec une bretèche ouverte au-dessus de l'eau. disposée de la même façon que celle de Saint-Yon (Voir notre étude, Le Palais royal d'Etampes et sa peinture historique, extrait du Bulletin de la Commission départementale des Antiquités de Seine-et-Oise, 1909). 1. Voici les portes étampoises du même style: dans l'église Notre-Dame, les deux portes de la Sacristie (1514); église Saint-Basile, deux portes au Sud et une au Nord, plus une quatrième, à l'intérieur; église Saint-Gilles, portes nord et sud; porte d'une petite construction sur la Promenade du Port; porte dernièrement déplacée, d'un ancien petit manoir, rue Saint-Mars. Quelques-unes de ces portes ont une ornementation beaucoup plus riche, plus complète, étant abritées sous des larmiers en accolades avec des crochets ou des figurines animales et un fleuron. 2. Toutes ces croisées sont l'oeuvre de la restauration. |00000098| - 46 Ces cabinets font pourtant sur la façade deux parties saillantes que l'on prendrait volontiers pour des contreforts, malgré les étroites ouvertures dont elles sont percées. Enfin je puis signaler encore l'existence d'une cave avec voûte en berceau légèrement brisé. En résumé, l'hôtel Saint-Yon est une grande maison où les ornements assez nombreux ont tous été exécutés avec beaucoup de soin. A défaut d'une plus grande originalité, et en raison du souvenir de la haute famille qui s'y rattache, cela suffit amplement pour qu'il retienne notre attention. Louis-Eugène LEFÈVRE. |00000099| LA PAROISSE DE SAINT PIERRE D'ÉTAMPES Suite et fin (1). LES HAMEAUX BOIS-GALLON Ce lieu n'est plus rappelé aujourd'hui que par le champtier portant son nom, qui, en partie boisé, occupe, d'après le cadastre, la vallée qui sépare La Montagne et Guignonville de La Forêt St Croix; la route de Malesherbes le coupe en deux fractions; l'une, à gauche, en avant de La Montagne, est de la commune de Morigny; l'autre, à droite, en avant de Guignonville, est de celle d'Etampes, dont le territoire, très étendu de ce côté, prend fin à plus de 6 kilomètres de la Ville, à un chemin de traverse à l'angle duquel se voit une grosse borne ancienne où est gravée la lettre E, signifiant la limite d'Etampes. Jadis toute cette contrée était couverte d'arbres, ce que prouvent les noms des localités voisines: Bois-Herpin, Bois-Mercier, Boischambault, La Forêt, etc. Y eut-il des habitants à Bois-Gallon aux temps lointains? On pourrait le croire par un document conservé aux Archives du Loiret, daté de Juillet 1308, d'après lequel Thomas de Boissy, chevalier, 1. Pour le commencement, voir Bulletin de 1907, pages 31 et 77 et Bulletin de 1908, page 5. |00000100| 48 - fait recette du droit de péage et des cens sur Bois-Gallon, au Chapitre de Ste Croix d'Orléans, qui vraisemblablement, a conservé ce lieu et ses dépendances dans son domaine de Mesnil-Girault avec le village voisin de La Forêt ; rien n'indiquant qu'il eût appartenu aux seigneuries de Guignonville et de La Montagne. En tous cas, il est certain qu'une Chapelle y a existé. MM. P. Quesvers et Henri Stein nous disent (¹) qu'elle était de la paroisse de La Forêt Ste Croix et qu'elle dépendait de l'abbaye du Jard. En 1760, elle tomba en ruines, elle n'avait plus alors de titulaire connu. Le 25 juin 1792, elle fut vendue comme bien national pour 380 livres. La chapelle était située au milieu du bois, dont ce qui reste, à droite, a pris le nom de Bois-Gallon. On y trouve encore des pierres, reliques de cet édifice qui n'avait probablement que peu d'importance. Elle était dédiée à Notre-Dame, le curé de S. Pierre d'Etampes en célébrait la fête, et la jeunesse d'Etampes et des environs venait y danser le jour de la Nativité de la Vierge. Cela dura jusqu'en 1793. C. Barbier nous apprend, dans son Mémoire sur la Généralité de Paris en 1700, qu'il existait là autrefois un prieuré de l'ordre de S. Augustin, dont le revenu n'était plus alors que de 30 livres par an. Or l'abbaye du Jard, de Brassac, diocèse de Sens, était de l'ordre de S. Augustin. Nous n'avons pas trouvé trace de prêtre, ni de chapelain depuis cette époque; il est présumable qu'il n'y en avait plus depuis longtemps et que le curé de S. Pierre d'Etampes, qui venait y officier, au xviie siècle, dans les rares cérémonies qui s'y faisaient, jouissait de cette prébende. Contrairement à ce que dit le pouillé du diocèse de Sens, cité plus haut, et malgré la bénédiction nuptiale donnée, le 10 juillet 1725, par le curé de La Forêt Ste Croix, à des enfants de laboureurs des environs (2), nous pensons que Bois-Gallon était bien de la paroisse de S. Pierre, ainsi que l'indique d'ailleurs sa situation topographique, et que le confirment des actes tirés de cette paroisse, notamment en 1709 et en 1711. Le 12 mai 1709, Françoise Marchand, fille d'un cultivateur de Mainvilliers, côtoyait avec une compagne et quelques personnes, un ruisseau proche Guignonville; elle y tomba accidentellement; il faut croire qu'il était assez profond, puisque malgré les efforts de ceux qui l'accompagnaient, elle s'y noya. Retiré enfin, son corps 1. Pouillé de l'ancien diocèse de Sens. 2. Registres paroissiaux du canton de Méréville, p. 97. |00000101| - 49 - fut porté à la chapelle de Bois-Gallon, en attendant son transport dans l'église de S. Pierre, où l'on fit le service avant de l'inhumer au cimetière. Pareil accident n'est pas à craindre aujourd'hui ; depuis bien longtemps, si longtemps qu'on n'en a plus le souvenir, la vallée est asséchée, cultivée; comme tant d'autres, depuis les déboisements qui ont eu lieu partout, le cours d'eau a disparu ; qui sait s'il n'était pas dû simplement aux fontes de neige de ce terrible hiver de 1709, le plus rigoureux qui se soit produit dans notre pays, suivant les anciennes chroniques. 1711.4 août, mariage entre laboureurs célébré dans la chapelle de Bois-Gallon, par le curé de S. Pierre. La ferme de Bois-Mercier, située en face du hameau de La Montagne, de l'autre côté de la route d'Etampes à Malesherbes, et à peu de distance de Guignonville, avait pour seigneur, en 1556, François Olivier, chancelier de France, et, à partir du xviie siècle jusqu'à la Révolution, au moins en partie, les possesseurs du Bourgneuf, dont elle était devenue une dépendance, comme nous l'avons vu plus précédemment. * Vers 1660, il y eut un procès au sujet d'une redevance de 20 setiers de blé et 7 setiers d'avoine, prétendue par la famille de Lisle, sur 150 arpents de terre formant la métairie de Bois-Mercier, entre les membres de cette famille, seigneurs de Marivault, Orsonvilliers, Aubourville, Montagu, La Roue, Mainville, Bois-Mercier et Valnay, d'une part, et Alexis François de Cœurs, seigneur du Bourgneuf, et André Petit, seigneur de la Montagne, d'autre part. Les registres paroissiaux donnent les noms de quelques-uns des fermiers ou receveurs : - - BOIS-MERCIER. 1714. Jean Baron, époux de Florence Hardy (¹). 1721. Noël Hautefeuille, receveur. - ― 1736-1750. François Lepère, laboureur. 1788. Le 20 mai, mariage entre François Valery Gibier, fermier de Bois-Mercier, et Anne Geneviève Resnon; la marquise de Valory et sa fille y assistent. 1. Voir les Inhumations dans l'église. 1909. - I. |00000102| - - 50 - 1790. Jean Gérard Geoffroy, avocat en Parlement, demeurant à Etampes, fondé de la procuration spéciale de François Etienne Michel de La Bigne, écuyer ordinaire et commandant le premier manège de la grande écurie du Roi, demeurant à Versailles, propriétaire de la terre de La Montagne et Guignonville, et du fief de Bois Mercier et Valnay, dont le domaine utile est tenu en roture par M. de Valory, déclare avoir reçu de Charles Jean Marie de Valory, chevalier de Saint-Louis, colonel commandant le premier régiment provincial d'état-major, la somme de 18.184 livres, dont 15.084 pour le sort principal de 20 setiers de blé froment et 10 setiers d'avoine, de la rente foncière et seigneuriale, payable annuellement sur le domaine utile dudit fief de Bois-Mercier et Valnay, dont la nu-propriété appartient au sus dit Valory, et l'usufruit à Casimir Louis de Valory et Marie Jeanne Marthe de Valory, ses frère et sœur, et 250 livres pour le rachat et extinction des droits casuels dudit domaine utile (1) ». En novembre 1792, Casimir Louis de Valory, chevalier de justice de l'ordre de Malte, et sa sœur Marie Jeanne Marthe de Valory, ex-chanoinesse du Chapitre noble de Largentière, tous deux sans domicile connu (c'est-à-dire ayant émigré), avaient, par moitié, (comme il vient d'être dit), la jouissance viagère de la ferme de Bois-Mercier, d'après la déclaration faite devant la municipalité d'Etampes, conformément à la loi du 23 août 1792, par leur chargé d'affaires, Etienne Simonneau, ancien lieutenant particulier au bailliage, frère du Maire assassiné au mois de mars de cette même année. La ferme qui se composait, outre les bâtiments, de 192 arpents de terres labourables, de 2 arpents et un quartier de pré, de 4 arpents de terres en friche et de 2 arpents de bois taillis, était alors louée à Gibier (2) pour 2.500 livres et affermée, pour la louée des guérets de Pâques 1793, à Simon Gillotin fils, laboureur à Guinette, moyennant 3.100 livres et 12 poulets. Dans la même déclaration, il est dit, de plus, que Mlle de Valory, l'ex-chanoinesse, demeurait à Paris, qu'on ignorait si elle était ou non en Normandie, comme elle était en usage d'y aller auprès de 1. Arch. de S.-et-O., E 3940. 2. Le 13 floréal an II, Gillotin acheta la ferme avec 129 arpents de terre, moyennant 90.000 fr. (Arch. départementales). L. MARQUIS. |00000103| 51 ― sa belle-sœur, Mlle de Valory, pour lui porter les soins que réclamait son malheureux état (?). Elle possédait personnellement à Abbéville « une maison couverte de chaume, jardin, ouche devant, le tout contenant en fonds de terre 3 quartiers ou environ et 8 arpents 89 perches de terres labourables, loués à Pierre Hutteau pour 9 ans, moyennant 100 livres par an. BRETAGNE. GÉROFOSSE. MONTAUCHAU. Les registres paroissiaux, qui en parlent fort peu, ne nous donnent rien d'intéressant sur ces trois localités. Les deux premières ne sont à proprement parler que les prolongements du faubourg St Pierre, et leur histoire se confond avec la sienne. Le hameau de Bretagne rappelle un souvenir historique, c'est là que le 29 juillet 1465 vint camper l'armée des ducs de Berry et de Bretagne, après la bataille de Montlhéry, avec des malades en grand nombre, dont une partie succombèrent et furent enterrés en ce lieu qui en a retenu le nom de cimetière des Bretons (¹). Gérofosse se compose aujourd'hui du moulin de ce nom, l'ancien moulin Foulleret, appartenant aux Barnabites, et d'une maison de retraite pour les vieillards (2). Nous lisons qu'en 1671 « Basile Moulin, vigneron, demeurait à Giraufosse ». LES GRANGES-SAINT-PÈRE. La ferme des Granges-St Père, ou St Pierre, anciennement des Granges-Notre-Dame, que la bande d'Orgères a rendue si tristement célèbre à la fin du xvi siècle, était en plaine sur le chemin rural qui, de la route de Pithiviers à Etampes, va à Guignonville. Il n'en reste que les ruines des deux piliers de la grande porte, seuls témoins de son antiquité et de sa sinistre destinée. Certains ont confondu les Granges St Père avec la Grange aux Nonains. Dom Basile Fleureau, dans son « Histoire de l'Abbaye royale de Villiers » (3) se charge de rétablir la vérité : 1. D. B. FLEUREAU, M. LEGRAND, Etampes pittoresque. 2. L. MARQUIS, Les rues d'Etampes. 3. Editée par M. Paul PINSON, Annales du Gâtinais, XI, p. 14. |00000104| 52 « Grange des Nonains. On ne trouve pas tous les titres de la Grange aux Nonains, assise au terroir de La Montagne et de MesnilGirault, proche la métairie qui fut à Montrieu de Dreux, dite aujourd'hui les Granges de Notre-Dame, à cause qu'elle appartient à Messieurs de Notre-Dame du chapitre d'Etampes ». Quelques actes donnent des noms de tenanciers de cette ferme depuis le xvIIe siècle : Le 20 septembre 1660, est baptisé le fils de Claude Poiget, « laboureur, demeurant aux Granges Notre-Dame, en ma paroisse », dont le parrain est Martial Roger, chanoine. Le vendredi 28 avril 1662, est inhumé un pauvre âgé, du Gâtinais, mort aux Granges. Le 20 juin 1663, est célébré à St-Pierre le mariage d'Eloi Guittard et de Marie Coutault, tous deux servant aux Granges Notre-Dame depuis plusieurs années. On voit le nom de Claude Poiget, père et fils, jusqu'en 1704. Ils sont dits: en 1675 « laboureur demeurant aux Granges St-Père»; en 1679, « fermier de la Grange Notre-Dame »; en 1704, « fermier de messieurs de Notre-Dame aux Granges ». 1715. 27 octobre, citation de Jean Collet, époux de Jacqueline Flagis, laboureur aux Granges Saint-Pair. - - - 1721. Jacques Grugeon, receveur des Granges, époux d'Anne Rabourdin; en 1722, fermier des Granges. 1787.14 septembre, inhumation de Jean Lemaire, laboureur aux Granges S'-Père, époux en secondes noces de Marie Madeleine Bellier, déjà veuf de Jeanne Chauvet. 1788. 14 janvier, mariage célébré (à St-Pierre) par Jean Jacques Fromentin, prêtre, chanoine de Ste-Croix, entre Jean Louis Rousseau, md mégissier, et Marie Jeanne Lemaire, fille de feu Jean et de Jeanne Chauvet des Granges St-Père, en présence de Jean Lemaire, père de la mariée. Marie Madeleine Bellier, veuve de Jean Lemaire (1), mort en 1787, était encore dans sa ferme en 1797. Le 4 avril de cette année, sa mère Marie Hutteau, veuve de Nicolas Bellier, y mourut à l'âge de 73 ans. Le lendemain soir, 16 germinal an V, Claude et Etienne Bellier, ses deux fils, appelés par leur sœur, veillaient tour à tour le corps de leur mère, lorsque tout à coup des brigands de la bande ― 1. Au moment de la Révolution, elle était locataire de 58 arpents de terre appartenant à l'abbaye de Villiers, qu'elle louait 1796 livres. |00000105| 53 - d'Orgères () « enfoncent la porte de la cour, dans laquelle ils se précipitent armés, les uns de sabres, les autres de pistolets. En entendant les aboiements de ses chiens, la V. Lemaire veut sortir avec son frère Claude, laboureur à Fenneville, Cue de Brouy. Les bandits se jettent sur eux; Bellier veut résister, le Rouge d'Auneau lui donne dans le dos un coup de sabre dont il mourut quelque temps après. D'autres, pendant ce temps, se saisissent de la fermière, de ses deux fils, de ses deux filles et de deux serviteurs de la ferme, les attachent et leur bandent la vue. Etienne Bellier (2), réveillé par le bruit, sort de sa chambre, les brigands le saisissent, il veut résister, Charles de Paris le tue d'un coup de pistolet. La dame Bellier mère, morte depuis la veille, n'est pas même à l'abri des fureurs de ces scélérats, car Charles de Paris enfonce son sabre dans le cadavre et l'en frappe de plusieurs coups; elle fut assassinée après sa mort! « Et tandis que les uns se livrent au pillage, les autres allument un feu de paille pour brûler les pieds de la fermière… Cela dura trois heures entières, puis ils partirent emmenant les chevaux de la ferme chargés d'effets de toute espèce ». Les principaux de ces brigands échappèrent encore cette fois à la justice; quelques-uns cependant expièrent leur crime. Nous lisons dans le registre spécial aux arrestations, jugements, etc., de cette époque, ce qui suit : « Du 4 Fructidor an V. Ordonnance de prise de corps contre Jean-Baptiste Blétry, prévenu d'assassinats, vols et viol commis dans la ferme de la Grange St Père, en cette commune d'Etampes, dans la nuit du 16 au 17 germinal dernier. « Du 25 Vendémiaire an V. - Les citoyens Jean-Baptiste Blétry, âgé de 22 ans, natif de Paris; François Rucelin, âgé de 32 ans, ouvrier serrurier, natif de Laons et Charles André Olivier, âgé de 48 ans, natif de Paris, marchand de mouchoirs, sont condamnés à la peine de mort ». Ils furent exécutés à Versailles le 27 pluviôse an VI. Quelque temps après, les bâtiments où s'était passé ce terrible - 1. Ce qui suit est extrait du livre de M. COUDRAY-MANNIER, Histoire de la Bande d'Orgères. 2. Il n'était âgé que de 40 ans et était natif d'Audeville; il avait épousé Marie-Louise Landry. La déclaration de décès fut faite le lendemain à la mairie d'Etampes, par le citoyen Savinien Chambon d'Orveau, beau-frère du défunt. |00000106| 54 ―― drame, furent démolis. Les pierres qui provenaient de la démolition servirent, en 1863, à la construction de l'Abattoir, nous dit M. Marquis. GUIGNONVILLE. Suivant un inventaire dressé vers le milieu du xviie siècle, le plus ancien titre concernant la terre de Guignonville remonte au 9 mars 1470. Nous avons mentionné déjà les anciens seigneurs de Guignonville, qui étaient ceux du Bourgneuf. Il existait encore dans ce hameau un fief important appelé le « Grand Hôtel de Guignonville» ou le « fief des Canivets » relevant de la Grosse Tour de Guillerval et en arrière-fief de l'abbaye de St-Denis. Un aveu du 31 mars 1540, nous apprend en quoi il consistait (1): «Je, Cancian Canyvet, drappier, demeurant à Etampes, tant pour moy que pour mes consorts, héritiers de deffunt Jehan Canyvet et Jehanne Boisseau, sa femme, mon ayeul et ayeulle, confesse tenir et avoir fait et porté les foy et hommage à nobles hommes Michel et Richard de Villezan, escuyers, sieurs de Guillerval en partie, à cause de la grosse Tour de Guillerval. « Ung manoir (2) et 28 arpents de terre labourable assis au village et terrouër de Guygnonville, paroisse de St-Pierre d'Estampes, qui vallent 2 muis de bled froment chacun an, mesure d'Estampes. « Item, dudit lieu dépendent trois vassaux, c'est assavoir les Célestins de Marcoussis, lesquels tiennent en fief de moy et de mes dits consorts, une maison, cour, jardin avec 16 arpents de terre labourable et 8 sols parisis de menus cens mal venans, portant lods, ventes, saisines, deffaults et amendes, quand le cas y eschet. «< François Jamet l'esné, tient en fief de moy et de mes dits consors, 9 arpens de terre labourable ou environ, situés et assis audit Guignonville ». Les fonds du Loiret et de Seine-et-Oise contiennent d'autres documents se rapportant à ce domaine. Bien qu'un peu longue, l'énumération (que nous avons rapportée ailleurs), mérite d'être copiée ici en raison des renseignements qu'elle fournit : 1. Archives du Loiret, et Registres paroissiaux de Méréville, p. 184 et suiv, 2. D'après M. L, MARQUIS, on y voyait autrefois un ancien château. |00000107| 55 - - Remarquons que certains des possesseurs du fief se donnent le titre de « seigneur de Guignonville ». « Aveus rendus à Philbert de Villezan par la dame Ve Lamy et consorts à cause du fief des Canivets, situé à Guignonville, mouvant de celui de la Tour de Guillerval, devant Jutet, notaire à Etampes (4 juillet 1614), par Nicolas Lamy, devant Hémery, notaire à Guillerval (9 juillet 1625); par le Sr Le Nain, devant Dupré, notaire à Etampes (16 mai 1661) - commission pour faire saisir féodalement le fief des Canivets, du 23 octobre 1706, et saisi à la requête du Sr de Villezan du 4 janvier 1707. Foy et hommage portés au sieur de Villezan par les demoiselles Lamy à cause d'une masure et jardin faisant partie du fief des Canivets, devant Mautains, notaire à Etampes (28 juin 1707). 5 janvier 1708, contrat de vente, faite par demoiselle Lamy à M. Le Nain, de cens, domaine et droit au fief des Canivets, devant le même notaire. wd.com Aveu et dénombrement par Jeanne Le Sage, veuve de Jean Baptiste Lamy, huissier à la connétablie à Etampes, à cause de 6 quartiers de terre (24 août 1723), restés sans doute en dehors de la vente à M. Le Nain, dont le père, cité en 1661, possédait déjà quelque bien à Guignonville. Foy et hommage contenant aveu par messire François Bonaventure de Tilly, marquis de Blaru, comme ayant épousé Marie Anne Le Nain, devant Jourdain, notaire à Paris, le 1er septembre 1726. Les dames de St-Louis de St-Cyr près Versailles, substituées à l'abbaye de S'-Denis, avaient acquis des Villezan le fief de la Tour de Guillerval et ses dépendances, suivant acte de mtre Jourdain, le 26 janvier 1719. Foy et hommage rendus pour cause d'héritages tenus à Guignonville, par Marie Anne Le Nain, femme de M. de Tilly, dame de Guignonville, légataire universelle, en partie, de feu Jean Le Nain, son ayeul, chevalier, seigneur de Guignonville, à Marie Marguerite Petit, dame de la Montagne, femme de Pierre Laumosnier. conseiller du Roi, élu en l'élection d'Etampes. En 1760 (30 septembre) l'aveu est rendu aux dames de St-Cyr par messire François Pépin, chevalier, seigneur de la Montagne, « pour raison du fief du Grand Hôtel, autrement dit des Canivets, et, en 1769 (11 octobre), par dame Anne Angélique Puzos, sa veuve. Enfin, le 23 février 1789, «foi et hommage devant Babault, notaire |00000108| 56 —- à Saclas, par le fondé de pouvoirs de messire François Etienne Michel de la Bigne », pour raison de partie du fief des Canivets. Dans ces déclarations, on trouve des noms de censitaires de familles encore connues à Etampes : Antoine Perthuis (1625); Lambert de Vaugrigneuse (1649); Etienne Barré (1677); le sieur Baron (1705); Nicolas Dupré (1707); le sieur Duverger, maître de poste (1720); Julien Guyot de la Barre, président du grenier à sel; Ch. Fois Botteau (1750); Jean Baron (1753); François Heurtault (1771); Martin Gabriel Gallier (1780); Théodore Alexis Charpentier (1782), etc. Pour terminer, citons quelques actes qui rappellent les noms d'anciens habitants de Guignonville. 1656. 28 octobre, baptême de Françoise, fille de Nicolas Dramard, laboureur, demeurant à Guinonville et de Françoise Lesage; parrain, François Richard, cocher de M. Le Ragois, S' de Guinonville; marraine, Françoise Dausse, femme de Philippe Lesage. Françoise Dramard épousa, le mercredi 14 juillet 1676, Jehan Herblot, laboureur, demeurant à Champmotteux. Nicolas Dramard eut un fils, prénommé Antoine, le 25 novembre 1677. 1669. - Lundi 28 janvier est trépassé Pierre Herbleau (ou Herblot), âgé de 17 ans, dans la maison de son père Jehan Herbleau, laboureur à Guignonville; ayant été apporté en notre église, l'office a été fait corpore presente, puis M. Pierre Colleau, mon vicaire, a conduit le corps jusqu'à Champmotteux, où lui et ses parents avaient demandé qu'il fut enterré Tanquam in sepulchro paterno. Il en est de même pour Anne Herblot, sœur de Pierre, le 4 septembre 1669 et pour Jean Herblot père, décédé à l'âge de 80 ans, le 15 octobre 1689. - 1697. Citation de Jean Richer, laboureur à Guignonville. 1716.22 août, baptême de Louis, fils de François Petit de la Montagne et de Jeanne Pelletier, demeurant à Guignonville (enfant naturel). 1782. 1787. 1733. Pierre Robert, laboureur. 1740. - - - M. Vassert, receveur, fermier de Guignonville. Mathurin Robert. Cantien Imbault. |00000109| -57- – LES ROCHES. Les Roches, qu'il ne faut pas confondre avec les Roches-Blaveau, autre lieu autrefois habité de la paroisse St Martin, les Roches étaient situées sur les hauteurs, aujourd'hui boisées, que l'on voit à peu de distance de la ville, à droite de la route de la Ferté-Alais et que longe, à leur base, du côté d'Etampes, le chemin rural allant à La Montagne. Non seulement cet écart était habité, mais il devait s'y trouver une demeure de quelque importance, si l'on en juge par cet acte de sépulture : « Le 12 septembre 1662, inhumation dans l'église de S. Pierre, du corps de Pierre Lamy, bourgeois d'Etampes, mort aux Roches, sa maison, lieu de ma paroisse ». Et par la citation, en 1682, du Sr Claude Renard, époux de Charlotte Collet, concierge des Roches, ferme de ma paroisse. Des laboureurs y sont aussi mentionnés : Jean Thiboust en 1665; Nicolas Jousse en 1705. Depuis les registres paroissiaux n'en parlent plus, croyons-nous. Le 1er mars 1791, le Conseil municipal d'Etampes, composé alors de MM. l'abbé Boullenier, Meunier, Pineau, Lavallery, Simonneau, Peschard, Banouart-Pinot, Périer et Sergent, après lecture de nouveaux articles additionnels à la loi du 24 novembre 1790, sur la constitution civile du clergé, formula la proposition de réduire à deux les cinq paroisses de la Ville : 1º la paroisse de Notre-Dame comprenant S. Pierre, S. Bazile et S. Gilles, jusqu'à la rue de l'Etape au Vin; plus Morigny, Brières-les-Scellés, Chandoux, le Chesnay, les Poélées, Malassis, Notre-Dame du Pré, La Grange des Noyers, Tire penne, Beauvais, Bonvilliers, la Montagne, Guignonville, et aussi le hameau de Dhuilet composé d'une ferme et de huit maisons, faisant partie de la paroisse d'Ormoy. 2º La paroisse St Martin formée du reste de celle de S. Gilles, d'Ormoy la Rivière, le Four Blanc, Valnay, Pierrefitte en totalité, Landreville, la Malmaison, Villesauvage et Lhumery. |00000110| - 58 - A la fin de la délibération, le Conseil municipal a soin de faire connaître à ses concitoyens que le but qu'il s'est proposé en donnant son avis sur ces suppressions de paroisses et la circonscription des nouvelles « est uniquement de concourir à diminuer les frais du culte et non d'éloigner les fidèles de leurs pasteurs ». Ce projet n'aboutit pas, mais la paroisse de St Pierre, malgré les supplications de ses habitants, fut sacrifiée, réunie à celle de NotreDame, comme on le sait, et démolie en 1805. Notre tâche, quelque incomplète qu'elle soit, se termine ici; la suite a été traitée mieux que nous ne pourrions le faire, par notre confrère, M. Léon Marquis, dans les « Rues d'Etampes »; on y lira, avec des détails intéressants sur l'ancienne église St Pierre, l'inventaire des objets mobiliers qui en garnissaient l'intérieur, les dates et les prix d'adjudications, etc. Parmi ces objets, vénérables reliques du passé, quelques-uns sont conservés au Musée d'Etampes; on y voit entre autres, un ancien Christ en bois peint de 0.32 de hauteur; un bas-relief en noyer, du XVIe siècle, représentant S. Pierre ; deux anges et un reliquaire en bois doré; deux pleureuses en pierre d'un beau travail, etc. Ch. FORTEAU. |00000111| LES SŒURS AUGUSTINES A CORBEIL (1643-1792). Notre regretté collègue, M. l'abbé Colas, curé de Soisy-sousEtiolles, a publié en 1890, dans les Annales du Gâtinais, une notice intéressante sur la Congrégation de Notre-Dame de l'ordre de Saint Augustin, établie à Corbeil en 1643 et 1644. Installées provisoirement en 1643 dans une maison particulière, les Augustines prirent possession, l'année suivante, de l'ancien Prieuré du Petit Saint-Jean de l'Hermitage ('), avec l'appui et l'autorisation des autorités de Corbeil et des habitants. Un acte de vente, dont on verra le texte plus loin, intervint en leur faveur, moyennant des charges et conditions indiquées au dit acte, notamment celle d'instruire les jeunes filles de la ville et faubourgs gratuitement et aux conditions y portées. Pendant près d'un siècle et demi, ces Religieuses, entourées de 1. Le Prieuré de St-Jean de l'Hermitage, communément appelé le Petit St-Jean, pour le distinguer de St-Jean en l'isle, situé non loin de là, mais en dehors des murs de la ville, était très ancien et relevait de St-Maur des Fossés. L'Eglise, d'après l'abbé Lebeuf, remontait au xr° siècle. Elle fut desservie par un Prieur jusque vers le milieu du xvr siècle; à cette époque le Prieuré et son église étant sans usage, on obtint de l'Evêque de Paris u'il servit å loger les Prêtres de l'église Notre-Dame et les Prédicateurs, comme aussi à tenir les Ecoles. Quand les sœurs Augustines furent investies de ce Prieuré, un article de l'acte de vente es obligea à indemniser la fabrique de Notre-Dame qui y avait fait divers travaux, et cette indemnité fut fixée à 2500 livres, somme versée par elles. Peu de temps après le départ des sœurs Augustines, l'administration de l'Hôtel-Dieu, dont les bâtiments tombaient en ruines, demanda à prendre possession de l'ancien Prieuré et à y installer ses services, ce qui lui fut accordé. L'Hôtel-Dieu resta dans ces bâtiments de l'ancien Prieuré jusqu'à la construction du nouvel hopital fondé par les frères Galignani en 1866. L'ancien Hôtel-Dieu fut démoli et plus tard l'ancien Prieuré de St-Jean eut le même sort; la disparition de ces deux établissements augmenta dans une grande proportion l'étendue de la place du Marché actuelle. |00000112| - - 60 l'affection générale à cause des services qu'elles rendaient aux familles, jouirent paisiblement de leur immeuble du Petit St-Jean; mais vint la Révolution, qui décréta la suppression des ordres religieux. Après bien des épreuves et des pourparlers, car elles étaient soutenues par une grande partie de la population, on exigea des Religieuses le serment à la constitution civile du clergé; elles refu. sèrent de prêter ce serment. Elles reçurent alors l'ordre de sortir de leur maison et on ne leur laissa emporter que ce qui était dans leurs cellules. 1. Village du canton d'Arpajon. 2. Archives de la ville. C'était un dimanche, le 9 septembre 1792; le Maire envoya des soldats pour les protéger à leur sortie. Elles trouvèrent un asile momentané dans une famille de la ville, et une petite maison fut louée, pour les recevoir, à Boissy-sous-St-Yon ('), où elles ne restèrent pas longtemps; elles allèrent ensuite à Montlhéry, puis à Versailles. Elles sont maintenant à Verdun. Mais il est juste de dire, à l'honneur de Corbeil, qu'il ne se trouva personne pour augmenter l'amertume du sacrifice qu'on imposait aux éducatrices des filles de cette ville. L'ordre d'expulsion ne fut notifié que le 7 septembre, et par les égards dont cette notification fut accompagnée, les magistrats témoignaient autant de sympathie pour les victimes, que d'aversion pour les oppresseurs. L'auteur de la notice que nous avons citée n'a pas connu les détails de l'expulsion des Augustines; mais un document d'archives que nous avons rencontré nous permet d'éclairer d'une manière plus complète la fin du séjour dans notre ville de la Congrégation de Notre-Dame. Ce document (2), que nous reproduisons ci-après, donne des détails, par la reproduction d'actes notariés, non seulement sur le départ des Religieuses de Corbeil, mais encore sur leur arrivée et leur installation dans notre ville. Il nous apprend encore que les Augustines ne furent pas chassées violemment, comme on l'a dit, mais que les autorités, obligées d'obéir à la loi, se trouvèrent dans la nécessité de leur retirer l'immeuble que la ville leur avait vendu en 1644, ce qui fut cause de leur départ; et ces mêmes autorités firent leur possible pour adoucir l'amertume de leur triste situation, jusqu'à les faire protéger par la force armée. A. D. |00000113| DISTRICT DE CORBEIL DÉPARTEMENT DE SEINE-Et-oise BUREAU DES BIENS NATIONAUX (N° 5117) EXTRAIT du registre des Délibérations du département de Seineet-Oise. SÉANCE publique du dix janvier mil sept cent quatre-vingt-treize l'an 2 de la République Française. Vů, par l'administration du Département, l'expédition en papier, collationnée sur l'original, dont acte passé devant le Boucher et Hassou, notaires au Chatelet de Paris, en date du cinq février, mil six cent dix, ladite collation faite par Closeau, notaire à Corbeil, en présence de témoins, le trois mai, seize cent quarante quatre, ledit acte portant abandon et cession, à titre de bail à rente fait par l'évêque de Paris, en sa qualité de Prieur du Prieuré de Saint-Jean l'hermitage, réuni au dit Evêché, d'une maison, chapelle, cour, enclos, jardin et bâtiments en dépendant, composant l'enclos dudit Prieuré de Saint Jean l'hermitage, aux habitans et échevins de ladite Ville de Corbeil, et accepté par eux, par les dénommés audit acte, et comme ayant pouvoir, par délibération du six janvier audit an, aux charges, clauses et conditions portées audit acte, entre autres de faire faire les réparations convenables et de faire faire le service divin dans la Chapelle dudit Prieuré. L'Expédition étant en suite de la délibération des dits échevins et habitans à l'effet de pouvoir acquérir. Vù une autre Expédition d'une délibération des dits échevins et habitans de ladite ville de Corbeil, en datte du dix avril mil six cent quarante trois, à l'effet de permettre aux religieuses de la congrégation de Notre-Dame, de s'établir en ladite ville, à la charge d'instruire les jeunes fille de la ville et faubourgs, gratuitement et aux conditions y portées. Và une autre expédition, collationnée par devant Clauseau, notaire à Corbeil, d'un acte en datte du vingt-six mars 1644, portant délibération des mêmes échevins et habitans de ladite ville, à l'effet de consentir que les dites Religieuses de la Congrégation de Notre-Dame, s'établissent dans la maison, enclos et bâtiments dudit Prieuré, 1º aux charges, clauses et conditions portées au bail à rente du 5 février 1610; 2º de ne pouvoir s'agrandir, par aucun achat, d'autres maisons voisines dudit Prieuré, attendu la petitesse du territoire de ladite ville, 3° que si les dites Religieuses vouloient s'en défaire, elles laisseroient à ladite ville, tous les dits lieux dans l'état où ils seroient, sans indemnité, et enfin à la charge de |00000114| — ―――― 62 rembourser à la paroisse de Notre-Dame, les avances et réparations qui avoient été faites, d'après l'estimation qui en seroit faite par experts. Vû une autre expédition, collationnée en date du 29 mars, audit an 1644, d'un acte passé devant Clauseau, notaire en ladite ville, portant vente, de la part des dits échevins et habitans, aux dites Religieuses de la Congrégation de NotreDame, aux charges, clauses et conditions y exprimées et détaillées en la délibération ci-dessus. Vû une autre expédition d'un acte passé devant ledit Clauseau, notaire en ladite vile, le 25 avril suivant, étant à la suite de l'acte sus datté portant quittance, de la part du marguillier en charge de la paroisse de Notre-Dame de ladite ville, d'une somme de 2.500 liv. qu'il a reçue des dites Religieuses pour le montant de l'estimation des dites réparations. Vû, la grosse d'un acte du 27 may audit an 1644, devant du Saullant notaire apostolique de l'archevêché de Paris, portant ratification et homologation, de la part dudit archevêque de Paris, des actes sus datés. Vû, le mémoire présenté par les maire et officiers municipaux et conseil général de ladite commune de Corbeil, par lequel ils demandent à être autorisés à rentrer dans la propriété, possession et jouissance de la maison et dépendances qu'occupoient ci-devant en cette ville, les Religieuses de la congrégation de NotreDame, dans l'etat où le tout se trouve aujourd'hui, aux clauses et conditions dont elles étoient tenues, et de continuer à perpétuer à faire leurs écoles gratuites pour les jeunes filles de ladite ville et faubourgs. Vû, enfin la délibération du district de Corbeil du 30 octobre dernier, par laquelle, considérant 1° que d'après le bail à rente fait à ladite ville de Corbeil le 5 février 1610, elle avoit acquis la propriété de la maison, chapelle, bâtimens et enclos du Prieuré du petit St-Jean de l'hermitage 2° que d'après ceux du 26 et 29 mars et 25 avril 1644 elle n'avoit cédé cette propriété aux Religieuses de ladite Congrégation de Notre-Dame qu'avec l'intention d'y rentrer, dans le cas où les dites Religieuses viendroient à la quitter; 3° que la stipulation que cette rentrée seroit faite des bâtimens et lieux dans l'Etat où ils seroient, sans aucune indemnité, a été formellement consentie, en sorte que cette rentrée est devenüe forcée par les circonstances. Considérant encore qu'il résulte de l'acte du 25 avril 1644, que la fabrique de ladite paroisse de Notre-Dame de ladite ville a reçu une somme de 2500 livres pour une plus value d'amélioration qu'elle avoit faite dans les bâtimens et clôtures dont il s'agit, depuis le bail du 5 février 1610, quoiqu'il soit de fait que les bâtimens actuels, ci-devant occupés par les dites Religieuses soient très vieux, et pour la plupart en mauvais état, néanmoins tous les bâtimens ont acquis une valeur plus considérable que celle qu'ils avoient en 1610, il estime et est d'avis qu'il y a lieu d'autoriser la commune de Corbeil à rentrer dans la propriété, possession et jouissance de tout l'enclos situé en cette ville et connu sous le nom de l'enclos du Prieuré dudit St Jean l'hermitage, Bâtimens et Chapelle en dépendant, et qui |00000115| - 63 - - étaient cy-devant occupés par les Religieuses de la Congrégation de Notre-Dame de ladite ville, à la charge 10 de payer ès-mains du Receveur de ce District une somme de 2500 liv. pour la plus value des bâtimens énoncés en l'acte du cinq février 1610, que les marguilliers de la Paroisse de Notre-Dame ont reconnu avoir reçue des dites Religieuses, le 25 Avril 1644; 2º de continuer, au profit de la République, comme étant aux droits du ci-devant archevêché de Paris, la Rente annuelle de trois livres, suivant leurs offres, pour le prix de ladite prise de bail à Rente, ensemble les arrérages qui en peuvent être dûs, à compter du jour de la sortie des dites Religieuses de la dite maison et dépendances, si mieux elle n'aime la rembourser ; 3° et enfin de continuer, suivant leurs offres, à faire tenir les écoles des filles de ladite ville et des faubourgs, jusqu'au nouveau mode d'instruction publique qui sera décrété par la Convention; et autres charges et conditions portées au dit Bail à rente du 5 février 1610. Oui, le Procureur Général Sindic, l'administration, considérant que la clause de l'acte de vente du 29 mars 1644, faite par la commune de Corbeil, aux dites cidevant Religieuses de la Congrégation de Notre-Dame, qui porte que, si les dites Religieuses veulent s'en défaire, elles laisseront à la dite ville tous les lieux dans l'état où ils seront sans indemnité, ne peut s'appliquer à la dépossession et évacuation des dites Religieuses ordonnées par la loi, puisque les dites possessions et évacuations ne proviennent ni du fait, ni de la volonté des dites Religieuses, mais bien des dispositions de la loi qui en a mis la propriété ès-mains de la Nation. Considérant encore que la nation s'étant chargée d'acquitter les dettes des communautés supprimées, il seroit injuste que la commune de Corbeil profitat seule des dépenses et améliorations qui ont pu être faites par les dites Religieuses dans les dits bâtimens et dépendances, tandis que l'acquittement de leurs dettes seroit supporté par tous les citoyens ; Arrête que, sur la demande de la commune de Corbeil en rentrée de possession, propriété et jouissance dudit enclos de la Congrégation de Notre-Dame de ladite ville, il n'y a lieu à délibérer, en conséquence, que ledit enclos et bâtimens en dépendant seront mis en vente comme domaines nationaux, sauf à se charger, par la République, s'il y a lieu, de l'instruction gratuite des jeunes filles de Corbeil. Pour copie conforme, RANDOUIN, Secrétaire du District. 90 |00000116| 1 C |00000117| PROMENADE ARCHÉOLOGIQUE Du 5 Juillet 1909 A ÉTAMPES Le 19 octobre 1896, notre Société inaugurait ses promenades archéologiques en allant visiter la ville d'Etampes qui jouit du privilège, assez rare, d'avoir conservé ses églises et ses maisons historiques. Depuis cette époque, notre Société s'est en partie renouvelée, et lors de l'assemblée générale du 7 juin 1909, beaucoup de nos collègues demandèrent avec insistance que l'excursion de 1909 eût lieu à Etampes, que beaucoup de membres de la Société ne connaissaient pas. Cette proposition, chaudement appuyée, obtint le succès qu'elle méritait; en conséquence, l'assemblée décida que la promenade archéologique de 1909 aurait pour but la visite de la ville d'Etampes et se ferait le 5 juillet de la même année. Ce jour-là le soleil brillait d'un éclat inaccoutumé, d'autant mieux apprécié que nous traversions une période de pluie fort ennuyeuse; aussi nos collègues répondirent, nombreux, à l'invitation qui leur avait été adressée. Cette excursion fut donc très réussie et nous pensons qu'elle a laissé un agréable souvenir aux personnes qui y ont pris part. Le choix d'Etampes avait en effet le double avantage de rappeler aux excursionnistes de 1896 l'agréable voyage qu'ils y firent alors, et à tous d'offrir l'attrait de la visite d'une ville pittoresque et de monuments anciens des plus curieux. Grâce au beau temps, le voyage fut très gai et, après l'arrêt obligé de l'embranchement de Juvisy, le train d'Orléans nous déposait à Etampes vers 10 heures du matin. 1909. - II. 5 |00000118| - – 66 Sur la route, et notamment à Lardy, nous avions recueilli de nouveaux adhérents qui attendaient notre passage pour se joindre à nous, et à Etampes nous en trouvions d'autres, assez nombreux, venus au devant de nous pour nous souhaiter la bienvenue. Parmi ces derniers, c'est un devoir de reconnaissance, de citer M. L. E. Lefèvre, savant archéologue et historien d'Etampes, qui avait bien voulu, avec la plus grande obligeance, se charger de nous diriger et de nous présenter, en les expliquant, les monuments et les curiosités de sa ville, qu'il connaît si bien, pour les avoir longuement étudiés. Le cortège se forme, on est une cinquantaine environ, parmi les quels nous sommes heureux de compter beaucoup de dames et de jeunes filles. Sous la conduite de notre aimable guide, M. Lefèvre, on se dirige vers la vénérable tour Guinette, le plus ancien des monuments d'Etampes qui, par-dessus la gare, domine la ville et la contrée environnante, comme il domina pendant de longs siècles toute l'histoire d'Etampes. M. Lefèvre rappelle que la fondation du vieux château féodal remonte au roi Robert-le-Pieux, vers l'an 1020. Souvent pris et repris, il devint, sous Louis VI, prison politique où plusieurs personnages de marque furent enfermés (¹). Et ce qui est plus intéressant pour notre histoire de Corbeil, c'est que, vers la fin du XIIe siècle, la malheureuse reine Isburge, épouse de PhilippeAuguste, y fut longtemps retenue dans une dure captivité; ce ne fut que plus tard, lorsqu'elle fut rendue à la liberté, qu'elle vint à Corbeil où elle finit ses jours en 1236, et fut inhumée dans l'église de St-Jean-en-l'Isle, dont elle avait été la bienfaitrice. Son tombeau subsista dans cette église jusqu'à la révolution. A cette époque elle fut désaffectée et servit à des usages divers. Depuis une quinzaine d'années, ce charmant édifice du XIIe siècle abrite nos collections du musée Saint-Jean. Le Roy Henri IV s'empara du Château d'Etampes en 1589, la forteresse fut détruite (1589-1590), il n'en resta que la tour du donjon qui fut démantelée; ce fut la fin de sa puissance militaire. Mais la solidité de ses assises jette encore un défi au temps, et cette tour, telle que nous la voyons, imposante encore, semble faire partie pour toujours du panorama d'Etampes. 1. Cf. Notice historique sur le Château féodal d'Etampes, par Léon MARQUIS. Paris, 1867, in-8°, de 89 pp. plan et gravures. |00000119| - 67 La terrasse qui est devant la tour est le meilleur point d'observation de la ville et de la vallée ; cependant, du haut de la tour on peut jouir d'une vue beaucoup plus étendue, et, pour y parvenir, on a installé, à l'intérieur de la vieille tour ruinée, des échelles plus ou moins branlantes, qui conduisent jusqu'aux créneaux. Les intrépides, il y en a toujours parmi les archéologues, tentent l'ascension, quelques dames mêmes, non moins intrépides, ne craignent pas d'affronter les échelles, tandis que les prudents, les sages, restés en bas, suivent avec intérêt une montée et surtout une descente qui n'est pas sans quelque péril. Mais les instants sont comptés et l'on abandonne à regret le vieux donjon pour entrer dans la ville d'Etampes; l'église la plus rapprochée est Saint-Basile; M. Lefèvre nous y conduit. Cette église, avec son antique verrière et son portail roman du x1° siècle, nous transporte dans la période la plus reculée de l'histoire d'Etampes; elle est en effet la paroisse la plus ancienne de la ville; le roi Robert, dit-on, la fit bâtir; quoi qu'il en soit, son architecture porte l'empreinte de diverses époques, mais conserve nettement les traces de sa première fondation, tel son portail qui est de pur style roman du xie siècle; le tympan représente le jugement dernier. Ces sculptures sont fort intéressantes, mais on ne peut s'empêcher de regretter que des réparations fâcheuses aient été faites dans les détails de ce curieux portail. De Saint-Basile on descend au musée, qui est proche. Là, on se trouve en pleine renaissance, car le musée d'Etampes est installé dans la gracieuse habitation de Diane de Poitiers; c'est donc une demeure historique. Avant d'entrer au musée, on admire les fines sculptures qui décorent la façade sur la cour, les jolies lucarnes avec leurs médaillons à personnages, puis toutes les pierres, sculptées ou gravées qui garnissent la cour, c'est là la partie lapidaire du musée. On entre ensuite dans les salles; là, notre collègue M. Forteau, qui en est le conservateur, reprend ses droits et guide les visiteurs à travers les différentes pièces, en leur faisant remarquer les objets. les plus intéressants; on admire, chacun selon ses goûts, les collections de numismatique, les outils préhistoriques, pierres taillées et polies des différents âges, la dinanderie, la serrurerie, les meubles anciens, les tableaux, etc., etc. Nos collègues se répandent dans toutes les salles du rez-de-chaussée et du premier étage, mais le |00000120| 68 - temps s'écoule, rapide, et l'on a grand'peine à les rappeler et à les réunir, car l'heure du déjeûner est arrivée, et l'on a encore beaucoup à voir après le repas, qui sera aussi un repos bien gagné. L'on se dirige donc vers l'hôtel des Trois-Rois, rue St-Jacques, où nous sommes impatiemment attendus. Là, autour d'une table artistement décorée et bien fleurie, prennent place 49 convives que le grand air et la promenade ont bien préparés pour faire honneur au déjeuner qui va leur être servi; voici le menu, dont chaque convive a un exemplaire imprimé sur carte postale illustrée de monuments ou vues d'Etampes. Hors-d'œuvre Sardines, saucisson, olives, beurre. Saumon de la Loire, sauce mayonnaise. Entrée Poulets sautés Marengo. Rôti Selle de mouton de la Beauce. Petits pois à la Guinette. Foie gras à la gelée. Salade romaine. Desserts Gateau d'amandes d'Etampes. Petits fours. Fraises, Cerises. Parfait glacé au café. Vins Bordeaux rouge et blanc Champagne. Café et liqueurs, eaux minérales. Comme nous venons de le dire, la table comptait 49 convives des deux sexes en nombre presque égal, et si M. P., de Morsang-surOrge, n'avait point été empêché au dernier moment par un deuil de famille survenu inopinément, il serait venu accompagné de Madame et Mademoiselle P., et alors les dames eussent été en majorité, ce qui est assez rare dans ces sortes de réunions. Nous ne pouvons indiquer tout le monde, nous bornant à citer les personnes les plus connues. Commençons par M. le Dr Boucher, Vice-Président de la Société, accompagné de Mme et de Mlle Boucher; M. Gérard, de Corbeil, Mme et Miles Gérard; M. et Mme Rous- |00000121| - - 69 - seaux; M. et Mme Geoffroy; M. et Mme Jarry, de Corbeil; Mme Léon Marquis, d'Etampes, Vve de l'historien regretté de cette ville; Mme Huard, également d'Etampes; M. Robert Dubois et Mlle Dubois, de Brunoy; M. Humbert, notaire à Brunoy et Mme Humbert; la famille Michelez, de Lardy, composée de six personnes; M. et Mme Dameron, de Corbeil; M. et Mme Lucien Bourdin, de Paris; M. Delessard, de Lardy; M. Dufour, secrétaire général de la Société; Mme Loisel, de Corbeil; M. Forteau, le sympathique directeur du musée d'Etampes; M. J. Prestat, de Paris; M. Ch. Sabrou, de Corbeil; M. Creuzet, l'aimable historien de Corbeil; M. L. Hutteau, d'Etampes; MM. Amiot et Collomp, de Paris; M. Flizot, d'Etampes; M. L.-E. Lefèvre, le guide dévoué des excursionnistes ; M. A. Marc-Pasquet, de Corbeil; M. Clavier, d'Etampes, etc., etc. Le repas fut très gai, et les convives, mis en appétit par la course matinale, lui firent largement honneur; et, chose assez rare, le service fut rapide et bien fait; aussi l'on n'eut que des éloges à adresser au maître-queux des Trois Rois, et l'on n'y manqua pas. Au dessert, le sympathique Président, M. Boucher, adresse de gracieux remercîments aux personnes présentes, il salue particulièrement les dames qui sont venues, nombreuses, embellir par leur présence la promenade de ce jour; il rappelle l'excursion faite, il y a 13 ans, dans cette même ville d'Etampes, et qui eut autant de succès que celle d'aujourd'hui. Il termine son allocution par un rapide exposé des visites faites dans la matinée, et de ce qui nous reste à voir dans l'après-midi, puis il donne la parole au Secrétaire général qui joint ses remercîments à ceux du Président, et présente les excuses des collègues qui, empêchés à la dernière heure, n'ont pu se joindre à nous, tel, entre autres, le cas de M. Mme et Mile Périn de Morsang-sur-Orge. Il regrette tout particulièrement l'absence forcée de M. Maxime Legrand, vice-président de notre Société, que sa mauvaise santé a empêché de prendre part à notre réunion. Il donne ensuite quelques indications relatives. aux voitures à prendre et aux monuments à visiter. En terminant, le Secrétaire général tient à remercier chaleureusement M. L.-E. Lefèvre, le savant archéologue Etampois, qui a bien voulu mettre sa science à la disposition de la Société, pour guider ses membres à travers la ville et, leur montrer les curieux monuments qu'elle a su conserver, tout en en faisant admirer les beautés et en expliquant les origines et l'histoire. |00000122| 70 - - Le champagne saute, les toasts se succèdent, débordants de cordialité, puis l'heure pressant, l'on quitte presque à regret cette table où l'on vient de passer de si bons moments. Devant les Trois Rois, de grands breacks attendent les excursionnistes pour les transporter à St-Martin, faubourg éloigné du centre d'Etampes, car cette bonne ville est tout en longueur, et d'une extrémité à l'autre, la distance est très grande. On arrive à l'église St-Martin dont la tour penchée fait songer à celle de Pise, quoique à Etampes l'inclinaison soit moins forte. M. Lefèvre, qui a repris son rôle de cicerone bénévole, nous fait pénétrer dans l'église où nous sommes accueillis par M. le curé Lauderault avec toute la bienveillance qui le distingue. Ce bon curé nous montre les curiosités de son église et M. Lefèvre les fait valoir et en raconte l'histoire et les origines. Il fait remarquer les piliers géminés du déambulatoire, qui sont d'une ornementation à la fois sévère et élégante. Le triforium, qui festonne entre les fenêtres et les arcs en tiers-point qui constituent la nef, est d'un motif ferme et gracieux. La partie la plus curieuse est assurément le choeur, d'une très belle ordonnance, et les travées du pourtour qui renferment les trois chapelles posées en trèfle (¹). L'église St-Martin renferme encore de curieuses pierres tombales du XIe siècle à la renaissance. Mais l'heure passe et il faut se hâter; on remonte en voiture pour regagner le centre de la ville. On s'arrête un instant au petit Saint-Mars, où M. Lefèvre a identifié un monument militaire inconnu dont il ne reste qu'une tour, qu'il croit antérieure au XIIe siècle. On passe devant les Portereaux et les remparts et l'on rentre en ville. On admire rapidement l'Hôtel de ville, construction ancienne qui a grand air, puis la maison d'Anne de Pisseleu, où l'on remarque un fronton de porte hardiment fouillé. Tout cela demanderait beaucoup de temps, mais il faut se hâter pour aller voir l'église Notre-Dame, la perle des églises d'Etampes. Et cependant l'on a été obligé de négliger l'église St-Gilles qui ne manque pas d'intérêt, ainsi que les curieuses maisons anciennes à piliers qui se trouvent sur la place près de l'église. Le temps qui 1. Maxime LEGRAND, Etampes pittoresque, la ville. Etampes, 1897. |00000123| 71 – reste avant l'heure du train, temps trop court, hélas ! est consacré à la visite de l'église Notre-Dame. M. Lefèvre fait admirer la façade fortifiée, avec ses curieux créneaux qui lui ont fait donner le nom de Notre-Dame du Fort, et surtout la haute et élégante tour du clocher, dont la vue fait gémir ceux de Corbeil, qui rappellent que leur ville possédait aussi une belle Notre-Dame, ornée d'une merveilleuse tour presque semblable à celle d'Etampes; les révolutions, les discordes, les guerres, l'ont fait disparaître avec les autres églises de cette pauvre cité de Corbeil, privée aujourd'hui de ses monuments; une seule lui reste, l'église St-Spire, qui n'est pas la plus belle de celles qu'elle a possédées. En pénétrant à l'intérieur de N. D. d'Etampes, on ne peut s'expliquer le plan bizarre adopté pour ce monument et l'on sent bien que la forme primitive a été modifiée au cours de la construction. La nef centrale et ses deux bas-côtés, avec le prolongement du chœur, forment véritablement la partie la plus remarquable, comme la plus ancienne; on la croit contemporaine de Robert le Pieux ou d'Henri Ier; mais telle qu'elle est, avec ses piliers élancés, elle est claire et élégante. Une crypte antique, dite de St-Seurin, occupe une partie du soussol du chœur et du sanctuaire, un double escalier y conduit de chacun des collatéraux. Cette crypte est certainement une des parties les plus intéressantes de l'église N. D. Elle est divisée en trois nefs par deux rangs de colonnes monocylindriques, et elle ne prend jour, aujourd'hui, que par les escaliers qui y conduisent'. Les archéologues s'engouffrent dans l'escalier, conduits par leur infatigable cicerone, qui leur conte la légende de Saint Seurin, et les mène ensuite dans un vieil ossuaire qui a peut-être renfermé le tombeau du Saint. Remontés dans l'église, M. Lefèvre leur fait admirer le vitrail célèbre des Sybilles qui est une véritable merveille. Le sujet, souvent traité au xvi° siècle, mais toujours différemment, représente les douze Sybilles. Nous admirons encore, toujours avec notre guide, deux magnifiques statues romanes de Saint Pierre et Saint Paul, qui avaient autrefois orné un portail extérieur et qui maintenant, et depuis fort longtemps, sont reléguées dans une chapelle assez retirée du centre de l'église. C'est probablement à cette circonstance qu'elles doivent 1. Maxime LEGRAND, Etampes pittoresque, loc. cit. |00000124| 72 - de n'avoir point été mutilées, comme celles qui sont restées à l'extérieur. On s'arrête encore devant quelques tableaux intéressants et, après une visite à la sacristie, très curieuse elle aussi, on donne le signal du départ. Tout en partant, M. Lefèvre nous donne encore quelques explications sur l'Hôtel-Dieu, qui est presque attaché à l'église Notre-Dame et qui fut doté de fondations royales par Philippe-le-Bel et ses successeurs. Mais l'heure presse, on se hâte vers la gare, accompagnés par nos amis d'Etampes qui veulent ne nous quitter qu'à la dernière minute. On se serre les mains, on se dit au revoir et le train nous emporte, heureux de cette bonne journée qui nous laissera l'excellent souvenir de l'aimable réception qui nous a été faite dans cette bonne ville d'Etampes, si pittoresque, si calme, mais si pleine de son glorieux passé. X. |00000125| LA CHEVALERIE ÉTAMPOISE LES CHEVALIERS ET LES VICOMTES D'ÉTAMPES Dans une étude publiée par la Société Historique de Corbeil, d'Etampes et du Hurepoix sur LES VICOMTES DE Corbeil et les chevaLIERS D'ETAMPES, nous avons exposé la généalogie d'une famille noble portant le surnom d'Etampes et citée, sous Philippe Ier, au nombre de celles relevant directement de la Couronne, parmi lesquelles se recrutaient les « Chevaliers du Roi ». Mais, à la même époque et sous les règnes suivants, ce surnom fut commun à de nombreux personnages issus de lignées parallèles et distinctes. Dans l'intitulé d'un rescrit donné l'avant-dernière année de sa vie, Philippe Ier réunit les chefs de ces diverses maisons sous une formule collective : « nos féaux d'Etampes, fideles nostri Stampenses ». En nous permettant de compléter ce qui, dans l'étude précitée, a été dit sur l'une de ces souches de chevaliers, la présente notice consacrera des monographies séparées et brèves à quelques autres maisons ayant possédé des fiefs à Etampes et dans sa banlieue et ayant emprunté à cette ville leur surnom sous Philippe Ier ou Louis VI. Ces familles, dont plusieurs sont peut-être des branches d'un même tronc, se distinguent ainsi : I. Guihard le Bouteiller et Ougrin le Chambellan. II. Orson Le Riche et sa lignée. III. Les Vicomtes d'Etampes. IV. La famille de Menier, fils d'Aubert. – ― SOUS PHILIPPE Ier ET LOUIS VI. - - 1909. — II. - 6 |00000126| -74 - - GUIHARD LE BOUTEILLER ET OUGRIN LE CHAMBELLAN, D'Etampes. La première des familles ayant porté le surnom d'Etampes aux XI et XII° siècles et qui doit attirer notre attention, appartenait à la familia regia, c'est-à-dire à la Maison du Roi, et ses membres ont exercé à la cour de Philippe Ir plusieurs charges domestiques. Son chef est un chevalier qu'on rencontre auprès de Raoul IV, comte de Crépy-en-Valois, et de ses fils, Gautier IV et Simon Ier. Il se nomme Guihard, fils de Rouhard, ou Guihard d'Etampes. Guidardus de Stampis figure en 1066 parmi les témoins qui assistent à l'abandon d'une main ferme à l'abbaye de Saint-Père de Chartres, par la veuve d'Hubert de Rosay, chevalier mantais, en présence du comte Raoul IV de Crépy et de son fils aîné, Gautier IV (¹). I Guidardus filius Rothardi apparaît aux côtés du comte de Mantes, Simon, fils de Raoul IV, dans un acte passé, après 1068, sous Gui, évêque de Beauvais, mort entre 1074 et 1078 (2). Le nom de Guihard (Guidardus) s'est aussi prononcé Gohard et orthographié Godardus ou Goardus. Parmi les témoins du diplôme de 1106 par lequel Philippe Ier accorde à l'abbé de Morigny, Rainaud, l'église Saint-Martin-du-Vieil-Etampes, figure Vulgrinus, Gohardi filius, de Stampis (3). Dès lors nous sommes amenés à identifier à notre Guihard le bouteiller Gohard (Godardus) qui, avec son frère Rainard et le sénéchal Geofroi, assiste à une libéralité faite à Marmoutier par un vassal du comte Gui de Ponthieu, Aleaume Costard, vers la fin du xe siècle (4). - Ougrin, fils de Gohard d'Etampes, est compris dans le mandement adressé, la même année 1106, mais avant le 4 août, par Philippe Ier à ses vassaux d'Etampes, fidelibus nostris Stampensibus, pour assurer - I. GUERARD, Cartulaire de Saint-Père de Chartres, p. 185. 2. Collection MOREAU, t. XXX, fol. 86. 3. MENAULT, Morigny, p. 38. n. CLV, p. 388. - - Maurice PROU, Recueil des actes de Philippe I, 4. Testibus… Godardo butellario, Rainardo fratre ejus, Gosfredo senescalco (Coll. Moreau, XXV, 123). |00000127| - 75 - aux serfs et aux colliberts de la Trinité d'Etampes le même statut qu'aux serfs de la Couronne. Dans l'énumération des « féaux » d'Etampes, Ougrin porte le titre de Chambellan du roi, Vulgrino camberlano nostro (5). Ougrin fut au nombre des bienfaiteurs de Morigny, abbaye fondée par Anseau, fils d'Arembert, l'un des chevaliers de Hugues du Puiset. Anseau avait donné le fonds où s'éleva plus tard le cloître de Morigny, du consentement de son suzerain, aux moines de Saint-Germer de Fly (6). Le prieuré établi par ces religieux ayant été transformé en abbaye autonome, cette érection amena de longs débats entre l'abbaye-mère et sa filiale. Saint-Germer finit par se contenter d'un tribut annuel, à titre de reconnaissance de l'ancienne sujétion de Morigny. Ce tribut consistait en une somme (fardeau d'un cheval) de barils d'huile. Mais il cessa d'être acquitté, le revenu qui servait à le fournir ayant été saisi par le fisc (regis violentiâ). Les protestations de Saint-Germer recommencèrent. Alors « un homme excellent, Ougrin fils de Gohard, Chambellan du roi Philippe, ne pouvant souffrir qu'un pareil différend se perpétuât, s'efforça d'y mettre un terme par ses démarches, et contribua de ses deniers à la constitution d'un revenu suffisant pour fournir aux moines beauvaisiens la somme d'huile qui leur était due (7) ». Cette intervention d'Ougrin est aussi de l'année 1106. Il épousa Hersende, sœur de Gui Ier de Linas, et la perdit sans en avoir eu d'enfants survivants. Hersende vaulut être inhumée à Notre-Dame de Longpont, monastère auquel s'intéressait sa famille. A son lit de mort elle légua au couvent, pour sa sépulture, ses droits sur l'église St-Michel et la dîme de cette paroisse. Son mari 5. Ms. lat. 17.049, fol. 96. MENAULT, Morigny, p. 42. (Le texte de cet éditeur maintient une leçon qui, à nos yeux, serait une erreur de copie, que nous signalons ici pour n'y plus revenir au lieu de « Haimoni Pagani Anselli filio »; il faut lire : « Haimoni; Pagano Anselli filio… »). - 6.- Quidam miles, nomine Ansellus, terras et fundos quibus locus ille primitus initiatus est, predicto Flaviacensi loco, concedente Hugone de Pusiaco domino suo, contradidit. Crevit autem, edificantibus monachis illis, donec in abbatiam conversus est (MENAULT, Morigny, p. 165). Anseau (Anselmus filius Aremberti) est témoin, à Etampes, d'un acte de Philippe I (PROU, n. CLXXIV, p. 425) maintenant certains privilèges aux enfants d'Eudes, maire de Chalo, en 1082. 7. - « Providente autem Dei clementia, quidam vir obtimus, nomine Vulgrinus filius Goardi, Philippi regis camberlanus, discordiam istam durare non patiens, suo et verbo et sumptu redditum quemdam praeparavit, ubi Flaviacenses dictam olei summam, sine difficultate aliqua, singulis annis acciperent » (Ibid. - MENAULT, Morigny, p. 164). - |00000128| 76 et son frère, au jour de ses obsèques, attestèrent cette donation et leur assentiment en prenant le calice de Saint Macaire et en le déposant sur l'autel. Voici le texte de la notice qui relate cette libéralité et qui, malheureusement, n'est point datée : Hersendis uxor Wlgrini in extrema parte posita, omnia que habebat in ecclesia Sti Michaelis Ste Marie de Longoponte donavit, scilicet duas partes de decimaria ipsius ecclesie, hoc est de annona, de vino, de lino, de cambe, de ovis, de porcis, de vitulis et de omnibus omnino rebus. Post obitum vero ejus, cum antiquum ad tumulum deferetur, Wlgrinus vir ejus et Guido frater ejus de Lynais istam donationem per sciffum Sti Macharii super altare Ste Marie posuerunt. Hujus rei sunt testes: Harduinus presbiter. Frotgerius decanus. Gaufredus Bernoala (*). Guido de la Novilla. Guido filius Aldeberti. Balduinus filius Rainardi. Nanterius de Donjonio. Aymo Angivinus (*). Guillelmus Cuchun. Hungerius de Cavanvilla. Hungerius de Limos. Johannes Beroardus, Herimannus filius ejus. Teoboldus, Guido, Hugo de Ver (1º). Parmi les parents et alliés présents à la cérémonie funèbre, à côté de Nantier du Donjon, des seigneurs de Limours, de La Norville, de Vert-le-Grand, on remarquera Gaufroi fils de Berneuil et Baudoin fils de Rainard; ce sont deux étampois. Nous rencontrerons Berneuil dans le chapitre consacré aux Vicomtes d'Etampes. Quant à Rainard, c'est un frère de Gohard; donc son fils est le cousin germain du mari d'Hersende. Ougrin se présente comme l'un des témoins de Notre-Dame de Longpont dans un accord conclu avec trois frères, de la famille bien connue des Morhier. Avec lui souscrivent une foule d'autres chevaliers étampois Jean, fils d'Anseau Payen, Orson Le Riche d'Etampes et son frère Aimon; Rainard fils d'Hermer; Geofroi le Monnayeur; enfin un maréchal, Guillaume. Du côté des Morhier se trouve comme premier témoin le vicomte d'Etampes, Marc fils de Roscelin (1). 8. Il faut lire Gaufredus Bernoalii. Il s'agit ici de Berneuil d'Etampes, connu par d'autres documents. 9. — Beau-fils de Giroud de Saulx, et contemporain du prieur Henri (Cartulaire de Longpont, n. 115). 10. Cartulaire de Longpont, n. 111 (ms. lat. 9968). 11. -(( Amalricus, Petrus, Gaufredus cognomento Moreherus, filii Tebaldi de Muro, concesserunt Deo et Ste Marie de Longoponte terram de Longoponte de Lysiu quam Gaufredus Turpis et Doda uxor ejus ex cujus patrimonio erat, dederant monachis… » Testes ex parte ipsorum: Marcus filius Roscelini. Ansellus de Alvers. Arnulfus Basset (maire d'Auvers). » Ex parte Ste Marie: Ursus Dives de Stampis, Aymo frater ejus. Johannes filius An- |00000129| - - 77 - En 1112 Ougrin, bien qu'il ne porte alors aucun titre d'emploi, est appelé à souscrire, à la suite du roi, lorsque de passage à Etampes, Louis VI accorde un privilège à Thomas, second abbé de Morigny (12). Si Louis VI ne maintint pas Ougrin dans les fonctions dont son père l'avait honoré, l'ancien chambellan de Philippe Ier, resté l'un des riches bourgeois d'Etampes, conserva pourtant de l'influence au palais jusqu'à la fin de sa vie. Elle arriva en 1130; ayant élu sa sépulture à Morigny, il avait disposé en faveur de cette abbaye d'une partie de sa fortune. Mais comme il ne laissait pas d'héritiers directs, et que, dans ces conditions, les biens d'un membre de la familia regis revenaient de plein droit au souverain, les agents du fisc saisirent tout ce qu'Ougrin avait possédé, sans en excepter ce qu'il avait laissé à Morigny pour sa sépulture. Toutefois les réclamations ultérieures des moines furent écoutées, et les libéralités du chambellan confirmées (13). Il est regrettable, à tous points de vue, mais spécialement en ce qui touche le chambellan de Philippe Ier, que la plus grande partie du premier livre de la Chronique de Morigny soit perdue. On voit en effet par le livre II, qu'Ougrin avait été cité à maintes reprises comme un bienfaiteur insigne du monastère, dans le début de la chronique (14). On vient de voir Ougrin participer à deux contrats relatifs à Notre-Dame de Longpont. Il faut se garder de le confondre avec deux homonymes qu'on rencontre dans les actes du même temps concernant ce monastère. L'un est Ougrin Le Riche, qui peu après la fondation des Vaux de Cernay, donna à cette abbaye deux muids sur sa vigne d'Athis tant qu'il vivrait, et après sa mort la vigne tout entière (15). Il laissa - selli cognomento Pagani. Wlgrinus filius Gunhardi. Reinardus filius Hermeri. Gaufredus monetarius. Willelmus marescaudus. (Cartulaire de Longpont, nº 109.) Le surnom traduit en latin par Turpis, ne serait-il pas le même que celui du Guillelmus Cuchun, l'un des assistants aux obsèques d'Hersende de Linas ? Quant aux Morhier, nous verrons l'un d'eux, tout à l'heure, qualifié chevalier de Balizy (note 25). 12. - «Signum Vulgrini filii Gohardi » (MENAULT, Morigny, p. 41). 13. BOUQUET, Recueil des Historiens de France, XIII, 78. 14. DUCHESNE, Historiæ Francorum Scriptores, IV, 363. - 15. - L'abbaye fut fondée en 1118. La libéralité d'Ougrin Le Riche est relatée dans une notice récapitulative dressée vers 1162. |00000130| 78 - ―――――― deux enfants : Jehan Le Roux d'Athis et Lucienne, mariée d'abord au seigneur d'Egly, puis à Gautier, chevalier d'Orangis (16). Une sœur de cet Ougrin, Rose (Rosza, c'est-à dire Rosceline), épousa Etienne, chevalier de Savigny; elle avait deux autres frères, Rainaud et Bertran (17). L'autre est Ougrin de Bullion, frère d'Aimon, cité comme l'un des arbitres, avec Jehan Le Roux d'Athis (mediantibus sapientibus viris atque laudantibus), d'un accord entre Longpont et Mathieu, mari d'Eudeline d'Egly. Cet Ougrin-ci ne fait qu'un avec le moine homonyme, frère d'Aimon du Donjon, qui obtint de ce châtelain, alors à ses derniers moments, la concession d'une libéralité faite par le chevalier Hervé et sa femme Emeline, à la prière du même moine, au prieuré de Longpont (18). Nous retrouverons Aimon et Hervé dans les chapitres suivants. Quant à l'origine du bouteiller Guihard et de son fils Ougrin le chambellan, elle se relie sans doute à celle des Le Riche de Senlis, qui eurent les mêmes charges dans la Maison du Roi. Le nom de Rouhard, porté par le père de Guihard, se rapproche de celui de Rouhaud (Rotholdus), fondateur de la dynastie des Bouteillers de Senlis (19). - - II Un diplôme du roi Philippe [er, donné à Melun en 1067, avant le 1er septembre, constate au sujet d'un accord entre l'abbé Hugues de Fleury et un seigneur nommé Gui (sans doute Gui de Mont- - 16. De son premier mariage elle eut Eudeline d'Egly, mariée à Mathieu, neveu du prévôt, sire Tébert, et l'un des croisés (Cartulaire de Longpont, nº 341). 17. Cartulaire de Longpont, nº 156. 18.- -«Sciant omnes quod miles quidam nomine Herveus et uxor ejus Emelina per ammonicionem Wlgrini monachi, dederunt Deo et Sancte Marie de Longoponte….. unum campum prope grangiam Ste Marie. Propter hoc acceperunt a monachis….. permissionem sepeliendi honorifice cum mortui fuerint….. Istam donationem Aymo de Donjone de cujus feodo hec res erat, jam in extrema infirmitate positus, Ste Marie concessit, videntibus istis Wlgrino monacho fratre suo; Frogerio decano, Aymone Angevino, Guidone de Linais, Galterio Meschino, Hugone Chamilli et multis aliis ». (Cartulaire de Longpont, no 141). 19. DEPOIN, Appendices au Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise, p. 280. ORSON LE RICHE ET SA LIGNÉE. |00000131| 79 — lhéry), que parmi les témoins de l'abbé se trouvait Thion, chevalier d'Etampes, fils d'Orson (2º). En 1082, Thion est aux côtés de Philippe Ier confirmant les immunités de Notre-Dame d'Etampes (”). Il est ainsi désigné : « Teudo de Stampis, filius Ursonis de Parisius ». En 1085 on retrouve à Etampes« Teudo et filius ejus Haimo», Thion I et son fils Aimon (22). Thion Ier d'Etampes eut aussi pour fils Geofroi ou Gaufroi (Godefredus filius Teudonis de Stampis) qui possédait à Palleau (23) des droits qu'il concéda à Notre-Dame de Longpont, du consentement de sa femme et de son fils Thion III. Ne pouvant se rendre luimême au monastère, il chargea Morhier, chevalier de Balizy (24), de déposer pour lui l'acte de donation sur l'autel de Notre-Dame (25). Gaufroi tenait ces droits en fief de Thion II, fils d'Ours ou Orson II, son cousin germain, qui confirma sa libéralité en présence de: Simon, châtelain de Neaufle, Thomas de Bruyères-le-Châtel, Roger et son fils Gautier de Saint-Yon, et autres (26). Il faut en effet distinguer les quatre générations: Orson I, Thion I, Orson II, Thion II. - - - Orson II d'Etampes, fils de Thion Ier (44), souscrit après le 29 août 1106, le privilège donné à l'église de Fleury par Louis VI, roi désigné. Il est probable que c'est celui qui en 1107, figure à la cour des rois Philippe et Louis comme grand connétable (27). - - 20. Ex parte domni abbatis fuerunt… Theudo miles Stampensis, filius Ursionis: hos omnes misimus in presencia Guidonis (Maurice PROU et Alex. VIDIER, Recueil des chartes de Saint-Benoit-sur-Loire, t. I, p. 202). 21. Maurice PROU, Actes de Philippe I, n. cvш, p. 275. 22. Ib., n. CLXXIV, p. 425. 23. Palleau-la-Chapelle, commune de Ballancourt, arr. de Corbeil. 24. Balizy, commune de Longjumeau, arr. de Corbeil. 25. — « Godefredus filius Teudonis de Stampis dedit Deo et Sancte Marie de Longoponte et monachis ejusdem loci medietatem portus de Paluello, et per Moreherium militem de Balisi, misit donum apud Longumpontem quod ex sua parte super altare Sancte Marie poneret, et hoc donum concesserunt uxor ipsius Godefredi, et Teudo filius amborum. Hujus rei sunt testes: Ansellus monachus. Mainerius filius Alberti; Guido frater ejus. Arnulfus Ruffus de Alvers. Moreherius miles. Paganus filius Anseis » (Cartulaire de Longpont, n. 214). - ――――― 26. — « Theudo filius Ursi de Stampis concessit Deo et Sancte Marie de Longoponte… portum de Paluel quem Godefredus dederat, et de eo in feodo tenebat. Testes… Simon Castellanus (de Nealfa), Radulfus de Virini, Thomas de Beneriis, Rogerius de Sto Yonio, Galterius filius Rogerii de Sancto Yonio… Rogerius Huretus » (Cartulaire de Longpont, n. 215). 27. — LUCHAIRE, Louis VI le Gros, p. 42, 52. Il y eut alors des remaniements impor. tants parmi les grands officiers, et M. Luchaire remarque que leurs noms ne concordent pas avec les données fournies par les chartes précédentes. Etant connue la situation toute spé- |00000132| 80 - Orson II figure après le vicomte Marc dans la nomenclature des féaux d'Etampes auxquels Philippe Ier adresse le rescrit du début de l'année 1106 (5). Il est appelé Ursio au lieu d'Ursus, mais ces deux prénoms s'emploient indifféremment (28). Une mention qui le concerne, dans le Cartulaire de Longpont, montre qu'il appartenait à la famille Le Riche; il possédait à Etampes un alleu dont la huitième partie constituait la dot de Sanceline, femme de Geofroi Châtel (29), apparemment fille ou nièce d'Orson II. Ours est cité avec son frère Milon d'Etampes, moine de Saint Martin des Champs, dans un acte antérieur au 14 juillet 1096 (3º), où Gautier d'Etampes et sa femme Adèle, puis Foucher de Bullion et sa femme Emeline donnent aux moines des Champs chacun leur moitié de la dîme d'Orsonville (Ursionis villa); le nom de cette localité rappelle un possesseur dont vraisemblablement descendait Orson II. Rainaud Chenard (surnom qui s'est conservé dans la dénomination de la paroisse chartraine de Levesville) qui pouvait aussi revendiquer des droits sur Orsonville, porte un prénom que nous avons rencontré déjà dans la noblesse d'Etampes. Orson II est surnommé, dans l'acte de Geofroi Châtel, Ursus Dives; nous avons vu plus haut son aïeul, Orson Ier, désigné ainsi : Urso de Parisius. Il n'y a donc aucun doute sur le rattachement de cette branche aux Le Riche de Paris, dont M. Auguste Longnon a, le premier, signalé l'importance historique. Aimon, dont le nom est juxtaposé à celui d'Orson II dans le rescrit royal de 1106, est vraisemblablement le même qu'Aimon du Donjon, frère d'Ougrin de Bullion qui se fit moine à Longpont, ainsi qu'on l'a vu déjà. Cet Aimon ne fait qu'un, croyons-nous, avec celui qui épousa Emeline de Longpont, veuve d'un seigneur de Morcerf dont elle avait eu un fils, nommé Roger Bourdin. Du ciale de la Cour à cette date, il n'y a pas lieu de tirer de cette diversité une objection contre l'authenticité des documents qui la constatent. 28. Le Liber Testamentorum Sancti Martini de Campis le démontre en ce qui touche le premier prieur, Ours ou Orson, contemporain de Philippe I. Voir l'édition publiée par la Conférence des Sociétés Savantes de Seine-et-Oise. ―― 29. « Gualterius Castellus et Sancelina ejus uxor, ex cujus patrimonio erat, dederunt Deo et Sancte Marie de Longoponte… hoc quod habebant apud Stampas in alodio Ursi Divitis patris Theudonis, videlicet octavam partem tocius terre culte et inculte, nemoris, hospitum, census, peagii, roagii, molendini de Crocheto. Testes… Robertus prior » Cartulaire de Longpont, n. 313). 30. Liber Testamentorum, 11. XL, p. 52. ――― |00000133| 81 - second lit, elle n'eut qu'une fille homonyme (31): ce doit être cette Emeline II, qui porta la seigneurie de Bullion et la moitié de la dîme d'Orsonville à son mari Foucher. Aimon survécut à sa femme qui voulut être inhumée à Notre-Dame de Longpont (3). Il se remaria, vers 1100, à Mabile, veuve de Guérin de Gallardon, qui avait succombé en se rendant comme croisé en Palestine. De cette seconde union sortit une fille, Euphémie. Aimon est appelé Le Roux d'Etampes dans une notice du Liber Testamentorum où l'on relate que, se trouvant à Etampes avec sa femme et sa fille, ils transigèrent avec le prieur de Saint-Martin-des-Champs au sujet d'une terre donnée par un des vassaux de Guérin, Amauri de Mondonville, au monastère parisien. Hervé, fils de Marc (le vicomte d'Etampes), fut un des témoins d'Aimon. Orson II, frère de celuici (1), fut l'un des témoins des moines (33). Le diplôme de Louis VI pour Thomas, abbé de Morigny, en 1112, fait mention de Thion II, fils d'Orson II; on lit dans les souscriptions, après celles d'Isembard Payen, fils d'Anseau, et de son fils Jehan et avant celle d'Ougrin, fils de Gohard, celle-ci : « Signum Theodonis filii Ursonis » (11). Il mourut après 1120, portant toujours les armes, et se fit enterrer à Morigny, laissant au monas- ――― 31. L'homonymie s'infère de l'omission du prénom de la fille d'Aimon et d'Emeline, qui, s'il n'était pas identique, laisserait une lacune inexplicable dans la notice. Roger Bourdin fut le fondateur du prieuré de Morcerf (Morissartum), où s'établirent les moines de Saint-Martin de Pontoise vers 1080, par la permission de l'évêque de Meaux, Gautier Saveir (mort en 1082). Cette terre de Morcerf (canton de Rozoy-en-Brie, Seineet-Marne), relevait d'Eudes, comte de Corbeil (DEPOIN, Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise, nn. xI et XIII, pp. 9-12). - 32. Notificari omnibus volumus quum omne illud beneficium quod Emelina apud Longumpontem Lysii habuit, in fine vite sue Ste Marie de Longoponte pro anima sua, marito suo et filia sua annuente, tradidit. Hujus beneficii donum Aymo maritus ejus et filia sua in die depositionis sui per textum Evangelii super altare Ste Marie posuerunt. Hujus rei sunt testes Henricus prior, Aduinus monachus, Otardus monachus, Harduinus capellanus, Reimbertus presbiter, Rainaldus presbiter, Anscherius clericus, Rainardus miles, Ebrardus. Paulo post venit Rogerius cognomento Burdinus filius Emeline et posuit super altare donum… videntibus istis: Henrico priore… Giroldo de Salicibus, Aymo Angevino privigno ejus, Petro Oseline filio, Gaufredo majore Ste Marie (Cartulaire de Longpont, n. 115). 33. Liber Testamentorum, p. 98. La note 385 doit être rectifiée; nous avions eu le tort d'ajouter foi sur ce point à la savante notice de M. de Dion sur Le Puiset aux x1º et XIIe siècles (p. 21-22), qui suppose Gui exerçant le vicomté à Etampes dès 1104. Voir sur Guérin de Gallardon, nos Appendices au Cartulaire de St-Martin de Pontoise, fasc. V, pp. 469-470. |00000134| 82 ― tère une moitié de pressoir, un pré et un petit champ devant la grange de Beauvoir (34). Les noms juxtaposés d'Aimon et de Thion sont significatifs. On les rencontre dans une autre famille dont la communauté d'origine avec les Le Riche d'Etampes est au moins plausible : Les Chef-deFer du pays chartrain. Etienne apparaît dans un acte épiscopal pour l'abbaye de SaintPère entre 1048 et 1060, avec ses deux fils Thion et Aimon : « Stephanus Caput-de-Ferro et filii ejus Tendo et Amo » (35). Vers 1083, Thion Chef-de-Fer est cité comme l'un des seigneurs de l'église Saint-Georges de Roinville lorsqu'elle fut donnée à SaintMartin des Champs; il y consentit, ainsi que sa femme Hersende et leur fils Hardoin. Plus tard Hardoin ayant réclamé, le prieur Orson transigea en lui offrant cinq sous, et à son fils Hugues des bottes et des souliers (36). Toute cette famille reparaît dans l'entourage de Giroie de Courville, lorsque ce châtelain donne à Marmoutier, du consentement de Geofroi Ier, évêque de Chartres (1064-1084), l'église Saint-Nicolas fondée par son père Ives Ier et dont il vient de chasser les chanoines. On cite alors à ses côtés : « Teudo filius Stephani Caput de Ferro cognominati; Harduinus filius ejus; Haimo frater ejus (37). Hersende survécut à son mari; elle est nommée dans un acte où son fils Hardoin agit comme seigneur de Denonville et sa fille Mélissende comme dame de Vierville: celle-ci avait pour mari Gautier d'Aunay-sous-Auneau (38). Hardoin fut aussi l'un des chevaliers du sire de Courville; il est appelé en effet : « Harduinus miles dictus Caput Ferreum de castro Curvavilla » (39). Les moines de Saint-Père de Chartres concédèrent à Hardoin, à sa femme nommée aussi Hersende, et à leur fils Hugues les revenus de la sacristerie, l'un des offices de leur communauté, à condition qu'il fournît tous les ans un cheval de service au monastère (40). 35. 36. 34. « Teudo vir militaris, veniens ad extrema, torcularis medietatem et pratum et turrulam ante grangiam de Bellovidere dedit ecclesiae »> (Chronique de Morigny, dans DUCHESNE, IV, 371). Collection MOREAU, XXIV, 152. - 39. 40. - 37. 38. Archives de l'Eure, H 2254. - - - Liber Testamentorum, nn. XXXVIII et XXXIX, p 49-52. Collection MOREAU, XXVIII, 157-168. Archives de l'Eure, H 2309. Ms. lat. 5417, fol. 461. |00000135| - 83 – Ces Aimon et ces Thion, de même que le châtelain de la FertéMilon (autrefois de la Ferté-Ours), Teudo de Firmitate que appellatur Urs, contemporain de Henri Ier (41), se rattachent à quelqu'un des sept fils de Thion, vicomte de Paris en 926, qui plus tard eut le titre de comte. L'un de ces enfants fut Aimon, considéré comme le premier comte de Corbeil (42). Sous Thion, le chef-lieu du comté fut probablement Melun: le titre de « comes Meledunensis » est en effet celui que les actes donnent à Renaud de Corbeil, évêque de Paris, successeur de Bouchard le Vénérable, issu de son mariage avec Elisabeth, veuve d'Aimon. La collégiale de Saint-Guénaud de Corbeil fut, comme celle de Saint-Spire, fondée par le comte Aimon, dans la seconde moitié du Xe siècle. Parmi ses bienfaiteurs, un prévôt de Paris, Thion, qui donna au chapitre des rentes à Courcouronne, est inscrit au 23 mai dans le nécrologe; son anniversaire se trouve réuni à ceux des comtes Aimon et Bouchard. Cette association prouve une parenté; l'obit de Thion étant rappelé le dernier, est postérieur à celui de Bouchard (26 février 1007). Ce prévôt, contemporain du roi Robert II, est apparemment la souche dont toutes les branches qui viennent d'être énumérées sont issues (43). - - III Le plus ancien vicomte d'Etampes qui nous soit connu, vécut sous Philippe Ier et se nommait Roscelin. Il est intéressant de rencontrer, dans le Cartulaire de Saint-Père de Chartres, les noms de Roscelin et de Thion unis dans une même généalogie, celle de TARDIF, Cartons des Rois, n. 280; Archives Nationales, K 19, n. 19. 41. 42. Nous établirons ailleurs la filiation d'Aimon, fils de Thion et petit-fils de Grimoard, vicomte de Paris sous Charles-le-Simple. - LES VICOMTES D'ETAMPES 43. Le texte du nécrologe de St-Guénaud, copié par l'abbé Guiot, porte au 23 mai : « Anniversarium solemne Haimonis comitis, fundatoris nostri… Item anniversarium Burchardi comitis… Item anniversarium Theudonis, praefecti Parisiensis, qui dedit B. Guynailo redditus quos habet apud Curcoronam » (Courcouronne, cant. de Corbeil). Puisque ce fut Aimon qui fonda cette collégiale, elle n'a pu recevoir de dons de Thion, vicomte de Paris en 926, avec lequel MOLINIER (Obituaires de la province de Sens, I, 411) croit pouvoir identifier Teudo, praefectus Parisiensis. Nous devons donc écarter cette identification qui, par surcroît, prête au mot praefectus en le prenant pour vicecomes, une extension qui serait, pour le moins, infiniment rare, surtout à cette époque. - |00000136| - 84 - chevaliers, vassaux d'Aubert III Le Riche, fils de Ribaud et neveu d'Aubert II Le Riche, seigneur de Bouafle. Le détenteur de l'église d'Armentières l'ayant donnée aux moines de Saint-Père (ce chevalier se nommait Erchenoul d'après une charte confirmative de Gautier, comte de Dreux), son fils Roscelin réclama et momentanément usurpa sur elle des droits de voirie dont Thion, son petitfils, se mit en possession de nouveau « per sonum campanæ » en s'arrogeant le droit de faire sonner les cloches. Plus tard, Thion et Engenoul, fils de Roscelin, y renoncèrent en faveur de l'abbé Landri (1033-1069). On connaît une fille d'Engenoul, Adeline, qui abandonna la voirie d'Anet au même abbé. Nous manquons de documents sur la descendance de Thion, fils de Roscelin, et nous ne pouvons que signaler un rapprochement curieux entre des prénoms qui sont juxtaposés plus tard parmi la noblesse étampoise. Revenons aux vicomtes d'Etampes. Roscelin fut le père de Marc et de Gaufroi. Dans l'accord des frères Morhier avec Notre-Dame de Longpont, l'un de leurs pleiges ou garants se nomme Marcus filius Roscelini (11). D'un autre côté, le Liber Testamentorum enregistre, dans une donation d'Anseau de Janville (fils de Gauslin II de Lèves) à Saint-Martin-des-Champs, le témoignage de Berneuil, petit-fils de Roscelin, « Bernoalus filius Godefredi filii Roscelini » (44). En 1082, Philippe Ier confirma les immunités de Notre-Dame d'Etampes en présence de Berneuil (2) ici nommé Bernodalius. Ne ferait-il qu'un avec l'abbé homonyme de Notre-Dame sous Philippe Ier cité par Dom Fleureau et avec Bernodalius Potinus qui donna, vers 1107, l'église de Cerny (+5) à l'abbaye de Morigny? Le surnom de Potin apparaît, dans le Cartulaire de Saint-Père de Chartres, à plus d'un demi-siècle en arrière : il a dû être, comme on le voit en d'autres cas pour le surnom de Gautier Tirel, par exemple porté dans diverses branches d'une même souche. Berneuil eut pour fils Gaufroi qui assista aux obsèques d'Hersende, femme d'Ougrin le Chambellan, et ce Gaufroi (Gaufredus) ne fait qu'un peut-être avec le Gaufroi Sauvage (Gode- – — ―― 44. Liber Testamentorum, n. xxvш, p. 36. On rencontre avec lui Isembard Payen fils d'Anseau (d'Étampes); Arnoul d'Auvers-Saint-Georges (fils d'Arraud de Corbeil); Rainaud de Dourdan; Thibaud fils d'Orson (I d'Etampes); et comme témoin pour les moines, Orson II fils de Thion Ier. Tous ces personnages devaient être alliés. 45. Canton de la Ferté-Alais, arr. d'Étampes (DUCHESNE, IV, 360). — Cf. D. FLEUREAU, Antiquitez de la ville d'Estampes, p. 405. ―- |00000137| - 85 ―――――――――― fredus Silvaticus), prévôt royal d'Etampes en 1141, que nous rencontrerons plus loin. Vers 1147 on retrouve un autre Berneuil ou Bernaud (Bernaldus) au nombre des gendres de Barthélemi Le Riche d'Etampes. Le Nécrologe de Saint-Jean-en-Vallée nous apprend que le premier abbé, Aubert, et l'un des chanoines de cette collégiale, Tescelin, eurent pour père Roscelin et pour mère Lieuse (Leoisa) dont les obits se commémoraient ensemble le 5 mars. La forme Lieuse est intermédiaire entre une plus ancienne, Lithuisa, et une plus moderne, Liesse ou Leticia. Nous verrons tout à l'heure que le vicomte Marc, fils de Roscelin, eut une fille nommée Liesse. Le premier abbé de Saint-Jean-en-Vallée près de Chartres, fut donc un des fils de Roscelin, tige des vicomtes d'Etampes (46) et la copropriété des biens à Lèves, domaine d'une branche bien connue de la famille Le Riche, tend à rapprocher de cette souche celle dont sortait, ou Roscelin, ou sa femme Lieuse. Le vicomte Marc souscrit en 1094 à un diplôme de Philippe Ier pour Saint-Pierre de Melun (47). Le rescrit de 1106 le mentionne avec son fils Hervé sans lui attribuer de titre, en tête des chevaliers du roi à Étampes. « Marconi et Herveo ejus filio». (5). Il dut mourir en 1107. En 1108, en effet, avant le 16 mars, le vicomte Hervé est l'un des témoins de Louis-le-Gros, roi désigné, lors de l'acte par lequel Gui Troussel, mourant, déclare remettre sa terre de Montlhéry entre les mains du prince en le priant de placer sous sa sauvegarde le prieuré de Longpont (48). C'est par erreur que M. de Dion a représenté comme vicomte d'Etampes, dès 1104, Gui, fils de Hugues Blavons, châtelain du Puiset. Les relations de Gui avec la famille des vicomtes d'Etampes sont établies par un passage de la Chronique de Morigny où il est 46. - « III Non. Marcii. Obiit Roscelinus pater Alberti abbatis et Tescelini canonici, et Leoisa mater eorum, pro animabus quorum ipsi huic ecclesie plurima beneficia contulerunt; prebendam quoque in secularis status usibus a Gilduino canonico diu habitam, in usus fratrum canonice viventium reddiderunt; qui etiam tres quadrantes vinee apud Leugas, ad opus luminarii ecclesie, contulerunt » (Nécrologe de Gui de Lèves, abbé de Saint-Jean-en-Vallée; ms. lat. 991, fol. 3). Letuissa est la forme hypocoristique donnée, dans un récit hagiographique du xre siècle, au nom de Liégarde (Letgardis) de Vermandois, femme de Thibaut le Tricheur, comte de Chartres (DEPOIN, Les premiers anneaux de la maison de Bellême, dans le Bulletin historique et philologique, 1909). 47. - MABILLON, De re diplomatica, 1. VI, p. 589, - 48. - LUCHAIRE, Louis VI le Gros, n. 53. |00000138| 86 ainsi désigné : « Guido vicecomes Stampensium, filius magni Hugonis domini Puteoli, sortitus uxorem filiam Marchi, Stampensis vicecomitis, unde sibi vicecomitatus accidit » (49). Une charte de Marmoutier nous apprend que la femme de Gui se nommait Liesse (Lætitia) et qu'ils eurent plusieurs enfants, dont deux fils, Hugues et Ebrard, relevant les prénoms habituels des châtelains du Puiset (50). Liesse est donc le nom de la fille du vicomte Marc d'Etampes; elle hérita de son frère Hervé, mort sans enfants. Gui, dans sa jeunesse, avait été chanoine de Chartres (51), mais il jeta le froc, refugus et clericalis militiæ desertor, comme l'écrit au Pape, peu après, le grand évêque Ives (52). Du chef de sa femme, il devint seigneur de Méréville, et il est connu sous ce nom dans une série d'actes. Il hérita aussi de Villepreux, l'apanage de son frère Galeran, mort en Palestine en 1124 (53). Lorsque, en 1106, Hugues II, vicomte de Chartres et châtelain du Puiset pendant la minorité de son neveu Hugues III, quitta cette charge temporaire pour suivre en Terre Sainte Bohémond Ier, prince d'Antioche, venu en France pour y recruter de nouveaux Croisés, il fallut chercher au jeune héritier un nouveau tuteur; c'est alors que Gui, frère cadet d'Ebrard III, de Hugues II et de Galeran, quitta l'aumusse pour la cuirasse (54). Son premier soin durant l'administration qui lui était confiée pour un laps de temps assez court, fut de chercher à s'enrichir aux dépens de l'Eglise. Ives de Chartres fait de ses déprédations, auxquelles n'échappèrent pas les terres de ce même chapitre que Gui venait de quitter, un tableau lamentable dans une lettre à Pascal II; il sollicite le Pape de confirmer l'excommunication lancée par lui contre le châtelain du Puiset, et d'en imposer la promulgation à l'archevêque de Sens, aux évêques 49. DUCHESNE, IV, 365. La même Chronique (ibid. 372) qualifie Gui«< cognatus Guidonis de Rupeforti ». La femme de Hugues Blavons, mère de Gui, était fille de Gui le Grand de Montlhéry; Gui du Puiset était ainsi parent du comte de Rochefort du côté maternel, par la Cognatio, suivant le terme juridique. 50. Ms. lat. 5441, p. 436. - SI. Il souscrit en cette qualité à un acte de l'an 1100 (E. DE l'EPINOIS et Lucien MERLET, Cartulaire de Notre-Dame-de-Chartres, I, 1º 24). 52. BOUQUET, Recueil des Historiens de France, XV, 148. La date de 1109 donnée à cetre épître d'Ives doit être reculée, car il attaque Gui comme châtelain du Puiset (Guido Puteacensis) et Gui perdit ce titre dès 1109. -― - 53. ORDERIC VITAL, 1. XI, c. 14. 54. A. de DION, Le Puiset, pp. 20-23. - |00000139| 87 d'Orléans et de Paris. Hugues III ayant été mis, dès 1109 (55), en possession des honneurs paternels, toutes ces poursuites vinrent à tomber. Gui de Méréville entra au service de Louis VI; on l'aperçoit dans la suite du roi, en 1111 à Etampes (56), en 1113 à Pithiviers (57) ; en 1129, par une disposition testamentaire, en présence et avec l'assentiment de sa femme Liesse, de ses fils Hugues, Ebrard et Galeran, il abandonne aux moines de Tiron la dîme d'un moulin (58). Parmi les témoins se trouve un Rainaud d'Etampes (Raginaudus de Stampis). En 1144 Louis VII approuva la cession faite à l'abbé Suger de Saint-Denis par Hugues vassal de la Couronne, au château de Méréville (Hugo homo nosier, de castro quod dicitur Meravilla), des droits dont il jouissait à Monnerville (59). Une charte de Bonneval donne de très intéressants et très complets détails sur la famille du fils aîné de Gui du Puiset. On y voit qu'Ebrard, fils de Hugues, étant mort en la fête de saint Barthélemi, son père conduisit sa dépouille au monastère de Bonneval, où on l'inhuma dans le cloître. En proie à la plus profonde douleur, le sire de Méréville conduisit le deuil; ses sanglots et ses gémissements ne cessèrent d'émouvoir l'assistance durant toute la cérémonie funèbre; sur la tombe de son fils, il affranchit solennellement un serf attaché sans doute à la personne du défunt et le consacra, lui et toute sa postérité, au service du monastère. Tous les siens l'approuvèrent: Helisende sa femme; Gui II son fils aîné, Hildeburge sa bru et leur fils Hugues ; les autres frères du jeune Ebrard, Hugues, Gilbert et Jehan; ce dernier fut d'église (60). 55. Le 18 septembre 1109, Gui se trouve avec la comtesse Adèle, à Etampes, lorsqu'elle se réconcilie avec l'abbé de Bonneval; il ne prend plus alors que le surnom de Gui de Méréville (Ms. lat. 17139, fol. 104). — – 56. Coll. MOREAU, XLVI, 44 (Wido Puteacensis). 57. — Ib. XLVII, 17 (Wido de Merulavilla). - 58. - “ ―――――――― - - LUCIEN MERLET (Cartulaire de Tiron, I, 131) lisant dans le texte corrompu Guido de Monevilla, a supposé qu'il s'agissait d'un seigneur de Moigneville. 59. Archives nationales K 23, n. 9; fragment de diplôme. 60. Voici le texte de ce document: - Hugo dominus Mereville quemdam Guillelmum quem sub jugo capitalis servitii diu tenuerat, Sancto Petro et martyribus Bonevallis donavit, pro anima Ebrardi filii sui, qui in festo Sancti Bartholomei defunctus est, et in claustro monachorum sepultus. Ipse quidem Hugo, inter planctus et lacrimabiles gemitus que in filii funere fundebantur, Guillelmum istum, super tumbam defuncti, de jugo servitutis, omnique exactione, liberavit, et super altare S. Petri obtulit, eumque et omnem ejus progeniem SS. Martyrum Bonnevallensium servitio delegavit. Hoc concessit Helis endis uxor Hugonis, et Guido, et Hildeburgis uxor |00000140| - 88 — M. le comte Ad. de Dion ayant constaté le passage de la seigneurie de Méréville, dès 1209, aux mains d'Ourson ou Orson, chambrier du roi, en avait conclu que celui-ci appartenait à la famille de Nemours et devait être gendre d'un seigneur de Méréville de la maison du Puiset (61). Dans ses Recherches généalogiques sur la famille des Seigneurs de Nemours, œuvre aussi consciencieuse que puissamment documentée et qui peut être donnée comme un modèle à suivre, M. Emile Richemond, sans avoir connu le travail de M. de Dion, est arrivé aux mêmes conclusions. Il a, tout d'abord, clairement établi qu'Orson Ier de Méréville est le second fils de Gautier de Villebéon, sire de Nemours, chambellan de Philippe Auguste. Aucun doute n'est possible à cet égard depuis la publication par M. Richemond d'un diplôme inédit de Philippe Auguste (62) approuvant le partage fait par Gautier de Nemours entre ses trois fils survivants et l'héritier de son fils aîné, en 1198, de toutes ses terres et seigneuries. L'acte royal s'exprime ainsi : « Hec erit pars Ursionis camerarii nostri. Ursio habebit Merevillam et omnes acquisitiones quas Galterus pater suus fecit in Castellania Mereville… » Gautier avait donc acquis personnellement la châtellenie de Méréville. Ce point semblerait faire échec à la conclusion de M. Richemond qui, ayant observé que la femme d'Orson se nomme Liesse, la considère naturellement comme la petite-fille de Liesse d'Etampes. Orson héritant Méréville de son père, ne l'a pas eu du chef de sa femme. Mais M. Richemond a trouvé une ingénieuse solution: «Si le chambellan Gautier s'est rendu acquéreur de la Vicomté de Méréville entre 1186 et 1190 et l'a donnée en partage à son fils Orson, c'est probablement en raison du mariage de ce dernier avec la fille de Gui II du Puiset » (63). Il est possible de simplifier encore les choses, et d'admettre que Hugues II, fils de Gui II, étant mort sans enfants après 1186, le roi concéda Méréville - Guidonis, et Hugo filius ipsorum ; et Hugo et Gillebertus et Johannes. Testes: Gaulenus de Mosteriolo, Ricardus Harens, Adam Prunellus, Simon de Larderiis (Laredoire ?) Gilo de Tuschis, Renaudus de Bailol, Rudulfus prepositus, Bonardus de Sancto Petro, Paganus prepositus, Robertus Maugerus ». (De VERNINAC, Mémoires, t. III, p. 52. Biblioth. d'Orléans, ms. 394³, fol. 52). 61. Ad. DE DION, les Seigneurs de Breteuil en Beauvaisis, p. 49; Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile de France, t. X (1883). 62. Annales de la Société hist. du Gâtinais, 1906. 1906, in 8°. 63. Tirage à part, Fontainebleau, Recherches sur… les Seigneurs de Nemours, II, 17. - - |00000141| 89 ――― à son chambellan à l'occasion du mariage convenu entre le jeune fils de Gautier et Liesse, petite-fille de Gui Ier. Il faut bien admettre que celle-ci était sœur de Hugues II, car autrement les autres enfants de Gui Ier ou leurs descendants auraient primé les droits de Liesse. Il existait notamment toute une branche de seigneurs de Villepreux, issus d'Ebrard IV, second fils de Gui Ier de Méréville. Ebrard, devenu seigneur de Villepreux après la mort de son père (64), saisit les bœufs du prieuré de Saint-Nicolas dépendant de Marmoutier, et qui avait alors à sa tête Etienne Loherain (Stephanus Loherengus prior). Il épousa Julienne héritière de deux frères, Ernaud III et Hugues, châtelains de la Ferté-Arnaud, et mourut, d'après M. de Dion, en 1169. Son fils, Ernaud IV de la Ferté, épousa, suivant le même auteur, Alice (Aélis) nièce de Milon, archidiacre de Chartres. Milon appartenait à la famille de Lèves, il était neveu de l'évêque de Chartres Geofroi II (65). Ernaud IV de la Ferté ayant eu une fille du nom de Mabile, il est à croire que sa femme Aélis eut pour père Milon de Lèves mort en 1167, pour mère Mabile et pour frère Geofroi, sire de Lèves, cités dans une charte de Josaphat (66). Des trois fils d'Ernaud IV, Ernaud V, Guillaume II de la Ferté et Ebrard V, les deux derniers portèrent le surnom de Villepreux, comme le montrent leurs sceaux décrits par M. de Dion. Ce fait corrobore l'hypothèse séduisante de M. Richemond, d'après laquelle Hugues de Dugny qualifié avunculus de Liesse, femme d'Orson de Nemours-Méréville, dans un texte important, n'est autre que le frère cadet de Gui II. En effet, un successeur de Hugues dans la seigneurie de Dugny (67), - Geofroi, qui en 1206 donna au couvent d'Yerres sa part dans le péage de Brunoy, est surnommé indifféremment de Dugny ou de Villepreux (68). Rappelons enfin qu'un troisième fils de Gui Ier du Puiset et de Liesse d'Etampes fut Hervé, abbé de Marmoutier de 1178 à 1186 (69). Il relevait le prénom porté par le vicomte Hervé, frère de Liesse. 64. Ms. lat. 5441, fol. 436. Gui hérita Villepreux de son frère Galeran, auquel il survécut ; ce n'est donc pas Ebrard qui succéda à son oncle, comme l'a cru M. de Dion. (Les Seigneurs de Breteuil, p. 49). 65. Ms. lat. 10102, n. 129. Milon était fils de Gauslin IV, mort en 1151, et frère de Gauslin V, mort avant son père en 1145. Cartulaire de Josaphat. Ms. lat. 10103, n. 105. 66. 67. 68. 69. - - - - - Canton d'Aubervilliers (Seine). RICHEMOND, ouvr. cité, p. 16, note 1. A. DE DION, Le Puiset, p. 31. 1909. - II. 7 |00000142| — 90 LA FAMILLE DE MENIER D'ETAMPES. Notre étude sur les Vicomtes de Corbeil contient un chapitre consacré à Gautier d'Etampes, à qui sa femme Adèle, fille de Hugues et sœur de Gui Payen, seigneur de Palaiseau, avait apporté en dot la moitié de la dîme d'Orsonville. Le Liber Testamentorum enregistre la cession de cette part de dîme à Saint-Martin-des-Champs par Gautier, Adèle et leurs deux fils, Pierre et Anseau (70). Le rescrit de 1106 établit la filiation des descendants d'Anseau : il est adressé « Pagano Anselli filio; Johanni ejus filio; Alberto, ejusdem Pagani fratri, Manerio ejus filio » (5). Aubert I (Albertus Anselli filius) est mentionné à Etampes en 1082 avec Thion II et Berneuil I (22) et avec un de ses propres frères, Robert (Robertus Anselli filius). L'étude précitée donne le véritable nom de Payen, fils d'Anseau il se nommait Isembard; d'une première union, il laissa Jehan, cité avec lui en 1112 dans l'entourage de Louis VI à Etampes, et marié depuis avec Eustachie de Châtillon; d'une seconde femme, Aélis fille de Gandri de Corbeil, il eut Anseau, Ferri et Geofroi, copropriétaires du domaine de Manterville avec leurs deux cousins. Ménier et Gui, fils d'Aubert (71). Sous Etienne, abbé de Saint-Jean-en-Vallée, qui mourut en 1130, ce monastère reçut le don de 40 arpens de terre in villa dicta Albereth (72) qui fut approuvé par Mainerius et Guido de Stampis, fratres, de quorum feodo erat». Mahaud, femme de Menier, et leurs enfants Simon, Aubert II et Hélisende y consentirent (73). Sur la descendance de Menier d'Etampes, ce chapitre apportera quelques éclaircissements. - IV Aubert II, fils de Menier, fut père de Gui II, dont la filiation est attestée par une charte de Geofroi II de Lèves, évêque de Chartres, datée de 1147, d'après ce synchronisme : « quando domnus Ludovicus, rex Francorum, consilium tenuit pro disponenda regni sui 70. 71. Coll. MOREAU, XLVII, 58. My - Liber Testamentorum, n. XL, p. 52. 72. Faut-il identifier ce lieu avec Aubray, hameau de Merobert (canton de Dourdan sud), ou n'y a-t-il dans cette graphie qu'une déformation d'Alvers, Auvers-Saint-Georges? 73. DEPOIN, Les Vicomtes de Corbeil, p. 58. |00000143| — – 91 tranquillitate, quam inviolatam conservari praeoptabat, dum in Jerusalem peregrinaretur». Le prélat fait savoir que Gui, fils d'Aubert, pour l'amour de Dieu et de lui Geofroi, a abandonné le droit féodal qu'il avait sur un bien cédé à Josaphat (74) par les fils de Vital de Chalou. Gui est alors veuf, car l'acte ne dit pas un mot de sa femme ; mais il a deux enfants, Richard et Aélis, qui, en signe d'assentiment, baisent l'anneau épiscopal et reçoivent chacun du prélat douze deniers, « Hec concesserunt liberi Guidonis, Ricardus et Aaliz qui pro recognitione osculati sunt annulum nostrum, et dedi unicuique XII denarios ». L'évêque assisté de Robert, doyen de son chapitre, se trouve alors à Etampes, dans l'hôtel de Barthélemi Le Riche, (apud Stampas in domo Bartholomei Divitis) où sont réunis Geudoin, abbé de Clairefontaine (au diocèse de Soissons); Gautier, chevecier d'Etampes; Gauslin le Vieux de Lèves; Gauslin de Méréville; le Chambellan Roscelin (sans doute un descendant du vicomte d'Etampes); Anseaume du Puiset ; Guerri Baise-Diable (Guerricus Basiat-Diabolum). Gui II perdit peu après son fils; il ne lui resta qu'Aélis, qui se maria. Il est appelé Guido filius Auberti de Stampis dans un état dressé en 1162, des bienfaiteurs de l'abbaye de Cernay fondée en 1118: Concedente filia sua Adelina et genero, dedit vineas quas habebat apud Estreichun (certainement Etrechy), et hoc per manum LUDOVICI regis Francorum » (75). - Barthelemi Le Riche d'Etampes, chez qui se rencontrent l'évêque de Chartres et Gui II d'Etampes, eut pour femme Hélisende, dans laquelle on reconnaît la sœur d'Aubert II. Nous lui connaissons quatre fils: Jehan, Garsieu (Garsilius), Ferri, Gui et trois filles mariées l'une à Jehan, l'autre à Bernaud, la troisième à Conrad d'Ardenne (Caradus de Ardana) (76). L'une de ces filles se nommait Fauque, et probablement l'autre Mahaud. - 74. Ob Dei nostrumque amore, et per manum nostram dedit monachis Josaphat feodum quod habebat in terra Ulmelli, quam Ar. Crassus eis dederat (Arraudus aut Arnulfus ?) (Ms. lat. 10102, n. 114). 75. Cartulaire des Vaux de Cernay, t. I, p. 32 et suiv. 76. « Clareat hoc cunctis quod Bartholomeus Dives de Stampis concessit monachis de Josaphat, in atrio Chaloi, ut ex qualibet parte ecclesie domos suas facere potuerint… Helisendis uxor de cujus dote reserat, concessit. Concesserunt etiam Johannes, Garsilius, Ferricus filius ejus. Testes Johannes, Bernaudus generi ejus, et Hugo miles ejus. Petrus - |00000144| 92 Le nom de Garsieu rappelle celui de Garséon (Garsadonius), fils d'Anseau et petit-fils d'Arembert, plusieurs fois cité dans la Chronique de Morigny; il partit pour Jérusalem en 1106 et mourut à Cluse au cours du voyage. Il avait, au départ, engagé à Morigny sa terre de Gommerville près Janville, qui devait revenir aux moines en cas de mort. Aélis, sa mère survivante, « primum monachis benevolentissima, sed postea muliebri levitate mutata », approuva, puis contesta cet accord. Une sœur de Garséon épousa Bernard, fils de Pierre, que la Chronique qualifie « homo profanae mentis ». En lutte avec l'abbaye, il incendia Gommerville, la grange de Maisons près Chartres, et des bâtiments au Touchet, hameau d'Etrechy donné aux moines par Anseau. Gui, comte de Rochefort, était alors en Terre Sainte. Les moines attendirent son retour, le reçurent processionnellement, et l'ayant conduit à Saint-Arnoulden-Iveline, lui exposèrent leurs plaintes. Bernard arrêté fut jugé par Gui, vicomte d'Etampes, et dut se désister de tout recours contre les libéralités de son beau-père. Vers 1128, l'anniversaire d'Anseau et de Garséon fut fondé à Morigny (77). Garsieu, fils de Barthélemi Le Riche, exerça les fonctions de prévôt royal à Etampes; ce ne peut être qu'à ce titre qu'il procéda en 1167 à l'arrestation d'un prêtre du diocèse de Bayeux (78). Garsieu avait succédé à Gaufroi Sauvage (Godefredus Silvaticus, Stampis prefectus), qui assista au don d'une terre à l'abbaye de Tiron par Adam Brochart. « Hoc donum ante regem Galliae qui tunc temporis Stampis aderat, factum est », ajoute la notice, que Lucien Merlet de Brahio… Willelmus capellanus de Chalou. Fauca filia prefati Bartholomei. Mathildis ». (Ms. lat. 10102, fol. 41). Au lieu de filius ejus, dans le texte qui précède, il faut lire filii ejus, ainsi que le prouve une charte en faveur de Josaphat, émanant de Jehan de Chalou, de sa femme Aélis, de ses fils Ansoud et Vital, de ses filles Erembour et Marie, de ses neveux Augier (Oldegarius), Geofroi, Bruneau et Robert, de sa nièce Vilaine, de Guillaume et Audiarde (Oldeardis) enfants de Bruneau ; cette charte dressée en présence de Geofroi II, évêque de Chartres, se termine ainsi : « Bartholomeus Dives concessit… concedentibus filiis suis Johanne, Garsilio, Ferrico. Testes Johannes, Bernaldus, Caradus de Ardana, generi Bartholomei. Guido filius Bartholomei. Guillelmus capellanus… Willelmus de Argentolio. Matheus armiger Garsilii» (Ibid., fol. 41). 77. DUCHESNE, IV, 371-375. 78. Cette arrestation opérée par Garsilius de Stampis donna lieu à une lettre de Hugues, archevêque de Sens, au roi (BOUQUET, Recueil des Historiens de France, XV, 716). W |00000145| 93 - place entre 1131 et 1145 (79) et qui peut se rapporter soit au séjour de Louis VI à Etampes le 3 août 1131, soit à celui qu'y fit Louis VII en 1142, d'après M. Luchaire. Gaufroi Sauvage avait à son tour pour devancier Guillaume (Guillermus prepositus de Stampis) qui en 1085 intervint en faveur de la Maison-Dieu du Vieil-Etampes (80). Ces prévôts ne semblent pas s'être succédé héréditairement ; toutefois le prénom de Guillaume que portait le troisième de ceux qui nous sont connus (81) se retrouve sous le règne de PhilippeAuguste, dans la personne de Guillaume Menier, bailli du roi et châtelain d'Etampes, mort en 1237. Le nom patronymique de ce chevalier rappelle la dynastie issue de Menier, fils d'Aubert. Les quatre familles qui viennent d'être l'objet de notre examen ont-elles eu entre elles une relation d'origine commune? Nous avons exprimé déjà ce sentiment: il se fortifie si l'on compare les prénoms en usage dans ces maisons avec ceux que, dans le second Appendice au Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise, consacré à diverses branches de la famille Le Riche, nous avons rencontrés dans celles où se recrutèrent les bouteillers et les chambellans, sous Henri Ier et Philippe Ier : les rameaux de Senlis et de Clermont. Ces prénoms sont ceux de Rouhaud (Raoul), Gui[hard, Guillaume, Anseau, Aubert, Gaufroi (Geofroi), Gautier, Renaud, Pierre, Jehan, Hervé. Le prénom d'Ougrin, nous l'avons vu, appartient aussi à la famille Le Riche. Il en est de même de celui de Ferri. Dans tous les cas, la présence continuelle de membres d'une des lignées que nous distinguons aux côtés des chefs d'une des autres maisons dans des actes familiaux, constitue une présomption d'alliances antérieures. Puisse cette modeste contribution à un sujet resté jusqu'ici fort obscur, aider de futurs travailleurs à le mieux éclairer un jour. C'est l'unique but que nous poursuivons en dépouillant des notes rassemblées patiemment et pourtant encore fort incomplètes. 79. 80. 81. Cartulaire de Tiron, I, 183. MENAULT, Morigny, p. 39. Avant Guillaume parait un Durand (Durandus praetor Stampensis) en 1067. (Prou, Actes de Philippe Ier, p. 99), et avant Durand un Archambaud bienfaiteur de Notre-Dame d'Etampes sous Robert le Pieux (D. FLEUREAU, p. 293). - J. DEPOIN. |00000146| L'ANCIEN CHATEAU D'ÉTIOLLES EN MIL SEPT CENT Dans un précédent bulletin (1) nous nous sommes occupé du Château d'Etiolles dont la vente venait d'avoir lieu et dont la destruction était décidée. Depuis, nous avons eu l'occasion de rencontrer un terrier-censier de la Commune d'Etiolles, très intéressant pour la topographie de cette commune. Ce terrier remonte à 1700; il a été établi par les ordres du Président de Bailleul, alors Seigneur d'Etiolles. Parmi les nombreuses maisons, terres, vignes etc. qui sont énumérées avec force détails dans ce document, il se trouve aussi des actes de foy et hommage rendus par des propriétaires de fiefs plus ou moins importants, mais toujours situés à Etiolles, et parmi ceux-ci, nous avons relevé le fief de la Grande maison, dont le propriétaire à cette époque était Charles le Normant de Tournehem, celui-là même qui, en 1741, maria son neveu, Charles Guillaume le Normant, à la petite Antoinette Poisson, qui devint alors dame d'Etiolles et, plus tard, Marquise de Pompadour ; et ce fief de la Grande maison n'était autre que le château d'Etiolles qu'habita la belle Marquise. En 1700, Charles le Normant rendant hommage à son suzerain, le Président de Bailleul, donne, comme il y était obligé, le détail de tout ce qui composait son fief de la Grande maison; c'est ainsi qu'il parle de la maison d'habitation et de ses dépendances, et en détaille toutes les parties. Les deux gravures publiées dans notre précédent article montrent ce qu'était le Château d'Etiolles en 1909, c'est-à-dire à l'époque de sa démolition; il est donc intéressant de le comparer avec le châ1. Année 1908, pages 90 à 98, avec deux gravures du Château d'Etiolles. |00000147| - 95 - teau de 1700, dont Charles le Normant a donné la description dans son acte de foy et hommage à M. de Bailleul. C'est le château du xvi siècle comparé avec celui du xxe. Pendant cette période, il est certainement survenu des changements, ne serait-ce que la disparition de la chapelle, indiquée par Charles le Nor mant, et d'autre part, nous savons que le Château qui vient d'être démoli n'était déjà plus celui qui avait été habité par la célèbre Marquise, ou tout au moins avait-il subi bien des modifications. Charles le Normant de Tournehem mourut en 1751, laissant sa fortune et sa terre d'Etiolles à son neveu Charles Guillaume, mari de Mme de Pompadour. Il existe un beau portrait de Le Normant de Tournehem, gravé par Nicolas Dupuis pour sa réception à l'Académie; on y lit la suscription suivante : Messire Charles François Paul le Normant de Tournehem, Conseiller du Roy en ses Conseils, Directeur et ordonnateur général des bâtimens de Sa Majesté, jardins, arts, académies et Manufactures Royales. Une légère erreur s'est glissée dans le précédent article, nous tenons à la rectifier. Nous avons dit, page 91, « le Château d'Etiolles passa dans la famille de Bailleul qui possédait déjà la Seigneurie de Soisy-sous-Etiolles » ; ceci n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas le château d'Etiolles qui passa dans la famille de Bailleul, mais bien la seigneurie d'Etiolles et il y a une distinction à faire entre les mots Château et Seigneurie; M. de Bailleul possédait bien la Seigneurie d'Etiolles, il en était le Seigneur, ce qui lui donnait des droits nombreux de justice, de cens etc. etc. sur toutes les propriétés d'Etiolles, mais s'il possédait le Château de Soisy-sur-Seine (ainsi nommé à cette époque), il n'était pas du tout propriétaire du Château d'Etiolles, puisque celui-ci appartenait à M. le Normant de Tournehem, dont la propriété ne portait pas le titre de Château, mais tout simplement le nom de la Grande maison, tel qu'il est indiqué dans le document que nous reproduisons ci-après. A. D. |00000148| - -96Aujourd'huy, date des présentes, avec et en la compagnie de moy, Nicolas Regnault, notaire royal à Corbeil, en la prévosté et Chastellenie de Corbeil sous signé ; Messire Charles Le Normant escuyer, conseiller du roy maison et couronne de France et de ses finances, seigneur du fief de la Grande maison assis à Estiolles, demeurant à Paris, rue de Torigny, paroisse de Saint Gervais, s'est transporté par devers hault et puissant seigneur Messire Louis de Bailleul, chevalier, marquis de Chasteaugontier, seigneur dudit Estiolles et autres lieux, Conseiller du roy en tous ses Conseils et président à mortier en la court de parlement de Paris, estant à présent en son chasteau de Soisy sur Seine, où estant, et après s'estre le dit sieur Le Normant, mis en debvoir de vassal, comme le requiert la coustume de Paris, Il a dit et déclaré audit seigneur président de Bailleul qu'il lui faisoit et portoit, comme de faict, il luy a faict et porté les foy et hommage et serment de fidélité qu'il est tenu et obligé de luy faire et porter à cause dudit fief de la Grande maison mouvant et relevant en plein fief et à une seule foy et hommage dudit seigneur président de Bailleul, à cause de sadite seigneurie d'Estiolles, lequel fief de la Grande maison consiste en un grand corps de logis et deux pavillons aux deux costez, le tout couvert d'ardoise, et un petit pavillon, aussi couvert d'ardoise, servant d'office, ayant veue sur la basse cour; un autre pavillon, couvert de tuilles, tenant d'une part au grand corps de logis, ayant veue sur le jardin, dont le bas sert de cuisine, une grande court devant ledit corps de logis, à l'entrée de laquelle court est une porte cochère et deux pavillons aux deux costez couverts d'ardoise, une chappelle, une foullerie et pressoir couverts de tuiles; à l'un des costez de ladite court et derrière ladite chappelle, est une maison couverte de tuilles, qui sert de logement au jardinier, à l'autre costé de la dite grande court est une basse court dans laquelle sont plusieurs écuries, bergeries, hangards et remises de carosses, le tout couvert de tuilles et un pavillon couvert d'ardoise qui sert de fourny, et derrière lequel grand corps de logis est un parterre potager, des bois de hauctes fustayes, des prez, vignes, et plusieurs fontaines et allées faisant partie du clos de la dite maison, et jusques à la quantité de cinquante arpens, vingt trois perches, le surplus dudit clos estant en roture, et tenu en censive dudit |00000149| – 97 ―― seigneur président de Bailleul à cause de sa dite seigneurie d'Estiolles, lesdits grand corps de logis, grande court, basse court, chapelle et bastimens et partie dudit clos estant en fief, assis à Estiolles, tenant d'une part à la rue et chemin allant d'Estiolles à la forest de Sénard, d'autre part à la rue qui conduit du Carrefour dudit Estiolles à Coupigny, et à plusieurs vignes et héritages appartenans à divers particuliers, et aux terres dudit seigneur président de Bailleul, abbant d'un bout par devant sur le carrefour d'Estiolles, et d'autre bout par derrière sur le surplus dudit clos; laquelle déclaration cy dessus, ledit sieur Le Normant a employée pour adveu et dénombrement dudit fief de la grande maison; lequel seigneur président de Bailleul, à ce présent, a accepté lesdits foy et hommage, adveu et dénombrement, dont et de tout ce que dessus ledit sieur Le Normant a requis acte, à luy octroyé par moy notaire susnommé et soubzsigné, pour lui servir, et audit seigneur président de Bailleul, en temps et lieu, ce que de raison. Faict et passé audit chasteau de Soisy, ès présences de M. Henry Dupuis, greffier de la justice dudit Soisy, y demeurant, et Louis Tréhet, clerc demeurant à Corbeil, tesmoins, le 25 jour de Septembre mil sept cens un, avant midy. Et ont ledit seigneur président de Bailleul, ledit sieur Le Normant et lesdits témoins signé avec ledit nore, la minutte des présentes, au bas de laquelle est escript : controllé à Corbeil le vingt neufième jour de septembre mil sept cens un, reçu dix sols, signé Bonny (¹). [signé] REGNAUlt. 1. Extrait du terrier-censier d'Etiolles *, établi en 1700-1703, pour Mr le Président de Bailleul, Seigneur d'Etiolles. Ce manuscrit provient de la Bibliothèque de Sir Thomas Philipps à Cheltenham (Angleterre); il est entré depuis peu à la Bibliothèque Nationale, département des mss. où il figure sous le N° 21240, fonds français, nouvelles acquisitions. Pages 142 et suivantes du ms. original. |00000150| L'ARTILLERIE DE CORBEIL AU XVI SIÈCLE (1534) La situation géographique de Corbeil lui donnait autrefois une importance relativement considérable. En effet, placée sur la Seine qu'elle dominait de ses tours et de ses murailles, en amont et à peu de distance de Paris, cette ville était en quelque sorte la clef des vivres de la capitale, honneur sans profits, qu'elle partageait avec Lagny, qui occupait une position analogue sur la Marne; car il suffisait de s'emparer de Corbeil et de Lagny pour affamer les Parisiens, qui se trouvaient ainsi empêchés de recevoir leurs provisions, dont la majeure partie venait de la Bourgogne par la Seine et devait par conséquent passer sous le pont de Corbeil avant d'arriver à Paris. Cet état de choses dura longtemps, il existait encore sous la Fronde; on en trouve la preuve dans le couplet suivant des Triolets du temps qui se chantaient à Paris en 1649: Corbeil sera bien tost repris, Et tout viendra par la rivière. Qu'on ne craigne point dans Paris, Corbeil sera bien tost repris; On aura de tout à bon prix, Et nous ferons tous chère entière, Corbeil sera bien tost repris Et tout viendra par la rivière. |00000151| 99 L'on voit donc que les épreuves sans nombre et les sièges répétés que notre malheureuse petite ville a subis étaient la triste preuve de sa dangereuse situation. Dans ces conditions, les habitants de Corbeil devaient pourvoir à sa sûreté ; ils y étaient d'ailleurs fréquemment invités par des lettres royales, encore conservées aujourd'hui dans les Archives de la ville, qui recommandaient aux manans et habitans de faire bonne garde et leur signalaient les dangers qui pouvaient les menacer. Ils étaient donc armés, mais les armes étaient la propriété de la ville qui en faisait la répartition entre les habitants dans les moments de trouble et de danger. Mais il vint un temps où la ville n'eut plus à se défendre par ellemême, elle songea alors à se débarrasser d'une artillerie ancienne qui était plus que démodée ; divers papiers des archives de la ville nous renseignent à ce sujet. Une première note nous apprend qu'en 1749 les Echevins obtinrent la permission de vendre sept canons qui restaient de toute l'artillerie qu'avait possédée la ville de Corbeil. Mais alors le Duc de Villeroy, faisant valoir sa qualité de Seigneur-Engagiste de Corbeil et de sa Chatellenie, réclama ces canons ; il obtint un ordre du Roy qui lui permit de les enlever du château de Corbeil où ils se trouvaient et de les transporter à son château de Villeroy, ce qui eut lieu en 1750. Une autre note portant la date du 28 juillet 1789, dit encore: « M. le Duc de Villeroy envoye trois députés aux officiers municipaux de la ville de Corbeil et au Comité alors établi pour traiter des affaires communes de la dite ville pendant les troubles dans le Royaume, à l'occasion de la tenue des états généraux, les dits députés chargés d'offrir à la ville les sept canons que feu M. le Maréchal de Villeroy, son oncle, avait fait transporter à Villeroy en l'année 1750 ». Ces faits sont longuement rapportés dans les registres municipaux de la ville de Corbeil; celle-ci accepta, avec quelques réserves concernant la propriété de ces pièces, de reprendre ces sept canons de bronze qui pesaient ensemble 812 livres. Que devinrent-ils plus tard, nous n'en avons trouvé aucune trace, mais il est bien probable, à cette époque où l'on fondait les cloches pour en faire des canons, que le gouvernement n'aura pas manqué de les reprendre. Mais plus tard, Corbeil posséda encore des canons, ce fut en 1830, |00000152| - - 100 quand on réorganisa la garde nationale; celle-ci fut composée de diverses compagnies, grenadiers, chasseurs et artilleurs; à ces derniers il fallut des canons, et le gouvernement de Louis-Philippe accorda à Corbeil deux pièces de 4, c'est ainsi qu'elles étaient dénommées. Les artilleurs s'en servaient dans les fêtes publiques pour tirer des salves, à la fête du Roi, aux glorieuses (anniversaire de juillet 1830) etc.; elles paradaient dans les revues, mais heureusement elles ne furent jamais meurtrières. A la dissolution des gardes nationales (1871) elles retournèrent à Vincennes, d'où elles étaient venues, et l'on n'en entendit plus parler. Ce fut la fin de l'artillerie de Corbeil. Après cette disgression sur l'artillerie moderne de notre ville, revenons à l'ancienne qui fait l'objet de la présente notice. En outre des armes portatives, Corbeil possédait une artillerie dont il est intéressant de connaître l'importance, à une époque où, comme la plupart des petites villes, elle était abandonnée à ellemême, sans garnison le plus souvent, et n'ayant pour défendre ses murailles, que sa compagnie d'arquebusiers aidés de quelques bourgeois. Nous possédons des détails sur l'artillerie de Corbeil au commencement du xvIe siècle, grâce à un curieux document conservé dans les Archives de la ville; c'est un inventaire, dressé en 1534, des pièces et artillerye et autres ustancilles trouvez ès tours… etc. Ce document, dont on trouvera le texte ci-après, est écrit sur trois morceaux de parchemin cousus l'un au bout de l'autre et formant une longueur totale de 142. Il est probable que cet inventaire a été fait plus spécialement pour l'artillerie et que les autres armes, telles que haquebutes, pistoles, arbalestes, etc., se trouvaient déposées dans d'autres locaux. Notre document paraît en effet n'avoir inventorié que la tour de la bonde Saint-Nicolas, située près de la porte de ce nom et de la maison commune, ou hôtel de ville, qui en était aussi très rapproché ('). Et cependant Corbeil possédait plusieurs autres tours qui défenI. - La maison commune, ou Hôtel de ville en style moderne, était située place de l'Arquebuse; elle a été détruite vers 1875, il n'en reste qu'une petite tourelle assez élégante, que le dernier propriétaire, M. Laroche, a eu le bon esprit de conserver et de restaurer. La porte Saint-Nicolas était à quelques mètres de la maison commune, et tout près de cette porte se trouvait une fortification importante qui se prolongeait jusqu'à la Seine: c'était la bonde Saint-Nicolas dont la tour, citée dans notre inventaire, servait de magasin pour les armes de la ville. |00000153| - IOI ―― daient ses trois portes (¹) sans compter la grosse tour du château (¹), que de la Barre, notre historien, appelle la tour de Corbulo (3), et encore la tour du Hourdy (4), qui servait de donjon à la forteresse qui se trouvait sur la rive droite de la Seine, à l'entrée du pont, défendant ainsi les approches du fleuve et de la ville. En terminant cette introduction, nous tenons à faire remarquer que si l'inventaire que l'on va lire porte la date de 1534, les pièces d'artillerie et autres objets qui y sont indiqués remontent certainement à une époque plus reculée, ainsi que le prouvent les mots à la mode ancienne plusieurs fois répétés dans ce curieux document. A. D. Inventaire faict par moy Jehan Lebergier, bachellier en loix, tabellion juré et estably de par le Roy nostre Sire en la ville, Prévosté et Chastellenye de Corbueil le mardi douziesme jour de may l'an mil cinq cens trente quatre, à la requeste de honneste personne Jacques de la Ruelle, marchant espicier, au nom et comme procureur des manans et habitans de la ville de Corbueil, des pièces et artilleries et autres ustancilles trouvez és tours et hostels cy après nommez, en la présence de honnestes personnes Jehan le Paige, Controulleur des deniers communs de la dicte ville, Spire Berry et Estienne Garnier, gouverneur de la dicte ville, et aussi ès présence de Guillaume Villain et Jehan Viellard, appellez pour tesmoings, et a esté proceddé audict inventaire ainsi qu'il s'enssuyt : Et premièrement. En la tour de la bonde de la porte Saint-Nicollas (5), sur la rivière de Seyne, au bas estaige, a esté trouvé deux pièces d'artilleries enfuttées de boys à la mode ancienne, les dictes pièces de fer garnys de leurs chambres, dont l'une a deux aigneaulx par dessus et l'aultre sans aigneaulx, l'une de trois piedz de longueur et demy pied de gueulle, et l'aultre de pied et demy de longueur et ung dour (6) de gueulle. Au second estaige, ung aultre pièce d'artillerie sans aneaulx, de pareille sorte, I. - La porte Saint-Nicolas, la porte Parisis ou de Paris et la porte de Brie qui s'ouvrait sur le grand pont. 2.- Cette tour était le Donjon du Château Royal bâti par Louis VI; elle a existé jusqu'à ces dernières années, mais les travaux entrepris par les Grands moulins viennent de la faire disparaître. Malgré une campagne entreprise pour sa conservation et des démarches sans nombre, il n'a pas été possible de la sauver. - 3. Les Antiquités de la ville, Comté et Chatelenie de Corbeil, par Jean de la Barre, cy-devant prévost de Corbeil, Paris, 1647, in 4°.. 260. — Ibid., p. 4. 5. La tour de la Bonde, qui baignait sa base dans la Seine, dépendait des fortifications de la porte Saint-Nicolas. 6. Le dour était la subdivision d'une ancienne mesure de longueur, en usage dans la partie sud de l'Ile de France. - - |00000154| ――― 102 enfuttée et garnye de charge, estant de deux piedz et demy de long sans ladicte charge et pardedans d'un dour de gueulle ou environ. En l'hostel de la ville, à la porte Sainct-Nicollas, à la première chambre basse, a esté trouvé une pièce d'artillerye, enfuttée de pareille sorte, de trois piedz de long ou environ sans ladicte charge et pardedans de demy pied d'ouverture. En l'autre chambre joignant la dicte première chambre, six grosses pièces de pareille sorte, enfuttez de leurs boys et garnys de leurs chambres et charges, l'une de trois piedz de longueur ou environ sans la charge et de ouverture de gueulle de six poulces ou environ, une aultre de deux piedz et demy de long et de sept poulces d'ouverture, les quatre autres de chacune deux piedz et demy de long ou environ, et d'ouverture deux de chacune cinq poulces et les deux autres de chacune quatre poulces et plus. Item, six aultres pièces en manière de faulconneaulx, enfuttez et garnys de leurs charges et chambres, dont deux de chacune quatre piedz de longueur sans la charge, et de ouverture de chacune deux poulces, et les quatre aultres de trois pieds de longueur ou environ sans la charge, et de ouverture trois des dictes pièces de chacune trois poulces et l'aultre de deux poulces. Item, deux menoires à mener les dictes pièces, telles quelles, et huict pièces de aultre vielz boys. Item, quatre aultres pièces d'artillerye d'environ vingt poulces de longueur, le feust d'icelle rompu, et garnys de leurs charges. En la chambre d'en hault dudict hostel a esté trouvé en chausse-trappes (1) de fer vingt sept livres pesant. Item, trois pièces d'artillerye non enfustez, appelez mortiers, dont deux de chacun deux piedz de longueur ou environ et l'aultre de pied et demy de longueur ou environ, et de ouverture de gueulle, l'une de sept poulces ou environ, et les deux aultres de cinq poulces de ouverture ou environ. Item, quatre haquebuttes (2) à crochet, dont deux grandes, une petite et l'aultre rompue. Item, une aultre pièce d'artillerye de fer, de trois piedz de longueur ou environ. Item, quatre salades de fer (3). Item, trois brigandines (4) à la mode ancienne, telles quelles. Item, trois lanternes de fer. Item, deux arbalestres garnys de leurs arcs en façon de carreaulx, l'une garnye de bandage sans carreaulx, telz quelz. Item, quatre caques dont trois plains de pouldre à canon et l'aultre où il y a environ demy pied pareillement. I. - Les chausse-trappes étaient des petites pièces de fer garnies de pointes aiguës que l'on jetait sur les chemins et dans les gués pour blesser les hommes et les chevaux. 2. Haquebute ou hacquebutte, nom primitif de l'arquebuse, il y avait diverses variétés de hacquebuttes ou arquebuses, à croc, à rouet, à crochet. 3. La salade était une sorte de casque qui fut en usage au xv et au xvr siècles. La brigandine était une cuirasse formée de lames de fer, clouées les unes à côté des autres. 4. - - |00000155| - 103 Item, ung coffre ferré auquel y a ung bary en fer, dedans lequel y a environ un tiers plain d'esmorc avecques ung sac de cuyr dedans lequel y a environ trois livres desmorc (1). Item, trois casses de boys plaines de trects à arbalestres, ferrés à trois quierres (2) empennez de boys, avecques deux aultres vielles casses, où y a quelque quantité de vielz trects. Item, trois verges de fer servant à porter banieres, l'une de sept à huict piedz de long et les deux aultres de cinq piedz ou environ. Item, trente deux gros bouletz de plomb, de chacune (sic) la grosseur d'une plotte ou environ, et quarante quatre petitz bouletz, dont vingt huit de grosseur de noys, et le surplus plus petitz, et dix sept aultres petits bouletz servant à petites haquebuttes. Item, en plomb a esté trouvé deux cens cinquantes livres, quatorze onces pesant, comprins deux pièces où y a quelque quantité de fer qui ont servy à la porte Parisis. Au garnier a esté trouvé trois roues ferrées. En une petite chambrette estant en l'auditoire (3) dudict Corbueil, où y a ung coffre fermant à deux clefz, qui sert à mettre les comptes et lectres de la ville, a esté trouvé deux chesnes de fer qui souloient servir au pont levys de la porte Parisis, deux torillons, quatre bandes de fer qui ont servy à ung pont levys, une serrure, un gros coireau (4) et aultre ferraille. Item, deux banières, en l'une desquelles y a l'escuçon de france d'un costé, et de l'aultre costé l'escuçon moyctié de france et du Dauphin, et l'aultre d'un costé de France et de l'aultre costé my party de France et de Bretaigne (5). Au boulevart de la fosse Saint-Guenault a esté trouvé une pièce d'artillerye enfuttée de deux piedz de longueur ou environ sans la chambre et de quatre poulces et demy de gueulles. Faict les an et jour dessus dictz. Signé: J. LEBERGier (6). I. - Vieux mot qui signifie amorces. 2. 3. 4. 5. Ces bannières avaient dû servir en 1519 lors de l'entrée à Corbeil de François Ier, accompagné de Claude de France, sa femme, du chef de laquelle il tenait la Bretagne, de Louise de Savoie, sa mère, et du Dauphin. Ils passèrent plusieurs jours à Corbeil et assistèrent, le 6 août, suivis d'une nombreuse et brillante cour, à une procession générale et solennelle des reliques célèbres de l'église collégiale de Saint-Spire. - Quierre, vieux mot qui signifie coin, angle. Le tribunal en ce temps-là se nommait l'auditoire. Ceinture, courroie. – 6. — Jean Lebergier fut plus tard Prévôt de Corbeil. En faisant des fouilles sur l'emplacement de l'ancien hôtel de ville, les ouvriers mirent au jour des objets divers en fer, chaînes, clefs, etc, et une grosse pièce de fonte ayant la forme d'une culasse de canon, munie d'une anse avec feuillure et lumière. C'était en effet la moitié d'un canon primitif remontant à l'origine des armes à feu, et bien conforme à la description des canons citée dans l'inventaire qu'on vient de lire; il est même très probable que ce canon est l'un de ceux que l'inventaire de 1534 a décrits. Ce curieux débris de l'artillerie de Corbeil au moyen áge a été offert, par M. Laroche, au Musée Saint-jean, où il est souvent remarqué par les amateurs d'armes anciennes. |00000156| LES SŒURS AUGUSTINES A CORBEIL (1643-1792). (SUITE) ¹. Extrait du Registre des Délibérations du Directoire du Département de Seine-et-Oise, du vingt huit may, mil sept cent quatre vingt onze. Vû par le Directoire du Département l'avis de MM. les Commissaires aux fonctions Directoriales du District de Corbeil du vingt may présent mois, ci dessus et des autres parts. Vû les pièces y mentionnées. Ouî M. le Procureur général Sindic en ses conclusions. Le Directoire du Département considérant que la Loy du dixsept avril dernier porte que toutes personnes chargées d'une fonction publique pour L'instruction de la jeunesse seront tenues de prêtter le Serment prescrit par les Lois des vingt six décembre et vingt deux mars dernier, et que faute par elles de le faire, elles ne pourront continuer aucunes des fonctions dont elles étaient chargées, déclare que les dites religieuses de la congrégation de notre-Dame de Corbeil, qui ont toutes signé leur refus de se soumettre à la loi du Clergé et de prêtter le Serment imposé à tous les fonctionnaires publics, notamment par la Loi du dix-sept avril dernier, cesseront toutes fonctions relatives à l'Education publique, que la maison servant aux dites Ecoles, sera remise à la disposition de la municipalité, et que toute communication avec le couvent 1. Voir, 1er Bulletin de 1909, la pièce qui y est citée à la page 61 et qui porte la date de janvier 1793, tandis que celle que nous donnons aujourd'hui est datée du 28 mai 1791; celle-ci, beaucoup plus importante, aurait dû être publiée la première; notre excuse est que la découverte de ce document de 1791 est toute récente. |00000157| 105 sera fermée ; que la municipalité établira provisoirement deux maîtresses pour continuer l'instruction publique des enfants et fera tous réglemens nécessaires pour la police des dites Ecoles, que la maison des dites Religieuses demeurera fermée au public pour les offices, et que le Chapelain des dites religieuses, qui a également refusé de se soumettre à la Loi en prettant le Serment, cessera d'exercer toutes fonctions publiques. A l'égard du traitement à fixer aux maitresses qui seront établies par la Municipalité, le Directoire, avant de statuer sur le taux d'icelui, ainsi que sur les fonds qui seront destinés à les acquitter, arrête, que le District se fera remettre un état exact du revenu de ladite maison, du nombre des Religieuses et des Sœurs, ainsi que des charges dont elles peuvent être grevées, le quel état sera envoyé au Département avec son avis. Signé : Durand; Belin; Cherou; Rouveau ; Huet; le Flamand; Viée, président; Challau, procureur général sindic; Boquet, Secrétaire général. Il est ainsi audit Registre, signé Chovot, vice-secrétaire Général. Pour copie conforme, 1909. II. - LEBAULT Secrétaire du District. 8 |00000158| ORIGINE ET EXPLICATION D'UNE TAPISSERIE DU XVI SIÈCLE Il ne reste d'autres vestiges de la célèbre abbaye royale de SaintVictor-lès-Paris, si longtemps féconde en hommes éminents par leur piété ou par leur savoir, que le nom porté par la rue sur laquelle ce monastère, dont on connaît encore l'emplacement, avait son entrée principale. Quantité d'objets précieux, souvent faits ou donnés par la maison royale de France, y étaient conservés; de ce nombre fut la tapisserie qui nous occupe. Avant que le souffle des révolutions ait dispersé ou détruit ces richesses, déjà ce curieux parement d'autel, brodé en soie, or et argent, sur velours noir, en avait été distrait. Il représente la cérémonie des obsèques des chanoines réguliers de cette célèbre congrégation. Cette tapisserie est de la fin du xv° siècle ou du commencement du xvie; elle est passée de Saint-Victor, on ne sait à quelle époque, dans l'église du prieuré-cure de Saint-Guenault, à Corbeil. Il est vrai que ce bénéfice dépendait de cette abbaye. Nous la trouvons ensuite dans l'église paroissiale de Saint-Spire, en la même ville. Elle lui fut donnée en 1795, par un ecclésiastique qui en appréciait le mérite; il l'avait sauvée du naufrage. On nous saura gré de le nommer. M. l'abbé Guiot, ancien chanoine régulier de Saint-Victor, fut à ce titre, pourvu en 1785, du prieuré-cure de Saint-Guenault et d'un canonicat dans l'église collégiale de Saint-Spire. Il eut beaucoup à souffrir (¹) durant les mauvais jours, et, plus tard, il fut chargé (1) Voir notre Bulletin de 1897, page 28 à 46; Une autobiographie, l'Abbé J.-A. Guyot, 1739-1807. |00000159| ANCIEN PAREMENT D'AUTEL A LABB.R.DE S. VICTOR DE PARIS Brode on Soie Or et argent sur Velours noir, representant les Obseques des Chanoines Réguliers de celle Congrégation Celle Stromate provenant de S.Victor del an Prieuré de S. Genault a Carbon Is Cord out porte para Pritres of a Diacres in Poles cendres somos de Croix rouges: Officiant et Table Régulier de l'Ordre avant les Comandes Le Clarge on habit de Chaur prente dos from Comers aveo das flambeaux of sun d'un groupe formant le del que mene lo Surples a la romaine, dumans ur la tête, Plages au bas des aubos, &c. on croit que cet (bete donnée par le dernier Titulaire à l'a aujourdes Parale de S. Spire, dant it de Cure lors du rétablissement du Cute Catholique Remain on 1795 de Univers, comp de Chartreux Celestins et autres Docteurs & Religi affilies a S.Viterbe est Jean Bordier, qui fit construire vers 1520 la nouvelle Rat ate vers 1800. |00000160| |00000161| 107 de rétablir le culte paroissial à Saint-Spire. C'est alors qu'il fit don à cette église, dépourvue des objets les plus nécessaires au culte, de ce parement d'autel. Nous l'avons souvent vu décorer le maître-autel pendant la quinzaine qui précède Pâques et dans d'autres occasions. Il est encadré, en forme de tableau, par une bordure large au moins de huit centimètres. Dans ce cadre, on compte trente-six personnages, tous revêtus de l'habit ecclésiastique; ils sont groupés comme le clergé l'est dans une cérémonie du genre de celle qui y est représentée. Le cercueil est porté par deux prêtres et deux diacres, en étoles cendrées, semées de croix. Il est précédé de quatre frères convers portant des flambeaux, et suivi de plusieurs religieux, qu'à leurs costumes on reconnaît aisément pour des Chartreux, des Célestins et d'autres docteurs, tous affiliés à Saint-Victor. Ces derniers forment le deuil que mène le recteur de l'Université de Paris, revêtu de ses insignes. L'officiant est l'Abbé régulier de l'ordre avant les commendes. On croit que c'est Jean Bordier, trente-troisième abbé de ce monastère. Ce dignitaire est précédé des divers degrés du clergé, tous en habits de choeur surplis à la romaine, aumusses sur la tête, d'une forme et d'une étoffe remarquables; et tous ont des plages au bas des aubes. En tête de la procession marchent trois enfants de chœur ou acolytes. Nous ignorons ce qu'est devenu cette tapisserie, qui a disparu de l'église Saint-Spire depuis longtemps déjà. T. PINARD. |00000162| NOTICE HISTORIQUE SUR L'ÉGLISE ET LE CIMETIÈRE SAINT-NICOLAS DE CORBEIL Nous avons dit, dans notre historique sur la rue St-Spire, que la chaussée de Nagis est une suite de cette voie ; qu'il nous soit permis de compléter ce chapitre par les notes suivantes, concernant l'église et le cimetière Saint Nicolas, qui existaient sur le côté gauche de cette chaussée. - I. ÉGLISE SAINT-NICOLAS. L'église Saint-Nicolas était située au sud de la ville, près la porte St-Nicolas, à peu de distance du rempart, et placée dans l'ancien cimetière de ce nom. Son entrée principale donnait sur la rue St-Spire; son étendue était, à l'origine, assez restreinte. Dans les plus anciens titres la concernant, parvenus jusqu'à nous, elle n'est qualifiée que de Chapelle St-Nicolas, Capelle sancti Nicolaï. Ce n'est qu'au commencement du xve siècle que le titre d'église paroissiale lui est donné. Il est certain que cette église subit au xve siècle, et surtout au XVI, des transformations et des agrandissements. C'est sans doute à la suite de travaux importants que l'église St-Nicolas fut dédiée et consacrée (¹) sous l'invocation de ce saint, le premier septembre I. Il y a un fort petit nombre d'églises qui aient été solennellement dédiées, car il ne faut pas confondre la dédicace avec la simple bénédiction. Toute église doit être au moins bénite, mais cette cérémonie est beaucoup moins auguste que la consécration. |00000163| - 109 - 1518, par le Révérend Père Jean, évêque de Megare, en l'absence et par la permission de Mgr Etienne de Poncher, évêque de Paris; quarante jours d'indulgence furent accordés à cette occasion. Cette dédicace est attestée par la note suivante, insérée à l'obituaire, à la date du premier septembre (1): 1518. 1 Septembris. Dedicatio hujus ecclesie Anno Domini millesimo quingentesimo decimo octavo, die vero mercurii prima mensis Septembris, reverendus in Christo pius et Dominus Dominus Johannes, episcopus Magarensis, de licentia domini vicarii reverendissimi in Christo pii et Domini Domini Stephani, miseratione divina, episcopi Parisius, civitate et diocese parisiense, notorie absentis, dedicavit et consecravit ecclesiam Beati Nicolaï in suburgio Corbolii sub invocatione ejusdem sancti, cum quadraginta dies indulgentiæ. Teste signo meo manuale hic apposito anno et die predicto. LONGEMAILLE. L'église Saint Nicolas avait un déambulatoire avec des collatéraux où se trouvaient plusieurs chapelles dédiées à Notre-Dame, à Saint Etienne, à Saint Nicolas et à Saint Laurent. – Comme l'on sait, le territoire où le nouveau Corbeil a été bâti était originairement de la paroisse St-Etienne d'Essonnes. L'église Notre-Dame de Corbeil, et, avant 1601, l'église St-Nicolas étaient dépendances de la cure d'Essonnes. Sans doute, il y eut, avant la destruction de l'église St-Nicolas, en 1590, dans les églises collégiales de St-Spire et de Notre-Dame, un autel destiné aux fonctions paroissiales (2), mais n'est-il pas à 1. L'obituaire de l'église Saint Nicolas, mi-partie en français, mi-partie en latin, écrit avant 1520, avec additions plus récentes, est conservé à la Biblioth. nat. ms. lat. 5185. L'original, en minute, est déposé aux archives de la ville de Corbeil. 2. C'était l'autel St-Yon à Notre-Dame, et l'autel St-Martin à St-Spire; la cure StMartin, dans l'église St-Spire, parait résulter d'un titre de 1466, mais elle fut toujours contestée par les curés de Notre-Dame, notamment par le curé Barbier, le 22 septembre 1765. |00000164| ΠΟ croire, dirons-nous avec l'abbé Lebeuf, que ces deux cures n'étaient que pour les familiers et officiers ou domestiques des chanoines? L'Eglise St-Nicolas, église paroissiale de Corbeil (rive gauche), était donc succursale d'Essonnes. Rendue nécessaire par la prospérité de la ville, elle fut construite dans un faubourg alors peuplé. Nous estimons, en nous basant sur des vestiges de cette église, que son édification peut être fixée au XIIIe siècle. D'ailleurs, des titres du xive et du xve siècles présupposent l'existence de cette église à une époque bien antérieure. Nous citerons. notamment : 1º un titre du 1er avril 1393, faisant mention de 10 sols parisis de rente que l'église St-Nicolas avait droit de prendre sur un arpent de vigne aux bas Vignons; 2º un titre du 13 avril 1395, passé devant Symon de Villemeneur, tabellion à Brie-comte-Robert, relatant 68 sols parisis de rente, au profit de la même église, sur des biens à Lieusaint; 3º et un autre titre de 20 sols parisis de rente qui lui avait été léguée par Perrette, veuve de Robert Taupin, par son testament daté du 25 janvier 1399, et qu'elle avait droit de percevoir sur deux maisons sises à Corbueil, en la rue de la Desguide. Enfin l'œuvre et fabrique de cette église possédait des biens considérables à Corbeil et aux environs, principalement à Ballancourt, à Itteville et à Vert-le-Grand. Des rentes lui étaient assignées sur les maisons portant les enseignes de la Nasse, la Roze, l'Image St-Nicolas, la Fleur de Lis, L'Ange, la Souche, la Grue, la Herse, la Lanterne, l'Escu d'Orléans, le Heaulme, etc. L'église St-Nicolas possédait aussi 40 sols parisis de rente qu'elle avait le droit de prendre sur deux maisons sises à Corbeil, devant le Donjon, suivant acte du 21 mars 1408; cette rente fut amortie par Mathurin de Douzonville, seigneur de Vaulx, en 1464. Nous relaterons ici plusieurs actes intéressants la concernant : I. - Par lettre du 25 juin 1460, Jehan Marcel, bourgeois de Paris, fit donation, à l'église Saint-Nicolas, d'une croix d'argent garnie de cristal, avec le pied de cuivre ; un titre nouvel passé devant Yves Tierré, prêtre, substitut de Pierre Pillevin, tabellion à Itteville, le 10 décembre 1542, fait mention de 13 livres tournois de rente donnée par « feu Me Laurent Gobillon, jadis curé des églises SaintNicolas et Saint-Estienne d'Essonne (¹), savoir: sept livres tournois aux Le curè Gobillon était aussi chanoine de l'église cathédrale St-Etienne de Melun. I. |00000165| III dictes églises, à répartir moitié par moitié, et six livres tournois au curé d'icelles; laquelle rente led. Gobillon avoit droit de prendre sur la moitié de deux moulins à blé, assis au lieu de la Bronyère, paroisse d'Yteville et sur leurs appartenances… » Cette donation eut lieu pour la fondation d'obits en ces deux églises, pour le repos des âmes des père et mère du donateur, de leurs parents et amis trépassés. II. Une transaction passée par devant Spire Guespereau, substitut de Dupré, tabellion à Corbeil, le 23 février 1538, entre Mes Claude et Jehan Le Bergier, à cause de leurs femmes, filles de feu Jacques Roze et Agnès Becquet, sa femme, d'une part, et Jehan Peteau et Etienne Fidé, marguilliers, d'autre part, fait mention de la fondation de deux messes pour Agnès Becquet, à cause de 28 livres 7 sols 3 deniers dus par l'église St-Nicolas à Jacques Roze, pour avoir « par luy plus mys que reçeu par le compte rendu comme marguillier d'icelle église ». D'autres fondations intéressantes ainsi que des détails liturgiques assez curieux, sont relatés dans l'obituaire de St-Nicolas (¹), écrit au commencement du xvre siècle. Nous en parlerons plus loin. III. Une épitaphe, qui se trouvait autrefois dans l'église StEtienne d'Essonnes, portant la date de 1499, relatait que, en vertu de la fondation de Gorgon de la Croix, marchand, les chanoines de Notre-Dame de Corbeil étaient obligés d'aller, deux fois par an, en procession à l'église St-Etienne d'Essonnes, et, à la première fois, d'entrer en revenant en l'église de Saint-Nicolas ; à la seconde procession devait assister celle de Saint-Nicolas, et rester à la grande messe d'Essonnes. ――――― IV. En 1535, a écrit l'abbé Lebeuf (2), Sébastien Tartaret est qualifié curé de St-Etienne d'Essonnes, cum ejus succursu Sti Nicolai de Corbolio; il ajoute qu'il y en a une collation dans les mêmes termes au 21 janvier 1550. – – V. Une lettre de l'évêque de Paris du 12 décembre 1542, autorisa les marguilliers de l'église St-Nicolas de transférer « de lieu en autres troys autels en icelle église pour raison des deux chapelles neusves et accroissement d'icelle église ». VI. — Une sommation du dernier juin 1543, signée Destouches, I. Bibl. Nat. ms. latin, nº 5185 B. 2. Hist. du diocèse de Paris, tome XI, p. 202. |00000166| 112 – 1 greffier, nous apprend qu'à cette époque la hideuse lèpre régnait encore à Corbeil, et que l'église d'Essonnes avait l'habitude de payer la moitié des frais de transport des lépreux à l'Ermitage de St-Lazare. En effet, par cet acte, Jehan Le Bergier, marguillier de l'église St-Nicolas, met en demeure les marguilliers et paroissiens de l'église d'Essonnes « qu'ils eussent à contribuer pour moyctié aux «frais qu'il convenoit faire et desbourser pour faire rendre le lépreux « Denis Morin, natif de Corbueil, à la malladerye Sainct-Lazare « dudict lieu ». A raison sans doute de sa situation, en dehors de l'enceinte de la ville, et du peu de sùreté qu'elle présentait, les marguilliers de l'église St-Nicolas avaient coutume de garder en leurs maisons les ornements et reliques de cette église, qu'ils portaient aux « bonnes festes et rapportaient ensuite en leurs hôtels. Un seul calice d'argent, « non doré » restait en la garde du vicaire de l'église, qui, en 1543, était René de Maisières; ce calice servait à dire les obits et messes chaque jour de semaine. Un inventaire fait à cette date par Etienne Parnot, tabellion juré, établi par le roi à Corbeil, nous a conservé l'énumération et la description des ornemens et objets cultuels ainsi laissés à la garde des marguilliers de St-Nicolas, comme il suit : « Premièrement une chappelle de damas rouge toute complecte garnye de chasuble, troys chappes, deux tunicques, estolles, fanons et paremens de mesme avec ung parement de damas rouge, à mectre devant l'autel, portant sur la pierre et servant de parement, et deux custodes de taffetas de diverses coulleurs garnies de bloncques. Item, une autre chappelle de satin en damas blanc non figuré, toute complecte et garnye comme cy dessus, servant aux festes de Nostre-Dame. Item, une autre chappelle de damas noir des trespassez aussi toute complecte et garnye avec les paremens d'autel, tant hault que bas, semez de figures et ossemens de morts et custodes; lesquelz paremens et custodes sont de demye ostade. Item, ung corporallier de velour viollet cramoysi, sur les quatre coings duquel il y a des perles blanches et au milieu une croix de drap d'or; ledict corporallier garny de son estuy. Item, une croix d'argent en laquelle y a du fust de la vraye croix, et au dessoubz ung petit relicquaire couvert d'une verrière, laquelle est garnye de son estuy; Item, ung relicquaire de laton ou cuyvre doré auquel y a plusieurs rellicques |00000167| - 113 - enchassez, couvert d'une verrière; lequel est garny de son estuy, dans lequel on mect les pardons d'icelle église ; Item, une croix de cristal sur le pomeau de laquelle au dessoubz de la croisée y a des pièces d'albastre blanc, entaillées, et, à l'entour d'icelle, des pierreryes de verre de plusieurs couleurs, garnye de son estuy; Item, ung autre relicquaire d'argent non doré carré en table par le hault, et par le pié rond à plusieurs carrés dedans, lequel y a ung parchemin couvert d'une verrière, auquel sont escriptz les relicques de dedans icelluy, garny de son estuy; Item, ung autre petit relicquaire ayant le hault en façon de clocheton, une verrière à l'entour, auquel y a plusieurs relicques, contenuz en un petit brief de parchemin, estant dedans icelluy, garny de son estuy; Item, deux burettes d'argent et une paix aussi d'argent, garnis d'estuy; Item, troys callices d'argent dont le plus séant, servant aux bons jours, et l'ung des autres dorez d'or, garnis chacun de leur estuy »>. Huet de Noyon Pierre Symon Les Marguilliers de l'Eglise Saint-Nicolas étaient élus et prenaient leurs fonctions, qui duraient un an, le jour de Saint-Jean Baptiste, le 24 juin. Ils étaient rééligibles. Nous citerons ici, avec la date de l'exercice de leurs fonctions, les marguilliers suivants, dont les noms nous sont parvenus. Jehan du Val Jehan du Val Jehan du Val Jehan Harvet Symon Becquet Guillaume Loré Jehan le Boullenger Pierre Barré Pierre Barré Pierre Barré Gilles Cornu Audry Pionard Jacques Roze Robert Dardenay Jehan Petau Charles Langlois Estienne Fide 1422-1423 1446-1447 1463-1464 1468-1469 1469-1470 Jehan Guérineau Nicolas Faulcœur Anthoine Loré Anthoine Loré Jehan le Bergier 1473-1474 Nicolas Clément 1478-1479 Germain Vieille 1486-1489 Claude Cotais 1488-1489 Antoine Loré 1495-1496 Guillaume Vetault 1505-1506 Jehan Gilbert 1508-1509 1513-1514 1520-1521 1522-1523 1533-1534 1534-1535 Jehan Parnot 1535-1536 Jehan Quentin 1536-1537 Jehan Tortouyn Pierre Tortouyn Gabriel Parrichon Nicolas Barré Jehan Quentin, lainé Pierre Parrichon 1537-1538 1539-1540 1540-1541 1541-1542 1542-1543 1543-1544 1545-1546 1546-1547 1547-1548 1548-1549 1549-1550 1550-1551 1551-1552 1553-1554 1556-1557 1566-1567 1571-1572 1574-1575 1575-1576 |00000168| - 114 ―― Nous ne pouvons indiquer, comme ayant été curés de l'Eglise St-Nicolas, que : Laurent Gobillon, vers Sébastien Tarteret Mathurin Gallon 1500 (1) Nicolas Laudasse 1535 Jehan Leroux Tristan Canu 1572 Tristan Canu, qui devint en 1601, curé de l'église Notre-Dame de Corbeil, annexée à St-Etienne d'Essonnes, fut le dernier curé de l'église St-Nicolas ; mais, une curieuse convention portant la date du 16 mars 1588 2, nous apprend que Jehan Leroux prétendait seul avoir droit à la cure de St-Estienne d'Essonnes et St-Nicolas, et qu'il avait même intenté, devant le prévôt de Paris un procès à l'encontre de Canu, qui la revendiquait aussi. Pour y mettre fin, et « nourrir paix et amitié » Leroux céda à Canu tout et tel droict qu'il avait à la dite cure St-Etienne d'Essonnes et St-Nicolas, son annexe, dont Canu jouirait, userait et desservirait seul; de son côté, Canu donnait à Leroux une prébende qu'il avait dans l'église Notre-Dame; il était entendu en outre qu'après la mort de Canu, Leroux jouirait de la cure d'Essonnes. 1575 1588 1588 Deux humbles prêtres de l'église St-Nicolas: René de Maisières, vicaire, et René Regnault, chapelain, méritèrent la reconnaissance de leurs concitoyens par le dévouement et le courage civique dont ils firent preuve en 1521, pendant une terrible épidémie qui désola la ville et la couvrit de cadavres. - «En ladite ville de Corbueil, y avoit peste et mortalité et ny avoyt « aucunes personnes qui voulsissent aller ensepvellir ne porter les morts « en terre ». Les habitants remontrèrent à Beranger Boucher, prévôt de Corbeil que: – «<le vicaire de l'église St Nicolas estoit ordinairement occupé à « aller confesser et visiter les malades; et, que pour soy saulver, il « prenoit medecyne, au moyen de quoy il perdoit ses messes ». Cent sols par mois furent alloués par le prévôt à René Maisières, pour l'indemniser 3. René Regnault remplissait aussi dignement son sacerdoce, en I. - On célébrait son obit le 2 mars. 2. Minute Grégoire, notaire à Corbeil. Arch. de Seine-et-Oise E 6846. 3. Ordonnance de Béranger Boucher du 8 octobre 1521. Archives de Corbeil, G G. 377. |00000169| 115 – allant administrer les pestiférés, le jour et la nuit, ainsi que l'établit la quittance suivante (¹): « Receu par moy René Regnault, prebstre, chappelain, de vénérable et discrette personne messire René de Maisières, aussi prebstre vicaire de l'église monsieur sainct Nicolas de Corbueil, de honneste personne Jehan Chandellier, au nom et comme procureur des habitans de la ville et faulxbourgs de Corbueil, la somme de cinquante solz tournois, faisant moyctié de cent solz tournois, qui ont esté ordonnez bailler pour moys par le dict procureur, par l'advis et congrégation faicte en l'auditoire de Corbueil, pour administrer les malades de la peste en ladicte paroisse et aultres, en la dicte ville, tant de jour que de nuyt, en me requérant de ce faire; de laquelle somme de cinquante solz, je quicte ledict procureur; tesmoing mon seing manuel cy mis, le dix huictiesme jour d'octobre mil cinq cens vingt ung. Signé René Regnault ». Leur mémoire, que nous saluons, ne mérite-t-elle pas de passer à la postérité ? C'est en l'église Saint-Nicolas qu'avait été fondée la confrérie religieuse de Saint Claude. Cette confrérie fut transférée en l'église Notre-Dame, devenue paroissiale. Un acte passé devant Etienne Grégoire, notaire à Corbeil, le premier juillet 1602 (2), constate en effet que Hubert Rodet, marguillier de l'église paroissiale SaintNicolas de Corbeil, transférée en l'église Notre-Dame, en la présence et du consentement de Tristan Canu, chanoine de St-Spire, curé de cette paroisse et de plusieurs paroissiens, a reconnu avoir reçu des membres de la confrérie « Monsieur sainct Claude » fondée et entretenue en l'église Saint-Nicolas par les mains de Mathurin Guyot, l'un desdits confrères, ce accepté par Santeny, procureur et receveur de la confrairie, et du consentement de Antoine et Pierre Santeny, Jean Tarteret, Claude Rolland et Pierre Baillard, tous confrères, une somme de 15 écus d'or sol, moyennant laquelle les marguilliers et paroissiens de Saint-Nicolas seront tenus de faire célébrer : « en icelle église à l'intention desdictz confraires et de ceulx « d'icelle confrairie trespassez, un beau salut solempnel qui se dira et «chantera le jour Sainct Claude, sixiesme jour de juing ». C'est aussi en cette église que le 24 juillet de chaque année, les I. - 2. Ordonnance de Béranger Boucher, du 8 octobre 1521. - Arch, de Seine-et-Oise, E. 6850. - |00000170| – 116 – marguillers étaient tenus de faire dire une haute messe du jour, et le lendemain une messe basse de Requiem pour « les pelerins et confraires de Monsieur St Jacques en Galice». A cet effet, les membres de cette confrérie avaient légué 15 sols de rente à lad. église, à prendre annuellement sur divers héritages sis à Bou (Evrypetit-Bourg), par acte passé pardevant Me Etienne Privé, tabellion à Corbeil, le 22 septembre 1494. L'obituaire de l'Eglise St-Nicolas, dont nous avons fait la lecture entière, nous révèle de curieux détails liturgiques, sur les cérémonies qui s'y célébraient chaque année. Nous en extrayons ceux qui suivent: Le 13 janvier, en exécution d'un legs de 16 sols parisis de rente, avec quatre livres tournois en argent comptant, qui avait été fait à la fabrique de l'église St-Nicolas, par Isaac Palot, et sa femme fille de Girard Fournier et de Catherine Pastard, on célébrait en cette église : « Un obit solempnel à diacre, soubz diacre et chouriers, à vigilles, laudes, et commendaces, et une haulte messe de requiem, pour feu Girard Fournier et Catherine Pastard, sa femme; et, à la fin de ladite messe, on ALLAIT EN PROCESSION A L'ENTOUR DU CHŒUR chantant libera, et à l'endroit de la croix de feu Michel Tinvard où est inhumé ledict Fournier, on disait le de profundis; au retour on allait sur la fosse de ladicte defuncte, près LES FONTS, aussi dire le de profundis et oraisons accoustumées ». Le 16 janvier, fête de St Marcel, on y disait pour Jeanne Duturot, femme de Pierre Duturot, qui avait donné à cet effet à la « fabrice capelle sancti Nicholai » 20 sols de rente, une messe basse de requiem, à laquelle les marguilliers étaient tenus d'offrir le pain, le vin et le luminaire. Les 23 janvier, 9 et 10 février, on célébrait des obits solennels. Le 14 février, fête de St Valentin, les marguilliers de l'église « St-Nicolas-lez-Corbeil » étaient obligés de faire dire par le curé ou vicaire : « Une haulte messe de la Croix, commençant : nos autem, à diacre, soubz diacre et chœuriers; et la dicte messe finie aller par ledict curé ou vicaire, diacre, soubz diacre et chouriers en procession devant le crucifix, chantant l'antienne O crux splendidior, avec le verset hoc signum crucis, et l'oraison propre; et, de là |00000171| ―― 117 aller sur la fosse feue Jehanne Barré, et DEVANT L'AUTEL NOTRE-DAME, en chantant le respons ne recorderis, et le verset amplius avec de profundis, l'oraison que Domine pro tua pietate, inclina, et fidelium. Laquelle defuncte a délaissé douze sols parisis de rente qu'elle avoit sur la maison de feu messire Jehan Barré, assize en la rue aux Tricheurs (¹), et continuer icelle messe par chacun an à toujours ». Le 24 mars, veille de l'Annonciation Notre-Dame, « après les Vêpres, complies et salut acoustumez » se disait en l'église StNicolas, un autre salut devant l'autel de Notre-Dame : « Comme sont les fondations des salutz que l'on dict ledict jour en l'esglise « Notre-Dame, et St-Spire de Corbeil, avec les oraisons propres et acoustumées, « à la fin du dict salut; et après icelluy salut, dict et chanté, aller en procession « avec la croix de devant led. autel Nostre-Dame, à l'entour des fonts, retour- «nant devant le crucifix, en chantant ne recorderis, et à la fin chanter de profundis « et oraisons acoustuméez, selon et ainsy qu'il est déclaré es lettres de fondation « de ce faictes, dactées du trentiesme et penultiesme mars 1543, après Pasques, « passées par devant Spire Guespereau, substitut de M• Ambert Destouches, lors « tabellion de Corbeil »>. Le jour de Pâques, les marguilliers étaient tenus de faire célébrer, en l'église St-Nicolas, une messe basse pour y donner la communion aux valets et servantes, lesquels étaient tenus de dire un Pater et un Ave pour le repos de l'âme de Aveline la Santenye, qui avait légué six livres pour cette fondation, antérieure à 1520. Le 28 avril on y célébrait un obit solennel avec «< diacre, soulbz diacre et chœuriers, avec vigilles, Laudes et commandaces, pour feu honorable homme Jehan Le Paige, lequel avait donné à l'église St-Nicolas 32 livres tournois pour 2 obits; l'autre se disait le 29 octobre ». Nous relevons encore dans l'obituaire de l'église St-Nicolas, les obits et cérémonies suivants : 2 mai. - Obit solempnel « à diacre, soubz diacre et chouriers ; neuf pseaulmes, neuf leçons, Vigilles, Laudes, commandaces; et une haulte messe, pour Blandine Monthion, femme de Loys Godeffroy et pour led. Godeffroy, moyennant 20 sols de rente, délaissez par elle à la lad. église, dont il y a lettres passées le XIX avril 1548 ». 3 mai. Basse messe de la Croix, « avecque une antienne devant le crucifix; ung obit solempnel pour après ladicte antienne, Libera, tout au long, avec les trois oraisons acoustumées ». 1. Actuellement la rue aux Tisseurs. |00000172| 118 V Le jour de la Trinité, issue de vespres, on chantait : « Vigilles à neuf leçons, et on allait au cimetière, sur la fosse de deffuncte Loyse Hideulx, chanter Libera et de profundis; et le lendemain les recommendaces, et messe haulte, à diacre et soubz diacre, et à la fin Libera sur la fosse de la d. deffuncte ». 6 juin. - Obit solempnel pour defuncte Denise Gilbert, en son vivant femme de honorable homme maistre Jehan Roger, procureur du Roy, à Corbueil ». 10 juin. «Obit solempnel pour deffuncte Jehanne Parnot; et à l'issue dud. obit, ce doibt aumosne à treize pauvres, treize liardz, qui est à chascun ung liards, par le marguillier de ladicte église St-Nicolas ». Juin. « Le vendredi devant la sainct Jehan, se devait dire un obit solempnel. « C'est assavoir: Vigilles, Laudes, recommandaces, et une haulte messe de requiem; le tout à diacre et soubz diacre et chouriers pour feu Jehan Petau (') ». 27 Juin. « Basse messe pour feue Jehanne du Four, en son vivant femme de feu Michel du Buz, et depuis femme de Lienard de Popon, seigneur de Bondoufle, laquelle a délaissé à la fabrique St-Nicolas de Corbeil 21 sols parisis de rente…» 30 Juin. Obit solennel pour feu Me Loys Privé, en son vivant chanoine de l'église Notre-Dame de Corbeil. « C'est assavoir: Vigilles, Laudes et recommandaces avec une haulte messe à diacre, soubz diacre et choeuriers. Item, après lad. messe se doibt faire procession sur la fosse dud. Privé, en commençant libera me Domine; puys après les pseaulmes de Miserere mei Deus secundum, De profundis, avec les oraisons Deus qui inter apostolicos, etc., pour le quel faire a donné 16 livres tournois (2) ». - 1er Juillet. Obit solennel pour feue Marguerite Rose, en son vivant femme de Me Claude le Bergier, advocat en parlement, prévost de Corbueil, et après la messe dicte, dire et chanter devant l'autel Notre Dame, Salve Regina, et oraisons convenables, et sur la fosse delad. defuncte, libera me, Domine, et oraisons acoustumées ». « Et decedda lad. defuncte le xxve jour de juing 1545 ». 23 Juillet. Obit solennel avec Laudes, vigiles, recommandations et offrandes à l'intention de Jehanne Garnier, femme de Me Jacques du Hamel, notaire. 28 Juillet. Ste Anne: Messe haulte de Ste Anne pour feu Anne 1. Acte du 9 mars 1539 devant Etienne PARNOT, tabellion à Corbeil. 2. Acte du 9 octobre 1538, devant Guespereau, substitut de Parnot, tabellion à Corbeil. |00000173| 119 Bardou, en son vivant veufve de feu Jehan du Gron ; la fondation est de 16 sols parisis. 31 Juillet.« Obit solempnel pour honnorable homme Jehan Cordeau, lesné, et Françoise Prévost, sa femme; le tout suyvant les lettres de fondation faictes et passées soubz le scel dud. Corbeil, pardevant Langlois, notaire le 18 Juillet 1577 ». 14 août. La veille de l'assomption Nostre Dame, à issue de vespres, se devait dire «ung salut de la solempnité de la feste et journée d'assomption Notre Dame, avec les oraisons à ce propres ; et à la fin dudict salut devant le crucifix de lad. église dire ne recorderis, de profundis, et oraisons acoustumées; le lendemain dudict jour d'assomption dire une haulte messe de Requiem, à diacre, soubz diacre et chouriers » etc…, en vertu d'une donation passée par-devant Langlois, notaire, le 21 août 1574. 1er septembre. - Ce jour, messieurs de Sainct Spire venaient en procession et faisaient les offices de la Messe, étaient tenus chanter ne recorderis et oraisons sur la fosse de feu Jehan Loré; une messe basse était dite à l'intention dudict deffunt pendant la grand'- messe. 8 septembre. Ce jour, issue de Vespres, beau salut pour feue Perrette Lemaire, veuve de Guillaume Parnot, où on chantait devant l'autel notre Dame, avec ne recorderis, commendaces, miserere, de profundis. 1er Octobre. Obit solempnel pour feu messire René de Mézières, en son vivant vicaire de la dicte église ¹. - — 19 octobre. Obit solempnel pour Nicolas Faulcoeur, en son vivant Me barbier et chirurgien à Corbeil 2. ― 1er novembre. « Ce dict jour, issue de Vespres, se doibt dire Vigilles à neuf leçons, pour deffuncte Marye le Page, en son vivant veufve de feu Fery le Fort; et le lendemain Laudes, recommandaces avecq ung obit solempnel à diacre et soubz diacre, avec libera sur la fosse de la deffuncte. 3 novembre. — « Obit de Robert Taupin, bourgeois de Corbeil, qui en l'an 1399, donna à la fabrique de la Chapelle Saint-Nicolas 12 sols parisis de rente annuelle et perpétuelle, à percevoir sur 2 maisons situées en la rue de la Desguide, contigues, tenant d'une part la rue du Port de la Ferté, et de l'autre côté aux héritiers de défunt Robert Pigné, pour son anniversaire, devant être fait dans la dite chapelle ”. 1. René de MÉZIÈRES OU MAISIÈRES, était vicaire en 1521 ; il l'était encore en 1543. 2. Acte REGNAULT, notaire à Corbeil, du 20 Juillet 1551. |00000174| - ――― 120 ――― 3 novembre. <«< Les marguilliers de l'église de céans sont tenus faire dire ung obit solempnel à diacre et soubz diacre et chœuriers, avec vigilles, trois leçons; et à fin de la dite messe faire procession, au cimetière de la dite église, chantant Libera, miserere mei Deus secundum, avec de profundis, et oraisons acoustumées; et à l'offertoire de laquelle messe seront offerts: pain, vin, chandelle et luminaire pour ung paroissien de la paroisse de lad. église, non nommé » (¹). - 8 décembre. Après Vespres, se disaient en l'église St-Nicolas, les vigiles d'un obit solennel, duquel les recommandations et la messe avec le libera me se célébraient le lendemain, à l'intention de Nicolas Guiboys, bourgeois de Corbeil. Enfin le 31 décembre, les marguilliers de l'église St-Nicolas étaient tenus de faire célébrer en cette église un obit anniversaire solennel, « c'est assavoir: vigilles, laudes, commendaces, avec haute messe à diacre, soubz diacre et deux chouriers pour Marion, jadis femme de Etienne Dauvergne, et ses amis trépassez, laquelle avait donné à l'église 16 sols de rente, sur une maison assise aux faulx bourgs de Corbueil près la dicte église St-Nicolas, où pend pour enseigne La Grue» (acte du 15 mai 1512). Cette église a eu le sort de Notre-Dame ; elle a été détruite, mais dans des temps plus anciens et dans des circonstances bien différentes. A raison de sa situation, qui dominait les fortifications, l'église St-Nicolas de Corbeil commandait la ville et nuisait à sa défense, ou en facilitait l'attaque. A l'époque des guerres civiles de religion, qui désolèrent et ensanglantèrent la France sous le règne des Valois, et notamment sous le règne de Charles IX, les habitants de Corbeil n'hésitèrent pas à sacrifier leur église paroissiale à la défense de la cité. Déjà, lors du siège de 1562, ils avaient été dans la nécessité de la ruiner partiellement, afin que l'ennemi ne pût s'en servir avantageusement pour battre la ville de son artillerie. On sait, en effet, que le 13 novembre 1562, le prince de Condé, à la tête de l'armée protestante et de troupes étrangères, vint menacer Corbeil, commandé par Charles de Conte, seigneur de Pa1. Led. paroissien était M. Jacques de Hamel. |00000175| 121 vans, lieutenant du Roi et de la compagnie du Duc de Lorraine. Ce n'est que grâce à la défense énergique des troupes de Pavans et au patriotisme des habitants que Condé, après avoir perdu plusieurs officiers et deux à trois cents soldats, se vit contraint de lever le siège, le 21 novembre, et de marcher sur Paris, accompagné par l'amiral de Coligny. « Le prince de Condé, nous dit de la Barre, n'ayant pu secourir les siens a «Rouen, au sortir d'Orléans, il fut prendre Pluviers (1), Estampes et Dourdan, et <«<le 13 novembre il vint planter son camp aux environs de Corbeil, dans l'assu- <«<rance que ceux de son parti lui avoient donnée de luy livrer la ville, à la charge « d'être épargnée du pillage, mettant des enseignes rouges aux fenestres de leurs <«< maisons, où ils avoient désigné de se retirer. « Pour lors il y avoit beaucoup de maisons autour de l'église de St-Nicolas, hors « la ville; les protestants s'approchèrent de ce côté là et firent facilement retirer «<les soldats de Pavans qui estoient sortis à l'escarmouche, puisque entre eux il « y avoit des réformés qui aydèrent à donner l'épouvante à leurs compagnons, « et s'entendoient de donner l'entrée libre aux ennemis; mais, l'un des échevins, «< qui se trouva à la porte, abattit promptement le tapecul qui fit visage de bois « aux ennemis, et les arquebusiers qui étoient sur les murailles de la ville les <«< contraignirent de se retirer au gros de l'armée, qui se logea aux villages voisins ». Nul doute que l'église Saint-Nicolas fut saccagée et dévastée lors de ce siège, où les murailles de la ville furent « rompues et abattues en plusieurs endroits, entre le Port aux tanneurs et le corpsde-garde, dessus le pont-levis de la porte Saint-Nicolas ». Cependant des réparations y furent faites, et elle continua de servir de paroisse aux habitants de la ville; le culte y fut certainement célébré jusqu'au grand siège de Corbeil par Farnèse, en septembre 1590, où, pour les besoins de la défense, elle fut abattue et rasée définitivement. L'abbé Lebeuf prétend, il est vrai, qu'on ne peut assigner à la destruction de l'église St-Nicolas une époque postérieure à 1554, en se basant sur un fragment d'ordonnance de l'évêque de Paris, du mois de mars ou avril de la même année, qui porte que les chanoines de Notre-Dame seront tenus de fournir un autel en leur église aux habitants de cette paroisse de St-Nicolas, pour y faire l'office. Mais cette opinion est erronée. Rien ne justifie cette ordonnance, si ce n'est que l'église St-Ni1. Pithiviers. 1909. — II. - 9 |00000176| 122colas étant trop exiguë pour le service paroissial, et la population s'étant aussi déplacée, l'évêque, sur la demande même des habitants, les a autorisés à jouir d'un autel à l'église Notre-Dame. Il est établi, en effet, par des documents probants, que l'église St-Nicolas existait encore longtemps après cette date. C'est ainsi que nous invoquerons notamment : 1º un acte du 18 février 1566, contenant vente par Vincent Destouches, md boulanger à Corbeil, à Jean Buisson, aussi marchand, d'un petit jardin, « assis ès faulxbourgs de Corbueil, près l'église St-Nicolas »; 2° un acte du 3 février 1572, contenant fondation de messe en l'église St-Nicolas de Corbeil, par Me Jacques Patin, notaire royal à Corbeil, seul héritier de Denise Chicquart, sa mère, en son vivant veuve de Hugues Patin (). Par cet acte Patin avait cédé à « l'œuvre et fabrique de l'église parochiale Monsieur Saint Nicolas de Corbueil » 16 sols parisis de rente annuelle, à prendre au jour St Martin, sur une maison assise à Corbeil, proche de la porte de Paris appelée « l'hostel du PILIER VERT≫ tenant à la dite porte; les marguilliers s'engageaient à faire dire, chanter et célébrer, chacun an, « en ladicte église » le lendemain du jour St Marc, en avril, une messe haute de requiem. pour l'âme de ladite défunte et de tous ses parents et amis; 3º un contrat passé pardevant Me Lusson, notaire à Corbeil, le 19 juin 1574, contenant transport à la même fabrique de Saint-Nicolas, de 35 sols tournois de rente par Jacques du Hamel, notaire, pour la fondation de l'obit solennel de Jehanne Garnier, sa femme, qui se célébrait en cette église le 23 juillet; 4° enfin, le traité conclu le 12 décembre 1588, entre Mes Jehan Leroux et Tristan Canu,« prestres, eulx se disans « curez de l'église et paroisse St-Estienne d'Essonne et St-Nicolas, « son annexe, pour nourrir paix et amitié entre eulx » et dans lequel « il est stipulé que : ledict Leroux a ceddé, quitté et mis ès mains « dudict Canu, tout et tel droict qu'il a et prétendoit en ladicte <«<cure St-Estienne d'Essonne et St-Nicolas de Corbeil, son annexe, et «ce, pour d'icelle joir, user et desservir par ledict Canu, seul…» (²) De la Barre, dont le témoignage est précieux pour l'histoire de cette époque, confirme notre assertion. Ne laisse-t-il pas entendre, en effet, que l'église St-Nicolas fut abattue pour la défense de la ville, par l'autorité de M. de Villeroy? N'a-t-il pas écrit que «M. de « Tregny fit employer les pierres du bâtiment à revêtir les éperons et 1. Archives de Seine-et-Oise. E. 6836. 2. Minute Etienne Grégoire, not. à Corbeil. Ibidem. E. 6844. |00000177| ―――― 123 - « terrasses qu'il fit élever aux environs (1) », notamment le bastion, depuis connu sous le nom de l'Arquebuse. Or, ce n'est qu'en 1585 que Neufville de Villeroy devint seigneur engagiste de la châtellenie de Corbeil, et au mois de novembre 1590, seulement, que M. de Tregny devint gouverneur de la ville. Enfin viennent corroborer notre opinion, les termes même de la requête présentée par les habitants de Corbeil à Henri IV, le 13 juillet 1594, aux fins d'obtenir la réunion des « deux collèges, chapitres et « communaultés de Sainct-Spire et de Nostre Dame de Corbeil », et dans laquelle ils demandent au roi : « Ordonner que l'esglise de Nostre Dame seroit delaissée ausdictz habitans pour servir d'esglise paroichialle, en considération qu'il n'y avoit en ladicte ville autre esglise cappable pour recepvoir le peuple, et que l'esglise St-Nicollas par plusieurs fois réédifiée après les esdictz de pacification, estoit à présent ruynée et les matériaulx jusques aux fondementz appliquez à la fortification de la dicte ville (2) ». C'est à la suite de cette requête, après enquête, et avis du cardinal de Gondy, alors évêque de Paris, qu'intervint, le 9 août 1601, un arrêt portant union des chapitres de St-Spire et de Notre-Dame de Corbeil. Il est dit dans cette décision que l'église Notre-Dame sera délaissée aux habitants, avec les cloches et chaires du chœur et qu'elle leur demeurera pour leur servir d'esglise paroichialle au lieu de l'esglise St-Nicollas qui soulloit estre hors la ville, à la charge de l'entretenir et maintenir ». Les habitants de Corbeil eurent à payer pour ce délaissement 400 écus aux chanoines. L'arrêt de réunion fut mis à exécution dès le 15 septembre 1601, après procès-verbal de Martin Langlois, sieur de Beaurepaire, me des requêtes en l'hôtel du roi. Tristan Canu, qui avait été le dernier curé de St-Nicolas, prit possession de la nouvelle église paroissiale, dont il fut ainsi le premier curé. Il ressort donc, à l'évidence, des faits que nous venons de signaler que l'église St-Nicolas, réparée à diverses reprises, notamment après le siège de 1562, fut abattue et démolie complètement lors du siège de septembre 1590, et non antérieurement à 1554, comme l'a présumé l'abbé Lebeuf. Sa destruction rendit nécessaire l'arrêt de 1601, et motiva l'érection de la collégiale Notre-Dame en église paroissiale de Corbeil, sous le titre d'EGLISE ET FABRIQUE DE NOTRE-DAme et 1. Les Antiquités de Corbeil, par DE LA BARRE, chap. 27. 2. Arch. de S.-et-O. G, 238. |00000178| - 124 - SAINT-NICOLAS DE CORBEIL, qu'elle a conservé jusqu'à la Révolution. Lors de la démolition du bastion de l'Arquebuse, les pierres qui provenaient de l'ancienne église St-Nicolas ont été employées à l'établissement des murs de terrasse du quai de l'Instruction, actuellement quai Bourgoin; et, vers 1843, lors des fouilles faites après la vente du cimetière, les fondations de l'église ayant été en partie arrachées, les matériaux qui en sont provenus ont été employés à la construction du perré de la porte Paris (ou de l'apport Paris), en face de la rue dite du Chemin de fer. Les pierres extraites du surplus des fondations qui se trouvaient sur la partie du terrain acquise par M. Nedek (¹), ont servi à la construction des murs de clôture des jardins qui occupent l'emplacement de l'ancien cimetière. Telle fut la fin de l'église St-Nicolas. – II. LE CIMETIÈRE SAINT-NICOLAS. On sait que les cimetières ont toujours été en grande vénération parmi les chrétiens; c'est à l'endroit où reposaient les morts que, dans les premiers temps, ils se réunissaient. L'habitude prise dès la fin du XIIe siècle d'inhumer dans les églises les ecclésiastiques, puis bientôt après, par faveur, les laïques d'une grande vertu, et enfin d'autres fidèles, sous divers motifs, provoqua la création de cimetières attenant aux églises,« sous l'égoût du toit», comme on disait par humilité. C'est ainsi que chaque église de Corbeil avait son cimetière propre. Celui de l'église St-Nicolas était destiné aux inhumations. des habitants de la partie de la ville située sur la rive gauche ; aussi était-il de beaucoup le plus étendu. Après la destruction de l'église, il continua de servir de grand cimetière public jusqu'en avril 1832, époque du choléra-morbus ; il était devenu l'unique lieu d'inhumation après 1792. C'est au cimetière St-Nicolas que furent transportés, en 1792 et 1793, les ossements provenant des nécropoles de la ville qui avaient été fouillées, notamment des cimetières de St-Léonard, S'-Guenault, de l'hôtel-Dieu et du couvent des religieuses. Aussi peut-on dire que presque toutes les générations de Corbeil, jusqu'en avril 1832, avaient reçu leur sépulture dans ce cimetière. 1. M. Nedek avait acquis le 2 lot, en bordure sur la rue St-Spire, ce qui nous indique exactement l'emplacement de l'église St-Nicolas. |00000179| - 125 - C'est là aussi que reposaient les pauvres prisonniers vendéens, qui tous, au nombre de cent, à l'exception de deux, succombèrent à la dysenterie en l'an II de la République, dans l'ancien hospice qui leur servait de prison. Enfin c'est au cimetière St-Nicolas qu'étaient encore les débris glorieux des armées qui succombèrent à la bataille de Montereau, en défendant, pied à pied, en 1814, sous les ordres de Napoléon, le sol de la patrie. Le cimetière St-Nicolas se trouvait hors de l'enceinte de la ville, sur le chemin de Nagis, et attenait à l'église. Un plan de ce champ du repos, daté de 1842, nous indique qu'il se trouvait exactement placé entre la rue de la Quarantaine et la rue St-Spire; la rue StNicolas, percée après la fouille du cimetière, en 1843, en dépendait; sa rive droite formait son extrême limite au midi; les maisons Moineau et Doublet le limitaient au nord. Sa contenance était, à l'origine, d'un peu plus d'un arpent, soit 4.400 mètres environ (¹). Il fut rétréci de quelque cent mètres, en 1785, en vertu de la permission qui avait été accordée, le 14 juillet de cette année, par le trésorier de France, d'élargir le grand chemin le limitant, actuellement rue St-Spire ou route nº 191 (2). C'est au cimetière St-Nicolas que, depuis 1601 jusqu'à la Révolution, les paroissiens de Notre-Dame se rendaient en procession le jour de la Toussaint. En souvenir de l'ancienne église St-Nicolas, il était aussi d'usage d'y aller processionnellement le 6 décembre, jour de la fête de St-Nicolas (3). L'abbé Guiot nous apprend que le 19 mars 1750, la Seine déborda jusqu'au cimetière St-Nicolas ; il y eut neuvaine à ce sujet. La situation du cimetière St-Nicolas entre la Seine et la rue StSpire a donné lieu aux pensées morales exprimées en vers latins et français qu'on lisait, avant 1792, aux piliers qui en formaient l'entrée : Inter aquas et iter tumulata cadavera fæno Quam sit vita brevis quam fragilisque docent : More via calcabimur: ibimus instar et undæ ; Et fæno similes nascimur et morimur. Crux hic ipsa cadet: Deus at crucis usque manebit Ad vitam cujus nos revocabit amor. 1. L'arpent vaut à Corbeil 4219 mètres. 2. Almanach de Corbeil, année 1789. 3. Ibidem. |00000180| - - 126 TRADUCTION Entre le cours du fleuve et le bord du chemin Cette foule de morts sous l'herbe ensevelie, Sur la fragilité de cette courte vie Nous éclaire, et nous dit quel est notre destin. Etre foulés aux pieds ainsi que ce passage, Comme l'onde qui fuit disparoître et périr, Avec cette herbe éclore, avec elle mourir. De notre sort, mortels, voici la triste image. Cette croix même ici, comme nous finira; Mais le Dieu, qui pour nous dans ses bras expira, Ne passera jamais; et sa main paternelle Doit nous conduire un jour à la vie éternelle. Le cimetière St-Nicolas, devenu trop exigu, par suite de l'augmentation de la population de la ville, fut désaffecté en 1832. Son existence formant obstacle à l'édification de constructions dans le voisinage, le conseil municipal décida, par délibération du 21 février 1837, de l'aliéner, en réservant toutefois une partie destinée à créer une nouvelle rue de 8 mètres de largeur, devant donner communication de la rue St-Spire à la Seine. Pour opérer cette vente on dut attendre le délai de 10 ans, fixé par les décrets du 15 mai 1791 et 23 prairial an XII. Dès le 12 janvier 1839, Louis Julien Laroche, architecte à Corbeil, fit l'arpentage de l'ancien cimetière, dont la contenance totale était de 4197 mètres, et établit le plan de division en 5 lots. Le 17 mai 1842, intervint l'ordonnance royale suivante approbative des délibérations du conseil municipal des 21 février 1837, 1er et 25 juin 1841: Louis-Philippe, roi des Français. A tous présens et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre, secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Article premier. La ville de Corbeil (Seine-et-Oise), est autorisée à aliéner aux enchères publiques, sur la mise à prix de quatre mille trois cent quarante-cinq francs, prix d'estimation, une portion de son ancien cimetière, contenant trente-trois ares quarantesept centiares. Le produit de cette aliénation devra être placé en rente 5 0/0 sur l'Etat. |00000181| - 127 — Article deux. Notre ministre, secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance Au Palais de Neuilly, le 17 mai 1842. Signé LOUIS-Philippe. Par le roi, Le ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur. Signé: DUCHATEL. C'est ainsi, et en exécution de cette ordonnance, que la plus grande partie de l'ancien cimetière St-Nicolas, fut adjugée en 5 lots 9 octobre 1842, en l'étude de Me Lemenuet, notaire. le Il avait été stipulé dans le cahier des charges que les adjudicataires entreraient immédiatement en jouissance, sauf un délai d'un mois réservé en faveur des citoyens qui voudraient exhumer les dépouilles mortelles de leurs parents et amis. Le premier lot fut adjugé à Madame Veuve Jacques Moineau, le second à Mr Jean Nedek, et les trois autres lots à Mr Frédéric François Piat, ancien avoué à Corbeil; l'adjudication produisit 5575 fr. Les adjudicataires se disposaient à prendre possession du terrain, lorsque le conseil municipal exprima le vœu de faire exhumer tous les ossements, pour les transporter au nouveau cimetière, où ils seraient recueillis sous un monument funèbre ¹; ils acceptèrent religieusement cette proposition. La piété des habitants s'était en effet émue à la seule idée de délaisser dans un terrain, désormais livré au commerce, les restes de tant de citoyens. Pouvaient-ils, ces généreux Corbeillois, oublier et abandonner ainsi les os sacrés de leurs aïeux ? La fouille du cimetière St-Nicolas fut donc opérée sous la surveillance de l'administration municipale par deux entrepreneurs : Emile Auguste Pré et Antoine Poincloux2, aidés de 12 ouvriers, et pour un prix payé au moyen d'une souscription volontaire de la part des habitants, laquelle produisit 3148 fr. 25. Les restes mortels, soigneusement recueillis, furent déposés dans le nouveau cimetière de la ville 3 de novembre 1842 à février sui1. Délibération du conseil municipal, du 17 février 1843. 2. Acte du 28 juin 1843, portant réglement du compte définitif à l'occasion de l'association verbale faite entre eux pour les fouilles, les exhumations, transports, translation, remblais et autres travaux qui étaient à faire dans l'ancien cimetière St-Nicolas. 3. Ce cimetière, celui actuel, avait été dénommé, à l'origine, cimetière Ste-Marguerite, |00000182| 128 - vant, sous la base du monument que nous y voyons aujourd'hui, lequel fut terminé le 30 décembre 1843 (¹). Ce monument, élevé en exécution de la délibération du conseil municipal du 17 février 1843, présente un ensemble à la fois simple, religieux et pittoresque, Il se trouve au fond, à gauche, du cimetière actuel. Les frais s'élevèrent à 1780 fr. environ. Il se compose d'une pyramide triangulaire surmontée d'une urne funéraire en marbre blanc et appuyée sur un socle à 4 faces, dont la partie inférieure repose sur un terre-plein élevé de 1 mètre au-dessus du sol. Une plaque de marbre blanc, placée sur l'une des faces de la pyramide, porte l'inscription suivante : - 1843. - Ici reposent les ossements recueillis dans les anciens cimetières de Corbeil. Ce monument, consacré par la génération actuelle à la mémoire de ses ancêtres, est recommandé au respect des générations futures. Puissent les mânes de ces nombreux corbeillois être satisfaites du pieux hommage rendu à leur mémoire, et reposer en paix, éternellement, dans l'enclos bénit. Les fouilles terminées, les travaux de terrassement et d'empierrement de la portion de terrain de 8 ares 33 centiares, réservée pour la création d'une nouvelle rue, destinée à faire communiquer la rue St-Spire à la Seine, furent mis en adjudication le 21 septembre 1843; les travaux commencèrent le 15 avril suivant. Le 11 février 1849, le conseil municipal, considérant avec raison « qu'il était convenable de perpétuer, par le nom de la rue, la mémoire des faits historiques qui se rattachent à l'ancienne église et à l'ancien cimetière Saint-Nicolas », décida que la nouvelle voie serait appelée rue SAINT-NICOLAS, et rapporta, en conséquence, la délibération qui lui avait attribué le nom de rue de Seine. Emile CREUZET. 1. Nous signalerons que, dans la nuit du 9 au 10 février 1843, des voleurs s'introduisirent dans l'ancien cimetière et y détournerent plusieurs sacs d'ossements. Des procèsverbaux furent dressés pour constater cette profanation et en instruire la justice; l'enquête ne put faire découvrir les coupables. |00000183| ANGER (Dom). Les dépendances de Saint-Germain-des-Prés, - T. III. — Ligugé (Vienne), imp. Aubin. Paris, lib. Poussielgue, 1909, in-8°, c-368 pp. Archives de la France monastique, vol. 8. - BIBLIOGRAPHIE (1909-1910) (1). BLIN. Aide-mémoire de l'infirmier à la colonie de Vaucluse (Seine-et-Oise) par le Dr Blin, chef de service. - Montdidier, imp. J. Bellin. Paris, lib. Vigot frères, 1908, in-16º, 20 pp. Préfecture de la Seine. - BONNEFON (Paul). - Perrault (Charles) et Perrault (Claude). Mémoires de ma vie, par Claude Perrault. Voyage à Bordeaux (1669) par Claude Perrault; publiés avec une introduction, des notes et un index par Paul Bonnefon. — Ouvrage illustré de 16 planches hors texte. - Evreux, imp. Hérissez et fils. Paris, Laurens, 1909, in-8° de 255 pp. - Les Perrault étaient seigneurs de Viry, non loin de Corbeil. ―――― - 1909. — II. - BOUVIER (l'Abbé H.). Histoire de l'Eglise et de l'ancien ArchiIdiocèse de Sens. T. I, des origines à l'an 1122. Amiens, imp. Yvert et Tellier, 1906, in-8° de xii et 470 pp. Avant l'érection de Paris en Archevêché, Corbeil dépendait de celui de Sens. – – ―――― CLOUZOT (H.). - Saint-Maur, paradis de salubrité, aménité et délices. Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley-Gouverneur. Paris, Champion, 1909, in-8°, 28 pp. Extrait de la Revue des Études Rabelaisiennes, T. VII, 1909. I. Notre Bulletin étant très en retard cette année, nous nous sommes trouvé obligé d'indiquer dans cette bibliographie des ouvrages parus en 1910. Il eût été trop tard d'attendre le 2e bulletin de 1910 pour les signaler. 10 |00000184| 130 - Chartes (2) de Philippe-Auguste, en faveur du Prieuré de Longpont, 1181 et 1184. Une autre charte de la reine Adèle, mère du Roy PhilippeAuguste; donation de la dîme de Marolles à l'Eglise de Longpont, 1204. Extrait du Bulletin de la Societé de l'Histoire de Paris, année 1909, 2me bulletin, pp. 71 à 73. DANTE ALIGHIERI. -Vita nuova, suivant le texte critique préparé pour la Societa Dantesca Italiana, par Michel Barbi, traduite avec une introduction et des notes par Henry Cochin. Paris, Champion, 1908. - DIMIER (Louis). Fontainebleau. De la collection des villes d'art célèbres. Paris, Laurens, 1908. 168 pp. in-4°, 109 gravures. - - ESPARBÈS (G. d'). Le Palais de Fontainebleau, 26 pp. in-fol. non chiffrées, planches en couleurs. No du Figaro illustré de Juillet 1908. GAZIER (A.). Royal. – Fix (E.). L'impromptu du parc de Sceaux, pièce en un acte, en prose et en vers, précédée du Théâtre de Sceaux, prologue d'ouverture. Sceaux, imp. Charaire. Paris, lib. Boulinier, 1909, in-3º jésus, 35 PP. ―――― GROLLEAU (C.). A Monsieur l'Abbé Pierre Destarac, Curé de Saint-Denis de Wissous, fêtes des SS. Pierre et Paul (28 juin 1908), poésie par Charles Grolleau. Tonnerre, imp. C. Puyfagès, 1908, in-8°, 6 pp. ―― · Second centenaire de la destruction du PortPort-Royal au XVIIe siècle. - Images et portraits, avec des notes historiques et iconographiques; introduction par André Hallays. - Paris, Hachette, 1909. Recueil in-4° contenant 347 gravures, en 130 planches, dont 22 hiliogravures, 26 phototypies, 82 simili-gravures. GASSIE (J.-G.). - Le Vieux Barbizon, souvenirs de jeunesse d'un |00000185| - 131 paysagiste, 1852-1875, avec 10 dessins de l'auteur. Préface de G. Lafenestre. Paris, Hachettte, 1907, in-8° de 40 et 261 pp. - GACHONS (Jacques des). Le Miracle d'après-demain. Extrait de la Revue de Paris, No du 15 avril 1910, pages 827 à 847. Œuvre toute d'imagination. L'auteur s'endort dans l'église Saint-Spire de Corbeil, alors abandonnée et privée de tout culte ; il rêve et nous fait assister à une scène miraculeuse qu'il voit en songe et dont les détails se déroulent à travers les rues de Corbeil. Il évoque et met en relief les personnages civils et religieux qui ont illustré cette ville dans les siècles passés. Ces pages pleines d'esprit et de belles pensées, fort bien dites, font honneur à l'auteur. - HARTMANN (P.). Conflans près Paris, par Louis Hartmann. Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley-Gouverneur. Paris 1909, in-8° de 192 pp. avec gravures et plans. ―― - … Extrait des mémoires de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France, T. XXXV, 1908. - HERBET (Félix). Fontainebleau révolutionnaire. Liste des personnes mises en arrestation au ci-devant Chàteau, 1793-1794, in-8° de 47 PP. - Extrait des Annales de la Société hist. et arch. du Gâtinais, année 1907. Fontainebleau, imp. M. Bourges. Inondation (l') à Paris et ses environs. 1 vol. in-8° de 64 pp., illustré de 200 vues photographiques. Artistic éditions. Paris, rue Emile Gilbert, 3. (1 fr. 50). … Liste des objets mobiliers classés de Seine-et-Oise, à la date du 30 juin 1909. Versailles, imp. Cerf, 1909, in-16º de 48 pp. LEFEVRE-PONTALIS (E.). - Les Campagnes de construction de Notre-Dame d'Etampes, par Eugène Lefèvre-Pontalis, directeur de la Société française d'Archéologie. - Caen, imp. Delesque, 1909, in-8° de 30 pp. avec gravures dans le texte et plan gravé hors texte. - LEFÈVRE (L.-E.). — Quatre études archéologiques étampoises: Mémoire sur plusieurs importantes questions auxquelles on a rattaché l'église Saint-Martin d'Etampes (xiie siècle). — L'Eglise et la |00000186| ―――― 132 tour militaire du Petit Saint-Mard (xr° siècle). Le Château-fort Royal et la miniature des très riches heures du duc de Berry (1410-1415). Les caves du moyen âge à Etampes. Montdidier, imp. Bellin; Paris, Lib. A. Picard, 1909, in-8° de 32 pp. avec gravures. LEFÈVRE (L.E.). - Origine antique du plan quadrilobé de la tour d'Etampes, par L. E. Lefèvre, correspondant de la Société des Antiquaires de France. Fontainebleau, imp. Bourges. Paris, libr. Picard, 1909. In-8°, 15 pp. avec 5 figures. Extrait des Annales de la Société hist. et arch. du Gâtinais, année 1909. - LONGNON (Henri). - Petite monographie du Château de Rambouillet. Paris, Laurens, 1909. In-12, 35 pp. et 2 plans. ――― MONMARCHÉ (M.). La banlieue de Paris. Petit in-8°, 12 pp. avec gravures. ―――― Musée (le) Saint-Jean de Corbeil, guide du visiteur. Montdidier, imp. Bellin. Petit in-8°, 52 pp. et gravures. - ― - MARESCHAL DE BIÈVRE (Cte Gabriel). Le Marquis de Bièvre, sa vie, ses calembours, ses comédies, 1747-1789. In-8°, avec une héliogravure et 5 gravures hors texte. Paris, 1909. Libr. Plon-Nourrit. - ――――― Le Monument d'un Limousin philantrope à Draveil, le D. Rouffy. Extrait de l'Abeille de Corbeil No 80, 14 octobre 1909. C'est un juste hommage, rendu par ses concitoyens à l'homme bon et dévoué qu'était le Dr Rouffy, si connu et si aimé à Draveil et aux environs. Alphonse Daudet l'a plusieurs fois mis en scène dans ses romans. PIÉPAPE (DE). - Une petite fille du grand Condé, la Duchesse du Maine, reine de Sceaux et conspiratrice (1676-1753), par le général de Piépape; avec deux portraits en héliogravure. Paris, PlonNourrit, 1910. In-8°, 11-392 pp. ― PAWLOWSKI. Les Ports de Paris. I vol. in-12, avec 27 vues photographiques, 1909. Etude économique et technique sur le port Parisien qui est le plus important de |00000187| - 133 - tous les ports français (presque 12 millions de tonnes en 1909). Libr. BergerLevrault. - PAWLOWSKI. Les crues de Paris du 6 au 20° siècle; causes, mécanisme, histoire, dangers; la lutte contre le fléau, par Aug. Pawlowski et Albert Radoux. In-8° avec 6 gravures et 6 plans, 1910. Librairie Berger-Levrault. _ - Reliques (les) de Saint-Marc l'Evangéliste à Limours, document publié par F. Lorin, Secrétaire de la Société arch. de Rambouillet. Versailles, imp. Aubert, 1908. In-8° de 44 pp. RENART (E.). Répertoire général des collectionneurs et listes d'amateurs étrangers, publiés par E. Renart, libr. expert à Paris, 1909. Chez l'auteur, 2 rue de Lorraine, à Maisons-Alfort (Seine). ―— Révolution. Recherche et publication des documents relatifs à la vie économique de la Révolution. Bulletin de 1909. Comité départemental de Seine-et-Oise. Versailles, imp. Aubert, 1909. In-8°, de 120 pp. – Tout Seine-et-Oise en 1909. Services publics, culte catholique, enseignement, assistance, prévoyance, épargne, mutualités, syndicats, renseignements divers. — Versailles, imprimerie centrale de Seine et-Oise, 1909; in-16 de 402 pp. PÉRIODIQUES Journaux et revues. Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France. Bulletin, T. XXXVI, 1909. 1 vol. in-8°. Mémoires, T. XXXV, 1908. 1 vol. in-8°. Paris, Librairie Champion. Société historique et archéologique du Gâtinais. Annales, T. XXVII, 1909. 1 vol. in-8°. Fontainebleau, impr. Bourges.
| 00000188 |
| 00000189 |
| 00000190 |
| 00000191 |
| 00000192 |
| 00000193 |
| 00000194 |
| 00000195 |
| 00000196 |
| 00000197 |
| 00000198 |
| 00000199 |
| 00000200 |
| 00000201 |
ETAMPE PARIS ALPHONSE PICARD ET FILS, ÉDITEURS LIBRAIRES DES ARCHIVES NATIONALES ET DE LA SOCIÉTÉ DE L'ÉCOLE DES CHARTES Rue Bonaparte, 82 MCMX
| 00000202 |
| 00000203 |
| 00000204 |
| 00000205 |
| 00000206 |
| 00000207 |
| 00000208 |
| 00000209 |
| 00000210 |
| 00000211 |
| 00000212 |
| 00000213 |
| 00000214 |
| 00000215 |
| 00000216 |
| 00000217 |
| 00000218 |
| 00000219 |
| 00000220 |
| 00000221 |
| 00000222 |
| 00000223 |
| 00000224 |
Docteur Paul BOUCHER (1841-1909)
| 00000225 |
| 00000226 |
| 00000227 |
| 00000228 |
| 00000229 |
| 00000230 |
| 00000231 |
| 00000232 |
| 00000233 |
| 00000234 |
| 00000235 |
| 00000236 |
| 00000237 |
| 00000238 |
| 00000239 |
| 00000240 |
| 00000241 |
| 00000242 |
| 00000243 |
| 00000244 |
| 00000245 |
| 00000246 |
| 00000247 |
| 00000248 |
| 00000249 |
| 00000250 |
| 00000251 |
| 00000252 |
| 00000253 |
| 00000254 |
| 00000255 |
| 00000256 |
| 00000257 |
| 00000258 |
| 00000259 |
| 00000260 |
| 00000261 |
| 00000262 |
| 00000263 |
| 00000264 |
| 00000265 |
| 00000266 |
| 00000267 |
| 00000268 |
| 00000269 |
| 00000270 |
| 00000271 |
| 00000272 |
| 00000273 |
| 00000274 |
| 00000275 |
| 00000276 |
| 00000277 |
| 00000278 |
| 00000279 |
| 00000280 |
| 00000281 |
| 00000282 |
| 00000283 |
| 00000284 |
| 00000285 |
| 00000286 |
| 00000287 |
| 00000288 |
| 00000289 |
| 00000290 |
EX LIBRIS JOSEPHI ANDREE GUIOT magar et Corbolic 1800 POESIES Lat et Fr. Ex-libris et Portrait de l'Abbé Guiot.
| 00000291 |
| 00000292 |
| 00000293 |
| 00000294 |
| 00000295 |
| 00000296 |
| 00000297 |
| 00000298 |
| 00000299 |
| 00000300 |
| 00000301 |
| 00000302 |
| 00000303 |
| 00000304 |
| 00000305 |
| 00000306 |
| 00000307 |
| 00000308 |
| 00000309 |
| 00000310 |
| 00000311 |
| 00000312 |
| 00000313 |
| 00000314 |
| 00000315 |
| 00000316 |
| 00000317 |
| 00000318 |
| 00000319 |
| 00000320 |
| 00000321 |
| 00000322 |
| 00000323 |
| 00000324 |
| 00000325 |
| 00000326 |
| 00000327 |
| 00000328 |
| 00000329 |
| 00000330 |
| 00000331 |
| 00000332 |
| 00000333 |
| 00000334 |
| 00000335 |
| 00000336 |
| 00000337 |
| 00000338 |
| 00000339 |
| 00000340 |
| 00000341 |
| 00000342 |
| 00000343 |
| 00000344 |
| 00000345 |
| 00000346 |
| 00000347 |
| 00000348 |
| 00000349 |
| 00000350 |
| 00000351 |
| 00000352 |
| 00000353 |
| 00000354 |
| 00000355 |
| 00000356 |
| 00000357 |
| 00000358 |
| 00000359 |
| 00000360 |
| 00000361 |
| 00000362 |
| 00000363 |
| 00000364 |
| 00000365 |
| 00000366 |
on used en un point quelconque à cette arête, qui elle-même ne se serait pas présentée par le travers de l'objet, mais latéralement. D'autre part, il a fallu le reconnaître, la matière composant la hachette n'est point un produit ferrugineux mais bien une roche, et une 1. Le « Carré de Baston» est une portion du parc du Mesnil-Voisin, superbe propriété appartenant à M. Le Mis d'Argentré et faisant partie de la commune de Bouray. Baston, petite agglomération de quelques feux, a disparu, englobée dans l'enceinte du grand château. C'était jadis au XIe siècle le siège d'un petit fief. Cf. Etampes Pittoresque, l'arrondissement, T. III, p. 951 et suiv. 2. Un exemple de moulage assez curieux nous provient de Chine. C'est une hache moulée dans une substance grise semblable à de l'argile durcie et colorée à la surface en vert pour imiter le jade. On nous l'a donnée comme votive et non comme une contrefaçon (?)
| 00000367 |
| 00000368 |
| 00000369 |
| 00000370 |
| 00000371 |
| 00000372 |
| 00000373 |
| 00000374 |
| 00000375 |
| 00000376 |
| 00000377 |
| 00000378 |
| 00000379 |
| 00000380 |
| 00000381 |
| 00000382 |
| 00000383 |
| 00000384 |
| 00000385 |
| 00000386 |