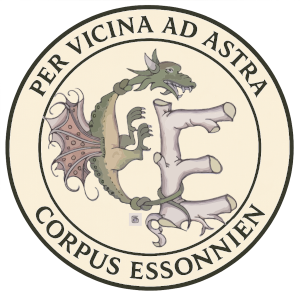jeanne.allegrin
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| jeanne.allegrin [2022/07/25 06:54] – bg | jeanne.allegrin [2022/07/25 07:12] (Version actuelle) – bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Jeanne Allegrin (...1513)====== | ||
| + | * 30e des [[: | ||
| + | * Autres graphies: en latin // | ||
| + | * [[jeanne.derauville|Abbesse précédente]] — [[guillemette.allegrin|Abbesse suivante]]. | ||
| + | |||
| + | =====Notule===== | ||
| + | |||
| + | * Jeanne Allegrin, religieuse de l' | ||
| + | |||
| + | =====Notice de l' | ||
| + | |||
| + | * **Chapitre XV. Jeanne Allegrin (1488-1513) — (...).** | ||
| + | *//Le Pape nomme une abbesse. — Famille et antécédents de Jeanne Allegrin. — Rescision des baux emphytéotiques, | ||
| + | |||
| + | * L’émotion produite à l’abbaye par le départ de Jeanne de Rauville empêcha-t-elle les moniales d’Yerres de s’entendre pour le choix d’une nouvelle abbesse? ou bien ne leur en laissa-t-on pas la liberté? L’histoire ne le dit pas. Le choix de la nouvelle supérieure fut fait, disent les annales monastiques, | ||
| + | * Par son origine et sa constitution primitive, l’abbaye d’Yerres se rattachait de bien près à la grande famille de saint Bernard; mais nos moniales s’étaient réclamées avec une persistance quatre fois séculaire du nom de Bénédictines. Elles portaient néanmoins l’habit blanc, en sorte que Jeanne Allegrin n’eut pas besoin de modifier son costume en montant dans la chaire abbatiale. Cependant ce fut toujours une chose |**166** délicate de placer, à la tête d’une abbaye, une religieuse élevée dans une observance différente de celle qu’elle devra faire pratiquer. Et la nouvelle supérieure d’Yerres ressentit à plusieurs reprises les inconvénients de sa situation; car jamais elle ne fut entièrement sympathique aux anciennes moniales, devenues ses compagnes et ses filles. | ||
| + | * Jeanne Allegrin sortait d’une vieille famille parisienne de bourgeoisie parlementaire. Dès le XIVe siècle, les Allegrin avaient des possessions à Gonesse; au XVe, ils sont grands propriétaires à Combs-la-Ville, | ||
| + | * Jeanne prit possession de l’abbaye en janvier 1488, et le 18 février suivant, elle promit obéissance à Louis de Beaumont, évêque de Paris. Sitôt qu’elle fut en charge, elle attira auprès d’elle plusieurs membres de sa famille: Guillemette, | ||
| + | * Tout le domaine utile de l’abbaye était aliéné. Les Allegrin étaient gens de robe, ils n’eurent guère de peine à démêler la supercherie de tous les contrats signés //in extremis// par Jeanne de Rauville; et les revendications commencèrent immédiatement. Elles avaient plusieurs côtés fâcheux: d’abord il fallait engager des procès coûteux, longs et toujours impopulaires; | ||
| + | * Jeanne Allegrin, en face de ces raisons, pour la tranquillité de sa conscience, et aussi pour diminuer l’odieux des mesures qu’elle jugeait indispensables de prendre, demanda et obtint, du pape Innocent VIII, une bulle l’autorisant à poursuivre la rescision de tous les baux à longs termes, passés par ses devancières. Ensuite, aidée de Guillaume et surtout de Simon Allegrin, agissant comme procureurs du monastère ((**Note d' | ||
| + | * Souvent il lui fallut lutter avec âpreté contre des fermiers récalcitrants, | ||
| + | * Les dîmes de Drancy avaient passé par plusieurs mains depuis quinze ans: Simon Coquillon, Colin Baudin et Jean le Maire les avaient louées successivement. Girard de la Rue, hôtelier au Bourget, en avait obtenu récemment un long bail, mais il y renonça moyennant certaines concessions, | ||
| + | * La ferme de Sénart, dont il a été question plus haut, est l’objet d’un litige assez pénible et très confus. Au moment où Jeanne de Rauville cherchait des gens de bonne volonté pour ses entreprises, | ||
| + | * Jeanne Allegrin redevient ainsi peu à peu maîtresse de toutes les possessions de l’abbaye. La terre de Tremblay est louée par elle à Jean Hesdin le 26 août 1489, et le 4 juin 1494 à Pierre Tilloust le Jeune, pour le prix annuel de 18 setiers de froment. — Celle de Carbouville à Simon d’Allonville, | ||
| + | * Un de ces contrats est particulièrement intéressant par les détails qu’il renferme. La ferme des Godeaux, voisine de l’abbaye, avait été louée comme tout le reste par bail emphytéotique à Louis Gendiet. Celui-ci vit son contrat rescindé et eut pour successeur Pierre Richer, qui réclama des travaux de maçonnerie indispensables, | ||
| + | * L'acte de juillet 1494 contient également une indication fort importante. Il nous apprend que Jeanne Allegrin ne se laissait pas absorber par le côté matériel de sa charge, et qu' | ||
| + | * Jeanne Allegrin poursuivait la tâche du relèvement de sa maison au milieu de difficultés sans cesse renaissantes. Louis de Beaumont, évêque de Paris, son protecteur, mourut en 1492. Elle fut mise en possession de la chèvecerie, | ||
| + | * Jeanne était abbesse depuis douze ans, et depuis douze ans aussi elle était en lutte ou mieux en guerre ouverte avec le seigneur d’Yerres son voisin. Jean Budé ((**Note d' | ||
| + | * Le meunier Macé Chevalier et sa femme sont journellement dans la cour des moniales et jusque sous le cloître; cette promiscuité est intolérable. Chevalier est l’homme de paille de Budé, et celui-ci excite journellement son fermier contre l’abbesse et ses sœurs. Ce dernier refuse de moudre le blé du monastère, ou le retient par devers lui, malgré la clause de son contrat. De plus, lui et sa femme surtout injurient continuellement Jeanne Allegrin, menacent de la frapper, veulent entrer malgré tout, à toute heure de jour et de nuit, dans la cour et dans les bâtiments attenant à la chapelle Saint-Nicolas. — L’abbesse en appelle à toutes les lois civiles et religieuses pour faire cesser un tel état de choses. Dans un mémoire très serré, très bien fait, œuvre de Simon Allegrin sans doute, Jeanne se plaint amèrement: " | ||
| + | * D’ailleurs lorsqu’un peu d’accalmie se faisait sur un point, Budé recommençait la lutte sur un autre. Il se trouvait en face des Allegrin, comme lui un peu robins et hobereaux de province. Alors la guerre de plume au moyen de mémoires, |**171** de rapports, d’expertises devient quotidienne. Parfois elle menace de tourner au tragique. | ||
| + | * Pour se mettre à l’abri, Jeanne Allegrin a eu l’idée de construire un mur de clôture. Budé s’y oppose, en prétendant qu’il a le droit de justice sur le terrain qu’on veut entourer. On ne tient pas compte de son opposition, et déjà les ouvriers élèvent la construction. Budé en l’apprenant fait battre la générale à Yerres; il rassemble du monde comme pour repousser une attaque, et voilà 60 à 80 hommes, armés de bâtons et de piques, qui arrivent à l’abbaye, sous la conduite du châtelain, s’opposent à la continuation des travaux, crient, blasphèment, | ||
| + | * Une autre fois, c’est le droit de justice qui amène les contestations et la lutte. Budé prétend avoir à lui seul la justice dans toute l’étendue de la paroisse. Les moniales y prétendent de leur côté, sur leurs terres et leur enclos. Elles prouvent, par le témoignage de Jean et de Robert de Boncourt ((**Note d' | ||
| + | * Toutes ces luttes étaient suivies d’actes de procédures, | ||
| + | * Il ne faudrait pas croire que Budé est le seul à batailler contre l’abbesse. "Jean de Wibourg, curé de la partie senestre de Brie" est non moins ardent à combattre contre l’abbaye, pour la possession totale des dîmes de sa paroisse ((**Note d' | ||
| + | * Lorsque la querelle est terminée sur un point, le litige recommence sur un autre. On ne saurait dire les difficultés et les tracas suscités à Jeanne Allegrin et à tous les siens, pour la reconstitution de la fortune abbatiale. Partout les bornes de la propriété ont été arrachées au temps de la guerre et depuis, par des voisins avides et des tenanciers peu délicats ou insouciants. Les Allegrin s’efforcent de refaire un plan terrier, opération épineuse en tout temps, mais particulièrement délicate à la fin du XVe siècle, où la plupart des titres ont été détruits, et où on est contraint de s’en rapporter à des témoignages oraux, très souvent confus et contradictoires. Parmi tous les propriétaires limitrophes de nos moniales, seuls les chanoines de Saint-Marcel à Paris semblent avoir accepté le bornage sans contestation, | ||
| + | * Si pénibles que fussent les luttes, soutenues par Jeanne Allegrin contre des séculiers, elles l’étaient moins toutefois que celles entreprises contre des religieuses comme elle. Jeanne avait en horreur tous les actes du gouvernement de sa devancière; | ||
| + | * Dès les premiers mois de sa prélature, elle voulut imposer à Gif une supérieure de son choix et de sa maison. Nous avons dit ailleurs ((**Note d' | ||
| + | * Cet insuccès ne découragea pas Jeanne Allegrin. Ayant appris la mort d’Isabelle de Brindesalle à Saint-Remy de Senlis, elle se fait mettre, par autorité de justice, en possession du temporel; et tente d’y envoyer Isabelle Lempereur, l’une de ses moniales. Celle-ci avait été nommée solennellement dans la salle capitulaire d’Yerres, où on lui fit prêter tous les serments, exigés 20 ans auparavant d’Isabelle de Brindesalle. | ||
| + | * Ainsi engagée, Isabelle Lempereur part pour Senlis en janvier 1502. Elle n’est pas seule; deux ou trois moniales d’Yerres l’accompagnent; | ||
| + | * Isabelle Lempereur fait appel de cette sentence. L’affaire est portée au Parlement et au roi Louis XII: rien n’y fait. Isabelle et les siens sont contraints de déguerpir, de quitter Senlis et de regagner Yerres. Puis les moniales de Senlis ((**Note d' | ||
| + | * Malheureusement Jeanne de Vaulx mourut au bout de dix-huit mois de prélature, et en octobre 1503, l’abbaye de Saint-Remy se trouve sans titulaire, en face des mêmes difficultés que l’année précédente. Afin de prévenir les entreprises d’Yerres, la communauté de Senlis élit en toute hâte Marie Charlette pour abbesse. Les chanoines de Saint-Rieul confirmèrent cette élection, on ne sait de quel droit, le 31 octobre 1503. C’était rentrer d’un seul coup dans la légalité et la tradition, puisqu’on avait trouvé, sous le cloître de Saint-Remy, une moniale capable de le gouverner. Mais à Yerres on proteste, et par l’entremise de Jean Lefebvre, son représentant, | ||
| + | * Jeanne Allegrin part pour Senlis, accompagnée cette fois de quatre de ses sœurs: Marguerite Poilloüe, réfectorière; | ||
| + | * Mais les religieuses d’Yerres avaient-elles un droit quelconque, qui légitimât leur âpreté dans cette circonstance? | ||
| + | * Détournons nos regards de ces querelles et de ces luttes sans utilité et sans gloire, pour considérer Jeanne Allegrin dans une attitude plus conforme à son honneur et à sa vocation. Les difficultés extérieures ne l’avaient point empêchée de poursuivre avec une louable ténacité sa mission, qui consistait à relever sa communauté. Elle y réussit pleinement. Si elle a voulu, avec une âpreté qui pourra sembler excessive, la reconstitution du domaine abbatial, ce n'est pas pour la vulgaire satisfaction d’être grande propriétaire, | ||
| + | * En un mot, l’abbaye est redevenue une maison de prière, où le silence n’est peut-être pas très rigoureux, la discipline très étroite, ni la vie très austère. Mais quel changement cependant, si on compare la situation en 1505 ou 1510, à ce qu’elle était 30 ans auparavant. Alors il n’y avait ni prière, ni office, ni religieuses dignes de ce beau nom; tandis qu’aujourd’hui le cloître est peuplé de quarante moniales au moins, trois prêtres et parfois davantage y célèbrent tous les jours la sainte messe; les lieux réguliers sont reconstitués et les exercices de la vie claustrale en honneur, bref, le couvent vit et fonctionne. | ||
| + | * Aussi le public ne s’y trompe-t-il pas. Il a repris le chemin de l’abbaye, et, signe caractéristique, | ||
| + | * Les dernières années de Jeanne Allegrin furent attristées parla continuation de ses luttes et de ses procès avec des adversaires que nous avons déjà nommés. Elle fut condamnée par le Parlement en 1510, à payer annuellement 2 muids de grain à Simon Marin, curé de Yillabé. Des fermiers agressifs, tel que Jean Logre, établi à Lieusaint, lui suscitèrent de longs et coûteux embarras. Enfin, chose plus grave, l’évêché de Paris, occupé par le pieux Etienne Poncher, voulait la contraindre à introduire chez elle des changements et une réforme, qu’elle repoussait. | ||
| + | * C’est au milieu de ces tristesses et de ces épreuves que |**177** Jeanne Àllegrin termina sa carrière par une sainte mort, le 4 mai 1513, après avoir porté la crosse à Yerres pendant 26 ans. En mourant elle laissait 35 professes à l’abbaye et une dizaine de novices. Elle avait vu plusieurs des siens disparaître tour à tour, et n’avait de consolation que dans la présence de sa sœur Guillemette qui lui succéda ((**Note d' | ||
| + | * On a reproché à Jeanne Allegrin l’introduction de ses parents à l’abbaye et leur trop grande ingérence dans les affaires du monastère; on lui a fait un crime de ses prétentions injustifiées; | ||
| + | * (...). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Documents===== | ||
| + | |||
| + | =====Sources===== | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | =====Notes===== | ||